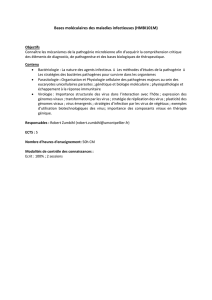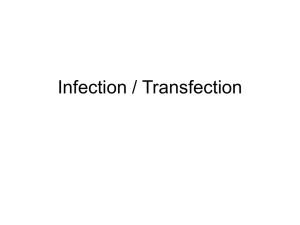Vous êtes chercheur en virologie à l`INRA et vous travaillez sur une

Tale S Thème 1A TP5 : les virus et la diversification génétique des êtres vivants
L
Y
C
É
E
Vous êtes chercheur en virologie à l’INRA et vous travaillez sur une molécule particulière, la syncytine.
Vous découvrez que cette protéine, est codée par un gène hérité d’un virus !
Devant vos confrères chercheurs vous devez présenter vos documents et les arguments pour :
1) Montrer que les virus sont loin d’être tous pathogènes et montrer comment la métagénomique a révélé
l’immense réservoir génétique que représentent les virus. (Élève 1)
2) Montrer que par leur mode de multiplication, les virus, et notamment les rétrovirus, introduisent leur
génome dans le noyau des cellules hôtes. (élève 1)
3) Montrer la vitesse d’évolution des virus et préciser la part des génomes viraux dans le génome humain.
Evoquer les conséquences que peuvent avoir l’insertion du génome viral dans la cellule hôte (élève 2)
4) Montrer que le placenta a été hérité d’une infection virale (élève 3).
5) Conclure sur un mode possible de diversification du vivant à l’aide de cet exemple.
Document 1 : « Les humains sont apparentés aux virus » Le Monde 28 mai 2012
Un entretien avec Clément Gilbert
Clément Gilbert est chercheur au laboratoire Ecologie et Biologie des interactions (CNRS / université de
Poitiers). Avec Cédric Feschotte, professeur à l’université du Texas à Arlington, il a récemment publié un article
dans Nature Reviews Genetics consacré aux virus endogènes, ces virus dont le génome est intégré pour tout ou
partie dans le génome des espèces-hôtes (dont l'espèce humaine) et qui ouvrent une fascinante fenêtre sur
l'évolution du monde viral.
Des films comme Contagion ou des alertes médiatiques comme celle entourant la grippe aviaire ou la grippe
A (H1N1) donnent au public la même image du virus pathogène et dangereux. Pourtant l'image que s'en est
faite la science n'est-elle pas bien différente de ce cliché ?
En effet notre compréhension du monde des virus et de leurs interactions avec le reste du vivant a beaucoup
évolué ces dernières années. Tout d’abord il faut bien réaliser que la mauvaise réputation des virus s’est
construite autour des effets – certes parfois dévastateurs – causés chez l’homme par une infime proportion de
la totalité des virus présents sur notre planète. Moins d’une dizaine sont responsables des maladies virales les
plus fréquentes dans nos régions, comme le rhume, la grippe, la varicelle, la rougeole. S’il est bien normal que
ce petit nombre de virus nous préoccupe particulièrement, il faut savoir que l’écrasante majorité des virus non
seulement ne peut pas infecter l’homme mais joue un rôle crucial dans son « écosystème » interne. Le corps
d'un homme adulte sain abrite plus de trois mille milliards de virus, pour la plupart des bactériophages
infectant les bactéries présentes dans le tractus intestinal et sur les muqueuses. L’impact de ces virus n’est pas
encore complètement compris, mais on peut déjà parier qu’ils jouent un rôle important dans la régulation de la
composition des communautés bactériennes vivant en symbiose avec l’homme.
Les virus sont non seulement très nombreux mais on sait désormais qu'ils présentent une très grande
diversité génétique...
Nos connaissances sur la diversité génétique et l’écologie des virus sont restées très limitées jusqu’au milieu
des années 2000, où de nouvelles technologies de séquençage d’ADN ont été mises sur le marché. Aujourd’hui,
les machines produisent jusqu’à 120 milliards de paires de bases (l’équivalent de 40 génomes humains) en 24
heures à un coût dix mille fois plus bas que la méthode utilisée dans les années 1990 pour séquencer le premier
génome humain. Les génomes viraux étant entre trois mille et trois millions de fois plus petits que le nôtre, je
vous laisse calculer la quantité de nouveaux génomes viraux que l’on peut théoriquement séquencer par an.

Tale S Thème 1A TP5 : les virus et la diversification génétique des êtres vivants
L
Y
C
É
E
Ces méthodes sont à présent régulièrement utilisées afin de séquencer ce qu’on appelle des métagénomes,
c’est-à-dire les génomes de tous les microorganismes présents à un moment donné dans un environnement
donné, tel qu’un litre d’eau de mer, un kilogramme de sol ou même quelques grammes de fèces humaines.
Un des résultats majeur de la métagénomique a été de révéler l’incroyable diversité génétique des virus. Une
étude a par exemple montré qu’un kilogramme de sédiments marins prélevé sur le littoral californien pouvait
contenir jusqu’à 1 million de génotypes viraux. De plus, entre 75 et 90 % des séquences produites dans toutes
les études de métagénomique virale publiées depuis 2002 n’ont pas d’homologues dans les banques de
données de génomes déjà séquencés. Autrement dit, ces séquences correspondent à des gènes qui ne
ressemblent à aucun gène connu jusqu’alors. Les virus forment donc un réservoir presque infini de gènes et
certains pensent que ce réservoir a constitué et constitue toujours une source majeure de nouveauté
génétique sans laquelle les formes de vie telles qu’on les connaît aujourd’hui (y compris notre propre espèce)
n’auraient jamais existé.
L'article que vous avez récemment publié traite des virus endogènes. Que sont-ils ?
On parle de virus endogènes pour décrire des génomes ou fragments de génomes viraux intégrés dans le
génome de leurs espèces hôtes et transmis de manière héréditaire de génération en génération. On sait
désormais que, depuis l’origine des vertébrés il y a environ 500 millions d’années, de nombreuses insertions de
rétrovirus se sont produites dans le génome des gamètes (spermatozoïdes et ovules) de leurs espèces hôtes.
Certaines de ces insertions impliquant des génomes viraux incapables de continuer de se répliquer ou
suffisamment atténués pour ne pas affecter la fertilité de leur hôte, elles ont pu être transmises de manière
héréditaire à tous les descendants des espèces chez lesquelles elles se sont originellement produites. Le
résultat de ce long processus d’accumulation de séquences d’origine rétrovirale dans le génome des vertébrés
est assez surprenant, voire troublant, puisqu’il apparaît que plus de 8 % du génome humain dérivent de
rétrovirus. Autrement dit, étant donné que sur les 3,5 milliards de paires de base constituant notre génome,
environ 300 millions sont d’origine virale, on peut dire que nous sommes d’une certaine manière apparentés
aux virus !
Les rétrovirus sont restés pendant près de quarante ans les seuls virus connus ayant la capacité de devenir
endogènes. Et ce n’est en fait qu’au cours des trois dernières années que l’on a réalisé qu’à peu près n’importe
quel type de virus pouvait devenir endogène chez à peu près n’importe quel organisme eucaryote, même si ces
virus endogènes sont bien moins nombreux que les rétrovirus endogènes. Cependant, leur analyse a déjà
révélé des trésors d’information concernant la co-évolution à long-terme entre les virus et leurs hôtes.
Tout comme il y a une paléoanthropologie, il existe désormais une paléovirologie. A quoi cette fenêtre sur
l'histoire passée des virus peut-elle nous être utile ?
A l’instar des paléoanthropologues qui étudient les fossiles de primates et l’environnement dans lequel ceux-ci
vivaient, les paléovirologues étudient les fossiles moléculaires de virus afin de retracer les vagues d’infections
virales passées et de comprendre comment les organismes ont su combattre ces attaques répétées. Ces
connaissances contribuent non seulement à combler un vide dans notre compréhension de l’évolution des
virus à moyen-long terme, mais de plus elles fournissent un cadre conceptuel important pour le
développement de nouvelles stratégies médicales de lutte contre
certains virus. Concernant les avancées en matière de compréhension de
l’évolution des virus, il a par exemple été montré que des virus
endogènes appartenant à la famille des Hepadnaviridae (qui inclut le
virus de l’hépatite B, en photo ci-contre) s’étaient intégrés dans le
génome de l’ancêtre d’un groupe de passereaux il y a plus de 19 millions
d’années. Cette découverte a complètement changé notre façon
d’appréhender l’évolution de cette famille virale puisque jusqu’en 2010,
on pensait que les virus d’hépatite B avaient... moins de 30 000 ans. On
ne sait pas si le virus de l’hépatite B circule toujours aujourd’hui chez les
passereaux, mais cette étude montre qu’il serait judicieux de conduire
des tests de dépistage chez plusieurs espèces de ces oiseaux. En effet, cela pourrait permettre d’identifier un
nouveau modèle animal facile à élever et à manipuler pour l’étude du virus.
Par ailleurs, plusieurs travaux publiés par Sara Sawyer (université d’Austin au Texas) et Harmit Malik (Fred
Hutchinson Cancer Research à Seattle) se sont attachés à disséquer les forces évolutives gouvernant les gènes
de résistance aux virus, notamment chez les primates. Leur résultats montrent que la séquence de ces gènes a
changé bien plus vite que celle tous les autres gènes encodés par le génome humain et que cette évolution
rapide témoigne de la course aux armements dans laquelle les primates sont engagés contre les virus depuis
des millions d’années. Autrement dit, ces gènes se sont adaptés sans relâche afin de contrer les stratégies sans
cesse renouvelées par certains virus pour entrer dans nos cellules et accomplir leur cycle de réplication,
souvent à notre détriment. D’un point de vue plus appliqué, ces études ont aussi caractérisé avec précision les
interfaces de contact, autrement dit le champ de bataille moléculaire, entre certains virus et certains domaines

Tale S Thème 1A TP5 : les virus et la diversification génétique des êtres vivants
L
Y
C
É
E
de protéines antivirales humaines. Ces découvertes ont offert des pistes intéressantes pour développer de
nouveaux médicaments antiviraux, dont certaines font aujourd’hui l’objet de recherches poussées.
Ne pourrait-on pas considérer les virus pathogènes comme des virus qui ont raté leur carrière ?
Peut-être conviendrait-il mieux de dire que de tels virus sont en période d’apprentissage... Mais c’est une
image intéressante car elle illustre que le propre d’un virus n’est pas d’être pathogène, ou en conflit permanent
avec ses hôtes. C’est en tout cas l’idée que semblent soutenir certains résultats de l’analyse de séquence des
virus endogènes. Dans le cas des Hepadnaviridae par exemple, le calcul de l’âge de ces virus reposait jusqu’à
2010 sur un taux de mutation estimé à partir de comparaisons de séquences d’hépatite B pathogène extraites
d’hommes infectés. Comme je l’ai dit plus haut, l’âge obtenu par cette méthode est bien inférieur (30 000 ans)
à l’âge obtenu par les datations d’hépatites B endogènes trouvés chez les passereaux (19 millions d’années).
Aussi, le taux de mutation des hepadnaviridae calculé sur 19 millions d’années est mille fois plus lent que celui
des virus circulant actuellement dans les populations humaines. Bien que plusieurs éventuels problèmes
d’ordre méthodologique aient été proposés pour expliquer cette différence, ceux-ci ne semblent pas suffisants
pour expliquer un tel écart de trois ordres de grandeur.
Avec Cédric Feschotte, nous avons proposé en 2010 que cette différence pouvait refléter une réalité
biologique. L’hypothèse serait que les virus d’hépatite B actuels trouvés chez l’homme sont pathogènes car ils
circuleraient chez lui depuis relativement peu de temps. Ils seraient donc « mal adaptés », incapables de se
maintenir sans causer trop de dégâts. Le système immunitaire de l’homme, également mal adapté au virus, est
incapable de le tolérer, ce qui génère un conflit évolutif, une course aux armements. La réponse immunitaire
de l’homme pousse le virus à se répliquer, muter et évoluer très rapidement, d’où le taux de substitution très
rapide obtenu à partir des séquences pathogènes actuelles. Nous proposons que ce type de situation en
déséquilibre ne reflète pas l’évolution à long terme des Hepadnaviridae et que, la plupart du temps depuis 19
millions d’années, ces virus ont évolué en paix avec leur hôte, sans induire de pathologie et en étant bien
tolérés par leur système immunitaire. Plus généralement, ce cas d’étude nous a amenés à penser que nos
connaissances sur la dynamique évolutive des virus sont probablement biaisées car jusqu’à présent nous avons
surtout étudié des virus pathogènes.
Porter dans notre ADN des génomes de virus nous a-t-il été profitable ou pas ?
L’intégration de génomes viraux dans les chromosomes de leur hôte n’est bien sûr pas sans risque pour l’hôte.
Cela peut mener à l’inactivation complète d’un gène, à la réduction, ou à l’augmentation de son activité. Ces
trois types d’effets risquent d'engendrer des dysfonctionnements importants du tissu affecté pouvant aboutir
au développement de cancers. Chez le chat domestique par exemple, plusieurs études ont montré que
l’insertion du virus de la leucose féline de type B à l’intérieur ou aux environs de six gènes pouvait conduire au
développement de lymphomes, de leucémie ou d’anémie. Les rétrovirus insérés dans notre génome depuis des
millions d’années et complètement inactifs sont aussi capables de causer des problèmes de manière plus
indirecte, en provoquant des réarrangements chromosomiques à l’origine de diverses pathologies. Par
exemple, la recombinaison entre deux copies d’un rétrovirus endogène humain appelé HERV15 situées sur le
chromosome Y peut provoquer la disparition d’une longue région génomique de 800 000 paires de bases. Cette
délétion entraîne la perte d’un gène appelé « azoospermia factor 1 » et les hommes porteurs de ce
réarrangement sont stériles.
On peut tout de même penser que les problèmes, somme toute assez rares, causés par les virus endogènes
sont un maigre tribut à payer comparé aux énormes bénéfices évolutifs que ces séquences ont apportés à leurs
hôtes durant des millions d’années. La grande quantité d’ADN ajoutée au génome humain par l’intégration des
rétrovirus endogènes a fourni un terreau très fertile de matériel brut, recyclé de nombreuses fois en séquences
remplissant désormais des fonctions cellulaires capitales. Prenons par exemple le cas de deux gènes humains
appelés syncytine 1 et 2, qui sont impliqués dans la formation du placenta. Ils dérivent d’un gène rétroviral
codant une protéine permettant normalement aux virus de fusionner avec la membrane des cellules de l’hôte
et de pénétrer à l’intérieur du compartiment cellulaire. Les syncytines ont retenu leur capacité fusogénique
d’origine mais elles sont désormais impliquées dans la fusion de cellules du placenta pour former une couche
qui permet les échanges de nutriments entre la mère et le fœtus. L’équipe de Thierry Heidmann (Institut
Gustave Roussy à Villejuif) a montré que ces deux gènes humains dérivaient de deux rétrovirus endogènes
différents intégrés dans le génome des primates il y a environ 40 millions d’années. Il est assez intrigant et
fascinant de réaliser que le nid dans lequel nous avons tous baigné pendant les neuf premiers mois de notre vie
n’aurait certainement pas été aussi douillet si les virus n’existaient pas… Cet exemple et bien d'autres montrent
qu'il serait très réducteur de ne considérer les virus que comme des parasites dangereux et inutiles.
Propos recueillis par Pierre Barthélémy (@PasseurSciences sur Twitter)
Lire aussi : http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2011/10/14/evolution-la-grossesse-humaine-nous-vient-elle-
dun-virus/

Tale S Thème 1A TP5 : les virus et la diversification génétique des êtres vivants
L
Y
C
É
E
Document 2 : Bordas p.43 et p.57
Document 3 : Etude à différentes échelles (macroscopique, cellulaire et moléculaire) de la mise en place du
placenta humain
Utiliser le logiciel approprié pour réaliser la comparaison de séquences !
D’après TS SVT Belin, ed. 2012, p.42
Document 4 : autre exemple de transfert horizontal
http://www.inra.fr/presse/des_vers_s_attaquent_aux_plantes_grace_a_des_genes_derobes_a_des_bacteries
http://forums.futura-sciences.com/biologie/14223-humains-naturellement-transgeniques.html
Par exemple :
Gène de la syncytine appartenant au virus MPMV, présent seulement chez les primates ; il permet la
fusion des cellules du placenta.
Gène de la cellulose appartenant aux végétaux, présent chez un animal (l’ascidie) devenu capable de
produire de la cellulose
Gène de la cellulase appartenant aux bactéries, présent chez des nématodes devenues capables de
digérer la cellulose
Gène de caroténoïde appartenant à certains végétaux, présent chez des pucerons devenus oranges
Gène de la porphyranase appartenant à la bactérie Zabellia, présent dans les bactéries de l’intestin de
japonais mangeurs de sushi.
1
/
4
100%