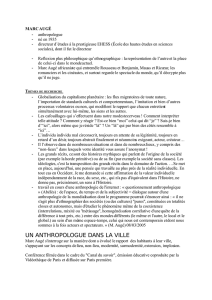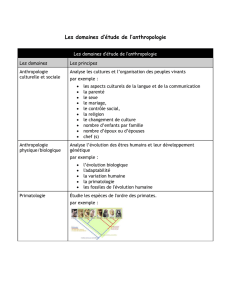anth des md contemporains- Marc Aug- - prepa-bl

1
Marc Augé, Pour une anthropologie des mondes contemporains, Champ Flammarion.
I. L’espace historique de l’anthropologie et le temps anthropologique de l’histoire
L’anthropologie requiert une triple exigence : le choix d’un terrain, l’application d’une méthode et la construction
d’un objet. Mais la diffusion du mot « anthropologie » a tendance à le réduire à ses objets empiriques (micro-
terrains) ou à sa méthode ou encore à ses objets théoriques.
Certaines disciplines s’approprient des éléments de l’anthropologie, comme l’histoire. Histoire et anthropologie
ont toutes deux un double et complémentaire objet : les disciplines elles-mêmes et les terrains auxquels elles
s’appliquent. On a considéré que l’objet de l’étude anthropologique était les peuples que l’on disait presque dénués
de conscience historique, dont le degré d’historicité était quasi nul : sociétés sans histoire, alors que l’histoire aurait
pour objet les sociétés avec histoire.
Marc Augé souligne l’ambiguïté de ces positions et des termes même utilisés : le changement n’est pas
nécessairement l’histoire, l’histoire comme discipline ne naît pas forcément à des époques/dans des sociétés
caractérisées par une conscience historique. (cf Paul Veyne Comment on écrit l’histoire).
L’auteur, pour dépasser ces oppositions, éclaircit certains points. L’anthropologie, dont la naissance est liée à la
période coloniale, est l’étude du présent des sociétés éloignées. En revanche, l’histoire est l’étude du passé de
sociétés proches. Mais la matière de l’anthropologie est l’espace historique et celle de l’histoire est le temps localisé,
donc anthropologique :
▪ l’espace de l’anthropologie est historique car investi par des groupes humains, espace symbolisé.
Cette symbolisation de l’espace est à la fois une matrice intellectuelle, une constitution sociale, un héritage et la
condition première de toute histoire. Cf Lévis-Strauss : nécessité du symbolique se traduisant par une mise en ordre
du monde dont l’ordre social est un aspect.
Cette symbolisation n’est pas un obstacle au développement de l’histoire mais lui donne un sens.
L’ « ethno-histoire » est l’étude de la conception que les peuples se font de leur propre histoire. Elle a deux
objectifs : s’interroger sur l’histoire réelle des sociétés étudiées et sur la crédibilité des témoignages qu’elles
fournissent (étude de la transmission orale croisée avec des sources écrites, des moyens de mémorisation) et
s’interroger sur le sens de la place d’une mémoire historique.
▪ La conception d’une histoire purement évènementielle (diplomatique et militaire) avec pour matière la succession
des dates et des évènements n’est plus à l’ordre du jour. En affirmant que l’histoire se situe dans un espace concret
où toutes les formes de rapport interviennent, les historiens s’imposent une exigence sociologique.
La naissance des Annales (Bloch, Febvre puis Labrousse, Braudel) constitue une révolution de l’histoire et les
historiens des Annales ont été influencés par la sociologie durkheimienne (Jacques Revel) : s’éloigner de l’individu,
de l’évènement, du cas particulier pour privilégier le répétitif, les régularités à partir desquelles peuvent s’induire
des lois. Les historiens ont voulu diversifier la méthode historique sur le modèle anthropologique face à la
complexité des enchevêtrements du social. Mais il subsiste des différences entre anthropologie et histoire : la nature
des témoignages (archives dans le cas de l’historien) et le problème de la représentativité : l’historien ne peut pas,
comme l’anthropologue vérifier sur le terrain la validité et la portée de ses hypothèses.
Le travail des historiens s’est considérablement rapproché de celui des ethnologues et ce dernier n’a jamais nié sa
dimension historique. Le rapprochement est aujourd’hui encore plus remarquable car les objets empiriques de
l’anthropologie s’inscrivent désormais dans le même espace que celui des historiens de l’Europe moderne : étude
d’entreprises, d’hôpitaux, de quartiers urbains.. Selon M. Augé ce déplacement de l’étude anthropologique est
naturel et appelé par les problèmes spécifiques de notre époque. Il y a toujours des sociétés lointaines (du point de
vue européen) mais l’exotisme est définitivement mort avec le « rétrécissement de la planète », la circulation des
images qui contribuent à effacer la dimension mythique des autres, le sentiment d’étrangeté.
Il y a également une évolution de l’histoire. L’histoire locale et régionale est désormais prise dans la mouvance
planétaire. De plus, la modernité, par l’instantanéité de l’information et la diffusion des images engendrent une
« accélération de l’histoire », la création d’un passé immédiat alors qu’elle prétend stabiliser l’histoire et unifier le
monde. La frontière entre histoire et actualité devient de plus en plus floue.
Cet état du monde met en doute la possibilité d’interpréter systématiquement les observations. Mais on continue
à le faire : pour les historiens qui s’intéressent plus au facteur temporel, l’accélération de l’histoire met en valeur
l’unification (« fin de l’histoire », « consensus »). Les anthropologues, plus attentifs au paramètre spatial estiment
que le rétrécissement de la planète engendre, en les rapprochant, des diversités (« postmodernité »). L’auteur

2
nuance la divergence de ces deux perspectives qui, d’après lui, dépendent des innovations technologiques dans le
domaine de la circulation, l’information.
Le problème est de savoir si, en systématisant l’interprétation de la réalité contemporaine, les théories du
consensus et de la postmodernité réussissent vraiment à rendre compte de ses aspects inédits. Comment penser
ensemble l’unité de la planète et la diversité des mondes qui la constituent ?
II. Consensus et postmodernité : l’épreuve de la contemporanéité
Le terme « consensus » est un terme du langage politique français et est apparu au moment où on a eu le
sentiment que sur un certain nombre de questions importantes il n’y avait pas de divergences entre les positions de
droite et de gauche. Mais ambiguïté et risques de ce terme engendrent pour certains l’apparition d’une nouvelle
langue de bois ou le risque de consécration de l’ordre établi (Emmanuel Terray dans la revue Le Genre humain).
Pour de nombreux historiens il est révélateur de la fin de l’histoire, ou, au moins, la fin de l’exceptionnalité française,
expression elle aussi politique.
Selon François Furet, Jacques Julliard et Pierre Rosanvallon, l’exceptionnalité française aurait disparu lorsque le lien
entre économie de marché et démocratie représentative a fait l’objet d’un consensus.
Marcel Gauchet, ayant contribué aux Lieux de mémoire de Pierre Nora, va plus loin. Selon lui, les notions de droite
et de gauche sont des « notions-mémoires » : en 1815 la droite est associée à l’Ancien Régime et la gauche à la
Révolution, en 1900 à la Foi et aux Lumières, en 1935 au fascisme et au socialisme. L’opposition droite/gauche
correspondait à l’affrontement entre des enjeux fondamentaux qui se voulait universaliste. Aujourd’hui, après que la
France ait connu le processus de stabilisation générale des démocraties, elle représente plus la nécessaire
coexistence des contraires. Marcel Gauchet nuance toutefois ses propos : il croit à une résurgence du clivage
gauche/droite mais on serait passée d’une opposition de conception à une opposition de gestion : le clivage
recouvre désormais l’opposition entre pouvoir privé et puissance publique.
M. Augé critique cette analyse des transformations du monde moderne qui se focalise sur l’évolution des idées
politiques en négligeant l’épaisseur et la diversité du social. De plus, il considère que l’idée d’un nouveau
« consensus » n’est pas inédite et qu’il a existé pendant la IIIème et la IVème République qui reposaient toutes deux
sur la coexistence et l’alternance des contraires. Il faut toutefois reconnaître à cette analyse l’existence, dans la
pensée française, depuis la Révolution, de prétentions universelles ancrées dans une réalité locale particulière.
Dans La condition postmoderne, Lyotard définit la modernité comme le moment de la ruine des récits fondateurs,
de la distinction radicale entre raison et mythes. Mais en substituant des idéaux universalistes aux récits
particularistes, la raison a elle-même recours à ses propres mythes : les grands récits eschatologiques qui annoncent
l’émancipation de l’homme. La postmodernité délégitime ensuite ces récits. La science et les techniques se
développent sans justification morale. Dans Le Différend, Lyotard analyse l’ambiguïté de la Révolution française qui
tient au fait qu’une communauté particulière -le peuple français- parle au nom du genre humain. Il se constitue alors
un différend (dans le sens où une même proposition est jugée contradictoirement de deux points de vue
inconciliables) : vue de France, la politique révolutionnaire est celle de la liberté mais vue des gouvernements
étrangers elle est la politique de puissance d’un peuple conquérant.
L’apparition du « consensus », la « fin de l’exceptionnalité française », la relégation de l’opposition droite/gauche
au statut de « notion-mémoire » marque la fin d’un « différend » : les démocraties du monde parlent aujourd’hui
d’une même voix. Mais lorsqu’il analyse la condition postmoderne, Lyotard n’évoque ni une immaîtrisable diversité
ni une idée de fin ou de retour, elle se caractérise en fait par une nouvelle modalité du social qui laisse du jeu à
l’initiative individuelle. Mais elle n’est pas la société et ne peut être ainsi le seul objet d’une analyse anthropologique
ou historique. M. Augé évoque le risque, lorsqu’on se focalise sur un aspect du réel, de glisser du point de vue
descriptif (propre aux sciences sociales) à un point de vue normatif (celui de la philosophie). Le danger concerne par
exemple la notion d’exceptionnalité française dont F. Furet, J. Julliard et P. Rosanvallon affirment qu’elle aurait
disparu lorsque le lien entre économie de marché et démocratie représentative a fait l’objet d’un consensus, pour
autant on ne peut généraliser cette disparition à tous les pays.
Pour approfondir la notion de consensus, M. Augé livre l’analyse de Vincent Descombes recourant au concept
wébérien de « désenchantement du monde ». Celui-ci affecte les rapports des hommes entre eux avant d’affecter
celui des hommes à la nature. L’enchantement premier est lié à un système d’interprétation, celui du malheur lié à
une définition du soi comme indissociable de son environnement matériel et social. V. Descombes s’appuie sur

3
l’ouvrage de Jeanne Favret-Saada consacré à la sorcellerie dans le Bocage. Cet exemple montre que dans une société
dominée par l’idéologie des Lumières, cette dernière n’opère pas partout.
M. Augé propose de prolonger l’analyse de Descombes sur les rapports entre les hommes et la nature pour
conclure que le monde « enchanté » est un monde de soupçon, de malheur et d’inquiétude qui s’emploie à
interpréter un monde où le calcul, l’observation et le raisonnement ont leur place mais à l’intérieur d’un univers où il
est plus important de se reconnaître que de connaître. Dans le monde enchanté ou « univers de reconnaissance »,
l’erreur est toujours provisoire et il n’y a pas d’inconnu : les rituels ont pour finalité de permettre à chacun de « s’y
reconnaître ».
Descombes conclut que la rationalité du mythe, celle de la philosophie et celle de la science se définissent pas des
degrés différents d’ « épaisseur ». Se référant à Louis Dumont, il considère que le mythe dit plusieurs choses à la fois,
pouvant se prêter à des interprétations contradictoires ce sur quoi le rite s’appuie. La rationalité de la philosophie
est moins épaisse mais se préoccupe de la totalité alors que celle de la science ne vise qu’une « tranche de la
totalité » (Louis Dumont).
Les notions de « consensus » et de « désenchantement » présentent ainsi une vision amaigrie du réel. Le
« consensus » est une sorte de désenchantement au deuxième degré car il élimine les mythes dont se nourrissait la
rationalité désenchantée, dont le mythe de la « fin de l’histoire ».
Concernant l’anthropologie, Augé regrette la trop grande division de la discipline en France. Il propose d’examiner
les conditions historiques et intellectuelles à partir desquelles l’anthropologie doit définir ses objets et sa démarche.
Le postmodernisme dans l’anthropologie américaine se serait d’abord imposé, selon G. Marcus et M. Fischer, par
rapport à des changements survenus : le Watergate, la guerre du Viêtnam, le choc pétrolier ont contribué à
l’affaiblissement de la puissance et de l’influence mondiale américaine et mettent en doute la capacité des systèmes
d’interprétation. Mais on impute également ce changement de paradigme à des modifications de l’objet de
l’anthropologie, un « ethnographic other » vaguement défini au départ. L’anthropologie postmoderne décrite par
Clifford parait contradictoire puisqu’elle se donne comme objet le texte ethnographique (et non la culture comme
texte) mais semble poser la traduction comme le seul problème posé par les diversités du monde actuel. Les
postmodernistes, selon Augé, ne font pas véritablement rupture. Alors que la raison « consensuelle » privilégie
l’évolution politico-économique ordonnant les bouleversements historiques, la raison postmoderniste remet en
question une telle mise en ordre et met l’accent sur une pluralité ethnico-culturelle. La première ne laisserait à
l’anthropologie que la tâche d’inventorier le patrimoine, la seconde celle d’harmoniser la pluralité mondiale. M.
Augé défend l’hypothèse que le paradoxe constitué par la coexistence de ces deux raisons est rendu possible par
l’avènement d’une situation inédite et que l’avènement de cette contemporanéité définit les conditions d’une
recherche anthropologique renouvelée en lui fournissant un objet.
III. Vers la contemporanéité
Se penchant sur la réflexion des anthropologues sur leur discipline, M. Augé distingue cinq modèles de révisionnisme
anthropologique.
• Le modèle « de la lettre volée » (en référence à Edgar Poe) où on s’étonne de la non prise en compte d’un sujet par
les prédécesseurs. Il a permis de faire évoluer « la frontière (…) entre la nature et la culture » (M. de Certeau).
L’anthropologie de la cognition, de l’économie et de la symbolisation ont représenté une prise ou une reprise en
considération de la nature.
• Le modèle des « évidences » où l’on oppose à une formulation théorique générale l’évidence empirique d’un cas
particulier. Cette critique pose le problème du rapport entre le cas particulier et la règle générale.
• Le modèle « hors-jeu ». L’anthropologue est hors-jeu lorsque, du fait des objets qu’il traite ou la manière qu’il a de
les traiter, il est considéré par les autres anthropologues comme étant au-delà de la légitimité anthropologique. Les
chercheurs qui, durant l’époque coloniale, ont tenté d’intégrer la situation dans laquelle ils travaillaient à la
définition de leur objet (George Balandier, « situation coloniale ») ont été dans ce cas. Ce modèle pose le problème
de la définition de la discipline et de son objet.
• Le modèle « de la culpabilité transférée » lié à la conscience prise par les anthropologues du contexte de
domination dans lequel s’exerce leur profession. Pour Johannes Fabian les différentes écoles anthropologiques
ignorent la « contemporanéité » (coevalness) de leur objet car elles en font un objet. Les anthropologues qui
s’intéressent aux représentations des autres, n’en font pas des interlocuteurs, ils ne s’intéressent pas à ce qu’ils
pensent et font mais à la façon dont ils pensent et agissent. Il en résulte une situation d’ « allochronisme ». Augé
relève des éléments importants de l’analyse de Fabian, notamment l’inégalité que celui-ci constate entre

4
l’enquêteur et l’informateur. Cette analyse appelle à des entretiens plus ouverts entre l’anthropologue et ses
interlocuteurs. Mais Augé critique deux points de l’analyse de Fabian : le non intérêt pour les conceptions du temps
propres au groupe étudié et la notion d’altérité présentée sous une opposition simpliste.
• Le modèle « du dialogue de sourds » où l’on reproche à un auteur d’avoir parlé de ce dont il a parlé et non d’autre
chose.
IV. Les deux rites et leurs mythes : la politique comme rituel
Toute anthropologie est tripolaire : elle a vocation à penser ensemble pluralité, altérité et identité, et son objet est
le symbolique : la constitution de l’altérité chez les autres. Elle traite la question du sens social, càd le sens
directement prescrit ou indirectement signifié des relations entre les uns et les autres. L’anthropologie des mondes
contemporains passe donc par l’analyse des rites qui sont essentiellement politiques. Le rite conjugue le langage
socio-politique de l’identité (rapport entre un individu et les diverses collectivités dont il fait partie) et le langage
psycho-philosophique de l’altérité (rapports entre le même et l’autre) : le rite donne à l’individu son identité sociale
et mesure sa part d’altérité. Il fournit également le « traitement » d’évènements pouvant surgir (la maladie, la
mort..). Le rite se révèle efficace lorsque les deux langages sont maitrisés. Alors que certains voient dans la crise de
la modernité une crise d’identité, M. Augé pense que c’est le langage de l’identité qui l’emporte sur celui de
l’altérité, ce dernier étant plus affecté par les phénomènes caractéristiques d’une situation de « surmodernité » :
excès évènementiel, d’images..
Il définit le rite comme la mise en œuvre d’un dispositif à finalité symbolique qui construit les identités relatives (à..
l’ethnie, la nation, la religion) à travers des altérités médiatrices.
Augé parle de contexte d’arrivée, celui qui conditionne le rite, et de contexte de départ, celui est conditionné par le
rite. Lorsque la distance entre les deux est assez longue pour que le lien de cause à effet soit difficilement
perceptible, Augé parle de « dispositif rituel élargi ». La « mise en spectacle » du monde y est liée. Elle est le fait de la
prolifération d’images qui s’impose de plus en plus au citoyen-spectateur. Ce dernier a un rapport imagé et abstrait
au monde : nous pensons parler de réalité mais nous discutons de textes et d’images. Ce rapport à la réalité est
médiatisé donc partiel. Le rapport à l’autre devient abstrait, détemporalisé. Ce monde d’images nous donne l’illusion
de tout connaître.
Une certaine ritualité politique se met en place, les responsables politiques sont « connus » car reconnus et le
public établit avec eux un rapport familier (mis en évidence par la caricature exercée par les marionnettes). Sachant
l’amplification effectuée par les médias, les politiques finissent par jouer toujours le même personnage pour ne pas
risquer de dégrader leur image qu’ils veulent toujours la même, rassurante. Le dispositif s’élargit alors doublement :
matériellement (réseau de communication international nécessaire à la diffusion) mais aussi au niveau des effets
escomptés du rituel (il s’agit de changer l’état des forces sociales, de faire bouger l’état de l’opinion). Par sa forme
(toujours étudiée et mise en scène) ou sa finalité (qui a toujours à voir avec la constitution d’une identité relative) le
dispositif politique de la prise de parole est un rituel.
M. Augé s’intéresse ensuite aux travaux de Michèle de La Pradelle sur le marché forain et le marché aux truffes de
Carpentras qu’elle traite analogiquement comme un rite. Augé y implique ses concepts : il y voit des « univers de
reconnaissance » et un « dispositif rituel restreint ». M. de la Pradelle quant à elle, voit dans la truffe un symbole
d’identité constitué par les habitants pour « personnaliser » leur ville : une « mise en spectacle » selon Augé. Elle
distingue rite religieux et comportements analogiques inspirés par ce modèle dont ce marché relève.
A partir de cette analyse Augé suggère que le dispositif rituel restreint et le dispositif rituel élargi (politique, pour
l’essentiel) se distinguent par leurs positions respectives vis-à-vis du mythe. En effet, alors que le premier peut être
englobé dans les manifestations du mythe et c’est le trop-plein de mythe qui peut menacer le rite, dans le second le
mythe nourrit le rite. Dans le cadre du dispositif rituel élargi, la prise de parole politique est l’expression d’un
paradoxe fondamental dû aux médias par lesquels la démocratie représentative s’exerce : un seul parle pour tous et
simultanément à chacun. Le politique doit convaincre un à un une majorité d’auditeurs mais il privilégie un discours
« gestionnaire ». La parole politique est responsable de la relation du passé avec le présent et s’adressant à tous elle
doit prévenir les ruptures de sens entre générations (la différence entre celle qui a connu tel évènement et celle qui
ne l’a pas vécu peut se muer en altérité).
La politique reste rituelle et se situe toujours entre deux mythes : ceux qui lui livre l’histoire et ceux qu’elle doit crée
pour faire l’histoire

5
V. Nouveaux mondes
Il faut parler de mondes et non du monde, mais chacun de ces mondes est en communication avec les autres. Ce
paradoxe fait la difficulté méthodologique de l’anthropologie à venir : comment choisir les objets empiriques où
puissent s’appréhender le paradoxe des nouveaux mondes ? Difficulté renforcée par l’hétérogénéité des mondes
sociaux. Les phénomènes de la contemporanéité modifient le rapport que nous entretenons avec notre entourage.
Il a été montré que derrière toute crise de l’identité il y a une crise de l’altérité : c’est parce qu’il n’arrive plus à
élaborer une pensée de l’autre qu’un groupe d’individu se dit en crise. Une « crise d’altérité » est lié à une «crise de
sens » à laquelle l’anthropologue va s’intéresser.
Augé se propose d’évoquer trois mondes « nouveaux », repères de l’anthropologue : l’individu, les phénomènes
religieux et la ville.
• L’individu a réapparu dans le regard anthropologique dès que celui-ci s’est détourné de l’institution et a cessé de
considérer la culture comme le tout dont il fallait partir pour comprendre les singularités. Mais aussi lorsque
l’ethnologue s’est intéressé à l’élaboration individuelle des représentations. Le recours à l’individu est nécessaire
face à l’affaissement des « rhétoriques intermédiaires » (corps intermédiaires : syndicats, partis..). Augé évoque les
effets de totalisation individuels en faisant référence à l’analyse de G. Althabe : avec les médias, chacun est ou croit
être en relation avec l’ensemble du monde. S’intéressant aux cultes actuels, l’auteur remarque qu’ils se caractérisent
souvent par un individualisme (évangélistes et télé-évangélistes mais aussi chez les catholiques quant à leur rapport
à la pratique du culte en fonction de leur sensibilité personnelle).
• Augé affirme que les cultes nés du « contact » ont anticipé la situation actuelle et illustre cette thèse par l’exemple
des prophètes ivoiriens. Les peuples colonisés ont été les premiers à faire l’expérience de la mondialisation, qui est
une triple expérience - l’accélération de l’histoire, le resserrement de l’espace, l’individualisation des destins – de la
contemporanéité et de la surmodernité. L’intuition prophétique a été de percevoir, au-delà de l’impact colonial, les
dimensions constitutives de la crise qu’instaurait l’ouverture brutale au monde extérieur.
• Augé constate que la « crise de l’urbain » dont on parle est avant tout dû à la difficulté de se représenter la ville et
plus généralement, la contemporanéité. L’auteur revient sur deux oppositions : lieu/non-lieu et
modernité/surmodernité. Le lieu symbolise le rapport de chacun de ses occupants à lui-même, aux autres occupants
et à leur histoire commune. Au contraire un espace ou ni l’identité, ni la relation, ni l’histoire ne sont symbolisées est
un non-lieu. Ce qui est un lieu pour les uns peut être un non-lieu pour d’autres. La multiplication des non-lieux est
caractéristique du monde contemporain : espace de communication, de circulation et de consommation. Ces
espaces sont caractéristiques de la surmodernité qui correspond à une accélération de l’histoire, à un rétrécissement
de l’espace et une individualisation des références. Alors que la modernité, malgré les différences, n’interdit pas la
proximité spatiale. Tout le tissus urbain n’est pas touché par la surmodernité : la ville est bien souvent encore une
combinaison de lieux. La ville est un monde et la question « Vous êtes d’où ? » suggère que l’identité de chacun
passe aussi par celle du lieu où il vit. L’auteur évoque trois risques liés à la ville : l’uniformité qui s’observe à travers
les espaces de consommation, de communication ou de circulation, l’extension qui amène à parler de lignes de
peuplement ou filaments urbains, et l’implosion liée paradoxalement à l’extension de la ville. L’ « urbain généralisé »
(JP Dollé) est le résultat d’une obsession de la circulation, de la mise en communication.
La ville est le lieu problématique où la relation symbolique (permettant de penser l’un et l’autre comme
complémentaire) est mise à l’épreuve. Donc, à travers les problèmes dits urbains, c’est la question politique et
anthropologique de la surmodernité qui est posée : la difficulté de créer des lieux est liée à celle de définir des liens.
La ville, pour Augé, doit rester fidèle à l’histoire de tous et rendre possible celle de chacun, conjuguer le sens du lieu
mais aussi la liberté du non-lieu (celle du promeneur).
L’analyse de Marc Augé envisage de montrer que, dans l’unité et la diversité de l’actuelle contemporanéité,
l’anthropologie est nécessaire. Elle doit s’adapter au changement d’échelle et désormais se généraliser à l’ensemble
de la planète sans pour autant négliger l’observation de petites unités (comme le prophète africain) mais en prenant
en considération les mondes qui les traversent et ne cessent de les (re)constituer.
***
Ce livre qui se veut un manifeste (avant-propos) part d’un constat (développé au chapitre 1), celui, dû à la
globalisation, du rétrécissement de la planète, de la disparition de l’exotisme et de l’accélération de l’histoire. C’est
ce constat qui a fait parler chez les historiens de « fin de l’histoire » et « consensus », de « postmodernité » chez les
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%