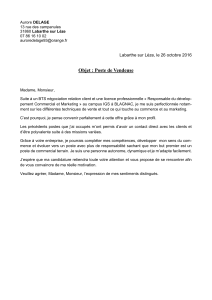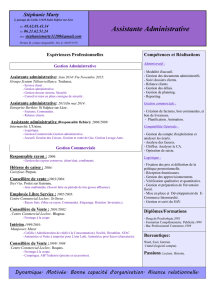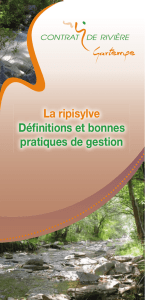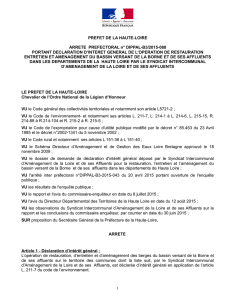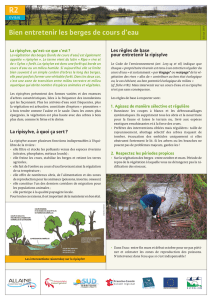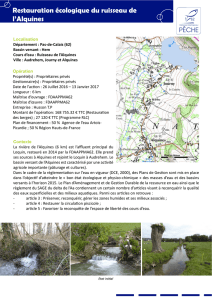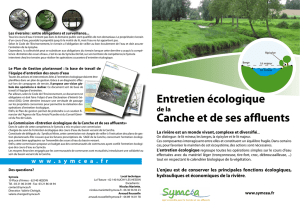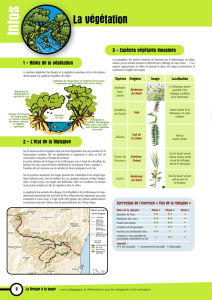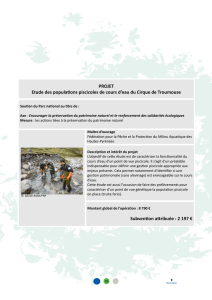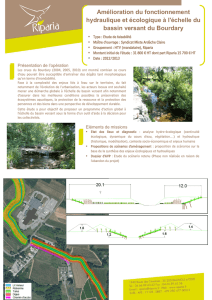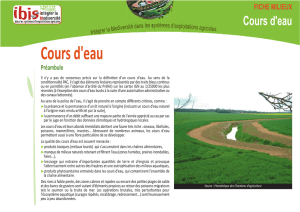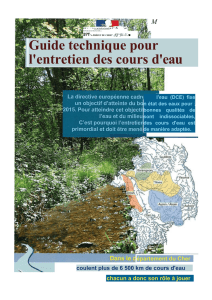le patrimoine naturel du bassin versant de la leze

LE PATRIMOINE NATUREL DU BASSIN VERSANT DE LA LEZE
Peu de données relatives aux espaces naturels sont disponibles sur la vallée de la Lèze. Mais malgré cette lacune,
il est néanmoins possible de présenter les grands traits du paysage de la vallée, et notamment les milieux naturels
remarquables, et de détailler les caractéristiques écologiques de la Lèze.
1. Les grandes unités écologiques de la vallée
1.1 Des paysages
La vallée de la Lèze, de par sa situation géographique, géologique et climatique, peut se décliner en trois
grandes unités naturelles correspondant assez justement aux ensembles morpho-pédologiques présentés en
première partie :
- le piémont pyrénéen,
- les coteaux molassiques,
- les plaines et terrasses alluviales.
1.1.a. Le Piémont pyrénéen, berceau de la Lèze
Le bassin amont de la Lèze est dominé par les contreforts pyrénéens du Plantaurel. En aval de sa source, à
environ 600 mètres d’altitude, et avant son arrivée sur la retenue de Mondély, la Lèze circule au sein d’une
petite vallée humide encadrée par des monts accidentés dont les versants plus ou moins pentus, sont
principalement boisés de chênes, des hêtres et de pins…
Le lit graveleux de la Lèze est dans cette portion relativement étroit et délimité par des berges verticales et
boisées d’une mince ripisylve à Aulne glutineux (Alnus glutinosa)... Les écoulements dominants sont de type
« plat courant », c’est à dire laminaire, les ruptures naturelles de pente (hauteurs de chutes) sont faibles, à
l’exception de l’entrée remarquable dans la cluse
1
du Pas du Roc. A l’aval de cette dernière, le cours d’eau
s’élargie et circule alors au sein d’un relief moins marqué. Il est cisaillé par quelques petites vallées secondaires
(ruisseau d’Argentat, ruisseau de Roziès). Les pentes des monts calcaires y sont toujours occupées par de vastes
boisements, des landes et des pelouses. Comme en amont, le fond de vallée laisse place aux prairies humides sur
marnes dont certaines présentent des cortèges floristiques à orchidées remarquables (Orchis mâle : Orchis
laxiflora, Dactylorhiza pratermisa : exemple de l’amont de la retenue de Mondély).
1.1.b. Un cours d’eau encadré par les molles collines des terreforts.
Au sortir du Plantaurel, à l’aval de Pailhès, la formation molassique couvre la majeure partie du territoire et
encadre la plaine alluviale de la Lèze. Ce système vallonné de coteaux de faible altitude (200-400 mètres) draine
la majeure partie des affluents de la Lèze. C’est d’ailleurs de ces terreforts que naissent une grande partie des
phénomènes hydrologiques
L’agriculture et notamment la céréaliculture y est prépondérante. Elle occupe les vastes pentes des collines,
reléguant l’élevage à la partie amont du territoire. L’irrigation ne s’effectue ici que sur les cultures de maïs, pois
et soja à la faveur des retenues collinaires disséminées sur l’ensemble des terreforts. Dans les reliefs plus
1
Cluse : gorge transversale dans un pli anticlinal (pli dont la convexité est tournée vers le haut).

accidentés, au sommet des collines et sur les coteaux calcaires et là où les rendzines dominent, les boisements de
chênes et quelques pelouses calcaires occupent encore de vastes espaces.
L’occupation des sols est donc majoritairement agricole. La céréaliculture domine et dans quelques cas, les terres
agricoles – quelles soient d’ailleurs pâturées ou cultivées – sont complétées de linéaires arborescents discontinus
et marquant bien souvent les ruptures de pentes. Le caractère fragmenté de cette formation végétale et paysagère
n’est pas suffisant ici pour mentionner la présence d’un bocage à proprement parlé ou même d’un semi-bocage.
Notons également que cette organisation se retrouve à proximité des habitats dispersés et isolés.
1.1.c. Les plaines et terrasses alluviales : espaces de divagation du cours d’eau
Les plaines et terrasses sont visibles de l’aval de Pailhès jusqu’à l’exutoire du bassin versant.
Elles s’étendent de part et d’autres de la Lèze et de ses affluents (notamment le Latou) sur des largeurs très
variables. Le système alluvionnaire de la Lèze par exemple présente des profils en travers variant de 5 km (au
niveau de Labarthe-sur-Lèze) à environ 1 km (à l’aval de Pailhès notamment).
Sur ce long tronçon, la dynamique fluviale est particulièrement active. Ainsi, plusieurs méandres se succèdent,
laissant apparaître dans les parties concaves des faciès d’érosion et dans les parties convexes des zones
d’atterrissement. Le lit mineur y est très encaissé et s’insère au sein de berges hautes, argilo-limoneuses, et
bordées d’une ripisylve mince (largeur inférieure à 5 mètres) relativement dégradée par le Robinier (Robinia
pseudo-acacia. Cette espèce est d’ailleurs omniprésente sur cette partie du cours d’eau.
De part et d’autre de la rivière, que ce soit au niveau des terrasses argileuses ou bien des basses plaines limono-
sableuses et sablo-argileuses, l’occupation du sol reste la même. L’agriculture, et notamment les cultures
irriguées du maïs, du soja, du pois et du sorgho prennent une place éminente, cantonnant la céréaliculture
(pratique agricole non irriguée) au second rang.
Quelques petits boisements, localisés pour l’essentiel autour de Lézat-sur-Lèze, Saint Ybars et en amont
d’Artigat, et six plans d’eau de loisirs, complètent néanmoins le paysage.
1.2 Une occupation des sols marquée par des mutations agricoles
La comparaison des cartes d’occupation des sols dressées en 1946 par GAUSSEN et REY et en 1995 par la
DIREN permet de proposer une identification des grands traits d’évolution du paysage.
Comme nous venons de l’observer plus haut, le bassin versant de la Lèze est actuellement marqué par une
agriculture que l’on pourrait caractérisée de monospécifique par rapport à une situation antérieure davantage
diversifiée.
Cette « monospécificité agricole » est tout de même à relativiser puisque l’occupation des sols de la vallée de la
Lèze est caractérisée à la fois par des cultures de maïs, de soja, de pois, de sorgho, de blé et de seigle.
Néanmoins, l’analyse de la carte de la végétation de 1946, nous renseigne d’une occupation des sols différente et
davantage diversifiée. Elle se traduit notamment par la présence de cultures de blé, de maïs, d’avoine et de tabac.
L’arboriculture et le maraîchage occupent également à cette époque de faibles surfaces à proximité de la Lèze.
Elles s’intercalent alors aux prairies qui dominent le long du cours d’eau et de certains affluents ; ce qui n’est
absolument plus le cas en 1995. Les vignobles, aujourd’hui faiblement représentés, sont dans les années 1940
disséminés sur les coteaux peu pentus de la Lèze.
L’agriculture des années 40, contrairement à la situation des dernières années, semble donc marquée par une
polyculture élevage encore peu soumise à des exigences économiques d’ordre nationale et européenne.
En ce qui concerne la répartition des boisements sur la vallée de la Lèze, une explication doit être proposée. En
1946, l’amont de la Lèze est occupé majoritairement par des boisements de chênes pédonculés, chênes
pubescents et hêtres ainsi que par des landes et des garrigues. Le reste du bassin versant est ponctué de petits
boisements de chênes pédonculés occupants notamment le sommet des buttes.
En 1995, une tendance très nette est à l’accroissement des boisements dans la zone amont à la faveur des espaces
autrefois cultivés. Sur le reste de la vallée, et compte tenu d’un procédé d’élaboration de la carte différent
(notamment en ce qui concerne l’échelle de travail), la carte dressée par la DIREN ne fait pas apparaître les

petits boisements de chênes caractérisant le hauts des collines alors qu’ils sont visibles sur les cartes IGN
révisées en 1999. Les surfaces boisées correspondent alors sensiblement à la situation de 1946.
Nous constatons donc un accroissement globale des surfaces boisées – notamment à l’amont – à la faveur du
déclin de l’activité agricole dans ces zones difficiles. Dans le domaine agricole, l’évolution de l’occupation des
sols se traduit par la chute, voire la disparition, des surfaces toujours en herbes, des vignobles, et des cultures de
légumes, d’arbres fruitiers et du tabac au détriment de l’intensification des cultures irriguées (maïs, soja) et de la
céréaliculture. Cette évolution agricole affecte particulièrement la vallée de la Lèze à partir de l’aval de Pailhès.
L’évolution de l’occupation des sols de la vallée de la Lèze a néanmoins préservé plusieurs espaces considérés
comme remarquables. Ces intérêts écologiques s’expriment notamment au travers de la présence d’une faune,
d’une flore et d’habitats remarquables classés ou inscrits à l’inventaire des Zones Naturelles Ecologiques
Floristiques et Faunistiques.
2. Des milieux naturels remarquables : les outils de classements et d’inventaires
2.1 Les ZNIEFF : Zones Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique
Il s’agit d’inventaires précisant la valeur écologique des milieux naturels (habitats, espèces animales et
végétales…). Cet outil n’a aucune valeur juridique directe. Il n’est pas opposable aux documents d’aménagement
du territoire mais doit être pris en compte dans toute opération de gestion de l’espace.
Sur le périmètre du bassin versant de la Lèze, cinq ZNIEFF ont été identifiées (3 ZNIEFF de type I, 3 ZNIEFF
de type II) équivalent à une superficie voisine de 6225 hectares (soit 1/5 de la superficie totale du bassin
versant).
2.1.a. Les ZNIEFF de type 1
Elles caractérisent des espaces souvent réduits dont l’intérêt patrimonial (faune, flore, habitat) est reconnu à
l’échelle régionale voire nationale.
N°ZNIEFF
Dénomination
Superficie totale
Superficie
dans le BV*
Création
730010259
La Forêt
262,97 ha
262,97 ha
01/01/1987
730012905
Crête du Pas du Roc au Pas de Porte
620.41 ha
533 ha
01/01/1985
730012021
Lac de Mondély
131,03 ha
131,03 ha
01/03/1989
* BV : Bassin versant
Ce sont tous des espaces collinaires (altitude supérieur à 250 mètres) caractérisés par une grande diversité de
milieux (carrières, grottes, rochers et falaises, forêts, landes, fourrés, pelouses, prairies humides, eaux douces…)
et par des intérêts écologiques et biogéographiques (cas de la ZNIEFF « La Forêt ») démontrés par les
rédacteurs des fiches.
Les inventaires ZNIEFF de type I sont joints en annexe du document.
2.1.b. Les ZNIEFF de type II
Ces espaces concernent de grands ensembles naturels riches et peu modifiés offrant de fortes potentialités
écologiques et paysagères. Deux ZNIEFF de type II sont localisées dans la partie amont du bassin versant au sein
du massif du Plantaurel.
N°ZNIEFF
Dénomination
Superficie
totale
Superficie dans
le BV*
Création
730012019
Le Plantaurel
(Pas de Roc à St Jean de Verges)
12596,74 ha
4625 ha
01/02/1989
730011906
Le Plantaurel occidental, Mas d’Azil
18575,48 ha
1335 ha
01/02/1989
* BV : Bassin versant

Comme précédemment, ce sont des espaces de collines et plateaux présentant une grande diversité de milieux et
d’espèces animales et végétales.
Les inventaires ZNIEFF de type II sont joints en annexe du document
2.2 Les sites inscrits
Trois sites sont inscrits au sein du bassin versant de la Lèze. Issus de la loi du 02 mai 1930, la procédure permet
de conserver des milieux et des paysages dans leur état actuel, des villages et des bâtiments anciens
Au titre du patrimoine architectural, il s’agit :
- de la place du Capitole et de ses abords, commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze (arrêté du 10/06/1965),
- des moulins de la vallée de la Lèze, communes du Fossat, Lézat-sur-Lèze, Sainte-Suzanne (arrêté du
10/10/1974).
3. Approche du patrimoine écologique du bassin versant de la Lèze
Les quelques inventaires disponibles sur le bassin versant de la Lèze sont loin d’être exhaustifs. Les différents
contacts pris notamment avec les associations de protection de la nature (les Naturalistes Ariègeois, Nature Midi-
Pyrénées), le Conservatoire d’espaces naturels de Midi Pyrénées et la Direction régionale de l’environnement
nous renseignent qu’il existe des données naturalistes et paysagères éparses et bien loin d’être centralisées.
Dans ce chapitre, nous nous intéresserons principalement aux caractéristiques écologiques des milieux rivulaires
et aquatiques de la Lèze.
3.1 Aspects faunistiques
3.1.a. L’avifaune
La diversité des habitats longeant le cours d’eau - ripisylve, gorges rupestres, éléments anthropiques (digues,
chaussées…), berges sableuses, bosquets… - offre des conditions favorables à l’observation d’une avifaune
relativement riche et diversifiée.
Ainsi, même si aucun inventaire avifaunistique précis n’est disponible sur ce secteur, il nous est possible de
lister plus de 40 espèces présentées pour la majorité protégées au niveau national en annexe du document
Certaines d’entre elles sont remarquables et ne se retrouvent que sur certains tronçons du cours d’eau. Il s’agit
notamment des espèces suivantes :
Le Martin-pêcheur (Alcedo atthis) et le Guêpier d’Europe (Merops apiaster). Ces deux espèces sont protégées
au niveau national (article 1)
2
et inscrites à l’annexe 2 de la convention de Berne
3
. Le Martin-pêcheur figure
également à l’annexe 1 de la directive oiseaux
4
.
2
Protection nationale, arrêté du 17/04/1981, article 1 modifié : Sont interdits en tout temps et sur tout le
territoire métropolitain pour les spécimens vivants la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la
destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la naturalisation ; pour les spécimens vivants ou morts le
transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat.
3
Convention de Berne du 19/09/1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe.
L’annexe 2 concerne les espèces de faune strictement protégées.
4
Directive Oiseaux du 02/04/1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. L’annexe 1 est relative aux
espèces faisant l’objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leur habitat (zone
de protection spéciale).

Ces espèces affectionnent tout particulièrement les berges sableuses et abruptes au sein desquelles elles trouvent
les éléments favorables à la nidification. La Lèze constitue alors un lieu de chasse important et il n’est pas rare
de pourvoir observer sur une branche surplombant l’eau, un Martin-pêcheur guettant sa proie. Le Guêpier
d’Europe, espèce beaucoup plus rare, est localisé quant à lui à la confluence entre le cours d’eau et l’Ariège.
Cinq individus chassant au dessus l’eau ont pu y être observés en mai 2003. La nidification sur ce tronçon du
cours d’eau est plus que probable. Les berges y sont en effet abruptes et d’anciennes traces de nidification y sont
encore visibles.
Certaines espèces sont présentes dans la vallée exclusivement à la faveur du corridor écologique formé par la
Lèze et ses nombreux affluents. Tel est l’exemple du Martin-pêcheur cité précédemment mais également de
nombreux oiseaux d’eau comme le Canard colvert (Anas platyrhynchos) , la Poule d’eau (Gallinula chloropus),
la Foulque macroule (Fulica atra), le Héron cendré (Ardea cinerea)… A préciser
3.1.b. La faune herpétologique
Plus de 10 espèces sont signalées sur tout le long du cours d’eau de la Lèze. Que ce soit les reptiles ou les
amphibiens, les milieux favorables pour l'accomplissement complet de leur cycle de reproduction sont
relativement bien représentés (ripisylve, bosquets, enrochements, dalles rocheuses, berges enherbées…).
Ces milieux accueillent à la fois les espèces qui ont besoin à un moment de leur cycle de développement de la
ressource en eau (cas de certains amphibiens pour la reproduction et de certains reptiles pour l’alimentation), et
les espèces dont le développement peut se faire sans réel lien avec les milieux aquatiques.
Les espèces inventoriées sont toutes protégées au niveau national. Elles figurent pour certaines d’entres elles à la
directive « habitats, faune, flore » et sont inscrites sur la liste rouge nationale.
En attente de la liste complète pour commentaires
3.1.c. Les mammifères
Sur la Lèze et ses affluents, il n’y a pas a proprement parlé de mammifères caractéristiques ou emblématiques,
tels que peuvent l’être par exemple la Castor d’Europe (Castor fiber) et la Loutre (Lutra lutra) sur certains cours
d’eau.
Les données disponibles ainsi que les diverse observations réalisées sur le terrain nous permettent d’identifier un
certain nombre d’espèces plus ou moins remarquables.
Il est possible de distinguer :
- les espèces dites « de passage », comme le Chevreuil (Capreolus capreolus), le Sanglier (Sus scrofa), le
Cerf (Cervus elaphus), ou bien le Blaireau (Meles meles) et qui utilisent le cours d’eau irrégulièrement.
Les individus sont cantonnés pour la majeure partie en amont du bassin versant, au sein des massifs
boisés où s’écoule la Lèze,
- Les espèces davantage inféodées aux milieux aquatiques, tels que le ragondin (Myocastor coypus), la
Genette (Genetta genetta) et quelques micro mammifères (Rat musqué…).
- Et les espèces peu exigeantes qui se satisfont d’un domaine vital réduit. Il s’agit notamment d’un grand
nombre de micro mammifères (Ecureuil, Hérisson d’Europe, Belette, Mulot sylvestre…) que l’on
retrouve par conséquent le long du cours d’eau ainsi que sur l’ensemble de la vallée.
Parmi les espèces plus ou moins inféodées au cours d’eau et aux zones humides en général, nous pouvons noter
la présence du Ragondin (Myocastor coypus). Cette espèce allochtone, introduite accidentellement en France à la
fin du XIX siècle, et apparut en Ariège à la fin des années 1970, semble s’être particulièrement accommodée aux
conditions offertes par la Lèze et par quelques plans d’eau voisins (cas de Saint-Ybars). Les impacts sur la
stabilité des berges et des chaussées bien qu’ils ne paraissent pas forcément éloquents sur les terrains prospectés
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%