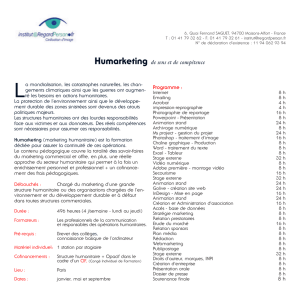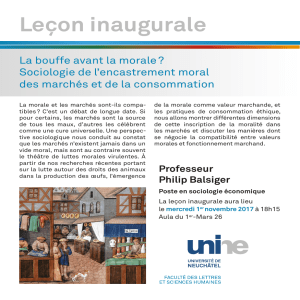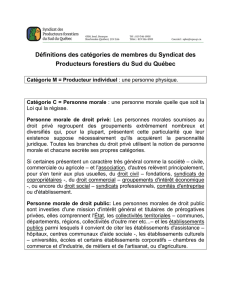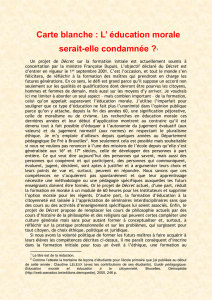Téléchargement Mémoire humanitaire

1
L’HUMANITAIRE DANS LES DEMOCRATIES CONTEMPORAINES :
QUELLE MORALE DONNER A NOTRE ACTION ?
Mémoire de Master de philosophie politique et éthique
Présenté sous la direction du Professeur Alain BOYER
Par Aurélie GUSTAVE
Université de Paris-Sorbonne (Paris IV)
UFR de philosophie et sociologie
Année académique 2007-2008

2
INTRODUCTION 3
I. LES CONCEPTS ET LES PHILOSOPHIES MORALES LIEES A L’ACTION
HUMANITAIRE 8
1. DIFFERENTES CONCEPTIONS DE L’AIDE A L’ORIGINE DE L’AIDE HUMANITAIRE : 11
L’ALTRUISME 11
LA CHARITE CHRETIENNE 13
LA PHILANTHROPIE 17
LE COSMOPOLITISME 18
2. CONCEPTS MORAUX EN JEU DANS L’HUMANITAIRE : 22
ROUSSEAU ET LA PITIE 22
ADAM SMITH ET LA THEORIE DES SENTIMENTS MORAUX 23
II. LES PHILOSOPHIES MORALES CONTEMPORAINES 36
1. LA MORALE DEONTOLOGIQUE 37
LA MORALE KANTIENNE DE L’IMPERATIF CATEGORIQUE 37
LES LIMITES DE LA MORALE DEONTOLOGIQUE 41
LES KANTISMES : L’ETHIQUE DE LA DISCUSSION 42
2. LA MORALE TELEOLOGIQUE 46
L’UTILITARISME 46
LA THEORIE DE LA JUSTICE DE RAWLS ET LE LIBERALISME MORAL 52
III. L’INDIVIDU ET L’AIDE HUMANITAIRE DANS LA DEMOCRATIE 54
1. LE CITOYEN ACTEUR DE L’AIDE HUMANITAIRE 59
LES SENTIMENTS MORAUX ENVERS AUTRUI ET LA CONSCIENCE DE NOTRE RESPONSABILITE 61
UN DESIR DE REALISATION PERSONNELLE… 64
LA CONSTRUCTION DE L’AUTRE DANS L’HUMANITAIRE 65
2. LA MORALE DE L’AIDE HUMANITAIRE : SUR QUEL SYSTEME SE BASER POUR PRENDRE DES
DECISIONS JUSTES ? 69
EFFETS PERVERS DE LA MORALE DEONTOLOGIQUE 69
CONSEQUENCES DE L’UTILITARISME 71
3. L’HUMANITAIRE ET LA DEMOCRATIE : INFLECHIR LA POLITIQUE PAR L’ACTION DE
L’INDIVIDU PRIVE OU ETRE INSTRUMENTALISE PAR ELLE ? 74
L’HUMANITAIRE CONTRE LA POLITIQUE 76
LA DEMOCRATIE HUMANITAIRE 77
L’AIDE HUMANITAIRE PRISE EN MAIN PAR LE POLITIQUE ET INSTRUMENTALISEE 83
CONCLUSION 87
BIBLIOGRAPHIE 89
SOURCES PRIMAIRES 89
SOURCES SECONDAIRES 91
ARTICLES 91

3
Introduction
L’aide humanitaire est une forme de solidarité ou de charité, généralement
destinée aux populations pauvres, sinistrées ou prises dans une guerre, qui
peut répondre à des besoins divers (faim, santé, reconstruction après un sinistre,
éducation, protection des enfants, mise en place de réseaux d'eau et de
communication...). On distingue souvent à ce sujet l'aide d'urgence de l'aide
permanente ou aide au développement.
Cette aide peut prendre diverses formes (dons d'argent, envoi de
marchandises et équipements de première nécessité, envoi de personnel faisant des
interventions sur place) et provenir de diverses sources : Les associations (laïques ou
non) et les ONG humanitaires (dites aussi caritatives) ou même les États et autres
collectivités publiques, les Organisations Internationales publiques, notamment
celles dépendant de l'ONU, de l'Union européenne, ou encore les entreprises.
L’aide humanitaire est née indépendamment du politique et est issue de
différentes sources, telles que la charité chrétienne, le colonialisme ou les guerres
européennes. Elle partage aujourd’hui certains idéaux de la démocratie, la liberté,
l’égalité… mais dans la pratique, politique et humanitaire peuvent entrer en conflit,
défendre des intérêts différents, engendrer des conséquences contradictoires.
L’aide humanitaire est un phénomène à la fois unanimement plébiscité et en
même temps fortement critiqué dans nos sociétés contemporaines. Ce qui pose
principalement problème, c’est la question de savoir si l’aide humanitaire, capable de
déplacer des foules et de drainer énormément de dons, est réellement désintéressée
ou si elle poursuit d’autres buts. Cette question se pose notamment en raison des
effets pas toujours souhaitables provoqués par l’aide humanitaire. L’aide humanitaire
communique beaucoup sur les notions de responsabilité, de morale, de don de soi…
mais elle ne semble pas toujours être réalisée pour ces raisons là. Parfois d’autres
motifs peuvent être pris en compte dans la décision de donner, d’agir ou d’aider qui
peuvent altérer la beauté du geste. Penser l’aide humanitaire, c’est réfléchir à la
morale qui y est intégrée. L’aide humanitaire est née de l’action de citoyens
indépendants qui se sont unis pour agir ensemble de manière plus efficace. Leur
action est souvent née de sentiments purs, mais elle mettait du temps à porter ses

4
fruits, trop liée à d’autres motifs (ethnocentrisme, colonialisme…). D’autre part,
l’aide humanitaire s’est vite rapprochée de la démocratie en raison des idéaux
qu’elles partageaient. Aujourd’hui, le lien existant entre humanitaire et démocratie
met en jeu tant la morale humanitaire que la morale politique. L’objet de ce mémoire
sera donc d’étudier l’apport théorique de la philosophie morale à l’humanitaire afin
de comprendre quels en sont les enjeux contemporains et en déduire la conception la
plus à même de réaliser l’idéal de l’humanitaire dans la pratique sans perdre de vue
les liens qu’elle entretient avec la démocratie dans laquelle elle existe aujourd’hui.
Notre étude sur la morale de l’aide humanitaire met en présence deux
notions philosophiques très proches qu’il convient d’expliciter avant de les utiliser
régulièrement au cours du mémoire, il s’agit des notion d’ « éthique » et de
« morale ». Si l’on souhaite réfléchir au lien ou à la différence entre éthique et
morale, il convient avant tout de rappeler que l’éthique est un terme d’origine
grecque alors que morale est un terme d’origine latine signifiant peu ou prou la
même chose. Souvent aujourd’hui, on assimile l’éthique à la science de la morale
1
,
eu égard à l’activité des nombreux comités d’éthique qui se mettent progressivement
en place.
Aujourd’hui des comités d’éthique cherchent à trouver une morale de
l’action pour résoudre des incertitudes et des tensions liées à l’application par
l’homme de connaissances nouvelles. La légitimité des actions qui vont être
accomplies se réfère alors souvent à Kant et les décisions prises visent le respect de
l’homme. Avec la morale utilitariste, il faut ajouter le respect des intérêts humains en
plus.
Le débat éthique existe souvent sous la forme d’une tension entre deux
rationalités morales reposant sur la raison mais n’aboutissant pas aux mêmes
résultats. La délibération éthique doit alors hiérarchiser, dans le contexte étudié, les
rationalités morales aux inférences divergentes. C’est ce que nous tenterons de faire
en hiérarchisant les rationalités morales dans le contexte de l’aide humanitaire en
tentant avant tout de ne pas se satisfaire d’un relativisme moral généralisé.
1
Axel Kahn, in Préface, Questions d’éthique contemporaine, Sous la direction de Ludivine
Thiaw Po Une, Stock, Les essais, Paris, 2006

5
Les sociétés contemporaines sont riches de la diversité des traditions, des
références philosophiques, religieuses et par conséquent morales. Les références
étant multiples, est-il possible de s’accorder sur les valeurs fondant l’action bonne ?
Au centre de l’éthique il y a le souci de l’autre, de sa liberté, de ses intérêts et de ses
droits. C’est ce point central de l’éthique qui nous intéresse tout particulièrement
dans ce mémoire.
Le problème de l’éthique contemporaine est alors de voir si ce que l’on
propose est probablement vrai, réalisable et raisonnablement sûr, si c’est là un moyen
de développer un marché et d’accumuler des richesses, et si c’est pour autant un
bien ? Il faut se méfier de la réduction des valeurs immatérielles à leurs dimensions
économiques et techniques. Dans une discussion d’ordre éthique il faut tenter
d’introduire de la rationalité et de l’argumentation plutôt que de l’émotion et de
l’idéologie. N’avons-nous pas déjà néanmoins commis cette erreur en agissant par
impulsion et sous le coup de l’émotion lors de crises humanitaires ?
L’éthique contemporaine subit d’importantes mutations. On fait de plus en
plus appel aux philosophes pour réfléchir aux applications possibles de la morale
dans des champs aussi différents que la technologie, la biologie, la médecine ou
même la politique. On fait appel à eux dans tous les domaines où se crée l’opinion,
où se prennent des décisions. « Qu’il s’agisse de prendre position sur une législation
destinée à réguler l’usage de technologies permettant de déterminer les
caractéristiques génétiques d’enfants à naître, de faciliter la décision d’une fédération
sportive sur l’usage de produits dopants ou de conseiller une entreprise sur les
mesures appelées par les conséquences écologiques de ses activités, les instances
concernées s’attachent la coopération d’éthiciens chargés de guider leurs réflexions
ou d’évaluer le suivi de leurs choix »
2
. « Ils font progresser la recherche
philosophique sur des questions aussi radicales que celles de la distinction entre le
Bien et le Mal, de la liberté et de la responsabilité des agents moraux ou des fins
morales à poursuivre, entre bonheur et devoir, par les personnes individuelles ou
collectives »
3
ajoute encore Ludivine Thiaw Po Une. Il ne fait alors aucun doute que
les problèmes de choix, ou de responsabilité dans le cadre de l’action humanitaire
tireraient de nombreux enseignements de ces réflexions éthiques et permettraient de
réfléchir à la façon de faire effectivement le bien là où l’on intervient.
2
Ludivine Thiaw-Po-Une, Questions d’éthique contemporaine, Stock, Les essais, Paris, 2006
3
(ibid)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
1
/
91
100%