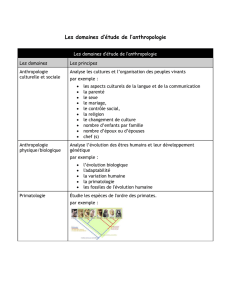COMPTES RENDUS Mauricio SEGURA, Janusz PRZYCHODZEŃ

La revue
La faculté
L'université
Ethnographie - Fictions? 28-3, 2004
Ethnography - Fictions? 28-3, 2004
Etnografia -Ficciones? 28-3, 2004
COMPTES RENDUS
Mauricio SEGURA, Janusz PRZYCHODZEŃ, Pascal BRISSETTE, Paul CHOINIÈRE et Geneviève
LAFRANCE (dir.), Imaginaire social et discours économique. Montréal, Département d’études
françaises de l’Université de Montréal, 2003, 148 p., réf.
D’entrée de jeu, il convient de préciser que l’ouvrage dont il est question ici n’a pas de prétentions
anthropologiques explicites. Son ancrage disciplinaire et théorique y est clairement établi par les
auteurs comme appartenant à l’analyse socio-discursive et à la veine sociocritique des études sur
l’imaginaire social. L’ambition des auteurs est d’y analyser « le regard oblique que jette la littérature
sur la vie économique » (p. 8) et, plus précisément, les contextes discursifs qui ont conditionné la
méfiance de plusieurs littéraires, par ailleurs forts différents, face à l’argent.
Les textes de la première partie portent sur les représentations critiques du capitalisme dans des
œuvres littéraires québécoises et françaises. La dépossession de Menaud, maître draveur et l’avarice
chez Un homme et son péché sont ici mises en regard par Janusz Przychodcheń ; Anne Caumartin
aborde la critique de la société de consommation dans l’œuvre de Jacques Godbout ; Marc Angenot y
fait un survol érudit du rapport à l’argent dans la littérature française du XIXe siècle et Mauricio
Segura revient sur la critique de la société de consommation, mais dans le contexte français des années
soixante. Il n’est pas possible ici de résumer les contributions importantes de chacun de ces textes,
mais tous traitent de ces « apories de l’argent » (Przychodzeń) qui entrent dans les consciences et
deviennent agents de servitude. Angenot note bien que la littérature peut devenir un site de résistance
par rapport à ces discours et à ceux qui les véhiculent, comme elle l’a été lors de la grande expansion
capitaliste du XIXe siècle. Caumartin et Segura montrent également que les discours critiques face à
l’argent et la spirale de la consommation qui lui donne une valeur sociale toujours plus grande,
peuvent connaître une flambée même dans les sociétés dites « d’abondance ».
Dans la seconde partie de l’ouvrage, Sylvain David, Johann Sadock et Olivier Parenteau examinent
tour à tour des œuvres littéraires qui entrent en résonance avec les écrits anthropologiques pour relever
l’envers de cette abondance imaginaire, c’est-à-dire certaines représentations de l’« indigent ».
L’intérêt que porte la discipline anthropologique à la pauvreté et à sa description détaillée semble lui
avoir fait oublier un aspect important de ce phénomène, celui de la construction imaginaire de ces «
pauvres » par ceux qui ne le sont pas. En fait, une lecture sociocritique des travaux d’Oscar Lewis, ce
Zola anthropologique, serait probablement fort instructive quant au rôle que les anthropologues ont
eux-mêmes joué dans cette construction du pauvre et de sa culture. Et ce serait une contribution
importante à l’inventaire des « figures de l’indigent » amorcé par les auteurs de cette section à partir
de matériaux littéraires.

La troisième partie de l’ouvrage quitte un peu la question des constructions et représentations
discursives de divers tropes économiques en littérature ; elle se penche plutôt sur l’analyse sociale de
l’« économie » de l’acceptation et sur la diffusion des auteurs et des ouvrages littéraires. Le texte de
Michel Lacroix, intitulé « Des formes de capital dans les sociabilités littéraires », particulièrement
intéressant, analyse comment le capital social se convertit en capital symbolique, voire en capital
économique, dans les cercles mondains parisiens du début du XXe siècle. Anthony Gliboer, pour sa
part, poursuit cette réflexion sociale en se penchant sur les réseaux littéraires privés. Il s’attarde à
l’imbrication de stratégies textuelles et de stratégies institutionnelles que révèlent les poésies dites «
cénaculaires » (diffusées par leurs auteurs à travers cénacles et salons pendant la période romantique
en France), pour en arriver à décrire le fonctionnement de ces réseaux de reconnaissance mutuelle – si
importants pour les carrières de l’écrit.
La dernière section du livre retourne à des études davantage centrées sur le contenu des œuvres
littéraires et examine le langage du don (et le don de langage) dans Delphine de Madame de Staël
(texte de Geneviève Lafrance) et dans La fille errante (texte de Florence Ogilvy-Magnot). Encore une
fois, voir la question du don traitée par des littéraires, et par des méthodes littéraires, peut devenir une
invitation au dialogue entre deux champs d’études qui, malheureusement, se croisent encore trop peu
souvent.
La lecture de cet ouvrage à travers la lentille des problématiques anthropologiques peut s’avérer fort
stimulante et dynamisante. Ce que les auteurs font pour le discours économique dans le roman pourrait
stimuler l’analyse d’autres types de discours qui, eux, seraient plus proches des matériaux
ethnographiques traditionnels. Les anthropologues vivent dans des sociétés, et étudient des sociétés, où
les revenus monétaires ont souvent acquis une grande importance dans la vie des gens, et où les
discours sur ces thèmes abondent. Pourtant, dans une discipline qui accorde une grande place aux
études sur l’économie en tant que relation sociale, les anthropologues semblent, paradoxalement,
éprouver une certaine réticence à se pencher sur les discours qu’articulent leurs informateurs à propos
de l’argent ; à tel point que l’on serait en droit de se demander si la discipline anthropologique, comme
le champ littéraire, n’aurait pas elle aussi hérité de cette « antique peur de l’or » dont traite Angenot (p.
35).
L’ouvrage présenté ici nous permet d’attaquer de front la question du rapport discursif et imaginaire à
l’argent. Le concept d’imaginaire social, qui était quelque peu en dormance depuis le milieu des
années quatre-vingt et qui semble reprendre du service en philosophie (Taylor 2004), en études
littéraires (dans le présent ouvrage par exemple) et chez les anthropologues sociaux se disant «
poststructuralistes » (par exemple Escobar 1998), peut devenir un pont intéressant pour entreprendre le
type de dialogues auxquels nous invite implicitement cet ouvrage. Imaginaire social et discours
économique est donc un livre dont la fécondité théorique peut facilement dépasser le champ des études
littéraires.
Références
ESCOBAR A., 1998, Encountering Development. Princeton, Princeton University Press.
TAYLOR C., 2004, Modern Social Imaginaries. Durham, Duke University Press.
Martin Hébert
Département d’anthropologie
Université Laval
Québec (Québec) G1K 7P4

Canada
Centre de recherches et d’études anthropologiques (CRÉA) et Université Lumière Lyon 2, Tohu-bohu
de l’inconscient : paroles de psychiatres, regards d’anthropologues. Actes de colloques. Bron, Éditions
la Ferme du Vinatier, 2001, 80 p.
Ce petit livre est le premier volume d’une série de quatre publications1 issues des rencontres intitulées
« Tumultes et silences de la psychiatrie » organisées par le Centre Hospitalier Le Vinatier, une
institution psychiatrique de la région lyonnaise (France), dont le but était de « favoriser les
mouvements entre l’établissement hospitalier et son environnement social et urbain » (p. 7), comme le
note la responsable du projet Carine Delanoë-Vieux, et cela autour de trois axes : un axe patrimonial et
muséographique, un autre centré sur la production et la diffusion artistique, le dernier enfin centré sur
la recherche et le débat en sciences sociale. Faisant alterner les contributions d’ethnologues (François
Laplantine, Jean Benoist, Axel Guïoux et Evelyne Lasserre), d’un psychiatre (Jean Guyotat) et d’un
écrivain (Sylvie Doizelet), le propos est ici de s’interroger sur la nature du dialogue qui peut s’établir
entre la psychiatrie et l’anthropologie aujourd’hui.
Dans son texte, Jean Benoist s’interroge sur les relations entre approche clinique et approche
ethnographique. Alors que « ce qu’essaie de connaître l’anthropologue, c’est l’expérience de la vie que
représente ce fardeau, la façon dont cette expérience se construit au croisement de ce qui est le plus
individuel en eux et de ce qui est modelé par la société » (p. 17), le psychiatre quant à lui « pénètre
nécessairement dans le même territoire, même si sa préoccupation est de comprendre, par delà sa
culture et son histoire, l’individu, tandis que celle de l’anthropologue est de découvrir, à travers
l’expérience de l’individu, sa culture » (ibid.). Ainsi le regard du clinicien et celui de l’ethnologue
n’est pas le même et les informations que chacun d’eux tire de ses observations sont différentes.
L’écart entre les deux démarches n’interdit pas le dialogue des deux disciplines. Si l’anthropologie a
un message à livrer à la médecine, c’est celui de la contextualisation, car l’individu n’existe finalement
pas en tant que tel, mais de par sa position dans un faisceau de relations. Toutefois, cette
contextualisation ne peut se cantonner à l’attitude de la clinique interculturelle qui en s’intéressant par
exemple à « l’immigré » le fige dans sa culture d’origine en oubliant qu’ils s’agit d’un individu « en
trajectoire », ce qui doit amener, selon Jean Benoist, à se méfier des situations où le « culturel » est un
alibi, un faux-semblant. Si la médecine et la psychiatrie ne sont pas à l’abri d’une utilisation dévoyée
de l’anthropologie, l’ethnologie n’en est pas moins protégée d’une utilisation vulgaire de la psychiatrie
ou de la psychologie. Et l’auteur de rappeler avec Georges Devereux que s’il faut « postuler
l’interdépendance de la donnée sociologique et de la donnée psychologique » (p. 24), cela nécessite de
« postuler en même temps l’autonomie absolue tant du discours sociologique que du discours
psychologique » (ibid.).
La contribution de François Laplantine expose, à la manière d’un cours et pour ensuite la critiquer,
l’approche ethnopsychiatrique de Georges Devereux. S’inspirant des travaux de la physique
quantique2 pour élaborer sa théorie de la complémentarité, Devereux estime que tout phénomène est
redevable de deux explications, l’une psychologique, l’autre ethnologique, mais que cette double
démarche ne peut se faire en même temps. L’ethnopsychiatrie (ou ethnopsychanalyse) n’est pas une
approche additive. Psychologie et ethnologie se distinguent par leur méthodologie mais sont incluses
réciproquement, « le psychisme étant de la culture intériorisée et la culture du psychisme projeté » (p.
30). Des théories quantiques, Devereux tire une autre idée, celle de la réintégration du rôle du
chercheur dans le champ de l’observation. La présence de l’observateur ne doit pas seulement être
considérée comme une source de déformation qu’il s’agirait de minimiser par l’objectivation mais
comme une source d’information qu’il faut exploiter par l’analyse de la situation transférentielle et
contre-transférentielle qui se joue dans l’interaction. En postulant l’existence de sociétés malades,
Devereux interroge à la fois la psychiatrie et l’ethnologie « et c’est sur ce point, comme le note
Laplantine, que le relativisme culturel des ethnologues rejoint le dogmatisme des psychiatres qui
s’accordent à définir le pathologique par l’inadaptation » (p. 31). La pensée de Devereux ébranle sur

ce point le modèle fonctionnaliste qui est incapable de penser le changement et dont le paradigme «
d’ordre et de non-temps » neutralise les dimensions historique et affective des phénomènes. Enfin,
dans la continuité de Freud, il utilise une méthodologie des correspondances et « utilise des
phénomènes culturels comme instruments révélateurs d’organisations psychologiques et de troubles
psychopathologiques » (p. 33). Reconnaissant l’apport de Devereux, Laplantine formule toutefois une
série de critiques autour de son idéal positiviste et universaliste. Pris dans une logique où chaque
culture est une recomposition d’invariants, la pensée de Devereux relève du « bricolage »
levistraussien et « permet bien de penser le recyclage mais nullement le métissage ». Ainsi,
l’universalité de Devereux se présente « comme un bloc à l’abri de l’histoire » et Laplantine de
fustiger « le côté obscur de la pensée des Lumières qui [...] ne retient que les aspérités, les contrastes,
[...], et répugne à penser les contradictions, [...], les nuances chromatiques, mais aussi
épistémologiques » (p. 35). Pour Laplantine, il ne faut pas renoncer à tout critère du normal et du
pathologique, dont le critère est la souffrance, mais un sentiment tel que la mélancolie par exemple est
un sentiment métis qui « n’a pas la pureté et la franchise d’un “tableau” psychopathologique
clairement indentifié » (p. 37). De fait Laplantine plaide en faveur d’un changement de regard de
l’anthropologie. Estimant que « la recherche ethnopsychiatrique [...] ne peut être stabilisée aujourd’hui
dans des unités discursives apaisées » (p. 38), il dénonce l’écriture sur la folie comme trop linéaire et
régulière, catégorielle et classificatoire, et estime que l’ethnographe à beaucoup à apprendre des textes
littéraires en ce domaine. Nous ne suivrons pas Laplantine sur ce dernier point, dans la mesure où
l’entreprise ethnologique reste à nos yeux, quitte à ne pas suivre la vague postmoderne qui caractérise
l’anthropologie contemporaine, une entreprise de raison et non une entreprise littéraire.
Au final si ce petit livre, dont nous n’avons rendu compte que partiellement, témoigne de la richesse
de l’entreprise pour ses participants et de l’ouverture du centre psychiatrique de Bron, le lecteur reste
toutefois sur sa faim et aurait préféré qu’on laisse plus de place, à côté des réflexions
épistémologiques, théoriques et parfois rhétoriques sur le dialogue entre les deux disciplines, aux
résultats de travaux d’enquête de terrain sur la psychiatrie, comme le titre le laissait entendre.
David Michels
Centre d’Anthropologie de Toulouse
39, allées Jules Guesde
31000 Toulouse
France
Patrice BIDOU, Le Mythe de Tapir Chaman. Essai d’anthropologie psychanalytique. Paris, Éditions
Odile Jacob, 2001, 259 p.
Bernard JUILLERAT, Penser l’imaginaire. Essai d’anthropologie psychanalytique. Éditions Payot,
Lausanne, 2001, 309 p., bibliogr. Index.
Qu’est-ce que l’anthropologie psychanalytique? Deux ouvrages récents en tracent les contours : Au
cours de divers séjours chez les Tatuyo (Nord-ouest de l’Amazonie), Patrice Bidou a recueilli, auprès
de cinq informateurs, des récits qui forment la trame du Mythe de Tapir Chamane. Il propose d’en
révéler le ressort profond, la sexualité, qui expliquerait pourquoi le corpus de cette région, pourtant
très riche en documents, fut délaissé par Lévi-Strauss dans sa fresque des Mythologiques. S’il ne
néglige pas la dimension narrative du mythe, qu’il entend même réhabiliter contre le structuralisme,
Patrice Bidou procède avant tout, le long des six derniers chapitres, à une exégèse psychanalytique du
« matériel narratif » qui ne tient aucun compte des diverses situations d’interlocution de ces récits (qui,
quand, comment, pourquoi) et ses éventuels enjeux. Une fois isolés et rassemblés ces récits en texte,

l’auteur leur donne cohérence et sens avec cet idiome commode qu’institue la psychanalyse. L’effet
est indiscutable : tout se tient, tout est dit. Comme si du travail ethnographique même ne se dégageait
rien d’autre que des informations complémentaires, mais composites – des fragments – subordonnées
et à la disposition de l’intelligibilité du texte.
Patrice Bidou spécifie sa démarche par deux décisions conceptuelles majeures : 1. Contrairement à une
influente tradition d’anthropologie psychanalytique, il distingue et hiérarchise clairement le mythe et
le rêve : le mythe traite du rêve et lui fait des emprunts. Le mythe ne se confond pas avec le rêve, c’est
une forme de cure : « Le mythe n’est pas un rêve, mais le traitement d’un rêve ancien et récurrent,
comme dans une cure » (p. 21). 2. D’où le parallèle entre les mythes et les vignettes cliniques
freudiennes qui sont, dans la bouche du Chaman Tatuyo, à la fois récit de maladie et de traitement. On
ne saisit pas très bien la pertinence de cette analogie qui escamote aussi bien la façon de faire de Freud
que du chaman ; Freud au contraire du Chaman ne prétendait pas soigner avec ces vignettes. Il s’avère
alors que la question de l’efficacité symbolique reste en suspens : prétendre soigner avec des récits
dans un langage indirect (situé dans un autre temps, avec d’autres acteurs tout en semant des référents
et des métaphores communes pour y insérer progressivement le ou les auditeurs). Dès lors, si l’unique
vertu de l’anthropologie psychanalytique est de faire voir autrement par un certain arrangement des «
données » le symbolique, l’ethnologue doit ou se résoudre à produire lui-même une forme moderne et
savante de mythologie (l’anthropologie?) ou convenir que l’intelligibilité s’obtient essentiellement par
un surcroît d’ethnographie.
Alors que l’activité symbolique, question léguée par Marcel Mauss, est au cœur des préoccupations de
l’anthropologie, les ethnologues n’ont guère cessé d’en rendre compte en des termes empruntés à la
psychologie, notamment. C’est pourquoi, si débat il y a, il se réduit ordinairement à la question de
savoir à quel modèle psychologique recourir pour expliquer au mieux le « matériel » ethnographique.
Ainsi, le recueil de textes de Bernard Juillerat s’ouvre-t-il sur une critique, fort pertinente et depuis
longtemps attendue, de l’anthropologie cognitive représentée en France par Dan Sperber et Pascal
Boyer. Elle porte essentiellement sur deux aspects : la réduction du mental au biologique qui relève de
l’acte de foi ; la confusion entre mécanisme psychologique et origine psychique. Bernard Juillerat
néglige néanmoins ce raccourci essentiel : l’anthropologie cognitive prétend expliquer la production
de significations par un traitement défectueux de l’information. Après avoir épinglé les dérives
cognitivistes de l’anthropologie, Juillerat réitère et prolonge hélas! un Manifeste, cosigné avec Patrice
Bidou et Jacques Galinier dans le numéro 149 de L’Homme, pour une anthropologie psychanalytique.
Il lui importe donc de défendre et d’illustrer, travaux à l’appui, l’apport de la psychanalyse freudienne
à l’étude d’objet symbolique réputé bien circonscrit comme les mythes, les rites, croyances,
cosmologie… son programme étant de « reconstruire les processus inconscients partagés par les
individus d’une même société et la façon dont ils sont traduits en symboles culturels partagés par tous
» (p. 11).
Aussi croise-t-il ses propres articles ou chapitres d’ouvrages pour tisser la trame historique et
théorique d’une collaboration fructueuse entre anthropologie et psychanalyse non sans en rappeler les
handicaps3. Il pense trouver une issue à ce dialogue dans une stricte division et hiérarchisation des
rôles. S’il inclut la psychanalyse au sein d’une anthropologie pluridisciplinaire, et en fait l’étude d’un
psychisme universel et autonome, il en restreint l’application à « certains types de matériaux ». À
aucun moment il ne s’interroge sur l’hétérogénéité de la psychanalyse ni sur la sociohistoire
qu’exigerait la notion de psychisme avant tout usage. Son problème est plutôt de montrer le nombre de
médiations nécessaires pour expliquer comment les représentations inconscientes individuelles passent
au collectif... Ce qui est en effet très problématique. Pour étayer sa démarche, il réunit ensuite des
travaux menés sur son terrain de Nouvelle-Guinée auprès des Yafars. La lecture a de quoi laisser
perplexe, voire sceptique. La facilité avec laquelle Juillerat propose des interprétations analytiques est
d’autant plus curieuse qu’il relève sur ces « matériaux » des références œdipiennes évidentes. On ne
peut pas s’empêcher de penser qu’il révèle ce qu’il présuppose. Il est donc permis de s’interroger en
amont sur l’opportunité de recourir à des modèles psychologiques ou des théories du mental pour
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
1
/
34
100%