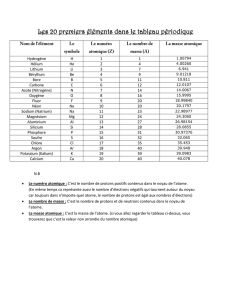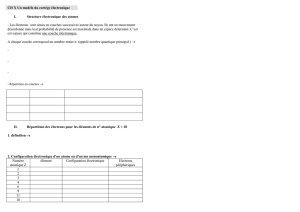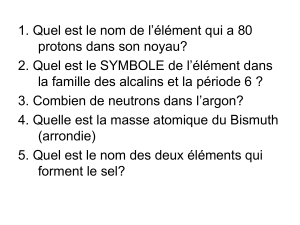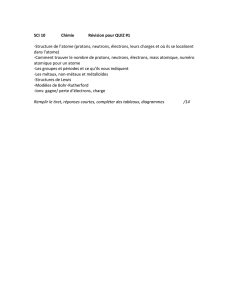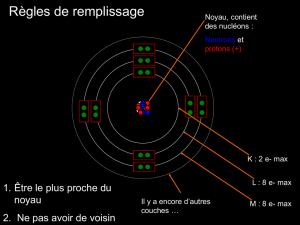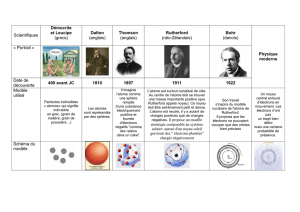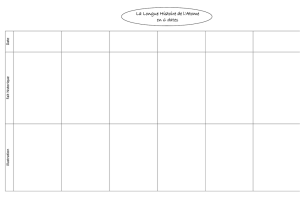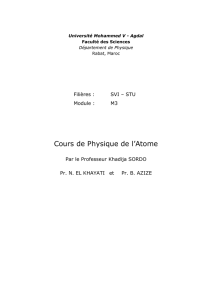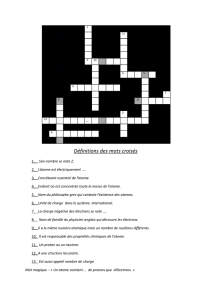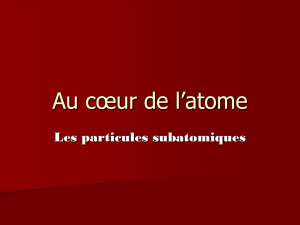Chap5 COURS ATOME

Physique 2nde G.Baudot – 2005/2006
Chapitre 5 : Un modèle de l’atome
I. Exploration de la structure de l’atome
1) L’expérience de Rutherford
Activité documentaire n°1 p.52
En 1909, Marsden, Geiger et Rutherford entreprirent d’utiliser des particules α
(noyaux d’hélium) pour explorer la structure de l’atome. Ils bombardèrent pour cela
une feuille d’or d’environ 0,6 µm par un faisceau de particules α et constatèrent que
la grande majorité des particules traversent la feuille d’or sans être déviées, que
quelques particules sont légèrement déviées et que certaines particules α (une sur
20 à 30000) sont renvoyées vers l’arrière.
Rutherford en déduisit que l’atome est constitué d’un noyau très petit par rapport
à la taille de l’atome qui concentre l’essentiel de la masse et toutes les charges
positives, et d’un cortège électronique dont le volume est celui de l’atome.
Un atome est constitué d’un noyau central entouré par un cortège d’électrons.
2) Au cœur de l’atome : le noyau
Grâce à l’expérience de Rutherford, on comprend qu’il existe au cœur de l’atome un
noyau très petit, très dense et chargé positivement.
Le noyau atomique est à peu près 100 000 fois plus petit que l’atome.
Le noyau atomique constitue l’essentiel de la masse de l’atome.
Le noyau atomique porte une charge électrique positive.
3) Principal constituant de l’atome : le vide
Un atome est essentiellement constitué de vide.
Le rayon du noyau est 100 000 = 105 fois plus petit que le rayon de l’atome cela veut
dire que le volume du noyau est (105)3=1015 fois plus petit que celui de l’atome.
Finalement, considérant la Lune, sphère de rayon RL= 1730 km, on calcule que si on
enlevait le vide des atomes qui la composent leur noyau tiendrait dans une sphère
de moins de 20 m de rayon.
Exercice n°13 p.61
II. Les constituants de l’atome
1) Les particules du noyau : les nucléons
Le noyau atomique est constitué de 2 types de nucléons : protons et neutrons.
Un neutron porte une charge nulle (qn = 0). Un proton porte une charge positive
qui vaut qp = +e = 1,602. 10-19 C
La masse du neutron est mn = 1,675. 10-27 kg, celle du proton mp = 1,673. 10-27
kg. Ces masses son très voisines et on prendra mn = mp = 1,67. 10-27 kg
2) Le cortège électronique
Autour du noyau gravitent des électrons.
Les électrons sont des particules de charge négative qp = -e = -1,602. 10-19 C
Les électrons sont des particules de masse très faible : me = 9,1. 10-31 kg.
III. La masse et la charge de l’atome
1) Symbole, nombre de masse et numéro atomique
Un atome est caractérisé par deux nombres :
- le nombre de masse, noté A, est le nombre de nucléons dans le noyau
- le numéro atomique, noté Z, est le nombre de protons dans le noyau
Le nombre de neutrons dans le noyau est donné par A-Z
Un atome est noté
X
24
12
avec X le symbole chimique de l’atome.
2) Electro-neutralité de l’atome
Un atome est électriquement neutre c’est-à-dire que sa charge électrique
totale est nulle.
Pour être neutre un atome doit comporter autant d’électrons dans le cortège
électronique que de protons dans le noyau.
Le nombre d’électrons est donc égal à Z (numéro atomique).
3) La masse de l’atome est concentrée dans le noyau
Toute la masse de l’atome est contenue dans le noyau.
La masse de l’atome correspond à celle des Z protons et des (A-Z) neutrons du
noyau : ma = Z mp + (A-Z) mn

Physique 2nde G.Baudot – 2005/2006
Exemple : Un atome de
Br
80
35
a un noyau qui contient A=80 nucléons dont Z=35
protons et A-Z=45 neutrons et un cortège électronique qui contient 35 électrons.
La masse de l’atome vaut mBr = 35 mp + 45 mn = 80 x 1,67. 10-27 = 1,34. 10-25 kg
Exercice n°14 p.61
IV. Répartition des électrons
Activité documentaire n°4 p.55
Tous les électrons du cortège électronique n’ont pas les mêmes propriétés. Le
cortège électronique est structuré en fonction des propriétés des électrons. Pour
décrire la structure du cortège électronique on utilise un modèle en couches.
Les électrons sont répartis sur différentes couches électroniques.
Les couches sont notées par des lettres : K, L, M ...
La couche K est la plus proche du noyau, les autres sont de plus en plus
éloignées du noyau.
Chaque atome ayant un nombre d’électrons différents le remplissage des couches
électroniques varie en fonction de l’atome considéré.
Pour savoir comment les électrons se placent sur les différentes couches
électroniques on utilisent les règles suivantes :
- on remplie les couches dans l’ordre K puis L puis M puis ...
- la nème couche peut recevoir 2n2 électrons
(2 sur la couche n°1 (K), 8 sur la couche n°2 (L), 18 sur la couche n°3 (M), etc...)
La façon dont les électrons sont disposés sur les différentes couches électroniques
donne aux atomes les propriétés qui détermineront leur comportement chimiques.
Il est donc important de pouvoir simplement résumer la structure électronique d’un
atome.
On représente la structure électronique par une notation qui résume combien
d’électrons contient chaque couche électronique : (K)nb e K(L)nb e L(M)nb e M...
La dernière couche qui contient des électrons est appelée « couche externe »
Exemple : le Mg a 12 électrons, sa structure électronique est (K)2(L)8(M)2
Exercices n°21, 22 et 25 p.62
V. Petite histoire du modèle atomique
1) Naissance de la théorie atomiste
Dans l’Antiquité, les spéculations des philosophes grecs donnent naissance à deux
grandes théories opposées sur les éléments constitutifs de l’Univers : la théorie
des quatre éléments, élaborée par Empédocle au ve siècle av. J.-C., et l’atomisme,
proposé par Leucippe un siècle plus tard.
Selon Empédocle, philosophe grec du Ve siècle av. J.-C., le monde serait
constitué de quatre éléments : la terre, l'eau, l'air et le feu. Mus par la
force de l'amour, ils s’uniraient et se sépareraient sous l'impulsion de la haine.
Par ailleurs, Anaxagore est convaincu que la matière est constituée d'un nombre
infini d'éléments indivisibles, dont le mélange, réalisé par l'opération de
l'intelligence éternelle, conduirait aux choses
Selon la théorie atomiste (fondée par Leucippe et développée par Démocrite),
la matière résulterait d'une composition particulière particules minuscules,
identiques et indivisibles : des atomes (du grec atomos, « indivisible »).
2) Premières théories atomiques
Le concept moderne d’atome est proposé par John Dalton en 1808, tandis que la
notion de molécule est précisée par Amedeo Avogadro en 1811, lorsqu’il publie ses
travaux sur la théorie moléculaire des gaz.
Lavoisier montra, par des expériences chimiques quantitatives, qu'en dépit du
changement d'état de la matière au cours d'une réaction chimique, la quantité
de matière restait constante entre le début et la fin de chaque réaction. Cela
conduit à la loi de la conservation de la matière.
En 1808, John Dalton publie son hypothèse atomique. Il considère qu'il est
possible de déduire les masses relatives des particules ou des atomes du
rapport des masses dans les composés. De plus, il affirme que les masses
relatives (aujourd'hui, on parle de masse atomique) de chaque élément sont
différentes. Il établit une table des masses pour tous les éléments connus.
La théorie de Dalton comporte de nombreuses erreurs, mais elle va permettre
de révolutionner la chimie théorique.
En 1811, Amedeo Avogadro suppose que des volumes égaux de gaz ont le même
nombre de molécules dans les mêmes conditions de température et de pression.
Il établit une distinction entre molécules et atomes : une mole contient 6,023 ×
1023 molécules (nombre d'Avogadro).
L’hypothèse de Dalton s’est trouvée renforcée par la classification périodique
des éléments de Mendeleïev publiée en 1869, qui range les corps simples selon

Physique 2nde G.Baudot – 2005/2006
leur numéro atomique. La spectroscopie, qui permet de caractériser un élément
chimique par son spectre, corrobore également les thèses atomiques.
3) Différents modèles pour l’atome
Le modèle atomique actuel est le résultat d'améliorations successives obtenues par
le biais de mesures expérimentales toujours plus précises. Quatre noms célèbres
sont attachés à l'évolution du modèle de l'atome : Thomson, Rutherford, Bohr et
Schrödinger.
Le modèle de J.J. Thomson suppose que
les électrons sont immergés dans un
matériau de charge positive, « comme
des raisins dans un cake » précise
Thomson pour donner une image
concrète à son modèle.
Ernest Rutherford améliore le modèle
atomique de Thomson en découvrant que
la quasi-totalité de la masse d'un atome
est concentrée dans un tout petit
volume chargé positivement : le noyau.
Les électrons gravitent autour du noyau
dans un espace très vaste, sur des
orbites plus ou moins proches du noyau.
Niels Bohr développe ensuite un modèle
atomique bien plus satisfaisant dans
lequel l'atome présente des couches,
correspondant chacune à une énergie
particulière. Lorsqu’un électron passe
d'une couche à une autre il y a émission
ou absorption d'énergie.
Enfin, Erwin Schrödinger révolutionne
l'idée d'orbite électronique, en
proposant un modèle ondulatoire dans
lequel l'électron n'est plus décrit
comme une particule mais comme une
onde à laquelle on associe une orbitale
qui est une région de l'espace où la
probabilité (possibilité) de rencontrer
un électron est très grande.
1
/
3
100%