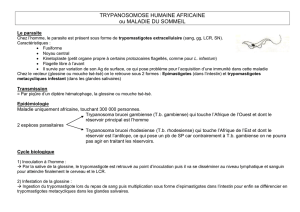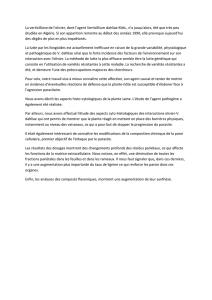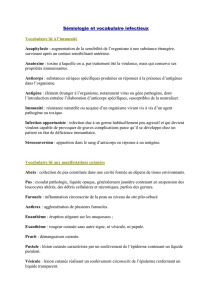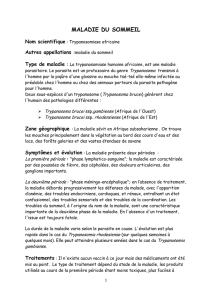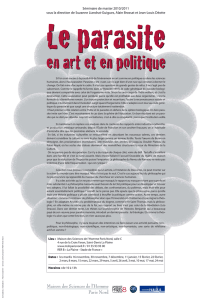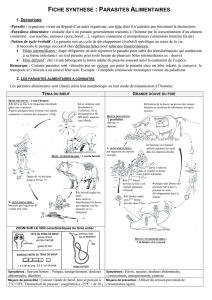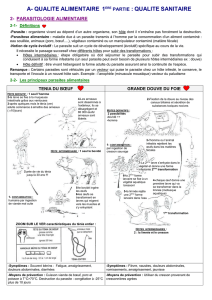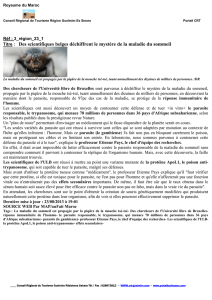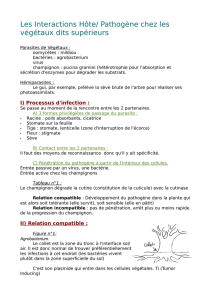Chapitre 12

1
Chapitre 12
Autoévaluation
Questions à court développement
1. La figure ci-dessous résume le cycle vital de la douve du foie Clonorchis sinensis.
a) Nommez l'hôte intermédiaire (ou les hôtes s'il y en a plus d'un).
b) Nommez l'hôte définitif (ou les hôtes s'il y en a plus d'un).
c) À quel embranchement et à quelle classe cette douve appartient-elle ?
d) Pourquoi les Canadiens et les Canadiennes ne risquent-ils pas de contracter cette
douve du foie ?
a) L’escargot et le poisson
b) L’humain
c) À l’embranchement des Plathelminthes et à la classe des Trématodes.
d) La douve du foie, Clonorchis sinensis, est d'origine asiatique ; on la diagnostique chez les
immigrants aux États-Unis et au Canada mais elle n'y est pas transmissible parce que les
escargots aquatiques qui servent d’hôtes intermédiaires n’existent pas dans ces pays. Dans

2
le cas de Paragonimus westermani, la douve pulmonaire, les hôtes intermédiaires de ce
parasite se rencontrent partout dans le monde, y compris aux États-Unis et au Canada ;
elle est donc transmissible.
2. La taille de la cellule est limitée par le rapport entre sa surface et son volume ; en
d’autres termes, si le volume devient trop grand, la chaleur interne ne se dissipe pas, et
les nutriments et les déchets ne peuvent pas être transportés efficacement. Comment les
protistes fongiformes plasmodiaux parviennent-ils à contourner cette difficulté ?
Le problème est réglé grâce à un mécanisme de transport interne appelé cyclose qui permet au
cytoplasme de circuler à l’intérieur de la cellule et de changer à la fois la direction et la vitesse
du mouvement cytoplasmique. Bien que le plasmode des protistes fongiformes présente un
grand volume, la chaleur interne peut se dissiper et les nutriments et les déchets peuvent être
transportés efficacement grâce au mécanisme de la cyclose.
3. Trypanosoma brucei gambiense (figure a) est le germe causal de la maladie du
sommeil ; il sévit en Afrique.
a) À quel groupe de flagellé appartient-il ? Comment sa morphologie est-elle adaptée à
son environnement ?
b) La figure b résume le cycle vital de T. b. gambiense. Nommez l'hôte et le vecteur de
ce parasite.
c) Comment le parasite se transmet-il ?

3
a) Trypanosoma brucei gambiense est un protozoaire de l’embranchement des Euglenozoa ;
c’est un hémoflagellé. Pour survivre dans le sang, un liquide visqueux, les hémoflagellés sont
dotés d'un corps long et mince, et d'une membrane ondulante (qui est une membrane bordée
d'un flagelle).
b) L’humain est l’hôte ; le vecteur est la mouche tsé-tsé.
c) Après s'être introduit dans l'insecte, le trypanosome se multiplie rapidement par scissiparité.
S'il arrive que l'insecte défèque pendant qu'il pique un humain, les trypanosomes libérés
peuvent contaminer la piqûre.
4. De jeunes amis à vous préparent un voyage en Afrique. Ils sont d’ores et déjà invités à
un méchoui. Quelle recommandation leur feriez-vous ?
Un méchoui est un repas où un animal tel qu’un mouton est mis à rôtir sur de la braise. La
viande à l’intérieur est parfois insuffisamment cuite et peut contenir des cysticerques de ténias
qui survivent. Il faut s’assurer de manger de la viande très bien cuite, ou s’en abstenir.
Applications cliniques

4
1. Émilie, 4 ans, va à la garderie. Depuis quelques jours, elle est irritable, fatiguée et a
perdu l’appétit. La nuit dernière, Émilie s’est réveillée en pleurant ; son anus la
démange et elle se gratte sans soulagement. Sa mère découvre des petits vers blancs à
peine plus gros qu’un cil. À la clinique, on donne à la mère un tube de prélèvement dans
lequel elle trouve une languette munie d’un papier gommé. Durant la nuit, elle applique
la languette gommée sur l’anus de la petite fille. Au laboratoire, l’examen révèle la
présence d’œufs. On prescrit à Émilie un médicament antiparasitaire, le pamoate de
pyrantel (Combantrin MD) ; tous les membres de sa famille doivent en prendre
également.
Quel est l’agent pathogène le plus probable ? Expliquez pourquoi le prélèvement
doit être effectué la nuit, en appuyant votre argumentation sur le cycle vital de cet agent
pathogène. Comment la contamination d’Émilie s’est-elle produite ? celle des membres
de sa famille ?
L’agent pathogène est probablement Enterobius vermicularis. En effet, ce petit ver de la
grosseur d’un cil se manifeste la nuit sur l’anus d’un enfant, et on soigne l’infection à l’aide
d’un antiparasitaire tel que le pamoate de pyrantel.
Les vers femelles et mâles résident dans le côlon à la hauteur du cæcum. La nuit,
lorsque la température corporelle est plus basse, les vers femelles se déplacent dans le côlon et
vont pondre leurs œufs dans la région de l’anus, ce qui cause la démangeaison. Il faut donc
effectuer le prélèvement au moment où l’activité de ponte des vers femelles est optimale, soit
durant la nuit.
Émilie s’est contaminée à la garderie, probablement en touchant des objets contaminés
par d’autres enfants et en portant ensuite les doigts à sa bouche. Les œufs ingérés se sont
développés dans son système digestif et, en bout de ligne, les vers femelles ont pondu leurs
œufs près de son anus. L’activité des vers a entraîné la démangeaison. Lors du grattage, les
œufs se sont logés sous les ongles de l’enfant, d’où l’autoinfestation.
Émilie a certainement touché les mains des membres de sa famille ou des objets d’usage
familial tels que des ustensiles, des jouets, de la literie, etc. ; les œufs déposés sur les objets de
la maison sont entrés en contact avec les mains des membres de la famille, d’où la
contamination de l’ensemble de la famille.

5
2. Un homme travaille dans un ranch dans une région semi-désertique de la Californie. Il
présente les signes et symptômes suivants : température subfébrile, douleur thoracique,
toux et perte de poids. La radiographie montre une infiltration pulmonaire. Un examen
microscopique des expectorations du patient révèle la présence de sphérules, petites
structures contenant des spores. La culture des expectorations fait apparaître des
mycéliums et des arthroconidies. (Indice : voir le chapitre 24.)
Quel organisme est la cause probable de ces symptômes ? Énumérez les éléments
qui vous ont mis sur la piste de l’agent pathogène. Comment cette maladie est-elle
transmise ? Quelle précaution doit prendre le personnel de laboratoire lors de la
manipulation des prélèvements ?
L’agent pathogène est un mycète appelé Coccidioides immitis.
C’est la présence de mycéliums dans la culture qui permet de déterminer que l’agent
pathogène est un mycète. La douleur thoracique et l’infiltration pulmonaire indiquent qu’il
s’agit d’une mycose respiratoire. C’est aussi un mycète qui produit des arthroconidies dans
une culture et des sphérules dans les tissus ; le fait que le patient travaille sur un ranch dans
une région semi-désertique de la Californie laisse penser que la contamination s’est produite
par inhalation des arthroconidies présentes dans la poussière. On sait que la poussière du sol
dans cette région est contaminée par le mycète Coccidioides immitis. Les symptômes
correspondent à ceux causés par cet agent pathogène (température subfébrile, myalgie et
toux).
La transmission se fait par inhalation des conidies.
Le personnel de laboratoire doit veiller à ne pas inhaler d'aérosols infectieux provenant
des prélèvements.
3. Un homme d’affaires a séjourné une semaine en Afrique rurale subsaharienne. Il se
plaint de fièvre rémittente qui survient à des intervalles de 2 jours, de frissons et de
maux de tête. Un frottis épais de sang révèle des parasites en forme d’anneaux dans ses
érythrocytes. Il est traité, avec succès, à la primaquine et à la chloroquine. (Indice : voir
le chapitre 23.)
Quel type de parasite est en cause ici ? De quelle maladie s'agit-il ? Expliquez en
quoi sa maladie est liée à son voyage.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%