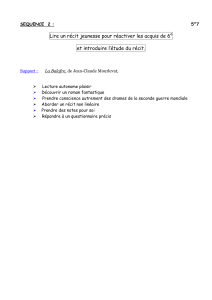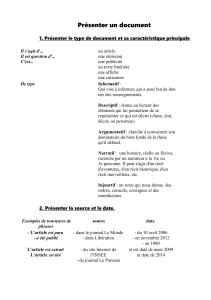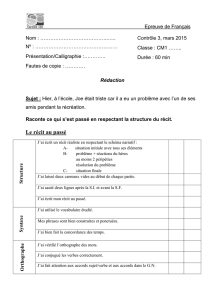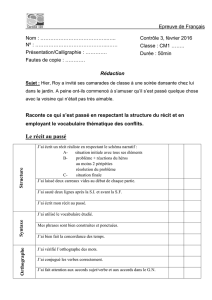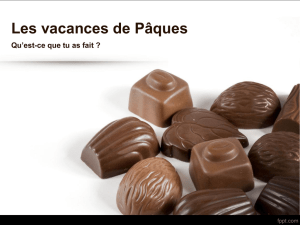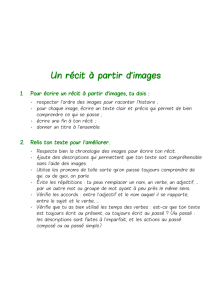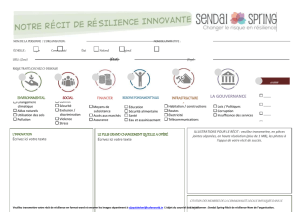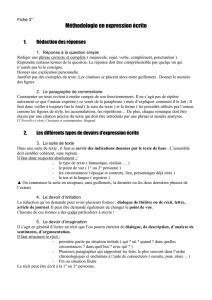Deleplace Le Récit comme acces a la connaissance

LE RÉCIT COMME ACCÈS À LA CONNAISSANCE HISTORIQUE
RÉFLEXIONS DIDACTIQUES SUR LE RÉCIT HISTORIQUE
Marc Deleplace
Maître de conférence en histoire contemporaine
EA 2616-CERHIC
Université de Reims Champagne-Ardenne
IUFM Champagne-Ardenne
Journée d’études Récit, savoir et société, Yves Reuter (EA 1764 THEODILE) université de Lille III.
Publié in Pratiques, 2007
À partir pour l’essentiel de l’exemple d’un récit d’événement, celui de la Révolution française, nous
nous proposons de suggérer quelques pistes de réflexion sur la place du récit dans la didactique de
l’histoire. Le récit a pu faire en lui-même l’objet d’une réflexion didactique (Audigier, 2000). Mais on
mesure également, et peut-être surtout, l’importance qu’il revêt pour l’enseignement de l’histoire par
la fréquence de son évocation dans des travaux dont il ne constitue pas le cœur. Il peut ainsi
intervenir dans le cadre d’une réflexion sur les apprentissages des élèves (Lautier 1997a). Il peut
trouver sa place dans une réflexion sur les pratiques de l’enseignement de l’histoire, soit dans une
perspective proprement didactique (Lautier, 1997b), soit dans une perspective autant historique que
didactique (Héry, 1999), voire épistémologique (Lautier, 1997a!; Bugajewski, 2000). Il peut enfin
relever de considérations sur l’enseignement de l’histoire et les débats qui le traversent (Laville, 2000!;
Garcia et Leduc, 2003). Quoi qu’il en soit de l’angle d’approche initial, chacun de ces travaux
souligne l’ambiguïté de la position du récit dans cet enseignement, à la fois fondateur et décrié,
alternativement suspecté d’enfermer l’enseignement de l’histoire dans une simple nomenclature de
faits, de noms, de dates, au détriment d’une véritable activité de connaissance, ou réaffirmé comme
un moyen d’accès privilégié à la connaissance historique.
Cette situation contradictoire du récit dans l’enseignement de l’histoire ne saurait se séparer, même si
elle obéit à sa logique propre, de la place qu’il occupe dans la constitution de l’histoire comme
discipline universitaire. C’est pourquoi nous opérerons un détour par le récit historique pour en
cerner succinctement les caractéristiques principales avant de revenir au récit déployé par les élèves à
propos de la notion de révolution, en fait le plus souvent la Révolution française, après un passage
par le récit didactique.
I- Quelques caractères du récit historique
Il ne s’agit ici pour nous que de souligner quelques caractères du texte historique ayant des
implications dans l’analyse didactique du récit dans l’enseignement de l’histoire et dans les
productions d’élèves.
1.1. Si comme l’écrit Paul Veyne (1971) l’histoire est avant tout un «!récit d’événements vrais!», le
récit historique doit pouvoir être soumis à une critique de vérification. Ce qui signifie que le texte
historique est un «!texte autorisé!» (Prost, 1996). Autorisation qui lui est extérieure et qui se manifeste
par les appels de notes renvoyant soit à des indications de sources soit à des références
historiographiques. Ce qui induit un deuxième caractère du texte historique.

Marc Deleplace Réflexions didactiques sur le récit en histoire 2
2
1.2. Le texte historique est un texte «!feuilleté!» (de Certeau, 1975!; Prost, 1996). La narration
historique déploie ainsi dans le même plan deux récits parallèles qui s’entrecroisent pour se renforcer
l’un l’autre!: le récit du témoin!; celui de l’historien. Le récit du témoin fonde en droit celui de
l’historien, mais il ne prend véritablement sens, n’acquiert la dignité d’un témoignage historique que
par le récit de l’historien qui enfin «!dit ce qui était déjà là et pourtant n’avait jamais été dit!»
(Foucault, 1969). Ainsi, si le texte de l’historien ne peut accéder au statut scientifique qu’autorisé par
la parole du témoin, c’est rétroactivement le récit de l’historien qui valide en dernière instance celui
du témoin (Prost, 1996). Cette double autorisation nécessaire se traduit par une structure narrative
particulière qui entrecroise deux discours. Mais cette procédure, pour maintenir la cohérence du
propos, exclut la parole divergente. Le témoin est cité en quelque sorte à décharge et non à charge.
L’irruption de sa parole ne peut rompre entièrement l’unité de la narration, troisième trait du récit
historique.
1.3. Le récit historique restitue une continuité narrative qui ignore les abîmes d’ignorance au-delà
desquels l’historien jette des ponts. Seules les notes infra-paginales peuvent rendre compte
incidemment du caractère fragmentaire de la connaissance historique. Le texte historique est ainsi un
«!texte plein!» (Prost, 1996). Cette continuité apparaît comme la condition qui rend possible le récit
historique, aussi bien celui de l’historien que celui du professeur d’histoire (Lautier, 1997a). Parce que
la continuité narrative est le support de la continuité logique d’un récit qui est tout autant un
discours, ce qui forme le dernier trait du récit historique.
1.4. Récit d’événement, le texte historique est aussi, voire d’abord, le récit de son sens. Jacques
Rancière (1992) a analysé les modalités de ce glissement du récit au discours (les catégories ainsi
mobilisées de «!récit!» et de «!discours!» renvoient à une distinction opérée par Émile Benvéniste,
1966), inauguré par Michelet, et qui fonde durablement la pratique narrative de l’historien. Le texte
historique remplit une double fonction!: raconter et expliquer (Prost, 1996). De cette dualité, le récit
historique, envisagé comme genre de discours, tire une organisation spécifique dans laquelle les
marqueurs chronologiques sont également des marqueurs logiques. Il déploie ainsi un régime de
causalité qui tend à devenir un régime de vérité.
La question pour nous est alors de saisir dans quelle mesure ces spécificités du récit-discours
historique influent sur la pratique de l’enseignement de l’histoire, c’est-à-dire de saisir les différents
niveaux d’implication du récit en didactique de l’histoire.
II- Place du récit dans les programmes et les manuels
2.1. Les programmes!: place du récit et forme de récit
2.1.1. Les programmes de l’enseignement secondaire français enregistrent la réhabilitation du récit en
lui assignant une place spécifique parmi les moyens pédagogiques mobilisables par le professeur. Le
récit est présent sous trois formes dans les programmes et leurs accompagnements.
Tout d’abord, et ce n’est certes pas là une nouveauté (Lavisse préconisait déjà en 1890 le recours au
document), le récit du témoin est convoqué non seulement pour illustrer le cours mais également
pour servir de support informatif en même temps qu’il donne lieu, comme tout autre forme de
document, à un travail méthodologique. La critique du document n’est-elle pas la pratique fondatrice
par excellence de l’historiographie!?
En second lieu, les accompagnements les plus récents visent à redonner au récit du professeur une
place qui lui avait été fortement contestée en même temps que la forme pédagogique à laquelle il se

Marc Deleplace Réflexions didactiques sur le récit en histoire 3
3
trouvait associé, celle du cours magistral (Héry, 1999!; Garcia et Leduc, 2003). Cette dignité retrouvée
se fonde sur une réévaluation de son efficacité en termes d’apprentissages. Nicole Lautier en situe
l’origine dans le courant cognitiviste qui avait lui-même contribué à discréditer le récit dans le champ
de la didactique!: «!J.!Bruner, pourtant lui-même psychologue cognitiviste, a en particulier montré
que la compréhension que les hommes se font des choses qui arrivent!- les actions des hommes,
ceux du présent comme ceux du passé!-, se fait par une sorte de prédisposition. L’auteur parle de
“disponibilité” naturelle, tout en soulignant que la banalité de ce naturel s’affirme par une immersion
dans une “culture”, un environnement social où toutes les actions humaines sont comprises par
imitation!» (Lautier, 1997b, 39). Une évolution qui rencontre la réflexion en épistémologie de
l’histoire!: «!Si l’on passe maintenant du côté des historiens, on peut reconnaître que l’écriture de
l’histoire!- quelles que soient son orientation, son style, sa forme!- appartient toujours au genre du
récit. Qu’il reconstruise les intentions et les justifications des acteurs ou qu’il s’intéresse aux
rencontres imprévues, aux forces ou aux causes matérielles, l’historien se livre, dans son travail
d’écriture à une mise en ordre, une “mise en intrigue”, qui intercale des événements dans une
situation particulière1!». De sorte que le récit y trouve une justification nouvelle comme moyen
pédagogique!: «!Le récit ne vaut pas seulement par l’intrigue qu’il raconte, il vaut également par sa
structure interne. En cela, il s’avère être un puissant mode de compréhension communément
partagée!» (Lautier, 1997b, 41).
Enfin, et c’est une nouveauté des programmes de 1995, le récit devient objet de connaissance en lui-
même, par le biais des «!documents!» dits patrimoniaux dont la liste est en partie fixée par les
programmes. Or, parmi ces «!documents!» patrimoniaux, figurent plusieurs récits (le mythe d’Osiris,
les poèmes homériques etc…) qui doivent donner lieu à une étude à la fois en histoire et en français.
2.1.2. Le récit s’insinue en plusieurs endroits des programmes et de leurs accompagnements. Cette
imprégnation, parfois discrète, parfois plus insistante, du récit renvoie le plus souvent au désir,
presque toujours maintenu en fait, si l’on songe au caractère «!exceptionnel!» des programmes de
1977 qui provoquèrent les réactions que l’on sait2 (Garcia et Leduc, 2003), de donner aux élèves des
«!repères!».
Le récit intervient tout d’abord dans un certain nombre de thèmes dont le traitement chronologique
interne peut laisser libre cours au récit d’événements, même s’il ne s’y résout jamais entièrement.
Ainsi en est-il des thèmes qui, de la Révolution française aux guerres mondiales, incluent une partie
plus ou moins longue sur les «!différentes phases!» de l’événement (CNDP, 1998).
Le récit s’inscrit aussi dans la volonté d’incarner l’histoire dans des figures représentatives. Certes, ce
ne sont plus ces figures «!lavissiennes!» constitutives du «!mythe national!» dont la mise en forme par
les programmes et l’enseignement primaires notamment aura marqué bien des générations, et contre
lequel des voix se sont par la suite élevées (Citron, 1987). Mais d’autres figures peuvent prendre le
relais, dont la présentation aux élèves induit le recours au récit, aussi concis soit-il. Ainsi pour la
Révolution française, pour nous en tenir à notre sujet principal, les programme de 4e, en 1985
comme en 1995, font-ils une part aux acteurs collectifs ou individuels dont la mise en scène suppose
le récit d’événement. L’entrée en scène du peuple de Paris lors de la prise de la Bastille, puis
l’évocation des groupes qui s’affrontent dans et hors de l’enceinte de la Convention nationale
(Girondins, Montagnards, Jacobins, sans-culottes), y est particulièrement propice. Mais le recours à
1 La notion de mise en intrigue renvoie de manière privilégiée aux travaux de Paul Ricoeur (1983-1985), essentiels
dans la réflexion sur le récit historique.
2 L’abandon d’une présentation strictement chronologique au profit d’une approche thématique, notamment en classe
de 6e, suscita alors un vif débat dont l’article publié par Alain Decaux sous le titre «!On n’enseigne plus l’histoire à
vos enfants!» en octobre 1979 marqua le point culminant. L’approche chronologique fut bientôt après rétablie.

Marc Deleplace Réflexions didactiques sur le récit en histoire 4
4
de courtes biographies, recommandé en 1985 comme en 1995, s’y prête également. Et ce d’autant
plus qu’il enregistre une évolution qui, de l’un à l’autre de ces programmes, rapproche la notice
biographique de la narration chronologique dans laquelle elle s’insère. Si l’individu est d’abord
rapporté à son appartenance sociale et générationnelle, ce qui limite le temps du récit à l’évocation de
ses années de formation (CNDP, 1989), son identification à un moment de l’événement, sa valeur
renouvelée de figure éponyme d’un temps fort de la période révolutionnaire, La Fayette et la
monarchie constitutionnelle, Robespierre et la Terreur, Napoléon et l’Empire, étend de fait la
légitimité du récit (CNDP, 1998).
2.1.3. Enfin, les programmes eux-mêmes dans leur structure générale peuvent se lire comme un vaste
récit de l’évolution de l’humanité. Telle était leur ambition d’origine, inscrite dans une organisation
chronologique qui ne répond pas seulement à une exposition évidente et «!naturelle!» mais répond à
une lecture «!évolutionniste!» de l’histoire. «!Le récit scolaire a pour fonction d’inscrire les jeunes
générations dans le grand récit collectif de la nation!» (Audigier, 2000, 128). Récit collectif à double
niveau en fait, et cela dès l’origine. D’une part, un niveau national qui instaure le devenir de la nation
française comme horizon de l’analyse historique, récit largement développé dans les collections
dirigées par Ernest Lavisse pour les différents niveaux d’enseignement. De l’autre, un récit collectif
plus large étendant cette perspective à l’humanité tout entière. Lavisse trace fermement cette
perspective universaliste dans les instructions de 1890!: «!Donner à l'écolier l'idée exacte des
civilisations successives et du progrès accompli au cours des siècles, et la connaissance précise de la
formation et du développement de la France ; lui montrer l'action du monde sur notre pays et de
notre pays sur le monde se servir de la comparaison avec l'étranger pour éclairer son jugement sur
nous-mêmes lui enseigner à rendre à tous les peuples la justice qui leur est due, élargir l'horizon de
son esprit, et à la fin, lui laisser avec la connaissance de l'état de son pays et de l'état du monde la
notion claire de ses devoirs de Français et de ses devoirs d'homme, telle est la part de l'enseignement
historique dans l'éducation.!» (Lavisse, 1890).
Certes, cette structure manifestée par l’exposé très chronologique de thèmes d’études essentiellement
factuels voire événementiels (le récit d’événements spécifiques redoublant le grand récit collectif)
tend à reculer au profit d’une approche plus problématisée. Ainsi du programme de troisième de
1995 qui substitue à l’étude des deux guerres mondiales et de l’entre-deux-guerres un thème intitulé
«!guerres, démocraties, totalitarismes!», et qui relègue au second plan le simple exposé chronologique.
Ainsi encore du programme de seconde articulé à partir de cinq thèmes sans continuité
chronologique (ce qui suscite des critiques qui pour être moins vives que celles provoquées par les
programmes de 1977, seuls à avoir rompus avec «!l’illusion chronologique!», n’en sont pas moins de
même nature), mais réunis sous une thématique générale de nature à restituer somme toute une
forme de continuité «!narrative!»!: les fondements du monde contemporain (BOEN, 2000). Chaque
thème peut ainsi être réinterprété comme une étape de cette fondation, fondation désormais
européenne plutôt que nationale, mais qui maintient en définitive l’inscription de l’élève dans le grand
récit collectif voulu déjà par Lavisse. Sans doute pourrait-on voir quelque abus de notre part à penser
en ces termes la résistance du «!grand récit collectif!», avec le risque de voir se diluer la notion même
de «!récit!» dans une extension indéfinie de son application. Mais peut-être voudra-t-on bien admettre
que l’idée sous-jacente d’une destinée commune, qui rend seule possible l’articulation des différents
thèmes de ce programme, de même qu’elle constituait «!l’horizon!» de l’historiographie scolaire de la
IIIe République naissante, oriente le regard vers une forme d’accomplissement de ces fondements
dans le monde actuel. Il y a là matière à concevoir une continuité narrative implicite qui relève bien
du genre du récit, plus strictement entendu.
Le changement le plus notable porte en revanche sur le grand récit collectif national qui, s’il subsiste
en partie, ne le fait que sous forme éclatée. Il ne constitue plus la trame essentielle des programmes,

Marc Deleplace Réflexions didactiques sur le récit en histoire 5
5
mais intervient plutôt comme l’un des exemples mobilisés pour soutenir un propos plus général,
souvent en concurrence avec d’autres (la France et les Etats-Unis comme exemples des difficultés
des démocraties dans l’entre-deux-guerres). On ne va plus, comme ce fut longtemps le cas, par un jeu
d’échelle à la fois géographique et historique, de la France vers le Monde, du local au mondial en
quelque sorte, mais au contraire du général au particulier, réinscrivant ainsi l’histoire de France dans
l’horizon plus large de l’histoire de l’humanité. Si «!l’ordre d’exposition des savoirs!», comme eût dit
Charles Seignobos3, a changé, le projet global ne nous paraît pas si différent, et surtout l’espèce
d’unité de sens ainsi maintenue dans l’exposition des savoirs nous paraît relever à nouveau de l’ordre
du récit. Malgré tout, les programmes conservent assez largement un caractère de «!méta-récit!», lors
même que le sens de ce récit s’est infléchi.
2.2. Les manuels!: le récit comme forme de la connaissance historique
2.2.1. Le récit comme forme (contestée) d’exposition des savoirs.
Les manuels scolaires ont fixé de longue date une forme spécifique de récit historique, très fortement
ancrée dans la pratique de l’historiographie française de la fin du XIXe siècle. Cette forme privilégie
l’exposé désincarné du savoir historique, renforcé par le caractère de discours d’autorité du récit
didactique. Mais elle présente, comme le discours historiographique, les mêmes caractères de récit-
discours, juxtaposant et entrelaçant narration descriptive, explication causale et généralisation
partielle.
La collection dite «!Malet-Isaac!», née d’une initiative d’Ernest Lavisse après la réforme des
programmes de 1902, lorsqu’il passa commande auprès d’Albert Malet d’un nouveau manuel
d’histoire pour les éditions Hachette, poursuivi après la mort de celui-ci sous la direction de son
collaborateur Jules Isaac sous le titre générique «!Nouveau cours d’histoire Malet-Isaac!», et
régulièrement réédité et mis à jour jusqu’en 1960, en présente l’archétype. Il propose un récit continu
qui, sous la forme d’une narration très «!classique!» (tant dans la forme que par le style de l’écriture),
instaure la continuité chronologique comme continuité logique. Ce qui contribue à produire une
histoire très linéaire, rythmée par des étapes incontournables mettant en scène une galerie de grandes
figures nationales et mondiales. Le récit-type pourrait bien être ici celui de la Révolution française.
N’est-il pas le récit d’une triple fondation, celle de la République, celle de son enseignement et celle
de son historiographie!? N’est-il pas encore le lieu d’élaboration du récit historique par excellence!?
Tel est en tout cas l’analyse développée, après d’autres, par Jacques Rancière (1992) à propos du récit
de la fête de la Fédération du 14 juillet 1790 par Michelet, fondateur de ce récit-discours qui constitue
proprement le récit historique et par suite le récit didactique4.
Le modèle de ce récit est donné pour longtemps par Albert Malet, dans le volume correspondant de
son cours d’histoire publié en 1908. Il reprend du reste, bien que nourri des apports les plus récents
de l’historiographie de son temps (Aulard et Mathiez notamment), avec une fidélité parfois
surprenante, le récit des événements entamé après le 14 juillet 1789 par le Moniteur universel (ce récit
s’étend, périodicité de la publication oblige, jusqu’à la fin du mois d’août dans les colonnes de ce
journal dont il occupe ainsi durablement la «!une!» si l’on peut risquer cet anachronisme). Jules Isaac
n’y apportera pas de modification sensible lors de la nouvelle édition du manuel à laquelle il préside
3 Seignobos,1898!: il s’agit de l’annexe I de l’ouvrage, dans laquelle l’auteur aborde les questions relatives à
l’enseignement secondaire, dans une perspective finalement fort «!didactique!».
4 Nous qualifions ainsi le récit des manuels pour le distinguer du produit de la recherche universitaire. Bien qu’ils
reposent tous deux sur la même structure, ils ne visent pas, ou pas toujours (le récit historique est largement
didactique dans son principe nous rappelle Antoine Prost, 1996), au même but, ne s’adressent pas au même public,
ne sont pas destinés au même usage.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%