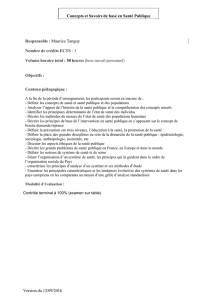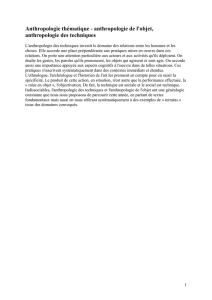Eléments d`épidémiologie bioanthropologique Alain FROMENT

Eléments d’épidémiologie bioanthropologique
L’anthropologie du vivant : objets et méthodes - 2010 29
Alain FROMENT
Dans l’Antiquité, les microbes étaient inconnus mais le rôle pathogène
de l’environnement était bien connu, comme en témoigne certaines
étymologies (« malaria » mauvais air, « paludisme » maladie du
marécage). L’école pastorienne, récusant la notion de génération
spontanée, a posé l’équation « un germe une maladie », et mis en
évidence l’importance du « terrain », c’est-à-dire des idiosyncrasies
individuelles. Avec la période moderne, cette notion est arrimée à la
découverte du polymorphisme génétique, mais aussi des « traits de
vie » personnels.
Au début du XXe siècle, l’anthropologie médicale, ou pathologique,
est considérée comme une branche de l’anthropologie physiologique,
et donc de la biologie pure. Cette anthropologie physiologique, après
l’ouvrage de synthèse de Damon (1975) a évolué vers des champs
spécialisés, comme l’adaptation à l’altitude ou, sujet plus négligé,
l’endocrinologie comparative. Dans un effort récent, l’anthropologie
biomédicale tente d’intégrer l’interaction entre facteurs biologiques
et sociaux. Autrefois réunies, les deux Anthropologies, biologique et
culturelle, forment à présent deux entités. Pourtant, dans l’espèce
humaine, toute maladie, qu’elle soit infectieuse ou non, a son
«histoire naturelle», c’est-à-dire un agent, une écologie, un terrain, et
un cursus, mais aussi son «histoire sociale», c’est-à-dire le contexte
sociologique et économique de son apparition, de sa transmission
et de son devenir. Il s’agit donc d’un processus bioculturel toujours
complexe et systémique (Froment et al. 2007).
C’est en ce sens que, selon l’angle choisi, on peut parler de deux
anthropologies médicales, l’une relevant de l’emboîtement de champs
appartenant surtout à l’Anthropologie culturelle : Ethnosciences >
Ethnobiologie > Ethnomédecine + Ethnopharmacologie (Guerci,
Conigliere 2003). Dans ce domaine, les anthropologues de la
santé peuvent expliciter leur démarche sans faire appel à la
biologie (Fainzang 2001). L’autre acception de l’Anthropologie
épidémiologique est du domaine de l’Anthropologie biologique :
Ecologie humaine > Ecomédecine > Anthropo-épidémiologie.
L’épidémiologie bioanthropologique a pour mission d’intégrer ces
deux démarches.
Si l’anthropologie biologique a indiscutablement une dette envers la
médecine, puisque depuis ses origines, que ce soit en France ou à
l’étranger, elle a été créée et animée par des médecins, la réciproque
n’est, curieusement, pas vraie : la bioanthropologie n’a en effet, pendant
le siècle et demi qui a suivi sa fondation, guère contribué à la médecine.
C’est seulement depuis les années 1990 que, sous le nom de médecine
darwinienne, s’esquisse une synthèse avec les acquis de l’évolution
humaine (Williams, Nesse 1996 ; Stearns, Koella 2008, McKenna
et al. 2008; O’Higgins, Elton 2008). A la différence de la médecine
classique, la médecine darwinienne s’intéresse au « pourquoi » et
non au « comment » de la maladie et raisonne au niveau de l’espèce
davantage qu’à celui de l’individu. Car si la maladie procède avant tout
du « colloque singulier », d’un problème individuel, la médecine n’a
pas érigé en système cette réexion sur la nature de la maladie en la
portant au niveau de l’espèce humaine toute entière, en tant qu’entité
zoologique, ni en terme de populations. Il faut pour cela s’éloigner
de la recherche d’une causalité immédiate, pour se placer dans une
perspective évolutive, notamment en termes d’adaptations (et de
mal-adaptations) et de compromis (trade-offs).
C’est en parasitologie et en infectiologie que le recours au
darwinisme a d’abord abouti à la notion de coévolution entre
hôte et pathogènes (Ewald 1996). Et l’épidémiologie, qui ne se
limite évidemment pas à l’étude des maladies transmissibles, a
de grands bénéces à tirer de cette perspective évolutionniste,
en intégrant les problématiques de l’anthropobiologie, comme la
notion de diversité génétique, et les outils de l’éco-anthropologie,
basée sur l’approche holistique, les réseaux, la causalité non-
linéaire, pour interpréter les interactions entre l’environnement
pathogène et le corps, tant biologique que social (Benoist
1968).
Mots-clés : médecine darwinienne, anthropologie biomédicale, épidémiologie
Problématique
Les anthropologies épidémiologiques

Eléments d’épidémiologie bioanthropologique
L’anthropologie du vivant : objets et méthodes - 2010 30
bases culturelles appropriées. Il faut en particulier admettre que les
attitudes et comportements sont gouvernés par une part d’arbitraire
qui échappe à la rationalité (Garine 1990).
* L’introduction de la pensée écologique dans la réexion médicale,
spécialement dans le domaine de la santé publique (McElroy,
Townsend 1985) : l’approche écologique est systémique et
entreprend de décrire, analyser et comparer les interactions existant
dans les différents milieux, compte- tenu des contraintes spéciques
de chaque milieu. Elle est modélisable et se fait aussi bien au
niveau macro que micro-écologique. La pertinence des concepts de
pathocénose (Grmek, 1983 : ensemble des maladies s’inuençant
réciproquement, dans un milieu et une population donnés), de son
corollaire la parasitocénose, et de méta-population (Grenfell,Harwood
1997), doit être mise à l’épreuve des faits. Cette démarche implique
une étude épidémiologique ne des différents groupes humains, en
fonction de leurs activités, de leur rapport à l’environnement, et des
réseaux d’échanges économiques dans lesquels ils sont insérés.
Concepts de l’épidémiologie
L’épidémiologie, tant descriptive qu’analytique, a besoin d’indicateurs,
tels que la prévalence (nombre de cas au sein de la population) et
l’incidence (nombre de cas/habitants/ unité de temps, un élément qui
traduit mieux l’évolution d’un processus pathologique). En épidémiologie
anthropologique on incorpore à ces indicateurs les caractères
anthropologiques biologiques (démiques) et culturels (ethniques) an
d’aboutir à des modélisations plus réalistes qu’avec l’épidémiologie
médicale classique.
Dans une perspective historique et anthropologique, c’est toute
l’épidémiologie de l’hominisation) qui est passée en revue, les
transitions démographique, culturelle, alimentaire, épidémiologique,
déclinant un véritable phénomène d’auto-domestication. Un des enjeux
est de tester la résilience des sociétés au changement. Depuis Charles
Nicolle (1932) on sait que les maladies infectieuses apparaissent et
disparaissent spontanément.
Sous le terme d’éco-anthropologie, nous entendons un processus
selon lequel l’enquête médicale est englobée dans une démarche
intégrative combinant l’anthropologie biologique (la diversité et la
microévolution dans l’espèce humaine), qui sert de socle, mais
aussi l’anthropologie culturelle, et la pensée écologique de type
systémique.
* La composante culturelle : dans les travaux épidémiologiques
traditionnels, les relations entre l’homme et le milieu ne sont
souvent analysées qu’en termes d’interactions physiques (Gillett
1985). Ainsi, l’exposition à la malnutrition, aux eaux contaminées
ou aux piqûres d’insectes, est bien sûr fonction des ressources
alimentaires ou des exigences écologiques des pathogènes,
mais elle dépend aussi d’un facteur de vulnérabilité lié à
l’occupation de l’espace, au type d’activité, au sexe, à l’âge, etc.
Or la connaissance de ces facteurs de comportements, dans
leur temporalité et dans leur spatialité, est indispensable, non
seulement pour comprendre la répartition des pathologies,
mais surtout pour asseoir les stratégies de lutte sur des
Conclusion
L’anthropologie biologique et la médecine ont un passé et un futur
communs. Le poids des diverses maladies qui affectent l’organisme,
qu’elles soient issues de l’environnement ou des pratiques socio-
culturelles, constitue une force de sélection majeure dans la genèse
de la diversité humaine. Depuis quelques années la médecine
darwinienne d’une part, l’anthropologie biomédicale de l’autre,
bâtissent un outil interdisciplinaire pour expliquer le pourquoi et le
comment de la maladie. Au sein de ce cadre conceptuel, l’épidémiologie
anthropologique développe deux notions prometteuses, celle de
pathocénose et celle de transition épidémiologique.
Ce que l’on pourrait nommer l’écomédecine procède d’une approche
globale, qui considère non plus «la» maladie, mais l’Homme, dans son
environnement, avec toutes «ses» maladies, considérées comme un
ensemble, et bien sûr, sa culture. L’interrogation spécique portera sur

Eléments d’épidémiologie bioanthropologique
L’anthropologie du vivant : objets et méthodes - 2010
les conséquences sanitaires des changements récents dans les rapports
Homme-milieu, sous l’inuence de ce que l’on appelle globalement la
«modernisation», c’est-à-dire les transitions que vivent la plupart des
sociétés rurales (Wirsing, 1985 ; Swedlund, Armelagos 1990).
Au total, l’évolution des systèmes de production, la transformation des
paysages, et leurs conséquences sanitaires seront traitées dans la
perspective de l’écologie humaine, c’est-à-dire de l’analyse des processus
bio-culturels de la relation homme-milieu (Hens et al. 1998). C’est
la double notion de plasticité et d’adaptitude (aptitude à l’adaptation),
par rapport à l’environnement, et de variabilité (dans le temps et dans
l’espace, intra et inter-populationnelle), qui trace le cadre de la diversité
humaine, laquelle servira de base à une analyse comparative.
31
Références bibliographiques
BENOIST (J.) 1968. Esquisse d’une biologie de l’homme social.
Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 59 p.
DAMON (A.) (ed.) 1975, Physiological Anthropology. Oxford University
Press, Oxford.
EWALD (P. W.) 1996, Evolution of Infectious Disease. Oxford
University Press, Oxford.
FAINZANG (S.) 2001, L’anthropologie médicale dans les sociétés
occidentales. Récents développements et nouvelles problématiques.
Sciences Sociales et Santé, 19 : 5-28.
FROMENT (A.), BLEY (D.), ENEL (C.) 2007, Anthropologie
épidémiologique: la dimension médicale de l’écologie humaine. In:
Guihard-Costa A.M., Boetsch G., Froment A., Guerci A. & Robert-
Lamblin J. (éds), L’anthropobiologie des populations vivantes,
état des lieux. Editions CNRS, Paris, p. 69-82.
GARINE (I. De) 1990, Adaptation biologique et bien-être psycho-
culturel. Bull. Mém. Soc. Anthrop. Paris, ns, 2: 151-173.
GILLETT (J.D.) 1985, The behaviour of Homo sapiens, the
forgotten factor in the transmission of tropical disease. Trans.
Roy. Soc. Trop. Med. Hyg., 79: 12-20.
GRENFELL (B.), HARWOOD (J.) 1997, (Meta)population
dynamics of infectious disease. Trend in Ecol. and Evol., 12:
395-399.
GRMEK M. (1983) Les maladies à l’aube de la civilisation occidentale.
Payot, Paris.
GUERCI (A.), CONSIGLIERE (S.) 2003, Anthropologie médicale, In:
Ch. Susanne, B. Chiarelli & E. Rebato (directeurs), Sur les Traces de
la Biologie Humaine. Les Fondements de l’Anthropologie Biologique.
De Boeck, Bruxelles, p. 625-630.
HENS (L.), BORDEN (R.J.), SUZUKI (S.), CARAVELLO (G.) 1998,
Research in Human Ecology : an interdisciplinary overview. VUB
University Press, Bruxelles.
McELROY (A.), TOWNSEND (P.K.) 1985, Medical Anthropology in
Ecological Perspective. Westview Press, Boulder.
McKENNA (J.J.), TREVATHAN (W.), SMITH (E. O.) 2008, Evolutionary
medicine and health: new perspectives. Oxford University Press,
Oxford.
NICOLLE (Ch.) 1932, Destin des maladies Infectieuses. Paris, Assoc.
des Anciens Elèves de l’Institut Pasteur, réed. 1993.
O’HIGGINS (P.), ELTON (S.) 2008, Medicine and Evolution: Current
Applications, Future Prospects. Society for the Study of Human
Biology Symposium Series, CRC, Boca Raton.
STEARNS (S.C.), KOELLA (J.K.) 2008, Evolution in health and
disease. Oxford University Press, Oxford.
SWEDLUND (A.C.), ARMELAGOS G.J. (éds) (1990) Disease in
Populations in Transition. Anthropological and Epidemiological
Perspectives. New York, Bergin & Garvey.
WILLIAMS (G.), NESSE (R. M.) 1996, Why we get sick: the new
science of Darwinian medicine. Vintage Books, New York.
WIRSING (R.) 1985, The health of traditional societies and the effects
of acculturation. Current Anthropology 26: 303-322.
Alain FROMENT
Directeur de recherche à l’IRD
- UMR 208 «patrimoines locaux (Paris, France)
IRD et MNHN
courriel : [email protected]
L’auteur
1
/
3
100%