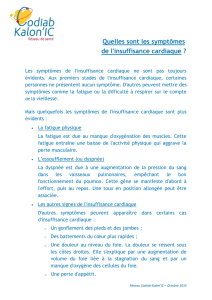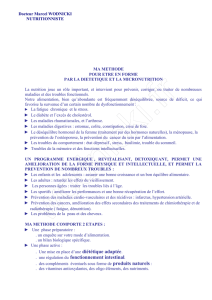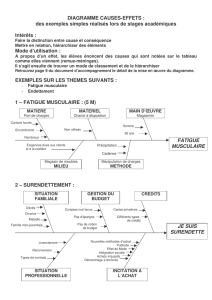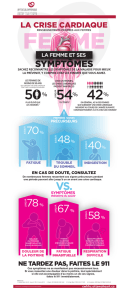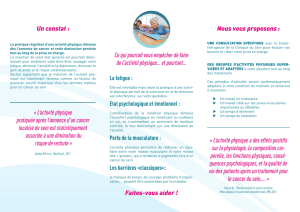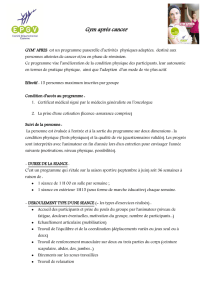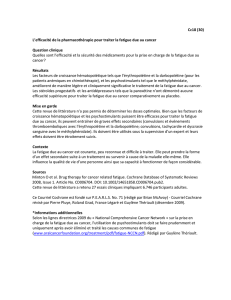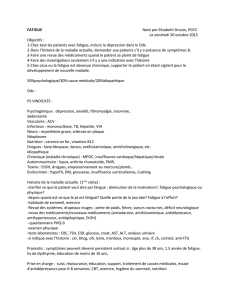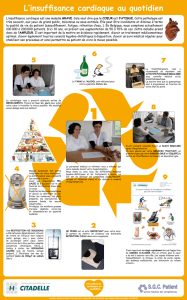5e Congrès International de Rééducation dans les

30 MAI AU 1er JUIN 2008
SAVOIR ET COMPRENDRE
Marseille
5e Congrès
International
de Rééducation
dans
les Maladies
Neuromusculaires
©
AFM
COMPTE RENDU FLASH

SAVOIR ET COMPRENDRE COMPTE RENDU FLASH
2
Environ trois cents participants, médecins, chercheurs et paramédicaux se sont rassemblés à
Marseille, du 30 mai au 1er juin 2008, pour le 5e Congrès International de Rééducation dans les
Maladies Neuromusculaires.
L’originalité de cette 5e édition était le partage du programme de la première journée de congrès
avec Myologie 2008 (Congrès International des experts en myologie organisé par l’AFM).
L’objectif de cette interaction était d’offrir l’opportunité aux différents professionnels concernés
d’échanger leurs avis sur les différentes échelles d’évaluation nécessaires à la réalisation des
études cliniques. En effet, à l’heure où de nouvelles thérapeutiques émergent, il devient primor-
dial de mettre au point des méthodes d’évaluation objectives, fiables, reproductibles et validées
pour les essais chez les patients.
Parmi les thèmes abordés lors des deux journées suivantes, la fatigue et la douleur chez les
patients atteints de maladies neuromusculaires ont été mis en exergue au cours de sessions
dédiées. Trop souvent négligée, la fatigue est parfois le premier, voire le seul symptôme de la
maladie neuromusculaire. Sentiment subjectif la rendant difficile à appréhender, toute fatigue
est, au demeurant, réelle et repose sur des bases physiologiques de mieux en mieux connues.
Si les tableaux cliniques classiques des principales maladies neuromusculaires n’incluent pas
les douleurs, celles-ci sont une plainte fréquente exprimée par les patients. Elles nécessitent
une prise en charge adaptée : thérapeutiques non médicamenteuses en première intention,
traitement médicamenteux si besoin.
Un état des lieux des échelles fonctionnelles et autres
méthodes d’évaluation de la fonction motrice et de la
force musculaire dans les maladies neuromusculaires
(MNM) a été fait. Certaines mesures incluent de nombreu-
ses capacités et semblent plus adaptées aux essais sur le
long terme. D’autres échelles sont plus spécifiques à une
maladie en particulier et plus adaptées à des essais sur un
terme plus court dans une population sélectionnée.
Des méthodes existantes peuvent être appliquées dans
les essais sur la dystrophie musculaire de Duchenne et
dans l’amyotrophie spinale mais de nouveaux développe-
ments peuvent être apportés.
MFM : une échelle adaptée à la plupart
des maladies neuromusculaires
La Mesure de la Fonction Motrice (MFM), échelle validée,
comporte 32 items distribués selon 3 dimensions indé-
pendantes : station debout et transfert (D1), motricité axia-
le et proximale (D2) et motricité distale (D3). Les capacités
fonctionnelles des patients, sans aucune aide ni orthèses,
sont notées de 0 à 3 (échelle de Likkert). La notation 0
correspond à l’impossibilité d’initier un mouvement ou de
maintenir la position de départ. L’initiation ou la réalisa-
tion incomplète de l’action à effectuer est cotée 1. Pour
une action effectuée complètement mais en utilisant des
stratégies compensatoires ou réalisée très lentement ou
encore avec une maladresse évidente, la note est égale
à 2. Enfin, la notation 3 est acquise si l’action est tota-
lement et normalement effectuée ou si elle est effectuée
selon un schéma standard.
Chacun des 32 items (actions à effectuer par le patient)
est décrit avec précision dans un manuel de l’utilisateur et
le score (basé sur les 4 notations) y est également détaillé.
Le manuel de l’utilisateur peut se télécharger gratuitement
depuis le site internet www.mfm-nmd.org (en français,
anglais, espagnol). La durée moyenne de l’évaluation glo-
bale de la fonction motrice est de 36 minutes, l’expérience
de l’investigateur étant déterminante.
Une formation est donc indispensable pour se familiariser
à l’utilisation de la MFM, elle peut être validée en partici-
pant à une journée de formation avec support vidéo. Ces
Les outils d’évaluation

3
5e Congrès International de Rééducation
dans les Maladies Neuromusculaires
Marseille - 30 mai au 1er juin 2008
sessions de formation, ouvertes aux kinésithérapeutes et
aux médecins, sont aussi proposées aux ergothérapeutes
et psychomotriciens.
La MFM est adaptée à la plupart des maladies neuromus-
culaires, tant pour la clinique que pour la recherche. Selon
les déficiences motrices prédominantes, il est possible
d’explorer une, deux ou trois dimensions. Dans la dystro-
phie musculaire de Duchenne, la MFM permet de don-
ner une valeur prédictive de la perte de la marche (exem-
ple : si D1 = 50% et le score total = 75%, prédiction de la
perte de la marche sous un an) et d’évaluer les effets des
corticoïdes.
Une version brève ne comportant que 20 items, adaptée
aux enfants de moins de 7 ans, est en cours de validation.
Par ailleurs, la banque de données MFM recueille, de
façon anonyme, les résultats des MFM passées chez tout
patient, enfant ou adulte, présentant une maladie neuro-
musculaire identifiée ou suspectée. Accessible aux diffé-
rents centres d’évaluation, elle permet notamment d’obte-
nir des courbes individuelles d’évolution MFM, pour suivre
chaque patient et adapter les thérapeutiques.
CHOP INTEND et NSAA :
des échelles spécifiques
Des échelles d’évaluation motrice existent pour les enfants
atteints d’amyotrophie spinale de type 1, notamment
le Test of Infant Motor Performance (TIMP) ou le CHOP
TOSS (Test of Strength in SMA). Mais aucune de ces
échelles n’est pertinente chez les tout-petits.
CHOP INTEND (Infant test for neuromuscular disorder),
une nouvelle échelle a été mise au point. Fiable, sensible
et bien tolérée, elle est adaptée aux très jeunes enfants
atteints d’une maladie neuromusculaire comme l’amyotro-
phie spinale. Issue du CHOP TOSS auquel ont été ajoutés
4 items du TIMP, elle comporte 2 items observationnels et
14 tests provoqués concernant le cou, le torse, les mem-
bres distaux et proximaux.
Ces tests durent environ 10 minutes. Chaque item pos-
sède un score allant de 0 à 4. Une vidéo d’entraînement
est désormais disponible et la validation de l’échelle est
en cours.
L’échelle North Star Ambulatory assessment (NSAA)
est un outil d’évaluation destiné aux enfants atteints de
dystrophie musculaire de Duchenne ayant conservé la
marche.
Développée à partir de l’échelle d’évaluation des capa-
cités motrices Hammersmith (Hammersmith motor abi-
lity score), elle donne une évaluation globale de la capa-
cité ambulatoire intégrant plusieurs activités (capacité à
se relever du sol, à marcher…). Fiable, pratique et rapi-
de (effectuée en environ 10 minutes), la NSAA est utilisée
dans 20 centres du Royaume-Uni et 200 patients sont
enregistrés dans une base de données spécifique.
Mesure de la qualité de vie :
une auto-évaluation
La mesure de qualité de vie (QdV) est importante pour
évaluer l’efficacité de la réadaptation dans les maladies
neuromusculaires.
Deux principes permettent d’appréhender le terme QdV
d’une part, faut-il réaliser son rêve pour connaître une
expérience de vie positive ? (perception entre espérance
et réalisation) et d’autre part, est-il nécessaire de satisfaire
à tous ses besoins, pour atteindre le bonheur ?
Temps clinique du positionnement :
le projet POSITI’F
Initié par l’AFM, le projet POSITI’F a pour but le développe-
ment, en France, d’un réseau dédié au « temps clinique du
positionnement » afin de favoriser la prise en compte des
besoins en positionnement des patients. Ce temps corres-
pond à l’investissement d’une équipe (médecin de médecine
physique et de réadaptation et au moins un ergothérapeute
ou un kinésithérapeute) spécialisée dans l’installation postu-
rale en fauteuil roulant.
En effet, l’installation posturale en fauteuil roulant est un pro-
cessus clinique visant à placer une personne ayant des trou-
bles posturaux dans une posture requise au moyen d’aide(s)
technique(s) à la posture. Les troubles posturaux ont une
incidence clinique, fonctionnelle et sur la qualité de vie de la
personne utilisatrice d’un fauteuil roulant. Il est donc impor-
tant de les prévenir, de les corriger ou de les compenser.
De ce fait, l’évaluation inclut une préconisation sur le
profil du fauteuil roulant afin d’optimiser l’interaction entre
les aides techniques à la postures (ATP) et les aides tech-
niques à la mobilité (ATM), notamment les fonctions de
positionnement offertes par le fauteuil roulant (bascule
d’assise, inclinaison du dossier, verticalisation…) en
tenant compte des habitudes de vie et des contraintes de
l’environnement.

SAVOIR ET COMPRENDRE COMPTE RENDU FLASH
4
ques, l’enregistrement de l’activité électromyographique.
L’utilisation d’un questionnaire prenant en compte la part
subjective (ou psychologique) de la fatigue accumulée au
quotidien complète l’investigation.
La fatigue subjective est une diminution ou une perte des
capacités (réversible, partiellement réversible ou non-
réversible) associée à un sentiment accablant d’épuise-
ment conduisant à l’incapacité ou à la difficulté à initier ou
à prolonger des activités même routinières.
La fatigue peut se développer en conséquence directe ou
à retardement d’une activité qui nécessite un effort plus ou
moins soutenu (fatigabilité/fatigue aiguë), ou indépendam-
ment comme un état primaire (fatigue chronique).
Il est donc important de baser les évaluations sur la per-
ception propre des patients quant à leur QdV. Cette mesu-
re subjective est à distinguer de l’état de santé objec-
tivé par les soignants. En effet, la perception de QdV
du malade n’est pas celle que le médecin s’en fait. Les
écarts importants entre la perception du médecin et celle
du malade rendent indispensables les mesures de QdV.
La mesure de la QdV doit être une auto-évaluation par
le patient et non une estimation en rapport avec la CIF
(Classification Internationale du Fonctionnement, du han-
dicap et de la santé) qui est une hétéro-évaluation. C’est
le malade qui « crée » son échelle et qui y répond, la CIF
pouvant être une référence initiale.
Des problèmes méthodologiques rendent les échelles
existantes de qualité de vie liée à la santé insuffisantes
comme mesure pour les essais cliniques et notamment la
recherche en réadaptation.
Le centre multidisciplinaire danois d’experts pour la
rééducation dans les maladies neuromusculaires
(RCfM) a multiplié les questionnaires de QdV.
L’utilisation d’un questionnaire adapté au handicap
chez 68 patients atteints de dystrophie musculaire
de Duchenne, âgés de 20 à 40 ans, sous ventilation a
montré que 83% d’entre eux estiment avoir un niveau de
qualité de vie élevé.
La fatigue est un des symptômes les plus mentionnés par
les patients atteints de maladie neuromusculaire. Son ori-
gine et les mécanismes responsables de son apparition
sont particulièrement diversifiés.
Au demeurant, cette plainte psychophysiologique doit
être évaluée et prise en compte afin d’adapter la prise en
charge.
Un symptôme
aux dimensions composites,
à prendre en compte
La fatigue peut-être aiguë (consécutive à un effort par
exemple) ou chronique.
L’augmentation de la pénibilité d’une tâche et la majora-
tion de la dépense énergétique associées à la perte de
force maximale ou à une moindre capacité à maintenir
un effort sous-maximal témoignent d’une fatigue aiguë.
Elle peut être inhérente à des mécanismes localisés à dif-
férents sites de l’axe sensitivo-moteur, depuis le cortex
jusqu’à l’appareil contractile musculaire. On distingue la
fatigue centrale, impliquant les étapes situées en amont
de la jonction neuromusculaire, de la fatigue périphérique,
même si ces deux types de fatigue sont interdépendan-
tes. L’installation de la fatigue aiguë est donc complexe et
souvent multiple.
La fatigue peut devenir chronique si des charges de tra-
vail excessives se reproduisent et que la récupération est
insuffisante.
La fatigue peut être appréhendée par l’évaluation de la
perte de capacité à produire de la force après un exercice
donné, par des mesures dynamométriques ou énergéti-
La fatigue
L’in-exsufflation chez l’enfant
La tolérance et l’efficacité de séances d’insufflations-exsuf-
flations par CoughAssist ont été étudiées (par une équipe
française) chez 17 enfants atteints de maladies neuromus-
culaires et présentant un état stable.
Une séance comprenait six cycles d’insufflation (2
secondes)-exsufflation (3 secondes), une période de repos
de 30 secondes intervenant entre chaque cycle. Des pres-
sions positives et négatives égales à 15, 30 et 40 cm d’H2O
ont été appliquées à chaque patient.
L’insufflation-exsufflation mécanique a été bien tolérée et
associée à une amélioration clinique chez tous les enfants
avec un état stable.

5
5e Congrès International de Rééducation
dans les Maladies Neuromusculaires
Marseille - 30 mai au 1er juin 2008
Fatigabilité musculaire :
le poids de l’invisible
La fatigue peut-être le premier et le seul symptôme de la
maladie neuromusculaire. Systématique ou fluctuante,
son apparition est corrélée à l’effort ou à un type d’effort.
Un dépistage précoce est nécessaire compte tenu des
conséquences : limitations imposées des activités, straté-
gies d’évitement, répercussions personnelles physiques et
psychologiques mais aussi sur l’entourage.
L’analyse des différentes dimensions de la fatigue conduit
à une meilleure estimation de l’ampleur de son retentisse-
ment chez les patients.
Dans sa dimension comportementale, elle génère des
moments de souffrance, une incapacité au travail et une
révision du projet professionnel, une limitation des sor-
ties et des loisirs ainsi qu’une restriction de la sexualité.
Sur le plan affectif, l’aveu de la fatigue, ressentie comme
déplaisante, destructive et négative, constitue un obsta-
cle entraînant une auto-marginalisation (refus des invita-
tions diverses) et à une marginalisation par l’entourage.
Il en résulte une angoisse de l’inconnu et une exclusion
progressive.
Au niveau sensoriel, les patients se plaignent de faiblesse,
de somnolence, d’une perte d’élan, d’une sensation de
vide et d’un manque d’énergie.
Enfin dans sa dimension cognitive, elle provoque des trou-
bles apparentés à la dyslexie, des pertes de mémoire et
une appréhension voire de la panique ainsi que des trou-
bles de l’humeur face à l’énergie dépensée pour un faible
résultat (impatience, irritabilité, dépression…).
Dystrophie myotonique de Steinert :
un symptôme à prendre en charge
L’étude des relations entre la somnolence diurne, la fati-
gue et la diminution de la motivation chez des patients
adultes atteints de dystrophie myotonique de Steinert
(DM1) montre que ces patients présentent des scores
élevés de fatigue, indépendants de la somnolence et du
handicap moteur. Il est donc important de discriminer
fatigue et somnolence apparaissant comme des variables
distinctes.
Sachant que 74% des patients atteints de DM1 présen-
tent une fatigue sévère associée à des atteintes fonction-
nelles, un protocole évaluant les intrications des compo-
santes neuropsychologiques et psychopathologiques a
été élaboré.
Les premiers résultats de cette étude, menée chez 30
sujets atteints de DM1 montrent que les plaintes principa-
les des patients sont : fatigue (33%), douleurs (23%), myo-
tonie (13%), perte de l’équilibre/chute (13%), marche limi-
tée (13%) et fatigue musculaire (10%). Une fatigue exces-
sive associée à des scores élevés concernant la dépres-
sion, l’anxiété et les troubles cognitifs est retrouvée dans
73% des cas.
La première étape de la prise en charge (PEC) évalue les
aspects physiologiques (problèmes respiratoires, endocri-
niens, troubles du sommeil ou anémie). La seconde éva-
lue la fatigue à l’aide d’outils spécifiques, les échelles les
plus utilisées dans la DM1 sont : CIS-Fatigue (Checklist
Individual Strengh), CFS (Chalder Fatigue Scale), FSS ou
KFSS (Fatigue Severity Scale).
Si des scores importants subsistent aux échelles de fati-
gue malgré la PEC des éventuels aspects physiologiques,
il peut s’avérer nécessaire de proposer une PEC psy-
cho-comportementale personnalisée. L’entretien avec le
patient permet d’évaluer son hygiène de vie et de don-
ner un sens aux symptômes de fatigue subjective, selon le
vécu et l’histoire du patient.
La PEC thérapeutique (traitement médicamenteux, prise
en charge émotionnelle) est aussi très importante. Si la
fatigue s’avère être le signe révélateur d’une dépression
VNI à domicile : évaluer le respirateur
Une évaluation sur banc d’essai pédiatrique systématique
est recommandée pour tous les respirateurs proposés pour
la ventilation à domicile d’un enfant atteint d’une maladie
neuromusculaire.
L’objectif est double : détecter tout dysfonctionnement
et guider le choix d’un respirateur approprié à un patient
donné.
En effet, une étude française a permis d’évaluer les carac-
téristiques des performances des 17 appareils disponibles
pour la ventilation non invasive (VNI) en pression positive, à
domicile, des enfants. Les respirateurs ont été testés sur un
banc d’essai simulant 6 profils de patients différents. Pour
chacun, les qualités du trigger inspiratoire et expiratoire
ainsi que la capacité à atteindre et maintenir les pressions
et volumes prédéfinis ont été mesurées.
Les performances des respirateurs se sont avérées très
variables et dépendantes du type de trigger (débit ou pres-
sion), du type de circuit et du profil du patient.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%