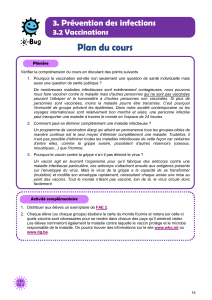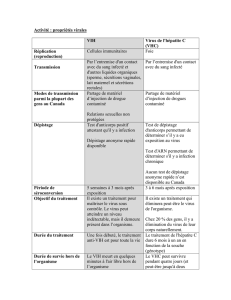artérite virale équine

990 Manuel terrestre de l’OIE 2008
CHAPITRE 2.5.10.
ARTÉRITE VIRALE ÉQUINE
RÉSUMÉ
L’artérite virale équine (AVE) est une maladie virale contagieuse des équidés causée par le virus de
l’artérite équine (VAE), virus à ARN classé dans la famille des Artériviridés. Actuellement, un seul
sérotype du virus de l’AVE a été identifié ; ce virus est présent dans les populations de chevaux de
nombreux pays dans le monde. Bien que peu fréquents dans le passé, le nombre de foyers du VAE
semble en augmentation.
La majeure partie des infections causées par le VAE est subclinique. Lorsqu’ils sont présents les
signes cliniques peuvent varier en forme et en sévérité. La maladie se caractérise principalement
par de la fièvre, de l’anorexie, un œdème variable plus particulièrement des membres, du scrotum
et du prépuce chez l’étalon, de la conjonctivite, une réaction cutanée de type urticariale, des
avortements et rarement par une pneumonie fulgurante, une entérite ou une pneumo-entérite chez
le poulain. En dehors de la mortalité chez les poulains le pourcentage de cas mortels dans un foyer
est très réduit. Les chevaux affectés par la maladie guérissent complètement dans la quasi-totalité
des cas. Un portage prolongé peut survenir chez nombre variable d’étalons infectés, mais ni chez
les juments, ni chez les hongres, ni chez les poulains sexuellement immatures.
Identification de l’agent pathogène : l’AVE ne peut être différenciée de nombreuses autres
maladies équines respiratoires ou systémiques. Le diagnostic de l’AVE repose sur l’isolement viral,
la détection de l’antigène viral ou de son acide nucléique, ou la mise en évidence d’anticorps
spécifiques. Les essais d’isolement viral doivent être effectués à partir d’échantillons appropriés
prélevés en fonction des signes cliniques ou post mortem et inoculés à des cultures cellulaires de
lapin, de cheval ou de rein de singe. L’identification des isolats de VAE doit être confirmée par une
épreuve de séroneutralisation virale, la technique de transcription inverse couplée à une réaction
d’amplification en chaîne par polymérase (RT-PCR) ou par des méthodes immunocytochimiques,
essentiellement l’immunofluorescence indirecte ou les techniques avidine-biotine-peroxydase
(ABP).
La détection et l’identification de l’acide nucléique du VAE dans les cas suspects peuvent aussi être
effectuées en ayant recours à la technique RT-PCR utilisant des amorces spécifiques de l’ARN viral
appropriées.
Lorsque la mortalité est associée à un cas suspect d’AVE, un échantillonnage large de tissus doit
être examiné en histologie pour recherche d’une panvasculite, particulièrement prononcée dans
toutes les petites artères. Les lésions vasculaires caractéristiques de l’adulte ne sont pas un
élément particulier des avortements dus au VAE. Dans ces cas, les antigènes de l’AVE peuvent
être visualisés par examen immunohistochimique du placenta ou de divers tissus fœtaux.
Épreuves sérologiques : une large variété d’épreuves, tels que la séroneutralisation (SN) la
fixation du complément (FC), l’immunofluorescence indirecte, l’immunodiffusion en gel, les
méthodes immuno-enzymatiques (ELISA) et l’épreuve des microbilles fluorescentes (MBF) a été
utilisée pour la détection des anticorps anti-VAE. Les épreuves les plus couramment utilisées sont
les épreuves de SN en présence de complément et les épreuves ELISA. L’épreuve de SN est une
épreuve très sensible et hautement spécifique dont la valeur a été démontrée dans le diagnostic
des infections aiguës et les études de séroprévalence. Plusieurs ELISAs ont été développés, mais
aucun d’entre eux n’a fait l’objet d’une validation comme ce fut le cas pour l’épreuve de SN bien
qu’ils semblent comparables en spécificité et qu’ils présentent une sensibilité presque identique. Le
test de FC est moins sensible, mais peut être utilisé comme moyen de diagnostic en cas d’infection
récente.

Chapitre 2.5.10. — Artérite virale équine
Manuel terrestre de l’OIE 2008 991
Spécifications applicables aux vaccins et aux produits biologiques à usage diagnostique :
deux vaccins commerciaux produits en culture cellulaire sont couramment disponibles contre l’AVE.
Le premier est un vaccin vivant atténué préparé à partir de virus atténué pour le cheval par de
multiples passages en série sur des cultures de cellules de première explantation de cheval et de
lapin. Il s’est révélé sans danger et protecteur pour les étalons et les juments non-gestantes. La
vaccination des poulains de moins de 6 semaines et des juments dans les deux derniers mois de
gestation est contre-indiquée. Il n’y a pas de preuve de reversions de virulence du virus utilisé dans
le vaccin suite à son utilisation sur le terrain depuis plus de 20 ans. Le second vaccin est un vaccin
inactivé adjuvé produit à partir d’un virus cultivé sur cultures cellulaires équines, pouvant être utilisé
pour les chevaux à la reproduction ou non. En l’absence de données suffisantes sur son innocuité
ce vaccin n’est pas recommandé chez les juments gestantes.
A. INTRODUCTION
L’artérite virale équine (AVE) est une maladie virale contagieuse des équidés causée par le virus de l’artérite
équine qui est un virus ARN de sens positif, simple brin et le prototype du genre Arterivirus, famille des
Arteriviridés de l’ordre des Nidovirus (10). La lymphangite épizootique « Pink Eye » (Œil rose), la fièvre typhoïde
et le rotlaufseuche sont quelques termes descriptifs utilisés dans le passé faisant référence à des maladies très
proches cliniquement de l’AVE. L’hôte naturel du VAE apparaît restreint aux équidés, bien que quelques
arguments laissent à penser que la maladie pourrait aussi toucher les camélidés du Nouveau Monde, comme les
alpagas et les lamas (63). Le virus ne représente pas un danger pour la santé humaine (59). Le virus de l’AVE est
présent dans la plupart des populations de chevaux dans le monde (59). L’incidence de l’AVE est en
augmentation depuis quelques années, augmentation qui a été associée à la fréquence accrue des mouvements
d’animaux et des transports de sperme (2, 59).
Bien que la majorité des cas d’AVE soient subcliniques certaines souches de virus peuvent entraîner une maladie
de gravité variable (59). Les cas typiques d’AVE peuvent présenter toutes les combinaisons des signes suivants :
fièvre, abattement, anorexie, leucopénie, œdème variable particulièrement des membres, du scrotum et du
prépuce chez l’étalon, conjonctivite, suppuration oculaire, œdème supra et péri-orbital, rhinite, jetage, réaction
cutanée urticariale générale ou locale, avortement, mortinatalité et de façon rare pneumonie fulgurante, entérite
ou pneumo-entérite chez les jeunes poulains. Quelle que soit la sévérité des signes cliniques, les chevaux
affectés récupèrent complètement de façon presque constante. La fréquence des cas mortels est très rare dans
les foyers d’AVE, la mortalité ne se rencontre généralement que sur les très jeunes poulains, notamment en cas
d’infection congénitale (37, 59, 62), et très rarement chez les chevaux adultes.
L’AVE ne peut être différenciée cliniquement de nombreuses autres maladies équines respiratoires ou
systémiques dont les plus fréquentes sont la grippe équine, les infections à herpes virus équin 1 et 4, les
infections par les rhino virus équins A et B, les infections à adénovirus équin et les infections streptococciques en
particulier le purpura hémorragique. La maladie a aussi quelques points communs avec l’anémie infectieuse, avec
des cas d’infection par les virus de Getah ou Hendra, avec les intoxications causées par l’Alysson blanchâtre
(Berteroa incana). Après contamination, le VAE se multiplie dans les macrophages et les monocytes circulants
(18) et est excrété dans diverses sécrétions ou excrétions des animaux faisant une infection aiguë, et notamment
en grande quantité à partir de l’appareil respiratoire (42)
Un pourcentage variable des étalons ayant fait une infection aiguë peuvent devenir ultérieurement des porteurs
chroniques du virus au niveau de l’appareil reproducteur et excréteur permanents par le sperme (59, 60). Le
portage dont il a été démontré qu’il était dépendant des hormones mâles, n’a été retrouvé que chez l’étalon mais
pas chez la jument, le cheval hongre ou le poulain prepubère (59). La preuve irréfutable de l’état de portage
chronique n’a été apportée que chez les étalons possédant des anticorps dirigés contre le virus de l’AVE (60).
Bien qu’une baisse temporaire du taux de testostérone dans le sang (soit par l’utilisation d’un antagoniste de la
GnRH ou par immunisation avec la GnRH) semble hâter la disparition de l’état de portage chronique chez
certains étalons, l’efficacité de l’une ou l’autre stratégie doit encore être pleinement vérifiée. Le risque que ces
approches thérapeutiques puissent être employées pour masquer délibérément l’état de portage soulève des
inquiétudes.

Chapitre 2.5.10. — Artérite virale équine
992 Manuel terrestre de l’OIE 2008
B. TECHNIQUES DE DIAGNOSTIC
1. Identification de l’agent pathogène
a) Isolement viral
En cas de suspicion d’un foyer d’AVE ou pour confirmation de cas subcliniques d’infection par le VAE
l’isolement viral doit être tenté à partir d’écouvillonnages nasaux ou de la conjonctive, de prélèvements de
sang complet sur anticoagulant et du sperme des étalons suspects d’être porteurs de virus (59). Pour
optimiser les chances d’isolement du virus, les prélèvements doivent être effectués aussitôt que possible
après la poussée thermique. Il a été démontré que l’héparine peut inhiber la multiplication du virus sur
cellules de rein de lapin (RK-13) (1) et, par conséquent, son utilisation comme anticoagulant n’est pas
indiquée, car elle peut interférer avec l'isolement du virus à partir du sang complet. Le dextrose-citrate acide
ou l’acide éthylène-diamine-tétra-acétique (EDTA) sont les anticoagulants recommandés. En cas de
suspicion d’AVE chez le poulain ou chez des animaux plus âgés, l’isolement du virus peut être tenté à parti
d’une grande diversité de tissus notamment les nœuds lymphatiques et organes de l’appareil digestif des
poumons du foie et de la rate (42). Dans les foyers d’avortement ou de mortinatalité dus à l’AVE le placenta,
les fluides fœtaux et divers tissus fœtaux lymphoréticulaires ou autres (en particulier les poumons) peuvent
être des sources de virus (59).
Les écouvillons pour isolement de virus doivent être immergés dans un milieu de transport approprié pour
les virus, ainsi que les fluides ou tissus qui sont collectés dans le même temps pour isolement viral et/ou la
technique de transcription inverse couplée à une réaction d’amplification en chaîne par polymérase
(RT-PCR). Ils doivent être expédiés au laboratoire si possible dans les 12 h, soit réfrigérés, soit congelés,
dans un emballage protégé. Les prélèvements de sang complet doivent être transportés réfrigérés mais non
congelés. Autant que faire se peut, il convient d’adresser les échantillons à des laboratoires compétents
pour le diagnostic de cette infection.
Bien qu’avec des succès inconstants lors de cas d’infection naturelle par l’AVE (43, 59), l’isolement du virus
à partir d’échantillons cliniques ou de tissus récoltés post mortem doit être effectué sur cultures cellulaires de
rein de lapin, de cheval ou de singe (43, 57, 59). Des lignées cellulaires telles que les lignées RK-13
(ATCC CCL-37), LLC MK2 (ATCC CCL-7) ou les cultures de cellules de première explantation de rein de
cheval ou de lapin peuvent être utilisées, mais les cellules RK-13 semblent le système de choix (57).
L’expérience acquise au cours des années a montré qu’il est plus difficile d’isoler le virus de l’AVE à partir du
sperme que des autres échantillons ou des tissus infectés sauf si un système cellulaire approprié est utilisé.
Plusieurs facteurs peuvent influencer l’isolement en premier passage sur RK-13 du virus à partir du sperme
(49). Les isolements ont un meilleur rendement en utilisant des cultures monocouches de 3 à 5 jours, un
large inoculum par rapport à la surface d’inoculation en flacon ou sur plaques multipuits et, le plus important,
en incorporant de la carboxy-méthyle cellulose dans le milieu de culture (viscosité du milieu : 400-800 cps). Il
est à noter que la plupart des cultures de cellules RK-13 provenant de l’ATCC CCL-37 sont contaminées par
le virus de la maladie des muqueuses, dont la présence semble stimuler la sensibilité du système cellulaire
au premier passage pour isolement du virus de l’AEV, notamment à partir du sperme. Il paraît prouvé que
les chances d’isolement en premier passage de l’AEV sont plus fortes avec des cultures de cellules RK-13
ayant un nombre de passages important1 (57).
Les cultures cellulaires inoculées doivent être examinées quotidiennement pour rechercher un effet
cytopathogène (ECP) qui apparaît habituellement entre 2 et 6 jours. En absence d’ECP visible les
surnageant de culture doivent être inoculés de nouveau sur des cultures confluentes de cellules au bout de
4 à 7 jours. Alors que la plupart des isolements sont obtenus au premier passage en culture, l’isolement
d’une petite fraction n’est visible que lors du deuxième passage (ou plus) in vitro (59, 60). L’identification des
isolats de VAE peut être réalisée par séroneutralisation directe (SN), par RT-PCR classique ou RT-PCR en
temps réel (2, 12, 51, 53), par une méthode immunocytochimique (36) principalement l’immuno-fluorescence
indirecte (16) ou par la technique avidine-biotine-peroxydase (ABP) (36). Un sérum polyclonal de lapin a été
utilisé pour identifier le virus de l’AVE en culture cellulaire. Des anticorps monoclonaux murins (AcMs)
dirigés contre la nucléocapside (N) (2, 40) ou la glycoprotéine majeure d’enveloppe (GP5) (2, 17), ainsi
qu’un sérum de lapin mono-spécifique contre la protéine non-glycosylée d’enveloppe (M) (2, 39, 40) ont
également été proposés et peuvent détecter les diverses souches du virus sur cellules RK-13 dès 12 à 24 h
après inoculation (2, 36).
1 Une telle lignée cellulaire (RK-13-KY) est disponible auprès du Dr. P.J. Timoney, Maxwell H. Gluck Equine Research
Center, Université du Kentucky, Lexington, Kentucky 40546-0099, États Unis d’Amérique (adresse électronique :

Chapitre 2.5.10. — Artérite virale équine
Manuel terrestre de l’OIE 2008 993
• Isolement du virus à partir du sperme (Épreuve prescrite pour les échanges internationaux)
Il est largement démontré que les étalons porteurs du virus à court ou long terme excrètent le virus de l’AVE
de façon constante dans le sperme, mais pas dans les secrétions respiratoires ni dans l’urine ; la présence
de virus n’a pas non plus été démontrée dans les cellules blanches du sang de ces animaux (59, 60). Le
sang de ces étalons doit au préalable être testé par une épreuve de séroneutralisation (SN), une épreuve
immuno-enzymatique validée de manière appropriée (ELISA) ou toute autre épreuve sérologique.
L’isolement du virus doit être fait à partir du sperme d’étalons trouvés positifs (titre ≥1/4) par recherche des
anticorps anti-virus de l’AVE. Le sperme doit en outre provenir d’étalons non vaccinés ou vaccinés mais
avec la confirmation que leur sérologie était alors initialement négative (titre ≤ 1/4). L’isolement du virus est
aussi indiqué en cas d’envoi de sperme lorsque l’on ne connaît pas le statut sérologique ni l’historique d’une
éventuelle vaccination du donneur. Il est recommandé de procéder à deux recherches de virus sur des
prélèvements différents effectués le même jour ou à quelques jours ou semaines d’intervalle. Il n’y a aucune
preuve que les isolements de virus sur certains étalons puissent dépendre de la fréquence ou de l’intervalle
entre les prélèvements ou de la période de l’année. L’isolement du virus doit être tenté autant que possible à
partir d’un éjaculat entier recueilli sur vagin artificiel à l’aide d’un préservatif et d’un mannequin ou d’une
jument souffleuse. Lorsqu’il n’est pas possible de recueillir du sperme de cette façon un procédé alternatif
est de prélever un échantillon de sperme à l’occasion d’une saillie. Il est nécessaire de prendre des
précautions lors du nettoyage des parties génitales externes de l’étalon et de s’assurer qu’il n’est pas utilisé
d’antiseptiques ni de désinfectants. Les prélèvements doivent contenir la partie de l’éjaculat riche en sperme
à laquelle le virus de l’AVE est associé, le virus n’est en effet pas présent dans la partie pré-éjaculatoire du
sperme (59, 60). Immédiatement après avoir été recueilli le sperme doit être réfrigéré sur de la glace pilée
ou sur des poches réfrigérées destinées au transport à destination immédiate du laboratoire. En cas de
risque de retard avant mise en route des examens de laboratoire le sperme peut être refroidi à température
égale ou inférieure à –20 °C pour une courte durée avant envoi. Il ne semble pas que la congélation diminue
les chances d’isolement du virus à partir du sperme d’un étalon porteur. Lorsque le statut de portage d’un
étalon ne peut pas être déterminé par isolement du virus ou par RT-PCR, il est possible de lui faire saillir
deux juments séro-négatives puis de tester celles-ci pour l’apparition d’anticorps 28 jours après la saillie
(59).
• Protocole
i) À l’arrivée au laboratoire, il convient de noter si les prélèvements de sperme sont congelés, refroidis ou
à température ambiante. Chaque échantillon doit être vérifié pour s’assurer qu’il contient la fraction de
l’éjaculat riche en sperme. Il est possible de le vérifier en examinant au microscope une fraction de
l’échantillon entre lame et lamelle. En outre, il convient de contrôler visuellement les éjaculats pour la
couleur et l’absence de grosses particules de contamination. Si l’échantillon est contaminé par du
sang, ce qui peut survenir lors d’un traumatisme de l’appareil génital de l’étalon au moment de la
collecte, un nouvel échantillon doit être demandé car l’isolement du virus peut être compromis lorsque
l’échantillon provient d’un étalon séro-positif.
ii) Bien que cela ne soit plus considéré comme essentiel, le traitement préalable avant inoculation aux
cultures cellulaires des échantillons par une courte sonication (3 cycles de 15 s) améliore le mélange et
la dispersion de l’échantillon.
iii) Après rejet du milieu de culture, des cultures en couches monocellulaires confluentes de 3 à 5 jours de
cellules RK-13, cultivées soit en flacons de 25 cm2 de surface soit dans des plaques multipuits, sont
inoculées avec des séries de dilutions décimales (10–1 à 10–3) de plasma séminal. Effectuées dans du
milieu de culture contenant 2 % de sérum de veau fœtal et des antibiotiques l’inoculum doit être de
1 ml par flacon de 25 cm2 de surface et ne doit pas être inférieur à deux flacons par dilution de
l’échantillon de plasma séminal. Le volume de l’inoculum et le nombre de puits inoculés par dilution
doivent être calculés lorsqu’on utilise des plaques multipuits. Une dilution appropriée de sperme témoin
positif ou de virus témoin de titre connu doit être incluse dans chaque test ;
iv) Les flacons ou les plaques sont fermés ou couverts et délicatement agités afin de repartir l’inoculum
sur les couches monocellulaires ;
v) Les cellules inoculées sont alors incubées pendant 1 h à 37 °C, soit en étuve conventionnelle, soit en
étuve humide à 5 % de CO2 dans l’atmosphère, suivant qu’on utilise des flacons ou des plaques
multiples ;
vi) Sans enlever l’inoculum ni laver le tapis cellulaire, ces derniers sont recouverts de milieu de culture
contenant des antibiotiques et 0,75 % de carboxy-méthyle cellulose ;
vii) Les flacons ou les plaques sont laissés à incuber à 37 °C et examinés au microscope pour recherche
d’ECP qui apparaît habituellement au bout de 2 à 6 jours ;
viii) En absence d’ECP visible, les surnageants de culture sont re-inoculées au bout de 5 à 7 jours à une
culture de 3 à 5 jours de cellules RK-13. Après élimination du milieu de culture, les cellules sont fixées
par le formol à 0,1 % et colorées au cristal violet.

Chapitre 2.5.10. — Artérite virale équine
994 Manuel terrestre de l’OIE 2008
L’identification de tout virus isolé doit être confirmée par séroneutralisation, par immunofluorescence (16) ou
par une épreuve à l’avidine-biotine-peroxydase en utilisant un sérum monospécifique anti-virus de l’AVE ou
des AcM dirigés contre les protéines structurales, N ou GP5 du virus (2, 18, 36, 37), ou encore par RT-PCR
classique ou en temps (5, 38, 64).
Pour l’épreuve de séroneutralisation directe des dilutions décimales de l’isolat viral sont mises en présence
d’un AcM neutralisant ou d’un antisérum monospécifique préparé contre la souche de référence de l’AVE
Bucyrus (ATCC VR 796) et d’un sérum témoin dépourvu d’anticorps neutralisants vis-à-vis du virus. Des
titrages en parallèle de la souche de référence Bucyrus avec les mêmes sérums de référence sont réalisés
comme témoins. Le test s’effectue soit sur des façons de culture de 25 cm² de surface soit en microplaques
Des quantités appropriées des solutions d’anticorps positives et négatives de référence sont inactivées
pendant 30 min au bain-marie à 56 °C et diluées au ¼ dans du tampon phosphate pH 7,2 ; puis 0,3 ml
d’anticorps dilué sont déposés dans 5 tubes pour chaque isolat de virus à identifier. Des dilutions décimales
(10–1 à 10–5) de chaque virus sont réalisées dans du milieu essentiel de Eagle contenant 10 % de sérum de
veau fœtal des antibiotiques et 10 % de complément de cobaye fraîchement dilué. 0,3 ml de chaque dilution
virale sont ensuite ajoutés aux tubes contenant les solutions d’anticorps de référence positifs et négatifs
dilués. Les tubes sont ensuite agités et les mélanges virus anticorps mis à incuber pendant 1 h à 37 °C.
Les mélanges virus anticorps sont ensuite inoculés à des cultures monocellulaires confluentes de cellules
RK-13 de 3 à 5 jours soit en flacons de 25 cm2 de surface soit dans des microplaques de culture cellulaire à
raison de deux puits ou deux flacons par dilution de virus. Chaque flacon ou chaque puits est inoculé avec
0,25 ml de mélange virus-anticorps ; lors d’inoculation à des puits en microplaque la taille de l’inoculum est
adaptée au support. Les plaques ou les flacons inoculés sont mis à incuber 2 h à 37 °C et agitées
doucement au bout de 1 h, pour disperser l’inoculum sur la couche cellulaire. Sans rejeter l’inoculum ni laver
le tapis cellulaire recouvrir celui-ci d’un milieu de culture contenant 0,75 % de carboxy-méthyle cellulose et
incuber 4 à 5 jours à 37 °C soit en caisson anaérobie soit en étuve dans une atmosphère humide à 5 % de
CO2. Après avoir rejeté le milieu, le tapis cellulaire est coloré par une solution tamponnée de cristal violet et
de formol à 0,1 %. Les plaques de lyse sont comptées et le titre infectieux est calculé en présence et en
absence d’anticorps anti AVE par la méthode de Searman-Karber (34). La confirmation de l’identification
d’une souche de virus repose sur la comparaison des réductions de plages (au moins 102 log) en présence
d’anticorps positif dirigés contre la souche de référence Bucyrus d’AVE
La grande majorité des souches d’AVE isolées à partir des étalons porteurs le sont lors du premier passage
en culture cellulaire selon le protocole du test décrit ci-dessus (59, 60). Le risque d’une cytotoxicité non due
au virus ou provenant d’une contamination bactérienne des échantillons n’est pas considérée comme
significatif lors des essais d’isolement de virus à partir du sperme des étalons. La cytotoxicité lorsqu’elle est
observée, n’affecte habituellement que les tapis cellulaires inoculés avec des dilutions à 10-1 de plasma
séminal et plus rarement avec des dilutions à 10–2. Le traitement du plasma séminal par le polyéthylène
glycol (PM 6000) avant inoculation a été utilisé avec quelque succès pour surmonter ce problème (25). La
méthode décrite consiste à ajouter du polyéthylène glycol afin d’obtenir une concentration de 10 % de
polyéthylène glycol à chaque dilution de plasma séminal de 10–1 à 10–3. Les mélanges sont maintenus une
nuit à 4 °C en agitation douce, puis ils sont centrifugés à 2 000 g pendant 30 min et le surnageant rejeté.
Les précipités sont remis en suspension dans du milieu de culture, ajusté au 1/10 du volume initial et
homogénéisé. Ces nouveaux mélanges sont centrifugés de nouveau à 2 000 g pendant 30 min, le
surnageant de chaque mélange est alors prélevé et utilisé pour inoculation. Il ne semble pas que ce
pré-traitement des plasmas séminaux nuise à la sensibilité de l’isolement du virus (25). Quand la
contamination bactérienne pose problème, il est préférable de demander une nouvelle collecte de sperme
de l’étalon. Lorsque cette nouvelle collecte n’est pas possible, il peut être possible d’essayer de contrôler la
contamination bactérienne par incubation de l’échantillon une nuit à 4 °C dans un milieu de transport
contenant des antibiotiques, suivie d’une centrifugation et remise en suspension du culot avant dilution et
inoculation de l’échantillon sur cultures cellulaires.
La présence d’anticorps anti-VAE dans le plasma séminal de certains étalons ne semble pas empêcher leur
détection comme animaux porteurs.
b) Méthodes d’identification de l’acide nucléique
Les techniques de RT-PCR classique en deux temps, étape de RT-PCR puis une RT-PCR en temps réel
(rRT-PCR) sont de plus en plus utilisées comme alternatives à l’isolement du virus en culture cellulaire pour
la détection du virus de l’AVE dans les prélèvements. Les épreuves de RT-PCR permettent l’identification de
l’ARN spécifique du virus dans les prélèvements, à savoir les écouvillons naso-pharyngés, la fraction
leucocytaire (buffy coat), le sperme total ou dilué, l’urine et les tissus collectés à l’autopsie (5, 6, 27, 55, 56,
64). Des techniques de RT-PCR simple ou en deux temps, de RT-PCR nichée (RT-nPCR) et de RT-PCR
TaqMan® ont été développées et testées pour la mise en évidence du virus dans du milieu de culture
cellulaire, dans le sperme et les secrétions nasales (5, 6, 12, 27, 38, 50, 51, 53, 55, 56, 64, 66). Ces
épreuves ciblent 6 cadres de lecture différents (ORFs) dans le génome du virus de l’AVE (ORFs 1b, 3-7).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%