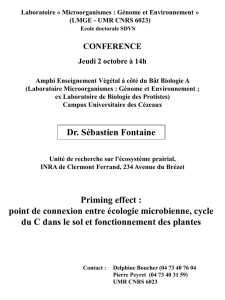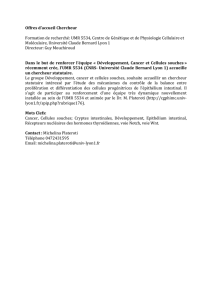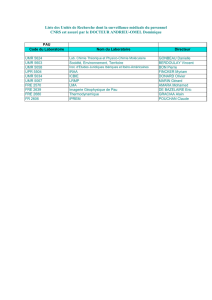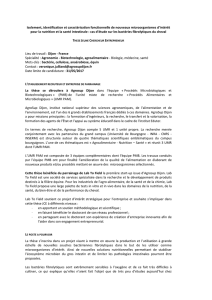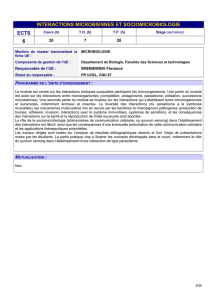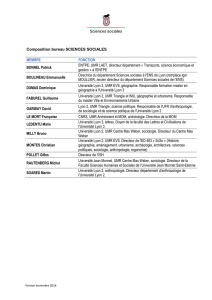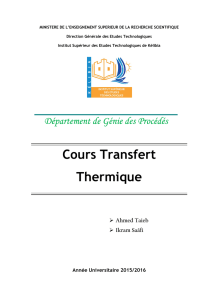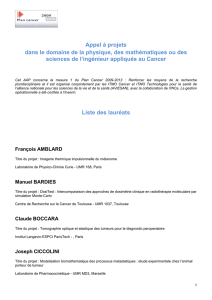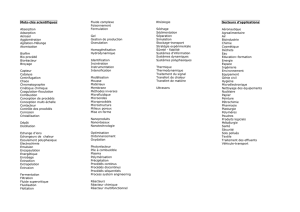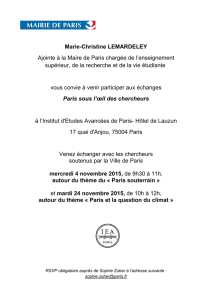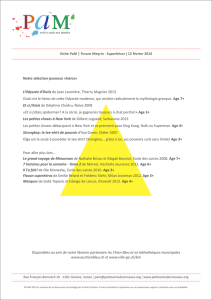Téléchargez le livret des abstracts du colloque

Programme
Abstracts
Liste des
participants
ORGANISÉ PAR :
ores
microbiennes
d’intérêt
dans les Procédés Alimentaires et la Santé
Le 7 octobre 2014, à DIJON
AVEC LA PARTICIPATION DE :
COLLOQUE

ores microbiennes d’intérêt
dans les Procédés Alimentaires et la Santé
7 octobre 2014, Dijon
PROGRAMME
13h30 – 14h30
CONSERVATION ET PRÉSERVATION DES SOUCHES AU COURS DES PROCÉDÉS ET
DE L’INGESTION
Chairman :
Pascal Molimard (Merck Consumer Healthcare)
• Le cas problématique des bactéries strictement anaérobies -
Cyril Iaconnelli (UMR
PAM)
• Conservation de la levure et le rôle antioxydant des stérols de la membrane -
Sébastien
Dupont
(UMR PAM)
• L’encapsulation de cultures de microorganismes -
Yves Waché (UMR PAM / NatEncaps)
14h30 – 15h30
MODES D’ACTION DES MICROORGANISMES
Chairman :
Nicolas Desroche (Nexidia)
• Effet de bactéries probiotiques sur la perméabilité de la barrière intestinale -
Luis
Bermudez (UMR MICALIS)
• Biolm et immunomodulation : cas d’un
Lactobacillus casei
-
Jean Guzzo / Aurélie
Rieu (UMR PAM)
• Activité réductrice des microorganismes d’intérêt laitier -
Rémy Cachon (UMR PAM)
15h30 – 15h45 CONCLUSION
Catherine Béal (AgroParisTech)
15h45 - 16h00 PAUSE
16h00 – 17h30 SPEED DATING
17h00 COCKTAIL APÉRITIF ET NETWORKING
18h30 CLÔTURE
8h45 – 9h00 ACCUEIL
9h00 – 9h30
CONFÉRENCE INTRODUCTIVE : Les ores microbiennes d’intérêt dans les
procédés alimentaire et la santé
Muriel Thomas (UMR Micalis) & Laurent Beney (UMR PAM)
9h30 – 10h30
BIODIVERSITÉ MICROBIENNE ET SÉLECTION DE SOUCHES D’INTÉRÊT
Chairman :
Laurent Rios (Biovitis).
• Sélection de levures œnologiques non
Saccharomyces
-
Hervé Alexandre (UMR
PAM)
• Dynamique d’évolution de la ore microbienne dans les fromages -
Christine
Achilleos (INRA Urtal)
• Démarche de sélection d’une souche d’intérêt probiotique -
Pascal Molimard
(Merck Consumer Healthcare)
10h30 - 11h00 PAUSE
11h00 – 12h30
IDENTIFIER ET CONSERVER LES FONCTIONNALITÉS
Chairman :
Patricia Ramos (Senoble)
• Impact des procédés de production sur le maintien des propriétés fonctionnelles
de
Lactobacillus
plantarum - Nicolas Desroche (Nexidia)
• Identication des fonctions bactériennes par une approche de banque génomique -
Florian Chain (UMR MICALIS)
• Stratégie de génétique inverse sur les lactobacilles : de la fonction aux gènes -
Jean-François Cavin et Hélène Licandro-Seraut (UMR PAM)
12h30 – 13h30 DÉJEUNER - BUFFET ET ÉCHANGES
Matin
Les organisateurs
Après-midi
VITAGORA®, pôle de compétitivité tri-régional (Bourgogne,
Franche-Comté et Île-de-France). Vitagora® réunit entreprises
de l’agroalimentaire avec des représentants de a recherche et de
la formation afin de favoriser la croissance par l’innovation pour
attaquer à des marchés alimentaires à haute valeur ajoutée.
www.vitagora.com
Le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) AGRALE est constitué de trois
partenaires, membres fondateurs : l’INRA, l’Université de Bourgogne,
AgroSup Dijon, qui rassemble l’ensemble des forces de recherche et
formation supérieure du Grand Campus dijonnais dans les domaines
de l’AGRicuture, l’ALimentation et l’Environnement.
www.agrale-dijon.fr

Conférence introductive
L’avenir des ores microbiennes d’intérêt pour les procédés
alimentaires et la santé
M. Thomas (UMR Micalis, Jouy en Josas) et L. Beney (UMR PAM, Agro-
sup Dijon – Université de Bourgogne, Dijon)
Depuis des millénaires, nous mettons à prot les propriétés des bactéries pour améliorer la
conservation, le goût, l’aspect, la texture des aliments après fermentation. L’utilisation des bactéries,
très ancrée dans nos procédés alimentaires, subit une évolution permanente qui est marquée par la
disparition progressive de l’empirisme au prot de pratiques rationnelles tirées du développement
des connaissances scientiques. La richesse du programme de la journée démontre le dynamisme
dans le domaine des « ores microbiennes d’intérêt » tant sur le plan des nouvelles connaissances
que sur le plan de leurs répercussions économiques et sociétales. Nous espérons que ce colloque
sera particulièrement favorable à l’innovation, à la créativité et à l’émergence de nombreux projets.
Son format y est en tout cas propice puisqu’il réunit des chercheurs académiques et des industriels
du domaine. Nos unités respectives, Micalis et l’UMR PAM ainsi que l’Unité URTAL sont fortement
mobilisées pour cet évènement et nombre de leurs chercheurs vous montreront le grand potentiel
technique et scientique qu’elles abritent.
La première des thématiques abordées aujourd’hui concerne l’étude de la biodiversité et
l’identication de nouvelles souches d’intérêt. En eet, l’immense diversité du monde microbien se
révèle à travers l’étude des méta-génomes des aliments fermentés, de notre tractus digestif et de
notre environnement. Dans leur totalité les microorganismes constituent une richesse biologique
et génétique immense et sont le siège de millions d’activités biochimiques pour la plupart
inconnues. Il ne fait aucun doute que certains d’entre eux contribueront un jour à la préservation
de notre santé ou de notre environnement. Pour cela quelques challenges sont à relever, au-delà
de la signature génétique, il s’agit par exemple d’isoler et cultiver ces microorganismes pour en
étudier leurs activités.
Les trois sessions suivantes sont consacrées aux fonctions des ores d’intérêt. Les enjeux principaux
sont d’identier puis de préserver les fonctionnalités des souches et cela tout au long de la chaine qui
s’étend du fermenteur, dans lequel sont produits les microorganismes, jusqu’à l’aliment et le tractus
digestif. Toutes ces investigations sont essentielles à l’utilisation rationnelle des microorganismes
et au développement de procédés industriels adaptés.
Enn les derniers exposés concerneront les modes d’action des micro-organismes à la fois dans
le produit mais aussi sur la santé humaine. Les bactéries utilisées dans les procédés alimentaires
sont souvent associées à des valeurs « santé » ce qui confère une plus-value à un produit et
représente un potentiel d’innovation impliquant des acteurs académiques et privés; cependant les
preuves scientiques sur l’eet bénéque de leur consommation restent insusantes. Les seules
bactéries alimentaires bénéciant d’une allégation « santé » approuvée par l’EFSA (« European
Food Safety Autority ») sont les bactéries lactiques du yaourt, dont la consommation aide à une
meilleure digestion du lactose. Ce cas d’école, qui reste isolé, montre qu’il y a une grande marge
de progression pour prouver des eets santé de bactéries alimentaires. Dans un contexte, où de
nombreuses études décrivent l’impact des bactéries intestinales commensales ou alimentaires sur
la physiologie et la santé ; les argumentaires des allégations santé devraient pouvoir être étayés
an de concilier les exigences réglementaires, les attentes et la protection des consommateurs.
Nous remercions le comité d’organisation de ce premier colloque consacré à la « ore microbienne
d’intérêt » ainsi que le pôle Vitagora et le Gis Agrale pour leur implication déterminante. Nous vous
souhaitons un colloque riche d’échanges et de projets.

Biodiversité microbienne et sélection de souches d’intérêt
Sélection de levures œnologiques Non-Saccharomyces
Hervé Alexandre
UMR A 02.102 Laboratoire VALMIS-UMR PAM AgrosupDijon/UB, Institut Universitaire de la Vigne et
du Vin Jules Guyot, Université de Bourgogne
La réalisation de la fermentation alcoolique du jus de raisin a été pendant très longtemps et est
encore dans certains cas conduite par les levures naturellement présentes sur le raisin ou dans le
chai. Dans ces conditions, le terme « levures indigènes » est utilisé. Sous ce terme co-existe une
multitude d’espèces de levures, fermentaires ou non. Toutes les « levures indigènes » ne sont pas
adaptées à la production de vin de qualité même si majoritairement cela se passe bien. En eet,
le départ en fermentation peut être long et n’est pas contrôlé, la vitesse de fermentation peut être
irrégulière et la fermentation peut ne pas aller à son terme. Enn les risques de déviances existent.
Pour ces raisons, des levures appartenant à l’espèce
Saccharomyces cerevisiae
ont été isolées et
sélectionnées selon un cahier des charges assez stricte. Peu de production d’acide acétique, de
sultes, départ en fermentation rapide, tolérance à l’éthanol, tolérance à la température,…. Et bien
d’autres propriétés.
Dans les années 70-80 les premières levures sèches actives (LSA) apparaissent et ont très vite
remporté un vrai succès. Ces LSA ont sans conteste contribué à l’amélioration qualitative des vins,
ces 40 dernières années.
Cependant, parmi les levures indigènes dans lesquelles il y a des
Saccharomyces cerevisiae
, il y a
également des levures dites « non-Saccharomyces » qui possèdent des propriétés intéressantes
pour la vinication et qui ont fait l’objet de nombreuses études qui ont relancé l’intérêt pour ses
levures.
Ainsi de nouveaux programmes de sélection de levures « Non-Sacchromyces » ont vu le jour avec
pour objectif de réaliser des co-fermentations avec Saccharomyces cerevisiae, an de mimer ce
qui se passe naturellement, mais de façon plus contrôlée. Ce sont ces diérents aspects qui seront
abordés dans cette présentation.

Biodiversité microbienne et sélection de souches d’intérêt
Dynamique d’évolution de la ore microbienne dans les fromages
Christine Achilleos
INRA, UR342 Technologie et Analyses Laitières, F-39800 Poligny, France
Le fromage est un écosystème complexe où cohabitent des bactéries, des levures et des moisissures.
Tout au long de la fabrication et de l’anage, par une multitude d’activités enzymatiques, elles
interagissent entre elles, et avec leur environnement, les constituants du lait, puis du fromage.
Ainsi, suivant les conditions de leur environnement, à un moment donné du process de fabrication,
certains micro-organismes se multiplient activement alors que d’autres tendent à disparaître. Les
équilibres entre les diérents groupes de micro-organismes, la diversité et l’importance relative
des populations sont donc en constante évolution en cours de fabrication et d’anage. Le
fonctionnement de cet écosystème microbien conduit à l’élaboration des diérentes caractéristiques
de la qualité des fromages : sensorielle, sanitaire et santé.
Décrire le fonctionnement de cet écosystème implique de connaitre la diversité microbienne et de
suivre tout au long du process de fabrication la vie dynamique de ces populations microbiennes.
La description des populations microbiennes en termes de diversité et de dynamique est basée sur
des méthodes cultures dépendantes, sur milieux plus ou moins spéciques, et peut être aujourd’hui
complétée par des méthodes moléculaires directes, cultures indépendantes, basées sur l’analyse
des séquences d’acides nucléiques, signatures des micro-organismes.
L’évolution de Lactobacillus delbrueckii pendant la fabrication fromagère, depuis le lait de cuve
jusqu’en n d’anage, a été suivie dans 24 fromages au lait cru, de type pâte pressée cuite. La
quantication de
Lb. delbrueckii
par une méthode moléculaire, PCR quantitative en temps réel
(qPCR), comparée au dénombrement par culture sur milieu sélectif, a montré la présence de
cellules non cultivables tout au long de la fabrication fromagère, dès l’étape de pressage du
fromage et jusqu’en n d’anage. Les écarts observés entre les deux méthodes de quantication,
surestimation par qPCR, expriment diérents états physiologiques des cellules selon l’étape de
fabrication considérée.
D’autre part, certains résultats, sous-estimation par qPCR, traduisent des problèmes d’extraction
de l’ADN de cellules cultivables. Ceci est clairement observé pour des échantillons dans le lait de
cuve, à l’étape d’inoculation de
Lb. delbrueckii
et à 12 h de fabrication, dans le fromage sous presse,
lorsque les cellules de
Lb. delbrueckii
sont en phase stationnaire de croissance. L’ecacité de la
méthode d’extraction de l’ADN varie selon l’état physiologique des cellules mais également selon
la souche de
Lb. delbrueckii
impliquée.
Cet exemple montre que la description d’un écosystème microbien est étroitement liée aux
méthodes mises en œuvre pour le mesurer. Les méthodes moléculaires s’aranchissent des cultures
sur milieux sélectifs mais nécessitent l’extraction des acides nucléiques directement de la matrice,
lait et fromage. Les populations microbiennes sont quantiables sous condition que les cellules
puissent être lysées et leur acide nucléique extrait.
Il n’y a pas d’outil idéal et il est nécessaire de bien connaitre les biais et limites de chaque méthode
pour une interprétation au plus juste. Il est souvent souhaitable de combiner plusieurs méthodes
pour avoir une image nale de la communauté microbienne la plus complète et la plus proche de
la réalité.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%