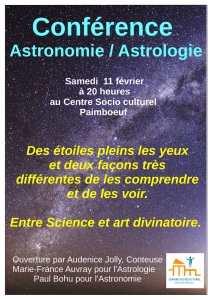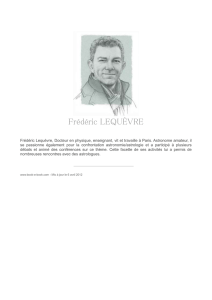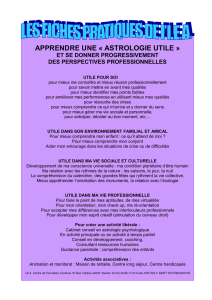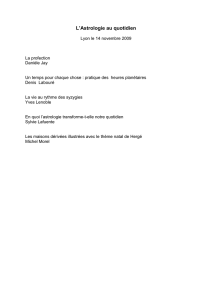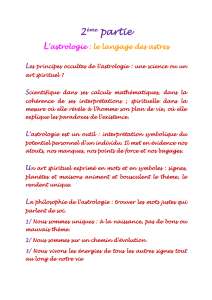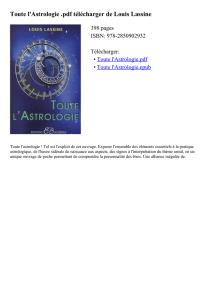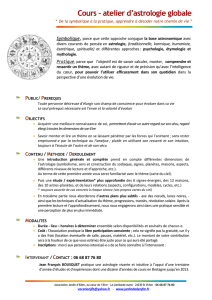Uranus et la petite souris

Vol. 96 - Avril 2002 François SAINT-JALM
BULLETIN DE L’UNION DES PHYSICIENS 677
Uranus et la petite souris
par François SAINT-JALM
Professeur agrégé de sciences physiques
Lycée Turgot - 75003 Paris
RÉSUMÉ
Il existe un lien caché entre la petite souris et la planète Uranus. Cet article en est
la preuve. Plus sérieusement cet article traite des multiples croyances que chacun peut
avoir et qui, parfois interfèrent avec l’enseignement délivré en sciences physiques. Deux
thèses sont ici soutenues. La première est que l’enseignement de la physique ne s’oppose
pas ouvertement à certaines croyances fort répandues. Leur coexistence avec le discours
scientifique suppose l’acceptation de nombreuses contradictions parfois résolues par le
rejet pur et simple du discours scientifique, peu racoleur. La seconde thèse dit qu’il est
très difficile de prouver qu’une croyance est infondée à une personne qui s’y adonne.
C’est donc souvent sur une petite contradiction que l’on peut s’appuyer pour faire naître
le doute. Une tentative d’argumentation en mode mineur est ainsi proposée sur l’exemple
de l’astrologie. Derrière l’aspect parfois anecdotique de cet article, c’est toute la ques-
tion du sens de notre enseignement qui apparaît : quelle représentation du monde pro-
posons nous de partager avec nos contemporains ?
DIALOGUE
Léa a six ans et demi.
– Papa, dis-moi pourquoi, la petite souris, elle nous rend la dent et chez Flora elle la
garde ?…
–…
Il fallait bien qu’un jour une incohérence apparaisse et qu’enfin un doute germe.
– Eh bien, vois-tu, la petite souris, … Eh bien, c’est… c’est les parents qui font la petite
souris. Chez Flora ils gardent la dent sans la montrer et chez nous on la met dans une
petite boîte et on la montre.
–…
– Ça t’embête ?
– Oui, un peu…
–…
– Je me demandais bien aussi comment elle faisait pour soulever un humain.
– Comment ça ?

BULLETIN DE L’UNION DES PHYSICIENS
678
Uranus et la petite souris BUP no843
– Ben oui, pour mettre le cadeau sous l’oreiller…
– Eh oui ! Maintenant tu sais…
– Et Sarah et Raphaël (son frère et sa sœur de 9 et 12 ans), ils savent ce secret ?
– D’après toi, ils savent ?
– Non.
– Si, ils savent.
–…
–…
– Et le Père Noël, il existe quand même ?
– Qu’est-ce que tu en penses ?
– Il existe.
–…
– Dis, c’est vrai qu’il existe ?
Il était temps, je pense, de mettre bas les masques…
– Tu sais, le Père Noël, c’est aussi les parents…
–Ah!
– Ça t’embête ?
– Un peu.
– Il ne faut pas… les cadeaux, il y en aura quand même encore.
– Alors, c’est pas lui qui les met dans le coffre de la voiture ?
– Non, c’est moi. Et après on les met sous le sapin.
– Alors, comment on les fabrique, les jouets ?
Et cætera… Elle pensait évidemment que le Père Noël les fabriquait lui-même,
comme c’est raconté dans certains livres pour enfants.
Très tôt, on se construit une représentation du monde et celle-ci se trouve mise à
l’épreuve des « faits ». Il est clair que la plupart des observations faites sont lues dans le
cadre de la représentation considérée comme valide et qu’il en faut beaucoup pour que
la question de sa validité soit posée. Ainsi la Petite Souris soulève des humains, le Père
Noël ne se salit pas dans les cheminées, et tout va bien jusqu’au jour où une petite contra-
diction se manifeste…
Nous touchons là une des contraintes cachées de l’enseignement de la physique.
Chacun arrive en classe avec son attirail conceptuel et le voit confronté au discours pro-
posé par le professeur. Le conflit n’est pas toujours déclaré. Il est en revanche souvent
très destructeur comme nous allons le voir.
LES « PARASCIENCES »
Y a-t-il quelque chose à comprendre en physique ? On peut en douter lorsqu’on

Vol. 96 - Avril 2002 François SAINT-JALM
BULLETIN DE L’UNION DES PHYSICIENS 679
écoute d’anciens élèves ayant suivi la filière scientifique pour finalement choisir une acti-
vité non-scientifique : « Moi, vous savez, j’ai bien réussi quand j’ai compris qu’il n’y
avait rien à comprendre et qu’il suffisait d’appliquer les formules ! ». Par exemple la
mécanique, cette partie fondamentale de notre domaine, est tout à la fois simple et diffi-
cile. En effet, chacun de nous possède un solide bagage expérimental : marche, course,
pratique de divers sports, nous mettent en position d’observation quotidienne de mouve-
ments variés. Pourtant, les théories mécaniques spontanées que chacun de nous construit
implicitement n’ont rien à voir avec ce que l’on appelle la « mécanique classique ».
Très tôt un enfant peut même se livrer à des expériences secrètes et personnelles
comme celle qui consiste à essayer de s’envoler en cherchant à agir sur la chaise sur
laquelle il est assis, jambes pendantes et ne touchant pas le sol. La croyance en la possi-
bilité de « s’autoporter » ou de faire se déplacer des objets par la seule pensée (psycho-
kinèse) contredit les principes premiers de la mécanique à commencer par la première loi
de Newton ou principe de l’inertie. Un dossier consacré à cette question (Les français et
les « parasciences » Daniel Boy. Guy Michelet) dans le n° 161 de la revue La Recherche
(décembre 1984) nous aidera à en prendre la mesure :
Depuis quelques années, l’essor des sciences parallèles constitue au sein de nos sociétés un
phénomène immédiatement perceptible. En marge des « sciences légitimes » se développe une
série de pratiques et de croyances rejetées par le rationalisme scientifique : transmission de
pensée, action de l’esprit sur la matière, influence des astres sur les caractéristiques psycho-
logiques, voire sur les destins individuels, etc. […]. Malgré l’expansion progressive des idées
de rationalisme, le XIXesiècle et le XXesiècle sont jalonnés de mouvements intellectuels refu-
sant les bornes fixées par l’épistémologie dominante : mouvement spirite au XIXesiècle, réha-
bilitation du spiritualisme opposé à la pensée scientifique dans l’entre-deux-guerres, mou-
vance de pensée de la revue « Planète » dans les années soixante, Colloque de Cordoue dans
les années soixante-dix. L’astrologie également, bien qu’en voie de disparition en France à la
fin du XIXesiècle réapparaît dans l’entre-deux-guerres dans la grande presse américaine puis
française et se diffuse très largement à partir des années soixante par le canal des radios péri-
phériques. Enfin, le crédit régulièrement accordé par la presse aux phénomènes paranormaux,
inexplicables ou mystérieux (objets volants non identifiés (OVNI), maisons hantées, phéno-
mènes de télékinésie, etc.) tend à ancrer dans le public le sentiment d’une « autre dimension »,
inaccessible à la science actuelle, objet par conséquent d’un autre mode de connaissance.
On pourrait penser que seule la partie la moins instruite de la population est atteinte
par cette vague de croyances et que, majoritairement, les gens dont les enfants désirent
suivre des études longues sont à l’abri de ces attrape-nigauds. Mais on lit ceci dans ce
même dossier :
Les croyances sont plus fréquentes parmi les couches cultivées (niveau d’études secondaires
dans le cas de l’astrologie, supérieur pour le paranormal) mais une formation de type scien-
tifique tend à diminuer la probabilité de croire, en particulier pour l’astrologie.
S’il fallait interpréter ces résultats, il serait tentant de dire que le « bon sens popu-
laire », dans ce qu’il a parfois de terre-à-terre est peut-être une bonne protection contre
les imaginaires (mais autoproclamées) sciences parallèles. Je suis également frappé de
voir ces deux auteurs (l’un est chercheur à la Fondation Nationale des Sciences Poli-

BULLETIN DE L’UNION DES PHYSICIENS
680
Uranus et la petite souris BUP no843
tiques, l’autre au CNRS (Centre national de la recherche scientifique)) risquer la confu-
sion entre corrélation et causalité : il est suggéré qu’une formation de type scientifique
est un bon antidote à ces croyances. C’est peut-être vite conclure à une efficacité du dis-
cours scientifique là où il porte rarement son effort : contredire ouvertement ces pratiques
sans réalité matérielle. Je pense que l’on peut avancer au moins une autre explication à
cette corrélation : l’enseignement des sciences est redoutablement sélectif (on le lui
reproche d’ailleurs souvent) et il se pourrait que les élèves qui sont écartés des cursus
scientifiques pour suivre leurs études dans une autre voie, essuient cet échec à cause d’un
système de valeurs ou d’un réseau de croyances qu’ils possèdent, qui est incompatible
avec l’aridité du discours rationnel, avec le désenchantement qu’il amène, et qu’ils refu-
sent de réviser au moment où un conflit se manifeste entre leurs convictions profondes
et ce qu’on leur enseigne. On ne retrouverait alors parmi les «brillants »bacheliers scien-
tifiques que ceux qui avaient au départ la distance culturelle la plus courte à franchir pour
adopter les modes de pensée utilisés par les hommes et femmes de sciences ou qui sont
intellectuellement assez dociles pour accepter sans discuter ce qui leur est proposé. Cette
remarque me semble dépasser la simple correction technique - corrélation ou causalité -
car elle ne nous conduit pas aux mêmes conclusions pratiques : les auteurs laissent
entendre que l’enseignement des sciences a un véritable pouvoir de conversion à la pen-
sée rationnelle. Je propose l’idée de son inefficacité dans ce domaine tant que l’on per-
siste à ignorer les présupposés et les croyances des candidats aux études scientifiques.
Toute démarche pédagogique qui ne tiendrait aucun compte de ces questions est, me
semble-t-il, vouée à générer des échecs apparemment inexplicables.
Jean-Paul DUFOUR, dans un article du journal Le Monde (« La science hors l’école »
30 août 1989) résume une autre enquête effectuée par Daniel BOY avec Anne MUXEL pour
le Centre des Études de la Vie Politique Française (« Les jeunes et la science », étude sur
les attitudes des 11-17 ans à l’égard de la science). Il cite les phrases suivantes :
« Les modèles culturels propres aux adultes sont inculqués très précocement aux enfants. Ils
se mettent très probablement en place avant onze ans ». Et : « La manière dont les enfants
perçoivent l’astrologie est, elle aussi, calquée sur l’opinion des parents. Les horoscopes sont
scientifiques pour 41 % des enfants dont le père n’a pas dépassé le niveau d’études primaires
contre 31 % pour ceux dont le père a atteint le niveau secondaire ou supérieur ».
Que penser du niveau d’études de la mère ? On est en droit de se poser la question.
L’article de Jean-Paul DUFOUR se termine par des statistiques alarmantes concernant l’in-
térêt que portent aux sciences les différentes tranches d’âge allant de l’enfance à l’ado-
lescence. La baisse constatée est entièrement attribuée au système scolaire. On peut
reprocher à l’école de ne pas mener une lutte acharnée contre ce désenchantement mais
il ne faut pas oublier que les causes du divorce entre nos jeunes et la science sont à cher-
cher dans le conflit existant entre ce que l’on croit et ce que l’on apprend tout autant que
dans la rentabilité estimée des études scientifiques : le rapport efforts/gains n’est pas des
meilleurs.
La science est souvent perçue comme un système par lequel on veut vous empêcher
de rêver. Il est vrai qu’elle séduit les très jeunes parce qu’elle permet des merveilles

Vol. 96 - Avril 2002 François SAINT-JALM
BULLETIN DE L’UNION DES PHYSICIENS 681
- aller sur la lune - et qu’elle promet des réponses à toutes les questions - « quand tu seras
grand(e) » -, mais ensuite elle les rebute lorsqu’elle ferme la porte à certains rêves. Un
de mes amusements préférés, alors que j’enseignais en collège (cela m’arrive encore en
lycée lorsque je veux organiser quelques minutes de détente) était d’affirmer qu’il est
rigoureusement impossible de dépasser la vitesse de la lumière. Ce genre de limite,
comme le zéro absolu des températures (on ne descend pas plus bas) (lire à ce sujet le
chapitre sept du livre écrit par Jean-Marc LÉVY-LEBLOND « Aux contraires » Gallimard)
ou le zéro du temps cosmologique (il n’y a pas d’avant) exaspère les jeunes (et les moins
jeunes) qui ont une vision naïve du monde, et qui rêvent à une science qui pourrait tout
faire - donc aussi l’impossible -. « Mais monsieur, peut-être qu’un jour on trouvera le
moyen de la dépasser quand même… » me répondait-on alors immanquablement dans un
mouvement de confiance totale en la science qui, c’est sûr, pourra abolir cette frontière,
et de défiance non moins totale à son égard quand elle énonce un fait gênant. Alors, pour
renforcer le sentiment de frustration qui avait pris naissance, je tentais d’ôter tout espoir
à mon auditoire en utilisant les arguments les plus expéditifs et les plus malhonnêtes :
« Si c’était possible, cela se serait déjà vu et déjà fait. Et puis, c’est Albert EINSTEIN qui
l’a montré ! ». L’autorité d’Albert EINSTEIN n’a bien sûr aucune valeur de preuve, mais
elle me permettait de mettre un terme à une impossible explication de façon à abréger
mon propos et à en augmenter le contraste. Je poursuivais en effet de la façon suivante :
« Savez-vous quelle curieuse conséquence Albert EINSTEIN en a tiré ?… Il est possible,
si l’on s’en donne les moyens techniques, de voyager dans l’avenir ! ». Devant l’incré-
dulité de mon public, je devais souvent confirmer cette affaire en précisant : « C’est l’his-
toire du Voyageur de Langevin ». Je la racontais dans une version plus ou moins romancée
et rappelais sa concrétisation dans les anneaux de stockage de particules subatomiques.
Je crois encore que cette incursion dans l’imaginaire de ces adolescents ne pouvait être
que salutaire : il s’agissait de leur proposer de remplacer un rêve chimérique par un autre
rêve, non moins tentant, mais possible. C’était leur donner un peu d’air à respirer là où
ils n’absorbaient que de l’éther. Ils ressentaient, malgré mes efforts, une sorte de manque
lorsque je concluais par : « Hélas, il est également certain que le voyage dans le passé
n’est pas possible ».
Lorsque je repense à cette scène plusieurs fois rejouée et que je tente d’imaginer les
sentiments que pouvaient éprouver ces jeunes gens au moment où je leur demandais de
rêver autrement, je ne peux éviter de voir l’Humanité se débattre et s’arc-bouter contre des
barrières qu’elle décèle dans son Univers, ou qu’elle formule elle-même, pour mieux
oublier la contrainte qu’elle subit le plus et que toutes les cultures ont dû gérer pour la faire
accepter : le temps qui s’écoule irréversiblement et qui porte en lui le signe de la mort.
QUE FAIRE ?
Il est très difficile de modifier les convictions d’autrui. Dans le cadre de nos cours
de sciences physiques, c’est même totalement impossible : la lutte contre les croyances
les plus diverses n’est pas inscrite dans nos programmes ni dans nos objectifs. Tout se
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%