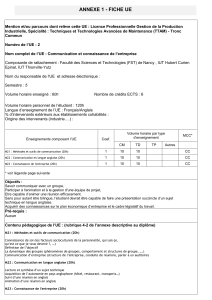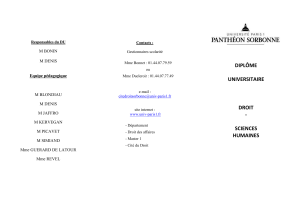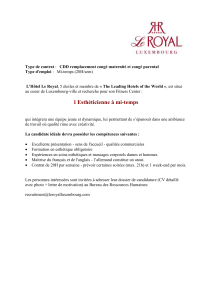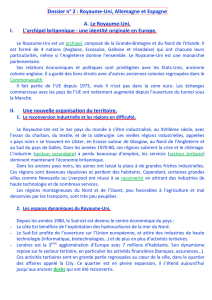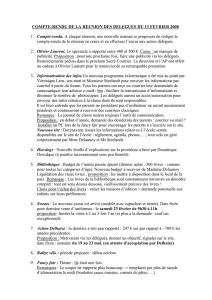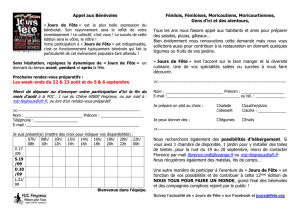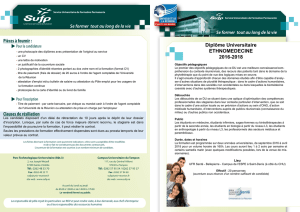Télécharger - Théâtre de l`Odéon

OD ON
JOËL POMMERAT
DES POINTILLÉS QUI
TRACENT PEU À PEU
LES CONTOURS
LES BIBLIOTHÈQUES DE L’ODÉON
DÉPOUSSIÉREZ
VOS LIVRES ET VOS IDÉES !
Lettre No12
Odéon-Théâtre de l’Europe décembre 2014
ANGÉLICA LIDDELL
RISQUER L’ÉCARTÈLEMENT
Jusqu'où l'art peut-il aller
Entretien avec Thaddaeus Ropac

2 3
sommaire
p. 2 à 5
RISQUER L'ÉCARTÈLEMENT
JUSQU'OU L'ART PEUT-IL ALLER
YOU ARE MY DESTINY
(Lo stupro di Lucrezia)
Angélica Liddell
p. 6 et p. 11
DES POINTILLÉS QUI
TRACENT PEU A PEU
LES CONTOURS
LA RÉUNIFICATION
DES DEUX CORÉES
Joël Pommerat
p. 7 à 10
LES BIBLIOTHÈQUES
DE L’ODÉON
FAIRE LE VIDE EN SOI
La Vie matérielle de Marguerite Duras
Laure Adler / Sonia Wieder-Atherton
IL NE FAUDRAIT PAS PRÊTER
UN LIVRE MAIS LE DONNER
Ma bibliothèque idéale
LE TREIZIÈME
DES TRAVAUX D'HERCULE
Mythes et Épopées
p. 12
UN QUART DE SIÈCLE
À LA MANŒUVRE
Entretien avec Michel Pons
p. 13
SENTIR FRÉMIR LES AUTRES
UNE APPROCHE
DE L'AUDIODESCRIPTION
Entretien avec Delphine Harmel
SOUTENEZ LA CRÉATION
THÉÂTRALE
LE CERCLE DE L'ODÉON
p. 14
TOUTE PHOTOGRAPHIE
FAIT ÉNIGME POUR LE REGARD
AVANTAGES ABONNÉS
Invitations et tarifs préférentiels
p. 15
ACHETER ET RÉSERVER
SES PLACES
p. 16
LE CAFÉ DE L'ODÉON
SUIVEZ-NOUS
Twitter
@TheatreOdeon
#MyDestiny
#Réunification
@Bibliodeon
Facebook
Odéon-Théâtre de l’Europe
Retrouvez la lettre et son contenu
augmenté (entretiens, sons, vidéos...)
sur theatre-odeon.eu / le-magazine
Un joyau
intact sous
le désastre.
Daniel Loayza : Anne Dufourmantelle,
vous êtes psychanalyste et philo-
sophe. Vous avez découvert Angélica
Liddell à l’Odéon avec son dernier spec-
tacle,Todo el cielo sobre la tierra (El
síndrome de Wendy).Qu’en avez-vous
pensé?
Anne Dufourmantelle : Ça a été un choc
extraordinaire. J’ai découvert la pièce
d’Angélica Liddell grâce à ma fille qui a
mis le doigt, dans un beau texte qu’elle
a écrit, sur «l’innocence radicale» du
monde de Liddell, qui est celui de l’en-
fance. Une enfance à laquelle on ne
parvient qu’au prix d'un combat sans
merci avec la médiocrité du réel. Cette
enfance inviolable et inviolée, c’est ce
que ma fille appelle le «miracle» de ce
théâtre. Il ouvre à un univers qui ne s’est
pas déconnecté de sa propre magie. À
un réalisme magique où l’animal et l’hu-
main, le jour et la nuit, sont dans une
proximité sensible, l’un tout contre
l’autre. Où les morts ne sont pas relé-
gués loin des vivants. Peut-être que
l’Espagne et les pays latins ont mieux
su préserver le sens de cette conti-
guïté? Nous, nous serions plutôt du
genre à vouloir éradiquer la mort! Mais
Liddell, elle, ne l’oublie jamais. Ni la mort,
ni la vie, ni le corps. Elle sait que vivre
fait mal, et c’est pourquoi son théâtre
est un théâtre de l’émerveillement. Au
Moyen Âge, la «merveille», c’était le
hors-normes, qu’il soit magnifique ou
terrifiant. Ce qui déchirait le cours ordi-
naire du monde. En ce sens, les batailles
étaient aussi une merveille. Son théâtre,
c’est cela: il montre la coexistence des
choses et de leur envers, il fait chucho-
ter les morts dans les voix des vivants,
il rend présent un autre monde. Cela a
un prix: il n’y a pas d’émerveillement
sans terreur. Notre premier rapport au
monde, c’est peut-être cet émerveille-
ment, cette exposition à quelque chose
d’insoutenable, dans un lieu où per-
sonne ne peut rester et habiter, un lieu
impossible et pourtant...
D. L. : Ce n’est peut-être pas un hasard
si ce spectacle est né à Venise...
A. D. : La scène selon Liddell, c’est peut-
être le seul endroit où un tel lieu puisse
advenir, et même être partagé quelque
temps: la beauté d’un volcan où pour
une fois on survivrait à l’explosion...
Mais pour répondre plus exactement, il
faut que je parle de ce qu’est le trauma.
J’appelle trauma quelque chose dont la
force d’implosion souffle le sujet hors
de la scène. Il ne s’agit pas de quelque
chose de mesurable, d’objectif: un évé-
nement terrible n’est pas nécessaire-
ment traumatique. Un trauma, c’est ce
qu’un sujet ne peut soutenir sans être
fragmenté, sans se retrouver dans les
bords de la scène, dans les bordures,
dans les détails. C’est dans ces détails
que le sujet se retrouve, se ressaisit.
Ce peut être une couleur, un oiseau, une
matière, une étoffe, qui vont servir à dire
le trauma, à le faire advenir à nouveau
mais sous forme fragmentée, parce que
le sujet ne peut pas être au centre de
la scène. Il se promène, pour ainsi dire,
au bord du cratère. C’est à cela que me
fait penser le travail d’Angélica Liddell.
Elle pose des balises autour d’un tel
cratère. Elle procède en quelque sorte
à la manière du trauma lui-même: par
déflagration, dispersion de détails, et
reprise à partir de ces détails. Et par les
détails, le sujet revient, de très loin.Un
joyau intact sous le désastre, comme dit
Mallarmé. L’enfance pure.
D. L. : Cethéâtre-là a-t-il des affinités
avec «l’autre scène» de l’inconscient?
A. D. : Liddell est en effet ultrasensible à
une logique de l’être même qui est tout
sauf morale. L’inconscient fonctionne
par plans d’intensité qui n’ont aucun
lien avec la moralité. Angélica Liddell
explore ce genre de terrain, et pour le
dégager, elle dynamite la morale très
systématiquement. C’est comme si elle
retrouvait à sa façon l’une des intuitions
les plus extrêmes de Lévinas, lorsqu’il
signifie qu’il faudrait pousser l’éthique
jusqu’à atteindre ce qu’on pourrait
appeler une hyper-éthique.Angélica
Liddell, pour aller vers cet au-delà de
l’éthique, ne cesse d’aller jusqu’à l’ex-
trême bord: chaque fois qu’on lui
oppose une morale, même très auda-
cieuse, elle la balance, elle la fracasse,
avec une frénésie qui est à la fois réjouis-
sante et terrifiante. Terrifiante, parce
que si on la prend à la lettre, à certains
moments, alors le fait est qu’on ne peut
fonder aucune communauté humaine
sur ces bases.Mais réjouissante aussi,
parce qu’il y a quelque chose qui est
profondément libérateur et vrai dans
ce mouvement.Quelque chose qui,
contrairement à ce qui a beaucoup été
dit sur elle, n’est pas hystérique, même
si ça yressemble!
D. L. : Pourquoi?
A. D. : Parce qu’il y a chez elle une grande
tendresse. Chez l’hystérique, il n’y a
pas de tendresse: l’hystérique passe
son temps à chercher son maître. Alors
que chez Liddell, il y a des moments
d’une tendresse qui me laisse sans
voix.Après la frénésie, les hurlements,
tout à coup cela arrive, cettecompas-
sionqui est paradoxalement toutsauf
de la compassion. Elle n’a aucune com-
passion pour ceux qu’elle accuse, pour
les bourgeois, pour ceux qui ne sont pas
droits, pour tous ceux qui ne luttent pas
pour l’enfance – c’est-à-dire presque
tout le monde. Elle a une tendresse et
un amour fou pour les innocents, ceux
qui gardent, d’une façon ou d’une autre,
l’enfance en eux. Et sa haine pour le reste
de l’humanité, c’est une haine de louve
envers ceux qui menacent cette inno-
cence-là. – C’est comme une mer qui
se retire après un déferlement, et cela
me bouleverse,elle nous donne accès
au cœur, au centre, à l’intouchable, tout
à coup.Les valses, dans son dernier
spectacle, produisaient cette douceur
énorme. Pour réussir cela, cette dou-
ceur et cette violence ensemble, il faut
une forme d’intelligence qui va au-delà
de l’instinct. Il faut une pensée de l’ex-
trême amour. Oui, le cœur est là. Voilà
pourquoi elle me fait penser à Lévinas.
Elle ne veut pas d’un lieu où l’on puisse
se tenir tranquille.
D. L. : L’amour, entendu en ce sens, peut-
il être autre chose qu’extrême?
A. D. : En fait,il me semble qu’on
appelle souvent «amour» toutes les
manières qu’on a de liquider l’amour...
Est-ce trop paradoxal ? Alors disons:
le problème qu’est l’amour, qu’il com-
mence à poser quand il n’est pas dis-
socié du désir. Car l’amour non dissocié
du désir est souvent une chose insup-
portable, intenable, ingérable, subver-
sive. Et donc, l’amour essaie derégler
son compte au désirde la façon la plus
«sympathique» qui soit: par l’harmonie,
par le temps, par la tendresse, dans le
meilleur des cas – ou quand c’est moins
brillant, par la convention, l’habitude,
l’attachement. Mais le désir, c’est l’évi-
dence, ne peut pas être cadenassé.
Il est dans le discontinu là où l’amour
est dans le continu. D’ailleurs, pre-
nez une à une toutes les oppositions,
et vous verrez qu’amour et désir, dans
leurs logiques respectives, s’affrontent
toujours terme à terme. Or je trouve
qu’Angélica Liddell remonte au-delà
de cette opposition. Elle est radicale,
ce qui veut dire qu’elle creuse jusqu’à
la racine de l’amour, jusqu’au point où
il s’enfonce obscurément dans le désir,
où il est hanté par les fantasmes et les
angoisses de la dévoration, de l’aban-
don... toute cette «boue», comme elle
dit, que la civilisation essaie de tami-
ser, de stabiliser, du côté des pulsions
premières de l’être, très profondes et
très archaïques. Le langage, la civilisa-
tion, l’éducation sont des décantations,
des sublimations de ces pulsions. Elles
sont essentielles, bien sûr. Mais les pul-
sions ne disparaissent jamais tout à fait
sans reste.
Propos recueillis par Daniel Loayza
Paris, 20 septembre 2014
Liddell, ou l’enfance ? Liddell, ou la douceur ? On croira peut-être à un paradoxe. Ce n’est pas
l’avis d’Anne Dufourmantelle : à ses yeux, les armes que brandit l’artiste espagnole sont celles
d’un «réalisme magique» où règne en souveraine une invincible innocence. L’auteur d’En cas
d’amour détaille pour nous les raisons de son admiration.
FAIRE CHUCHOTER LES
MORTS DANS LA VOIX
DES VIVANTS
Angélica Liddell © Brigitte Enguérand
Anne Dufourmantelle
Philosophe, psychanalyste, directrice de
collection, Anne Dufourmantelle est née
en 1964. Seule ou en collaboration, elle a
publié une vingtaine d’ouvrages. Dernières
parutions: En cas d’amour. Psychopatho-
logie de la vie amoureuse (Rivages, 2012);
Puissance de la douceur (Payot, 2013);
Se trouver. Dialogue sur les nouvelles
souffrances contemporaines
(avec Laure Leter, Lattès, 2014).

4 5
1965
Georg Baselitz
Die großen Freunde
(Les Grands amis)
Culmination de la série picturale des
«Héros», le tableau a été qualifié
d’élégie tragique sur le paysage perdu
de l’Allemagne.
septembre 1966
Rudolf Schwarzkogler
Action 6, Vienne
Une série de photos hermétiques et
troublantes où une figure enveloppée
de bandelettes manipule divers objets
(dont des fils électriques,
un stéthoscope, une ampoule,
des poulets morts).
30 mai 1969
Joseph Beuys
Iphigenie/Titus
Andronicus, Francfort
Une performance historique sur la
scène du Theater am Turm, associant
Goethe et Shakespeare.
Peter Handke est dans la salle.
19 juin 1970
Günter Brus
Zerreißprobe
(Tentative de déchirement),
Munich
Ultime action de Brus, réalisée en
exil à la suite d’une condamnation en
Autriche à six mois de prison ferme.
2012
Georg Baselitz
Adzer schwarler
L’un des derniers tableaux de
Baselitz, tiré d’une série «à la manière
noire» actuellement exposée à la
Haus der Kunst de Munich.
1965
Günter Brus,
Selbstverstümmelung
(Automutilation), Vienne
Brus, l’un des fondateurs de l’action-
nisme viennois, met en œuvre la souf-
france de son propre corps dans une
performance captée par le cinéaste
Kurt Kren.
Depuis le milieu des années
1980, Thaddaeus Ropac n’a
cessé d’accompagner des
artistes aussi différents que
Beuys, Basquiat, Haring,
Baselitz ou Kiefer. Jusqu’où
un créateur peut-il aller ?
À l’occasion du prochain
spectacle d’Angélica Liddell,
Thaddaeus Ropac nous fait
part de son point de vue.
Daniel Loayza : Un artiste a-t-il tous les
droits ?
Thaddaeus Ropac : Il m’est arrivé
de l’affirmer. Je ne suis pas sûr de
le redire en ces termes aujourd’hui.
Mais pour en parler, prenons des
exemples extrêmes. Quand je pense
aux limites de ce qu’un artiste peut
tenter, les deux premiers noms qui me
viennent à l’esprit, entre tant d’autres,
sont ceux de Günter Brus et de Rudolf
Schwarzkogler, deux figures majeures
de l’actionnisme viennois. En 1970,
Günter Brus a fait une performance,
Zerreißprobe, au cours de laquelle il a
risqué l’écartèlement. La décision de
s’arrêter ou de continuer lui revenait
à lui seul. Le visionnage du film est
impressionnant, encore aujourd’hui.
Après Zerreißprobe, Brus n’a plus
jamais fait de performance. Il est passé
à autre chose, à l’écriture et au dessin.
S’il avait continué dans la même voie,
il se serait probablement tué.
D. L. : Et Rudolf Schwarzkogler?
T. R. : Il s’est défenestré à Vienne le
20 juin 1969, dans des circonstances
obscures. Il avait 29 ans. Selon les
uns, il s’agissait d’une dernière per-
formance extrême, selon d’autres,
d’un suicide. Nous allons ouvrir, le 23
octobre 2014, une exposition dont le
curateur est Jack Pierson, un artiste
américain. Les quatre très jeunes
créateurs new-yorkais qui seront pré-
sentés ont tenu à y intégrer certaines
traces du travail de Schwarzkogler,
en particulier des photographies. De
quel droit pourrait-on juger de ce qu’il
voulait faire, ou de quel droit pou-
vait-on lui interdire de le faire ? Il est
sans doute trop simple, trop rapide et
confortable de déclarer que «tout est
permis». Je préfère dire que l’artiste
a tous les droits, mais au sens où ces
droits lui reviennent, lui appartiennent.
À lui de voir que faire, comment le faire
et jusqu’où. C’est à l’artiste que ce
problème se pose. Le public, lui, doit
l’accompagner, accepter ce qu’il fait.
Cela dit, je suis sûr qu’il y a des limites,
même si elles sont très difficiles à
décrire, et donc à anticiper.
D. L. : Et au théâtre?
T. R. : Il me semble qu’actuellement,
le théâtre et l’art contemporain sont
en train de converger comme jamais
peut-être auparavant. Il y a déjà eu des
moments historiques où leurs domaines
se sont rapprochés, du temps du sur-
réalisme, par exemple. Mais aujourd’hui,
les points d’intersection sont de plus
en plus nombreux. La performance
est devenue une forme d’expression
majeure. Nous avons d’ailleurs réservé
aux arts performatifs l’un des bâtiments
de notre galerie de Pantin, ouverte il y
a deux ans. Je suis très fier d’avoir pu
l’inaugurer en y accueillant les éléments
historiqueset les documents relatifs à
l’Iphigenie/Titus Andronicus de Joseph
Beuys, qui datait de 1969. Le même
espace présente jusqu'au 15 novembre
2014 un jeune artiste britannique,
Oliver Beer: son installationDiabolus in
musica est un ensemble qui fait appel à
des échos sonores, à des projections de
films... Les résonances avec certaines
recherches dramatiques sont d’autant
plus étonnantes que jusqu’ici, très sou-
vent, les artistes ne se connaissaient
pas. Il n’était pas si courant que les
créateurs sortent de leur propre bulle
pour prendre connaissance d’autres
domaines. Mais les choses sont en train
de bouger très vite. J’étais hier à la pre-
mière de Qui a peur de Virginia Woolf?,
d’Edward Albee, mis en scène à Munich
par mon compatriote Martin Kušej...
D. L. : Martin Kušej, que Luc Bondy a
invité à deux reprises à l’Odéon avec
Der Weibsteufel et Die bitteren Tränen
der Petra von Kant...
T. R. : Oui. Ceux qui ont vu ces spectacles
savent déjà que sa façon de travailler l’es-
pace-temps du plateau relève vraiment
de l’art contemporain. Cette fois-ci, la
scénographie était d’un noir opaque, et
les éclairages au néon divisaient l’action
en scènes, ponctuaient en éblouissant.
Kušej est un artiste qui visite beaucoup
les musées et les galeries, et cela se voit.
J’ai eu le privilège de lui présenter Anselm
Kiefer... Même à l’opéra, qui est peut-être
une forme plus conservatrice, un mouve-
ment est amorcé. Un peintre et plasticien
comme Daniel Richter a pu signer une
mise en scène très remarquée de la Lulu
d'Alban Berg. J’ai le sentiment que les
créateurs sont de plus en plus nombreux
à s’observer depuis leurs champs res-
pectifs, avec une curiosité prudente, et à
croiser le théâtre, la performance, les arts
plastiques, la danse, à des niveaux très
intéressants. L’art ne peut jamais échap-
per à un certain esprit de son temps.
D. L. : Vous êtes-vous jamais senti en
danger devant des images, des per-
formances? Avez-vous éprouvé que le
danger, la violence étaient des éléments
nécessaires de certaines œuvres?
T. R. : L’art doit vous émouvoir, d’une
façon ou d’une autre. Cela, c’est la base.
Tout le reste est construit sur cette base.
Ensuite, l’artiste peut partir dans toutes
sortes de directions. Il peut provoquer
ou non, mettre en question, mettre à
l’épreuve, irriter, donner à penser. Il peut
le faire bruyamment ou silencieuse-
ment. Tout est permis au sens où toutes
les voies sont ouvertes. Et parmi elles,
la théâtralité a sans doute une puis-
sance de confrontation et de provoca-
tion presque inévitable. Ce qui fait que
le théâtre a un certain rapport possible à
la douleur, qui fait partie de ses moyens
propres... Joseph Beuys le savait, lui qui
a intégré comme personne avant lui la
théâtralité parmi ses moyens d’expres-
sion. Mais Beuys ne cherchait pas à
vous faire violence, ni à vous mettre en
danger. Il connaissait les côtés les plus
sombres de la vie, mais son art était
aussi, à certains égards, une pratique
quasiment chamanique. Qu’il mette son
propre corps en jeu ou qu’il dessine sur
papier, il visait à nettoyer, à purifier.
À apaiser la souffrance. Mais les voies
sont tellement diverses... Connaissez-
vous Ilya Kabakov? Son travail se nourrit
des pages les plus sombres de l’URSS.
Et pourtant, il nous tient à une cer-
taine distance, comme si nous lisions
un livre ou assistions à un film sur la
cruauté de cette époque. Est-ce que le
théâtre permet ce genre de distance?
Par contraste, Anselm Kiefer provoque
en moi une sensation très différente.
Avec lui, on est confronté à un passé
qui ne passe toujours pas, après toutes
ces années, et qui ne cesse de hanter
l’âme allemande. Même pour moi, un
Autrichien né vingt ans après la guerre,
le miroir qu’il me tend est toujours aussi
actuel... Un dernier exemple. Hier, avant
d’aller au théâtre, j’étais à la Haus der
Kunst de Munich pour une exposi-
tion de peintures récentes de Georg
Baselitz. Baselitz, dès les années 1960,
a peint le «héros allemand», mais tor-
turé, abîmé, dépouillé de son héroïsme.
Ce qu’il nous montre dans son œuvre
nous parle immédiatement. Il ne s’agit
pas de danger physique, ni de provoca-
tion – mais de douleur ou de souffrance,
certainement.
D. L. : Beuys, Kabakov, Kiefer, Baselitz...
Les noms que vous citez sont ceux
d’artistes qui ont un rapport intime à
l’Histoire.
T. R. : C’est vrai. À la violence de
l’Histoire. Mais ce n’est pas une
Histoire à laquelle on puisse assister en
voyeurs. Leur art vous implique, il fait de
vous une partie de l’Histoire – soit un
lecteur, soit un acteur sensible, mais pas
un voyeur. Bien sûr, chez Kabakov, l’im-
plication est d’un tout autre ordre que
chez Kiefer ou Baselitz. Vu mes origines,
leur travail me parvient de façon plus
directe. C’est d’autant plus vrai qu’on
RISQUER L’ÉCARTÈLEMENT
Entretien avec Thaddaeus Ropac
«Lucrece,» quoth he, this night I must
[enjoy thee:
If thou deny, then force must work my way,
For in thy bed I purpose to destroy thee:
That done, some worthless slave of thine
[I’ll slay,
To kill thine honour with thy life’s decay;
And in thy dead arms do I mean
[to place him,
Swearing I slew him, seeing thee
[embrace him.
«So thy surviving husband shall remain
The scornful mark of every open eye;
Thy kinsmen hang their heads
[at this disdain,
Thy issue blurr’d with nameless bastardy:
And thou, the author of their obloquy,
Shalt have thy trespass cited up in rhymes,
And sung by children in succeeding times.»
William Shakespeare: The Rape of Lucrece, stanzas 74-75
4
Joseph Beuys, Iphigenie/Titus Andronicus,
1985, Positif et négatif photographique sur
lm, estampage à la peinture brune, plaques
de verre (107 x 79 x 5 cm)
Thaddaeus Ropac
Né en 1960 à Klagenfurt (Autriche), il fonde
sa première galerie à Salzbourg en 1983.
Sept ans plus tard, il ouvre au cœur du
Marais une deuxième galerie qui s’étend
aujourd’hui sur trois étages d’un immeuble
historique, avant d’inaugurer en 2012, dans
les huit bâtiments d’un ancien site indus-
triel de Pantin, des espaces d’exposition,
un lieu de performances, une salle de
projection ou des ateliers, entre autres.
Il représente aujourd’hui une cinquantaine
d’artistes internationaux.
Galerie Thaddaeus Ropac Marais
7 rue Debelleyme, Paris 3e
Galerie Thaddaeus Ropac Paris Pantin
69 avenue du Général-Leclerc, 93500 Pantin
Plus d’informations sur ropac.net
Il faut que cette nuit je jouisse de toi, chère Lucrèce ; si tu me
refuses, je saurai employer la force ; je t’immole dans mon lit
et j’égorge ensuite un de tes vils esclaves pour t’ôter l’honneur
avec la vie, et je le place dans tes bras morts, jurant que je l’ai
tué en te surprenant à l’embrasser.
De sorte que ton époux deviendra un objet de mépris pour tous
ceux qui le verront. Tes parents baisseront la tête et ta progé-
niture sera souillée par le titre de bâtards. Toi-même, auteur
de leur honte, tu iras à la postérité dans des couplets que les
enfants chanteront à l’avenir.
William Shakespeare : La mort de Lucrèce, in «Œuvres complètes de Shakespeare»,
traduites par Letourneur, nouvelle édition revue et corrigée
par F. Guizot et A. P. traducteur de Lord Byron, Paris, Ladvocat, 1821.
La traduction a été adaptée à la version qui en est donnée dans la pièce
d’Angélica Liddell. (N.d.T.)
a le sentiment aujourd’hui que cette
Histoire dont ils nous parlent n’est sur-
tout pas de l’ordre du passé. On a l'im-
pression que cela pourrait se répéter...
Devant de tels artistes, on ne passe pas
d’une œuvre à l’autre comme on feuil-
lette un magazine. Ils rendent l’Histoire
présente. Avec eux, l’art contempo-
rain est ce qui rend contemporain le
temps lui-même. Je pense à l’extraor-
dinaire série de ces derniers tableaux
de Baselitz que j’ai vus hier. Ils les a
peints au cours des deux dernières
années. L’un d’eux représente un aigle
tombant du ciel, complètement déchi-
queté. Un tournoiement de plumes, bru-
tal, puissant. L’aigle est un symbole très
fort, un emblème qui figure sur le dra-
peau allemand, l’oiseau de Zeus et de
Jupiter. On pourrait dire qu’il est le sym-
bole même de l’Occident. La toile fait
plus de trois mètres sur deux. Le corps
noir du rapace, le bleu-noir du ciel,
luttent et se confondent. On ne peut
plus les séparer. Le titre du tableau,
en langue allemande, confirme cette
impression de chaos tragique: Adzer
schwarler mélange les mots comme
les couleurs le sont sur la toile, car en
allemand, «aigle noir» devrait se dire
Schwarzer Adler. C’est à la fois impres-
sionnant et désespérant. Comme si la
peinture vous vidait de presque tout
votre espoir tout en vous communi-
quant quelque chose de sa force. Et
elle peut faire cet effet parce qu’elle est
présente et restitue au présent le drame
qui se joue. Elle date d’il y a quelques
mois à peine. Comparez-la avec cet
autre grand tableau de Baselitz, Die
großen Freunde, peint il y a presque
un demi-siècle. Les corps sont défor-
més, le drapeau est brûlé. Le paysage
est fait de ruines consumées. Le ciel
est déjà noir. Les mains ne se touchent
pas, les regards ne se croisent pas.
Voilà les «grands amis» selon Baselitz,
voilà le monde où il situe ce qui reste de
l’amitié. Est-ce qu’elle survit ou est-elle
déjà morte? Cinquante ans après, le noir
du ciel a désormais tout envahi, comme
si c’était le ciel lui-même qui tombait,
un tourbillon de ciel en cendres, tout
ce qui reste d’un vol, d’un élan qui vou-
lait s’arracher au monde... Si l’art a par-
tie liée avec la violence, c’est là qu’elle
se situe pour moi. Elle peut être silen-
cieuse, presque invisible si vous passez
sans regarder. Mais le grand art, si vous
consentez à le voir, ne vous fait pas de
cadeau. Il fera tout ce qu’il doit faire pour
vous toucher.
Propos recueillis et traduits
par Daniel Loayza
Paris, 19 septembre 2014
«Il avait 29 ans.
Selon les uns,
il s’agissait
d’une dernière
performance
extrême, selon
d’autres, d’un
suicide.»
3 – 14 décembre / Odéon 6e
YOU ARE
MY DESTINY
(Lo stupro
di Lucrezia)
texte et mise en scène
Angélica Liddell
en espagnol et italien, surtitré
scénographie et costumes
Angélica Liddell
lumière
Carlos Marquerie
son
Antonio Navarro
traduction en français
Christilla Vasserot
traduction en italien
Marilena de Chiara
avec
Joele Anastasi
Fabián Augusto
Ugo Giacomazzi
Julian Isenia
Lola Jiménez
Antonio L. Pedraza
Andrea Lanciotti
Angélica Liddell
Borja López
Emilio Marchese
Antonio Pauletta
Roberto de Sarno
Isaac Torres
Antonio Veneziano
chœur ukrainien
Free Voice : Anatolii Landar,
Oleksii Ievdokimov, Mykhailo
Lytvynenko
production déléguée
Iaquinandi, S.L.
production exécutive
Prospero: Théâtre National de Bretagne
– Rennes, Théâtre de Liège, Emilia
Romagna Teatro Fondazione, Schaubühne
am Lehniner Platz, Göteborgs Stadsteater,
World Theatre Festival Zagreb, Festival of
Athens and Epidaurus
coproduction
Odéon-Théâtre de l’Europe,
Festival d’Automne à Paris, deSingel
campus des arts international – Anvers,
Holland Festival – Amsterdam,
Le Parvis – Scène nationale Tarbes
Pyrénées, Comédie de Valence
– Centre dramatique national Drôme-Ardèche
avec le soutien
de la Comunidad de Madrid, Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte – INAEM
remerciements
Àlex Rigola et Biennale de Venise
créé le
26 septembre 2014 au Théâtre National de
Croatie / World Theatre Festival Zagreb
durée
2h15
certaines scènes de ce spectacle peuvent
heurter la sensibilité des plus jeunes, il est
déconseillé aux moins de 16 ans
avec le Festival d’Automne à Paris
en tournée
Festival de Otoño a Primavera
– Madrid (Espagne)
9 – 11 janvier 2015
Comédie de Valence
23 et 24 janvier 2015

6 7
LES
BIBLIOTHÈQUES
décembre – janvier 2015
OD ON
Couverture de l'ouvrage
Marguerite Duras. L'écriture de la passion
par Laetitia Cenac, éditions de La Martinière,
octobre 2013, réalisée par Floc’h
6
plus de revenir à «cette histoire»). Dans
l'amnésie antérograde, ce sont les évé-
nements postérieurs à l'épisode patho-
logique qui ne sont plus fixés: au-delà
d'un certain point, plus rien ne s'enre-
gistre sur la bande mémorielle. Cécile
souffre d'une forme d'amnésie qui est
à la fois rétrograde (elle ne se rappelle
pas avoir été mariée, ni même avoir eu
des enfants) et antérograde (d'un jour ou
d'une semaine à l'autre, elle ne se sou-
vient pas que Serge vient régulièrement
lui rendre visite).
Nous découvrons son état peu à peu, à
mesure que son mari, répondant à ses
questions, lui fournit les quelques infor-
mations nécessaires à leur stupéfiante
conversation. Lui la tutoie; elle le vou-
voie, puis le tutoie à sa demande, mais
on sent bien qu'elle risque à tout instant
(est-ce simple distraction, ou un effet de
sa maladie ?) de retomber dans le vou-
voiement, ce qui finit d'ailleurs par lui
arriver parfois. Il est pour elle un parfait
inconnu, mais un inconnu qui détient
la clef de sa propre identité, car elle le
croit – malgré sa surprise, elle ne cesse
jamais de lui faire confiance. (Cette sorte
de foi en l'autre, si évidente qu'elle va
sans dire, est-ce là, déjà, une forme de
mémoire d'avant la mémoire ?) Et pour-
tant, de cet «inconnu», son mari, le père
de ses deux enfants également oubliés,
elle ne pense pas même avoir un souve-
nir physique. Cette scène pourrait être
d'une tristesse affreuse; ce qui est bou-
leversant, c'est précisément qu'elle ne
l'est pas. Comme dit Serge: «C'est aga-
çant. Mais c'est pas grave... Il y a des vies
encore plus compliquées que la nôtre...
Faut pas se plaindre...». Et comme dit
Cécile: «Pour moi, j'ai l'impression que
c'est la première fois...»avant de confir-
mer quelques secondes plus tard, après
avoir pris cet homme dans ses bras:
«C'est la première fois».
La distance qui s'est creusée entre
ces deux êtres paraît immense, à la
mesure de l'écart entre la mémoire
et son absence; et de fait, elle ne se
résorbe jamais. Mais c'est comme si,
petit à petit, obscurément, nous décou-
vrions que cet abîme avait un envers,
une sorte de face indicible. Car Cécile–
comme si elle avait oublié son amné-
sie même, comme si cela pouvait servir
à quelque chose – veut tout à coup
savoir «comment on s'aimait […] quand
on s'est mariés». Alors Serge, pour
lui répondre, cherche à lui faire sen-
tir ce qu'est l'amour dans un «couple
ordinaire qui vient de se marier». Et
comme elle ne comprend toujours pas
– comment le pourrait-elle, elle qui ne
se souvient pas même de ce qu'est un
couple ordinaire?– Serge s'arrête, et
Pommerat nous précise qu'il regarde sa
femme dans ses yeux et explose. Voici
les mots de cette explosion :
«Mais non, quand on s'est rencontrés
c'était parfait. On était comme deux moi-
tiés qui s'étaient perdues et qui se retrou-
vaient. C'était merveilleux. C'était comme
si la Corée du Nord et la Corée du Sud
ouvraient leurs frontières et se réuni-
fiaient et que les gens qui avaient été
empêchés de se voir pendant des années
se retrouvaient. C'était la fête, on sentait
qu'on était reliés et que ça remontait très
loin.»
Serge parle de cette «fête» au passé. Mais
ce passé, malgré ce que suggère l'image
des deux Corées, n'est pas simplement
historique. Serge glisse d'un usage tem-
porel de l'imparfait à son usage modal
(dans «c'était parfait» ou «c'était merveil-
leux», l'imparfait renvoie bien au moment
de la rencontre, mais quand il est ques-
tion des Corées qui «ouvraient» leurs
frontières, nous ne sommes plus dans
une chronologie d'événements objec-
tifs, mais dans l'irréalité d'une comparai-
son). Derrière ce passé qui n'en est pas
tout à fait un, quelque chose comme un
outre-temps se laisse entrevoir. Au verbe
«retrouver», que Serge prononce deux
fois, fait écho une longue série allitérante:
rencontrer, réunifier, relier, remonter,
comme s'il y avait retour à un état anté-
rieur – mais cet état n'a jamais eu lieu;
comme s'il y avait répétition d'une unité
primordiale – mais jamais cette singulière
unité ne se sera produite, pas une seule
fois, dans nul passé.
Ce ressurgissement d'un état originel,
figuré à travers l'image si concrète d'une
séparation situable dans l'espace-temps
de notre monde, n'a jamais été présent.
Son temps est celui du mythe dont parle
Aristophane dans Le Banquet de Platon.
Aristophane qui, rappelons-le, raconte
comment les humains de la race primor-
diale, avant d'être coupés en deux sur
l'ordre de Zeus, étaient formés de l'union
de deux humains actuels, donnant ainsi
lieu à «trois catégories d'êtres humains et
non pas deux comme maintenant»: aux
rejetons purement mâles, nés du Soleil,
et au purement femelles, rejetons de la
Terre, s'ajoutait «une troisième <catégo-
rie> qui participait aux deux autres, dont
En feuilletant le texte imprimé de
La Réunification des deux Corées, on
découvre d'abord que chacune des
scènes de la pièce porte un titre. Il y en a
une vingtaine. Leur liste est donnée dans
la table des matières. En voici quelques-
uns, dans le désordre: «Philtre, Argent,
Clés, Amour, Attente». Le spectacle ne
permet pas à son public de deviner l'exis-
tence de ces titres. À l'inverse, la table
des matières ne fait nulle mention de la
présence, dans le spectacle, de «Celui
ou Celle qui chante», mystérieux andro-
gyne qui vient par trois hanter la scène et
y faire résonner «une voix étrange».
Ces titres tournent-ils ou non autour d'un
point central ? Sont-ils comme des poin-
tillés qui tracent peu à peu les contours
d'un domaine partagé? Et quel rapport
avec ce titre général, si bizarre au pre-
mier abord, La Réunification des deux
Corées? Bornons-nous ici à relever que
le seul mot à être répété dans la liste des
titres est le mot «Amour», mais que jus-
tement, cette répétition sert peut-être à
indiquer que l'amour ne permet pas de
couvrir à lui seul tout le champ parcouru
par la pièce (les deux titres en question
sont en effet «Amour» et «L'amour ne
suffit pas»). Et cela dit, concentrons-
nous sur le seul titre qui soit commun au
spectacle et au livre.
Qu'est-ce que «La Séparation des deux
Corées»? Pour l'apprendre, il faut patien-
ter jusqu'au début du dernier tiers du
spectacle. Dans la quatorzième scène,
«Mémoire», Philippe Frécon interprète
Serge, un homme obligé de dire com-
ment il s'appelle à Cécile, sa femme
(Agnès Berthon), qu'il prend soin d'inter-
peller par son prénom. Il ne peut pas faire
autrement: elle semble avoir complète-
ment perdu la mémoire. Dans l'amnésie
rétrograde, le patient ne parvient plus
à récupérer des souvenirs antérieurs
à l'épisode pathologique (qu'il s'agisse
d'une maladie dégénérative, d'une
tumeur ou d'un traumatisme importe
peu ici, et nous ne saurons jamais ce qui
est arrivé à Cécile, car Serge n'en peut
Lire en attendant de voir... Il y a un an, La Réunification des deux Corées faisait salle comble, et les admirateurs de
Joël Pommerat découvraient enfin ce que l’énigme de ce titre signifiait. Son mystère n’est pas pour autant éventé: simplement,
ce titre est maintenant comparable à une clef de chiffrage publique – on a beau savoir ce qu’il veut dire, il reste impossible de
le comprendre à moins d’assister à son tour au spectacle. Le texte de la pièce ayant été publié (Actes-Sud Papiers, 2013), nous
pouvons désormais le feuilleter à notre rythme, scruter le mouvement de chaque scène ou sauter de l’une à l’autre pour opé-
rer notre propre montage. Joël Pommerat, qui n’aime pas se laisser enfermer dans des oppositions trop tranchées, préfère
se définir comme «créateur de spectacles» plutôt que comme auteur ou metteur en scène. Mais il est aussi auteur, même s’il
conçoit son écriture comme une face parmi d’autres d’un travail plus global. Ce travail se laisse approcher par diverses voies
qui se complètent. Le spectateur pourra retrouver La Réunification dès le 10 décembre; d’ici là, le lecteur peut en explorer le
texte en toute liberté, et son plaisir à venir n’y perdra rien.
le nom subsiste aujourd'hui, mais qui,
elle, a disparu. En ce temps-là il y avait en
effet l'androgyne, un genre distinct qui,
pour le nom comme pour la forme, fai-
sait la synthèse des deux autres, le mâle
et la femelle. Aujourd'hui cette catégo-
rie n'existe plus [...]» (Le Banquet, 189e,
trad. Luc Brisson).
À moins d'être poète, personne n'a
conservé la mémoire de «ce temps-là».
À moins d e mét aphores, comment le dési-
gner? Mais dans la perfection de la ren-
contre, il est devenu sensible; sans être
là, il charge pour ainsi dire la présence
de son aura. Serge a rejoint Aristophane;
avec ses mots simples, le vendeur de voi-
tures du début du XXIe siècle a retrouvé
l'intuition d'un grand dramaturge, mis en
scène par un grand philosophe. Il n'en sait
peut-être rien, mais qu'importe: le lien qu'il
énonce remonte «très loin», en amont de
tout savoir, de toute conscience. Et que
Serge soit seul à porter le souvenir de cette
perfection pointant au-delà d'elle-même
n'y change rien. Cette charge, sans doute
écrasante, est sans doute aussi ce qui
l'anime. C'est elle qui le reconduit réguliè-
rement auprès de sa bien-aimée ; et cette
charge, l'amnésique «émue», à défaut de
pouvoir se la remémorer, l'entend.
Quand Cécile demande à Serge s'il
l'aime, il lui répond sans hésiter: «Oui,
absolument.» L'absolu, étymologique-
ment, c'est l'absence de lien; pour ce
«couple ordinaire» qui l'est tellement et
si peu, il faudrait ici préciser: l'absence
de tout lien qu'on puisse couper. Le
temps ne fait rien à l'affaire. «Mémoire»,
en quelques instants, quelques répliques
toutes simples, nous a reconduits sur un
seuil immémorial, là où l'effleurement
d'un corps contre un autre, «un petit
geste de la main, affectueux, presque
involontaire», suffit désormais à tout
résumer. Et c'est ainsi qu'à chaque visite,
au sein de la séparation, les deux amants
se rencontrent, presque comme dans les
contes, pour une nouvelle première fois.
Daniel Loayza
Paris, 25 septembre 2014
Philtre,
Argent,
Clés,
Amour,
Attente.
Un puzzle de
temps.
Retrouver.
Rencontrer.
Réunifier.
Relier.
Remonter.
DES POINTILLÉS
QUI TRACENT
PEU À PEU LES
CONTOURS

8 9
Clémentine Mélois est une artiste née
en 1980. Son travail se compose de
détournements d’images, de références
décalées, d’appropriations visuelles,
de pieds de nez, de clins d’œil et de
glissements sémantiques.
Dans
Cent titres
, elle pastiche par
l’i m a ge l es cl as si qu e s d e l a lit t ér a-
ture et nous présente son étonnante
bibliothèque. Lirons-nous aujourd’hui
Maudit Bic
, d’Herman Melville, ou
Père et Gay
, de Léon Tolstoï ? Au
fait, quel philosophe a-t-il écrit
Le Crépuscule des idoles des jeunes
?
Pour décrypter les anagrammes,
contrepèteries, homophonies, permu-
tations et autres astuces de ces cent
titres, on passera de la culture clas-
sique à la culture populaire, puisant
dans des souvenirs de lectures, de
chansons, de publicités ou de films.
ET POURTANT,
ILS LISENT
ENCORE...
Exer6 2 styl
© Clémentine Mélois
Ce jeu est aussi une façon de s’inter-
roger sur l’esthétique d’une couver-
ture, qui porte une double histoire,
celle de l’œuvre et de son destin, et
aussi celle de l’édition. Le premier
coup d’œil suggère un contenu, par
la typographie employée, par le for-
mat, la composition. À chaque genre
répondent une myriade de codes, qui le
rendent immédiatement identifiable :
fragilité d’un recueil de poèmes,
jaune et noir d’un roman policier,
sobriété d’un «grand» classique… ce
sont les lecteurs qui font les livres.
Cent titres
, éditions Grasset,
préface de Jacques Roubaud.
En librairie le 22 octobre.
http://www.facebook.com/Clementine.Melois
8FAIRE LE VIDE
EN SOI
Pour moi, qui lisais pour la première
fois à voix haute ce texte que je croyais
connaître, ce fut un exercice périlleux où
tout le corps fut obligé de participer, sans
que je m’en rende compte véritablement,
tant j’avais l’impression de remonter à
la nage le cours d’une rivière, contrainte
d’éviter à tout moment les pierres
– petites ou grandes – qui pourraient frei-
ner mon parcours, et il me semblait vital
– sans en connaître les raisons– de pou-
voir être capable d’aller jusqu’au bout.
Ce n’est pas seulement une question
de souffle. C’est une histoire d’appren-
tissage du calme. Faire le vide en soi
pour pouvoir aborder les différents
continents qu’elle explore dans ce texte.
La Vie matérielle est composée de cha-
pitres. Certains pourraient dire que c’est
un recueil de nouvelles. On y passe du
coq à l’âne. Et pourtant quand le texte est
sorti de moi, je n’y ai vu qu’un seul et long
lamento, comme si la substance qu’on
avait à l’intérieur s’écoulait, comme si le
procédé des associations libres, utilisé
en psychanalyse, était à ciel ouvert. Ce
livre peut apparaître comme une confes-
sion, un autoportrait tout morcelé, une
mise à nu. Marguerite Duras y parle de
la vie, de la mort, de l’amour, de la soli-
tude, de la séparation d’avec les autres,
du désir fou de pouvoir les atteindre par
le biais de l’écriture. Son regard, qu’elle
le porte sur un enfant sur une plage de
Normandie ou sur une route pluvieuse
du centre de la France, renvoie toujours
à un éternel ressassement de soi, une
fatigue d’être, mais aussi un espoir de
pouvoir s’en sortir. Alors, bien sûr, il y a
toujours des parades pour faire comme
si. Savoir faire la cuisine et plus par-
ticulièrement la soupe aux poireaux,
savoir tenir une maison, se tenir dans le
monde, faire semblant d’avoir des occu-
pations. Mais être écrivain c’est juste-
ment avoir su couper le lien social, savoir
descendre à l’intérieur de soi, prendre
des risques, sans même être conscient
qu’on les prend. Pouvoir dire les mots de
Marguerite Duras fut une épreuve initia-
tique, un exercice tant physique que psy-
chique, dont je ne sais si je suis sortie
indemne, et qui restera longtemps dans
ma mémoire.
L’écriture de Duras est musicale. Elle-
même le reconnaissait et elle jouait
du piano. Le son de Sonia Wieder-
Athertonet l’étrange mélancolie qui
en émane constitue pour moi non un
accompagnement – Duras n’a pas besoin
d’être accompagnée – mais une sorte
de tissu interstitiel, une affinité secrète,
une résonance magnétique. Ce que nous
tentons de faire ce n’est pas texte et
musiquemais respirations entremêlées.
Laure Adler, janvier 2014,
in «La Vie matérielle»
de Marguerite Duras,
lue par Laure Adler, Naïve livres lus
En 1955, Paul Grimault futur collaborateur
de Jacques Prévert (Le Roi et
l’Oiseau) réalise pour la société «La vache
qui rit», une campagne publicitaire impri-
mée sur papier buvard pour écolier et
reprenant sous un mode humoristique
Les douze travaux d’Hercule
Sonia Wieder-Atherton
© Xavier Arias
Grande salle
LES INATTENDUS
La Vie matérielle
de Marguerite Duras
Lundi 8 décembre / 20h
Lecture musicale de Laure Adler
Accompagnée au violoncelle
par Sonia Wieder-Atherton
Musique, extraits de Vita Monteverdi – Scelsi
Ma bibliothèque aussi s’écrit en pointillé… en raison des livres prêtés que l’on ne m’a jamais
rendus. Quand le rapt est fomenté par un étudiant, je tente de transformer ma déconvenue en
satisfaction, me disant qu’il s’agit là d’une victoire pédagogique. Mais la plupart du temps, je
n’ai pas cette élégance et je maugrée après le pilleur. En fait il ne faudrait pas prêter un livre
mais le donner. Ainsi la bibliothèque ne serait pas démembrée mais ouverte au monde et au
culot des écornifleurs.
Le cauchemar de la bibliothèque est aussi celui du trop-plein… Il est vrai que, volés ou
achetés, la pléthore de livres peut provoquer le malaise. L’Autodidacte, un personnage de
La Nausée est pris de vertige devant les rayonnages de la bibliothèque municipale. Il ne sait
pas par quel livre commencer. Pourtant il lui faut tout avaler. N’en omettre aucun. Alors il sera
méthodique et lira les ouvrages de A à Z. Par noms d’auteurs. Le classement alphabétique
empêchera ainsi tout oubli, en même temps qu’il annulera le plaisir et la liberté qui réside jus-
tement dans le fait de renoncer à telle ou telle œuvre. Ce caprice du lecteur est nécessaire.
Nos choix ou non-choix, nos amours ou désamours forgent notre jugement et, maintenant
celui-ci suspendu, rendent la surprise possible.
Cécile Ladjali, Ma bibliothèque. Lire, écrire, transmettre. Seuil, 2014
Texte publié avec l'aimable autorisation des éditions du Seuil
IL NE FAUDRAIT PAS PRÊTER
UN LIVRE MAIS LE DONNER
salon Roger Blin
MA BIBLIOTHÈQUE IDÉALE
Pour clore le cinquantième anniversaire de la
collection, nous avons demandé à cinq écrivains
de puiser dans le catalogue de la GF-Flammarion
et de constituer leur propre bibliothèque idéale.
Le solitaire
mardi 2 décembre / 18h
en présence de Vincent Delecroix
Le cosmopolite
mardi 13 janvier / 18h
en présence de Dany Laferrière,
de l'Académie française
Cécile Ladjali
Agrégée de lettres modernes,
elle enseigne la littérature à l’Université
de Paris III (Sorbonne Nouvelle).
Elle a publié un essai, Mauvaise langue
(Seuil, 2007), couronné par le prix
Femina pour la défense de la langue
française. Ses romans sont publiés
chez Actes Sud, le dernier paru étant
Shâb ou la nuit (2013).
Cécile Ladjali sera l'invitée,
au salon Roger Blin de
À QUOI TENONS-NOUS VRAIMENT ?
LIRE C'EST VIVRE
jeudi 6 novembre / 18h
Une étude menée aux USA à l’automne
2013 montre que parmi les moins de
trente ans, plus de 88 % ont lu un livre
au cours de l’année, contre 79 % l’année
précédente.
Si la lecture est une activité principa-
lement solitaire, les réseaux sociaux
et les flux d’informations numériques
transforment cette pratique. La lec-
ture se partage aujourd’hui aussi sur
internet, et par effet boule de neige,
partout : quand l’émission télévisée
«La grande librairie», sur France 5,
appelle en septembre 2014 à témoi-
gner sur «le livre qui a changé votre
vie», les réseaux sociaux s’enflamment
et chacun présente son livre fétiche.
Quand on aime un livre et qu’on a envie
d’en parler de manière vivante, quoi
de mieux qu’une vidéo postée sur un
réseau comme Youtube pour partager
ses coups de cœur littéraires ? La vogue
des «Booktubers» – ces jeunes et moins
jeunes qui parlent de livres sur Youtube–
née aux États-Unis, très présente aussi
dans les pays hispanophones, ne semble
pas avoir atteint la francophonie. Et si
vous vous lanciez ?
Au Québec, une initiative lancée sur
Facebook pendant l’été 2014 suggérait
«d’oublier un livre quelque part» pendant
la deuxième semaine de septembre. Le
but étant qu’un inconnu s’empare du
livre «oublié» et découvre à l’intérieur
une petite note expliquant pourquoi
on avait choisi de l’abandonner. 24 000
personnes auraient répondu à l’invitation.
Dans le même esprit, les «petites biblio-
thèques gratuites» (Little Free Library)
ou «biblioboîtes» poussent un peu par-
tout en Amérique du Nord. À Berlin, ces
bibliothèques de rue se rencontrent
aussi très fréquemment. Le principe :
dans une boîte prévue à cet effet et dis-
posée sur la voie publique de la même
manière qu’une boîte à lettres, vous dis-
posez des ouvrages que vous souhaitez
faire lire à d’autres. Le passant peut en
prendre un ou plusieurs, à condition de
disposer à la place un nombre équiva-
lent d’ouvrages.
En Italie, la pratique du don de livre en
librairie est en vogue : Il libro sospeso (le
livre suspendu). On achète un livre qu’on
aime pour qu’il soit donné à la prochaine
personne qui entre dans la librairie, en
laissant pour elle une dédicace sur un
post-it. Il y aurait trois millions d’occur-
rences du hashtag #librosospeso sur
twitter.
source : actualitte.com
salon Roger Blin
MYTHES ET ÉPOPÉES
Heraklès
mercredi 10 décembre / 15h
par Magda Kossidas
accompagnée de Petros Satrazanis
(percussions, cordes)
à partir de 9 ans
Le Chant du
Rossignol Brigand
mercredi 14 janvier / 15h
par Magda Lena Gorska
récit, chant, accordéon
à partir de 10 ans
LE TREIZIÈME DES
TRAVAUX D’HERCULE
Parmi les œuvres du patrimoine oral
de l’humanité, les épopées sont les
plus emblématiques de l’aventure des
hommes. Elles tiennent rassemblées
des communautés en perpétuant
leurs langues, croyances, traditions et
valeurs fondatrices. Si elles parlent
toujours de courage, c’est surtout du
courage silencieux de l’humain face
aux dieux et au destin.
Les mythes quant à eux sont des
récits fondateurs, anonymes et collec-
tifs. Ils servent d’explication du monde.
Ce sont des récits de création et de fin
du monde. Ce sont des faits et gestes de
Après les écuries d’Augias, les oiseaux du lac Stymphale et
les pommes du jardin des Hespérides, Héraclès ouvre le cycle
Mythes et Épopées des Bibliothèques de l’Odéon.
Pour petits et grands monstres, à partir de huit ans.
dieux et de héros. Ce sont encore des
superstitions qui restent puissantes
car les mythologies renferment toute
la poésie et la passion dont est
capable l’esprit humain. CLiO a
construit un cycle épique et mytholo-
gique qui donne à entendre quelques-
uns de ces récits qui ont marqué notre
continent.
Marguerite Duras
Laure Adler
Sonia Wieder-Atherton
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%