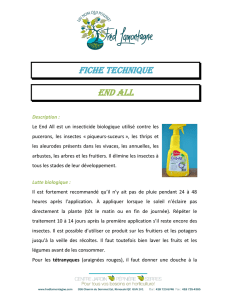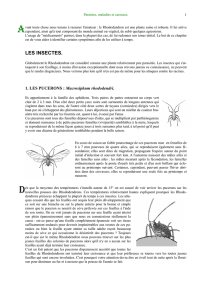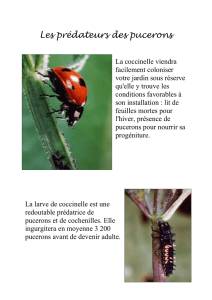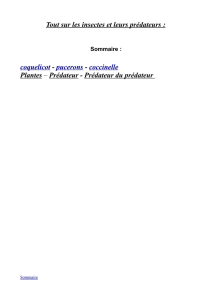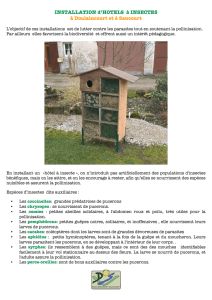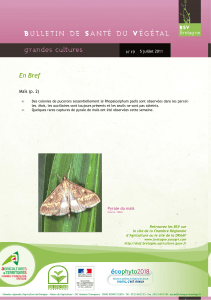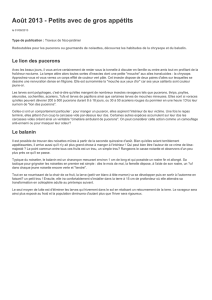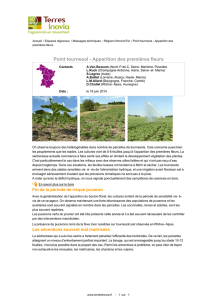05-4 giordanengo

BIOFUTUR 279 • JUILLET-AOÛT 2007 35
L
e phloème est un tissu vivant dont les éléments
fonctionnels majeurs sont les cellules des tubes
criblés, qui transportent les produits de la
photosynthèse. Ils constituent donc une manne
métabolique pour qui saura les localiser et les exploi-
ter durablement de manière concurrentielle par rap-
port aux autres tissus de la plante (racines, fruits,
méristèmes…).
Un pipeline alléchant
L
es caractéristiques majeures de la sève phloémienne,
qui façonnent l’ensemble des adaptations métaboliques
des pucerons, sont les suivantes :
•c’est un fluide intracellulaire, particularité rare pour
l’aliment exclusif d’un animal, les herbivores s’ali-
mentant généralement aux dépens des tissus et
organes des plantes. Outre les conséquences en termes
de composition, la structure de ce tissu nourricier
induit de fortes contraintes quant à la taille des pièces
buccales, et donc de l’animal. Par ailleurs, les consé-
quences de la quasi-stérilité de cet aliment sont évo-
lutivement importantes ;
•c’est un milieu généralement pauvre en protéines.
Il en découle une importance très secondaire de la
digestion protéique, et en retour une sensibilité poten-
tielle de ces insectes aux toxines protéiques ;
•c’est un milieu subissant de grandes variations
compositionnelles, d’origine physique (lumière,
saison…) ou physiologique (stade végétatif, posi-
tion architecturale…) ;
Comment les pucerons
manipulent les plantes
Les pucerons ingèrent la sève alors qu’elle circule dans les vaisseaux du
phloème, grâce à des pièces buccales modifiées en stylets souples percés
d'un canal alimentaire et d'un canal salivaire. Ce dernier leur permet
d'injecter dans les tissus végétaux des sécrétions salivaires jouant un rôle
fondamental dans la recherche, l’acceptation et la manipulation
physiologique des tissus cibles.
Philippe Giordanengo*, Gérard Febvay**, Yvan Rahbé**
* EA3900 Biologie des plantes
et contrôle des insectes
ravageurs, université
de Picardie Jules Vernes,
F-80039, Amiens
philippe.giordanengo@
u-picardie.fr
** UMR203 Biologie
fonctionnelle insectes
et interactions, IFR41,
Inra, Insa-Lyon,
F-69621 Villeurbanne
Pour étudier les différentes étapes conduisant à la prise ali-
mentaire, une électrode pénétrographique (EPG) est collée
sur le dos du puceron.
Électrode (fil d'or de 20 µm de diamètre)
Glue argentique
,
© PLATE-FORME MICROSCOPIQUE/UNIV. PICARDIE
05-4 giordanengo 21/06/07 11:16 Page 35

BIOFUTUR 279 • JUILLET-AOÛT 200736
Dossier
Pucerons, les connaître pour mieux les combattre
•c’est un milieu de transport extrêmement riche
en sucres (source non limitante de carbone
et d’énergie). Cette caractéristique rappelle celle
des fruits et des nectars
(1)
, même si elle en est
écologiquement très différente (faible accessibilité
et relation plante-insecte antagoniste). Cette ponc-
tion à la source du carbone photosynthétique
pose des problèmes majeurs de compatibilité
physiologique (gestion de l’eau et des composés
dissous) ;
•c’est un milieu éventuellement riche mais très désé-
quilibré en acides aminés et particulièrement limité
en acides aminés essentiels non synthétisables par les
animaux. Cette contrainte, aux conséquences méta-
boliques fortes, restreint l’utilisation de cette source
trophique aux insectes disposant d’une flore micro-
bienne symbiotique pouvant complémenter cette
déficience ;
•c’est enfin un milieu quasi exempt de lipides, dont
certains sont également essentiels pour les cellules
animales. Contrairement au cas de la gestion de
l’azote, les pucerons semblent avoir trouvé par eux-
mêmes la solution aux problèmes biosynthétiques
posés par les lipides et les pigments qui y sont appa-
rentés (aphines polycycliques responsables de cer-
taines de leurs couleurs prononcées, hors spectre
jaune couvert par des caroténoïdes). Leur stricte
dépendance vis-à-vis de certains composés végétaux
(stérols) pour la synthèse de leurs hormones impli-
quées dans les processus de croissance et de déve-
loppement (mues) des larves (stades de
développement après l’éclosion de l’œuf qui don-
nent l’adulte), reste cependant un mystère non
résolu…
C
hacune de ces caractéristiques constitue une bar-
rière évolutive importante que les pucerons ont su
lever, seuls ou avec l’aide de partenaires microbiens
(voir p. 49)
.
Un comportement alimentaire évolué
et complexe
L
e puceron insère ses stylets dans les tissus végétaux
et les fait pénétrer entre les cellules jusqu’à atteindre
le phloème. Au cours de ce transit, il réalise diverses
activités et prélèvements extracellulaires, mais éga-
lement des ponctions intracellulaires dans des tis-
sus non nourriciers. Ces prélèvements, qui
s’accompagnent toujours d’une injection de salive,
sont déterminants dans le choix de la plante hôte
(2)
,
ainsi que pour la localisation des stylets dans les
tissus végétaux.
L
es cellules bordant les vaisseaux phloémiens sont
plus ponctionnées que celles des autres tissus, indi-
quant une recherche du phloème par échantillonnage
et la capacité de l'insecte à reconnaître la composition
chimique des différents types cellulaires rencontrés.
Durant cette phase, les organes de l’épipharynx situés
dans la cavité buccale jouent un rôle fondamental dans
la perception gustative. Les principaux stimuli poten-
tiels d’identification du phloème sont le pH, la teneur
en certains sucres et acides aminés, ainsi que le poten-
tiel redox (résultant de la réactivité des composés
chimiques en présence)
(3)
.
C
es différentes phases aboutissant à la prise alimen-
taire des pucerons ont été étudiées par des techniques
analytiques ou comportementales dédiées, comme
la stylectomie (coupure des stylets pour la récolte de
sève) ou l’électropénétrographie (EPG,
figure 1
). Elles
permettent, par exemple, de bien comprendre les
modes de transmission des virus aux végétaux et le
rôle de certaines résistances génétiques des plantes
dans les mécanismes de leur colonisation par ces rava-
geurs
(4, 5)
. L’importance économique des pucerons
repose en partie sur cette étape de sélection de la plante
hôte
(voir pp. 22 et 40)
, comme sur leur exceptionnel
potentiel reproducteur
(voir pp. 49 et 53)
.
Figure 1 Exemples de graphes d’EPG
(électropénétrographie)
Cette technique mise au point par DL McLean,
MG Kinsey (USA) et WF Tjallingii (Pays-Bas)
permet de suivre les activités alimentaires des
pucerons
in situ
. En bleu, un enregistrement
global, analogue à ce que pourrait donner un
électrocardiogramme pour les activités élec-
triques du cœur humain.
Au centre, une coupe transversale de feuille,
avec l’emplacement des stylets et des liens sur
les vues élargies des ondes enregistrées à cha-
cune de ces localisations. Les ondes « C »
constituent les trajets extracellulaires, les « E »
signent l’alimentation phloémienne et les « pd »
(pour
potential drop
, ou chute de potentiel)
accompagnent le franchissement d’une mem-
brane cellulaire en activité. En vert sont repré-
sentées des activités normales, en rouge des
activités signalant des stress locaux, méca-
niques (F) ou trophiques (G).
(d’après Sauvion, 1996, thèse Insa-Lyon,
http://docinsa.insa-lyon.fr/these/pont.php?
id=sauvion)
© DR
(1) ) Douglas AE (2006)
J Exp Bot
57, 747-54
(2) Powell G
et al.
(2006)
Annu Rev Entomol
51, 309-30
(3) Rahbé Y
et al.
(2000)
pp. 212-236 (Walker, G.P.
et al
., Eds.) Thomas Say
Publ., USA
(4) Chen JQ
et al.
(1997)
Eur J Plant Pathol
103, 521-36
(5) Kaloshian I, Walling LL
(2005)
Annu Rev
Phytopathol
43, 491-521
05-4 giordanengo 21/06/07 11:16 Page 36

BIOFUTUR 279 • JUILLET-AOÛT 2007 37
Des insectes « furtifs »
D
’un point de vue évolutif, et contrairement à de nom-
breux insectes ayant une stratégie de « prédateurs »
vis-à-vis des plantes, les pucerons, ainsi que les autres
insectes phloémophages (cochenilles, aleurodes ou
« mouches blanches », psylles…), sont des parasites
(5)
adoptant une stratégie de furtivité. L’enjeu est de ne
pas affronter les principaux mécanismes de défense
développés par les plantes pour se protéger, qu’ils soient
constitutifs (certains composés toxiques) et s’expri-
ment quel que soit l’état de la plante, ou induits par
les blessures cellulaires et les sécrétions diverses occa-
sionnées lors de la prise alimentaire.
C
ependant, nous verrons qu’une interaction très par-
ticulière s’établit entre la plante et le puceron qui semble
être significativement différente de celles engendrées
par d’autres insectes. Comme toujours en biologie, des
exceptions à cette furtivité existent, et la salive des
pucerons peut provoquer des toxémies ou des galles
chez certaines plantes
(voir p. 22)
.
Les réponses de la plante à l'infestation
Le puceron et la plante se reconnaissent très vite
D
ès l’insertion de leurs stylets dans les tissus végétaux,
les pucerons effectuent des prélèvements de contenu
tissulaire qui leur permettent d’identifier les proprié-
tés physico-chimiques de la plante et d’évaluer ainsi sa
compatibilité alimentaire. La première couche cellu-
laire est ponctionnée, ainsi que les cellules bordant
le trajet vers le phloème, tout comme les fluides du
compartiment intercellulaire. Selon l’espèce de puce-
ron et la gamme de plantes susceptibles de l’héber-
ger (souvent très restreinte, parfois très large pour
les espèces d’importance agronomique), les stimuli de
poursuite de l’exploration alimentaire se situent à ces
différents niveaux (temps de réaction allant de la minute
à quelques heures).
À
l’inverse, les activités des stylets durant la recherche
du phloème (salivations extra- et intracellulaires, ponc-
tions cellulaires) peuvent induire des réactions de la
plante dans les quelques minutes suivant la piqûre.
C’est le cas de melons exprimant un gène de défense
(Vat)
(6, 7)
sur lesquels les pucerons présentent des com-
portements alimentaires très perturbés, conduisant
finalement à l’abandon de la plante après l’atteinte du
phloème
(4)
.
Le phloème réagit localement
L
e phloème, quant à lui, contient de nombreuses
protéines phloémiennes (protéines P) intervenant
dans le colmatage des blessures de ce tissu. De la
callose peut également se déposer après plusieurs
minutes et obstruer les vaisseaux, ralentissant for-
tement le flux de sève et empêchant la prise ali-
mentaire des pucerons. L’insertion des stylets dans
des cellules phloémiennes pauvres en calcium s’ac-
compagne au point d’insertion d’un influx de cal-
cium
(figure 2)
, amplifié par l’induction des canaux
calciques facilitant le passage de l’ion à travers la
membrane
(8)
.
C
et influx calcique peut initier des cascades de signa-
lisation à longue distance et ainsi réguler la réponse
systémique de la plante (réponse généralisée à la
plante entière). Chez les Fabacées, les forisomes, des
structures protéiques très sensibles à l’arrivée de cal-
cium, s’y lient pour former de très grosses structures
protéiques capables d’obturer les tubes criblés, stop-
pant immédiatement le flux de nutriments. Chez
d’autres espèces végétales, la capacité des protéines P
à se lier au calcium n’a pas été démontrée, excepté
pour certaines enzymes (protéines kinases)
(9)
. Il
est cependant très probable que la signalisation cal-
cique associée à la balance redox et aux molécules
d’oxygène réactives (H
2
O
2
, OH-…) soient les élé-
ments majeurs contrôlant réponse et tolérance des
cellules du phloème à l’alimentation des pucerons
(8)
.
L’influx de Ca++ a également un effet direct sur la
production de callose, polymère glucidique (1,3-β-
glucane, également majoritaire dans la paroi cellu-
laire des champignons) qui est impliqué dans la
défense à la blessure, et synthétisé par une enzyme
régulée par le calcium.
Alimentation
puceron Contexte génétique
de résistance
Contexte génétique
de compatibilité
Reconnaissance de l'acte alimentaire
par interaction de type gène-à-gène
Reconnaissance de l'acte alimentaire
par dommages spécifiques des pucerons
(parois, cellules ponctionnées, phloème)
Formation de la signalisation des réactions de défense de la plante
gradient d'intensité, résistances +/- fortes
O2 + acide α-linolénique
peroxydes d'acides gras
acide 12-oxodécanoïque
acide 12-oxo-phytodiénoïque
(OPDA)
acide jasmonique
(JA, MeJA)
Défenses chimiques spécifiques des insectes (et/ou des pucerons)
de
g
ré variable de spéci
fi
cité botanique (arsenal toxique plante) ou de cibles (sensibilité de l'insecte)
NO
ET
SA
H2O2, ROS
ABA, GA
dégâts oxydatifs directs
des pucerons
gradient d'intensité ± spécifique anti-pucerons
degré variable de spécificité taxonomique
Protéines PR
signalisation
phloème-spécifique
?
?
?
Calcium
Gènes R (Vat, Mi, Rm, Akr...)
Figure 2 Voies de signalisations déclenchées
chez les plantes par des agressions d’insectes
phloémophages tels que les pucerons
Les métabolites clefs de signalisation figurent en noir (SA :
acide salicylique ; ET : éthylène ; NO : oxyde nitrique ; ABA :
acide abscissique ; GA : acide gibbérellique ; ROS : espèces
réactives de l’oxygène ; MeJA : ester méthylique de l’acide
jasmonique). Certains gènes de résistance (« gènes R »)
contrôlant le déclenchement des cascades de défenses sont
mentionnés en vert.
Les points d’interrogation symbolisent des inconnues ou la
non caractérisation d’une voie (d’après Smith et Boyko, 2007,
doi://10.1111/j.1570-7458.2006.00503.x).
© DR
(6) Silberstein L
et al.
(2003)
Genome
46, 761-73
(7) Dogimont C
et al.
(2003)
Gène de résistance à
Aphis gossypii
. FR 0300287
(Inra, brevet)
(8) Will T
et al.
(2007)
PNAS,
doi: 10.1073/pnas.
0703535104
(9) Yoo BC
et al.
(2002)
J Biol Chem
277, 15325-32
05-4 giordanengo 21/06/07 11:16 Page 37

BIOFUTUR 279 • JUILLET-AOÛT 200738
Dossier
Pucerons, les connaître pour mieux les combattre
La plante réagit globalement
L
’insertion des stylets s’accompagne également de la
libération dans le phloème de molécules d’oxygène
réactives
(10 à 12)
responsables de l'induction d'une
réponse de défense systémique et spécifique, et ce
patron de réaction semble s’appliquer à toutes les dico-
tylédones
(13)
.
L
’attaque par un insecte phytophage de type brouteur,
qui prélève des portions de feuille ou de tige, se traduit
par une activation des voies jasmonates/éthylène, condui-
sant à la production et à l’accumulation de nombreuses
protéines ou de composés secondaires (inhibiteurs de
protéases, polyphénoloxydases, peroxydases, phényl-
propanoïdes…). En revanche, l’attaque par un patho-
gène (virus, bactérie ou champignon) s’accompagne
de la production de radicaux oxygénés actifs et induit
les voies de signalisation du salicylate. Elle conduit éga-
lement à la production locale ou systémique de « patho-
genesis-related proteins » (protéines PR), et s’accompagne
dans certains contextes génétiques de réactions d’hyper-
sensibilité, incluant un syndrome de mort cellulaire pro-
grammée qui limite l’extension de l’infection.
P
ar comparaison aux deux réactions précédentes, l’agres-
sion par les pucerons peut activer partiellement les deux
voies de signalisation décrites
(figure 2)
, mais privilégie
la voie salicylate, se traduisant par la production de pro-
téines PR
(10)
, avec cependant de nombreux cas d’hyper-
sensibilité sous contrôle génétique simple
(14)
. En plus de
l’implication majeure de l’une de ces deux voies cano-
niques, d’autres gènes activés montrent une réponse
systémique spécifique au compartiment phloémien de la
plante
(12)
. Ainsi, malgré la similitude avec la réponse aux
pathogènes, l’agression aphidienne semble induire chez
la plante une réponse spécifique qui reste à déchiffrer.
Sensibles à divers effecteurs de la voie des jasmonate/éthy-
lène, comme certaines enzymes ou inhibiteurs de pro-
téases, les pucerons tentent d’en limiter l’induction.
La manipulation de la plante
par les pucerons
Contournement des défenses induites
L
ors des phases de piqûre de sondage et de pénétration
dans le phloème, les pucerons relarguent plusieurs types
de salive
(figure 3)
jouant un rôle fondamental dans l’ac-
ceptation de la plante hôte
(15, 16)
. À la surface de la
plante, les pucerons déposent une petite quantité de
salive gélifiante ; cette salive, sécrétée ensuite en continu
lors du cheminement des stylets entre les cellules, forme
une gaine qui isole ces derniers des tissus de la plante.
Outre un hypothétique rôle mécanique, cette gaine joue
un rôle de barrière chimique limitant les flux calciques
transmembranaires impliqués dans la réponse rapide
des plantes à la pénétration des stylets dans les vaisseaux
phloémiens
(8)
, mais probablement également aux espèces
réactives de l’oxygène.
L
a salive liquide constitue le deuxième type de salive
produit par les pucerons. Lorsqu’un puceron effectue
une ponction, par exemple de sève élaborée, il injecte
en premier lieu de la salive liquide dans les vaisseaux du
phloème. À cet instant, la valve du canal alimentaire se
ferme, empêchant l’ingestion de sève
(17)
. La salive liquide
joue une part importante dans le contournement des
défenses immédiates de la cellule végétale. Elle pourrait
se lier au calcium ou à l’oxygène actif, inhibant ainsi
leur rôle dans la coagulation des protéines phloémiennes
ou les dépôts de callose. Elle pourrait également inhi-
ber directement la coagulation des protéines phloé-
miennes ou même hydrolyser la callose
(8)
. Une fonction
digestive est par ailleurs soupçonnée pour cette salive,
car une fraction du flux sécrété dans la cellule phloé-
mienne est vraisemblablement ingérée par l’insecte via
le flux alimentaire entrant
(17) (figure 3)
.
Altérations métaboliques
A
fin de compenser en partie les carences composi-
tionnelles de la sève phloémienne, les pucerons sont
capables d'accroître le flux de phloème, mais aussi d'in-
duire une augmentation systémique des taux d'acides
aminés circulants, dont les acides aminés essentiels. En
outre, ils semblent également capables d’induire une
accumulation phloémienne locale de glucides, aux
dépens des autres tissus de la plante
(18)
. Cette mani-
pulation trophique se manifeste de façon exacerbée
dans le cas des pucerons galligènes, étudiés depuis long-
temps pour leur manipulation locale et systémique de
la signalisation hormonale de l’hôte.
P
arce qu’ils s’alimentent exclusivement aux dépens de
la sève élaborée des plantes, les pucerons ont développé
tout un arsenal d’adaptations tant morphologiques
que physiologiques leur permettant d’exploiter cette
ressource trophique difficilement accessible, aux pro-
priétés physico-chimiques très particulières et siège de
l’expression des mécanismes de résistance systémique
induite (distribution des signaux de défense à l’échelle
de la plante). Du fait de l’intimité de cette interaction,
le modèle puceron-plante constitue un exemple main-
tenant bien étudié de coévolution plante-insecte.
Phloème
Tube criblé
salive intracellulaire phloémienne
salive de piqure intracellulairesalive extracellulaire de la gaine
salive liquide réingérée
Stylets
3
2
4
Puceron
2
3
4
1
1
Cellule
compagne
Plante
Épiderme
Rostre
Figure 3 Les quatre salives des pucerons
détectées par EPG
Une salive gélifiante extracellulaire (cercle plein) et trois
salives liquides injectées dans les cellules (cercles vides).
Seule l’une d’entre elles possède une fonction digestive
potentielle (4) (d’après Tjallingii WF, 2006).
© DR
(10) Moran PJ, Thompson
GA (2001)
Plant Physiol
125,
1074-85
(11)
Thompson GA, Goggin FL
(2006)
J Exp Bot
57,
755-66
(12) Divol F
et al.
(2005)
Plant Mol Biol
57, 517-40
(13) Kehr J (2006)
J Exp Bot
57, 767-74
(14) Sauge MH
et al.
(2006)
Oikos
113, 305-313
(15) Miles PW (1999)
Biol Rev
74, 41-85
(16) Cherqui A, Tjallingii WF
(2000)
J Insect Physiol
46,
1177-86
(17) Tjallingii WF (2006)
J Exp Bot
57, 739-45,
doi://10.1093/jxb/erj088
(18) Girousse C
et al.
(2003)
New Phytologist
157, 83-92
Pour en savoir plus
www.biocel.versailles.inra.fr/phloem/index.html
http://jxb.oxfordjournals.org/content/vol57/issue4
05-4 giordanengo 21/06/07 11:16 Page 38
1
/
4
100%