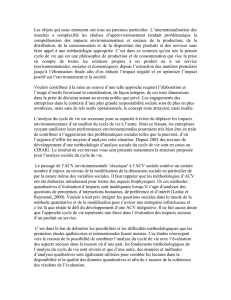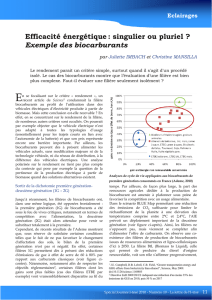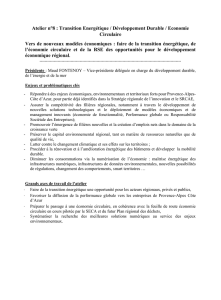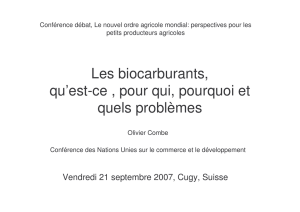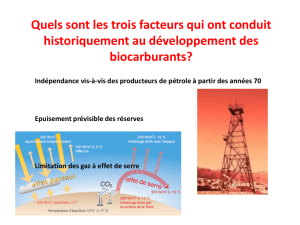1
Les biocarburants au Cameroun : une approche par la méthode
Analyse Cycle de Vie.
Biofuels in Cameroon. A life cycle analysis
Pierre Rolland ATANGANA

2
Résumé : Le développement des biocarburants comme substitut aux
carburants fossiles compte parmi les enjeux importants de ce début de siècle.
Ces enjeux concernent la sécurité alimentaire, l’épuisement de stocks des
énergies fossiles et le réchauffement climatique.
Au Cameroun, la stratégie gouvernementale consiste en la production de
biocarburants à partir des « huiles de palme » sans faire référence aux sources
cellulosiques. La raison invoquée pour justifier la stratégie, au-delà du
renchérissement du prix des produits pétroliers serait l’étendue des surfaces
cultivables et la réduction de la pauvreté en milieu rural.
On peut cependant questionner ces motifs, en tenant compte du fait que
certaines études portant sur l’impact environnemental de biocarburants issus
de source cellulosique présentent un bilan environnemental plutôt satisfaisant
par rapport à ceux de source agricole. Aujourd’hui, le bilan énergétique et
environnemental semble en voie de devenir une base décisionnelle importante
pour l’adoption ou le rejet du développement d’une filière de biocarburants.
Certes, certaines filières de biocarburants ne présentent pas actuellement de
bénéfices économiques suffisants pour leur adoption en dépit de leur bilan
énergétique et/ou environnemental avantageux mais, doit-on pour autant les
abandonner ? C’est dans cette perspective que l’analyse du cycle de vie
(ACV) nous a paru utile comme outil d’aide à la décision.
Le modèle ACV sous l’approche de l’équilibre partiel nous a permis de faire
une analyse comparative et objective sur la production des biocarburants
pouvant être compatible à la fois sur le plan économique et environnemental.
Elle nous a permis de constater que le gouvernement du Cameroun a appuyé
son orientation sur des choix beaucoup plus politiques, et économiques
qu’environnementaux.
Mots clés : Agriculture, biocarburants, Biomasse, Ecobilan, ACV

3
Abstract:
The development of biofuels as a substitute for fossil fuels is one of
the most important issues of the beginning of the century. These issues
concern food safety, the depletion of fossil energy and global warming.
In Cameroon, the government's strategy consists in producing only palm oil
biofuels without considering potential cellulosic sources. The reason invoked to
justify this strategy, beyond the increase in oil products prices, is the availability
of vast cultivable land and the reduction of poverty in rural areas.
We can however question these motives, considering that certain studies of
the environmental impact of cellulosic biofuels have shown that the carbon
footprint of the latter is rather satisfactory compared to that of agricultural
biofuels. Nowadays, the energy and environment balance is on the way to
become an important decision-making criterion for adopting or rejecting the
development of a biofuels industry. Admittedly, some biofuels industries are not
economically profitable enough to be adopted despite their advantageous
energy/environment balance. Yet, is this reason enough to give them up? In
this perspective, the Life Cycle Analysis appears to be useful as a decision-
making tool.
The LCA model under the partial equilibrum approch allowed us to make a
comparative and objective analysis of biofuels production that are likely to be
compatible both economically and environmentally. Our findings show that the
Cameroon government's strategy is driven more by politics and economics
than by concerns about the environment.
Keyword : Agriculture, biofuel, biomass, bioenergy, crops energy, LCA

4

5
Au cours des deux dernières décennies, la hausse des cours pétroliers et les
angoisses environnementales ont poussé la plupart des Etats du globe à
s’intéresser aux formes alternatives d’énergie. Motivé par ces facteurs, et par
d’autres enjeux comme la fourniture et l’accès à l’énergie et le développement
d’autres filières énergétiques alternatives, le gouvernement du Cameroun
inscrivait en 2001, le redressement du secteur énergétique dans son agenda.
Le développement des filières de biocarburants comme substitut aux
carburants fossiles comptait parmi les enjeux traités.
Malgré ces bravades, la production totale du Cameroun reste encore à un
niveau insignifiant. La stratégie énonce que, le gouvernement camerounais
privilégiera la production de biocarburants à partir de sources agricoles
notamment dans le cadre du projet « palmier à huile
1
» plutôt qu’à partir de
sources cellulosiques.
1
Aujourd’hui, dans le cadre de la production des biocarburants, les besoins en huile de palme de
l’Europe se sont élevés d’autant plus que celle-ci est déjà utilisée pour l’alimentation et les produits
cosmétiques. Ainsi, depuis un certain nombre d’années, les forêts primaires tropicales sont remplacées
par des palmeraies. Souvent brûlées, les forêts subissent un rythme de déforestation élevé alourdissant
ainsi la facture climatique.
Sur le plan écologique, l’écosystème se dégrade (symbole de ce drame, la menace sur plusieurs espèces
de singes, les orang-outants, les gibbons, qui voient leurs territoires disparaître). Ce sont aussi des
milieux vivants uniques, riches et irremplaçables qui disparaissent. Sur le plan économique et social,
l’exploitation très rentable des palmiers à huile attire les agro-investisseurs qui par spoliation des terres
des paysans locaux, s’approprient les territoires et remplacent la forêt primaire nourricière par des
monocultures de palmiers à huile. Par spoliation, cela traduit en fait que les habitants traditionnels n’ont
souvent pas de titre de propriété, ils ont toujours vécu là et, se font chasser de leur lieu de vie, sans que
leur Etat ne les défende d’aucune façon. De graves conflits fonciers opposent exploitants et populations
locales, auxquelles des terres sont confisquées sans compensation. Les pays concernés par cette
déforestation massive sont nombreux : Honduras, Colombie, Malaisie, Nigéria, Indonésie, Cameroun,
République Démocratique du Congo.
Cette conversion se poursuit, avec l’assentiment d’acteurs influents. Le Cameroun a lancé depuis 2001,
un projet de palmiers à huile avec l’aide active de la France, du FMI et de la Banque Mondiale (1% de
forêt est perdu chaque année). En Colombie, les déplacements de populations ont généré des problèmes
similaires. L’Indonésie a déjà perdu 72% de ses forêts. En république Démocratique du Congo, pays qui
contient 63% des forêts d’Afrique Centrale, la société chinoise de télécommunication ZTE international
développe un projet de production et d’exploitation de l’huile de palme (30% des forêts de ce pays soit 15
millions d’hectares sont légalement sous contrat avec des compagnies forestières. Au Cameroun, les
palmeraies du groupe français Bolloré s’étendent pour combler le déficit d’huile de palme, mais aussi
pour produire des biocarburants. Localement, le développement des plantations à huile de palme suscite
aussi des oppositions. A MBAMBOU, les riverains ont protesté, il y a quelques mois, contre l’occupation
de 7.500 hectares de terres que l’Etat a rétrocédées à la SOCAPALM pour étendre ses palmeraies. Ils
estiment que ces terres leur appartiennent et qu’ils ont donc le droit de les cultiver.
Mais, faute de disposer de titres fonciers en bonne et due forme, leurs revendications n’aboutissent pas.
Les autorités administratives de la localité leur ont signifié qu’ils n’avaient aucun droit à faire valoir sur ces
terres, mais que la société leur réservera des espaces pour les cultures vivrières.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
1
/
34
100%