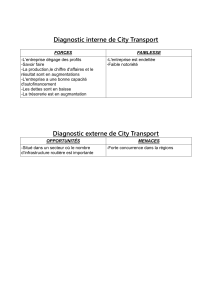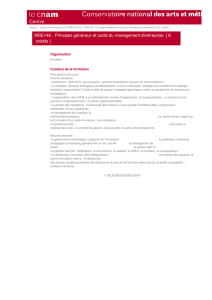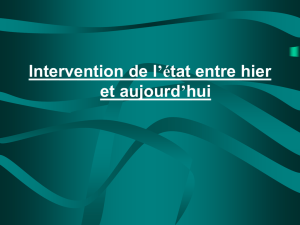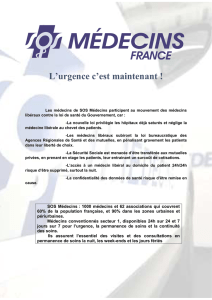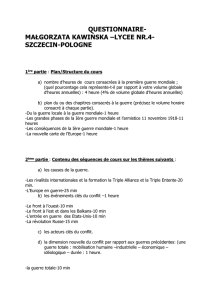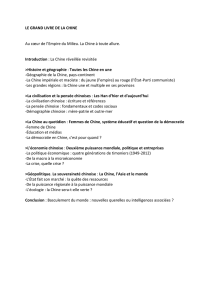II . Un lien père/ fille rompu (correction)
Entre le père et sa fille :
-le dialogue est rompu : « On mangeait sans parler » (l3)
-la communication est devenue impossible : « Il n’osait plus me raconter les histoires de son
enfance » (l5)
Le père semble craindre le jugement de sa fille comme le souligne l’expression « n’osait
plus ». Le père d’Annie se désintéresse d’ailleurs de ses études et refuse d’y accorder de
l’intérêt : « il refusait de faire mine de s’y intéresser » (l7/8).
Le père de famille adopte une attitude fermée, caractérisée par
-la colère « il se fâchait » (l8), « il s’énervait » (l12)
-la crainte qu’on ne prenne sa fille pour une paresseuse : « il craignait qu’on ne me prenne pour une
paresseuse et lui pour un crâneur » (l23/24)
-de la gêne face aux gens du même milieu social que lui : «devant la famille, les clients, de la gêne,
presque de la honte (…) » (l19/20). Il se justifie d’ailleurs du fait que sa fille fasse des études « comme
une excuse » (l23). Il affirme « On ne l’a jamais poussée, elle avait ça dans elle ». On peut noter dans
cette dernière phrase la construction grammaticale incorrecte avec l’emploi de la proposition
« dans » à la place de « en », qui trahit le manque d’instruction du petit commerçant.
Je retiens
Dans ce texte , Annie Ernaux se questionne sur la complexité des liens familiaux, notamment sur
les relations père-fille en replongeant dans son propre passé. Elle redevient dans son récit
autobiographique l’adolescente de dix-sept ans incomprise de son père. Son récit se nourrit donc
de son vécu personnel, de son histoire familiale. L’autobiographie devient ici le lieu du
questionnement sur les origines, le parcours personnel.
1
/
1
100%