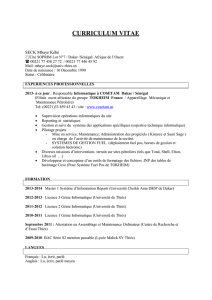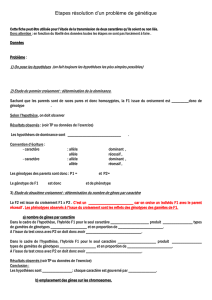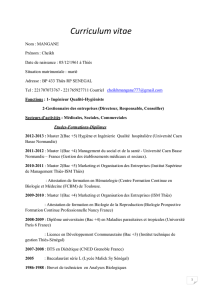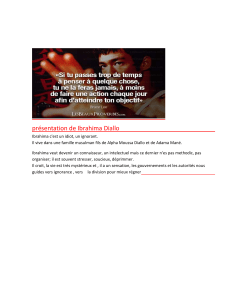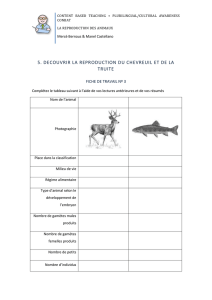Fascicule-SVT- Terminale-S2 NGOMlkjjli-2
genetique (Université Cheikh Anta Diop)
Scan to open on Studocu
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Fascicule-SVT- Terminale-S2 NGOMlkjjli-2
genetique (Université Cheikh Anta Diop)
Scan to open on Studocu
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Serigne DIALLO ([email protected])
lOMoARcPSD|58545447

M. NGOM, professeur au lycée Ahmadou Ndack Seck de thiès/:/ Cahier de SVT – Terminale S2 Page 1
ORGANISATION DU SYSTÈME NERVEUX CÉRÉBRO-SPINAL DES mammifères
INTRODUCTION
Pour se mouvoir et assurer leur survie, les animaux doivent être
informés de l’état du milieu extérieur dans lequel ils sont situés.
Le système nerveux (SN) assure le rôle de coordination de
l’ensemble de nos mouvements ou comportements.
Le système nerveux des mammifères comprend deux parties :
- Le système nerveux central ou névraxe ou S.N cérébro-spinal
qui est formé par l’encéphale et la moelle épinière.
- Le système nerveux périphérique qui est formé par les nerfs
qui sont distribués dans tous les organes.
I. LE SYSTÈME NERVEUX CENTRAL (OU CÉRÉBRO-SPINAL) :
C’est le système nerveux de commande, le centre de commande. Il contrôle l’ensemble des organes et
coordonnes les mouvements et comportements. Il comprend l’encéphale et la moelle épinière.
A. ORGANISATION DE L’ENCÉPHALE :
L’encéphale est la partie du système nerveux central logé dans la boîte crânienne qui est osseuse.
L’encéphale et la moelle épinière sont enveloppés par trois membranes appelées les méninges qui sont de
l’extérieur vers l’intérieur :
- La dure-mère : qui est collée à la paroi interne osseuse du crâne. Elle est épaisse, fibreuse et résistante.
Elle joue le rôle de protection de l’encéphale.
- L’arachnoïde : qui tapisse la face interne de la dure-mère. Elle a la structure d’une toile d’araignée, d’où
son nom. Elle contient des cavités dans lesquelles circule le liquide céphalo-rachidien qui permet d’amortir
les chocs mécaniques de l’encéphale contre l’os du crâne.
- La pie-mère : qui tapisse toute la surface de l’encéphale en épousant étroitement les replis, scissures et
circonvolutions. Elle est très fine et richement vascularisée. Elle joue un rôle nourricier.
1. Morphologie externe de l’encéphale
1.1. Organisation de la face dorsale ou supérieure de l’encéphale :
D’avant en arrière, on distingue : le cerveau, le cervelet et le bulbe
rachidien.
- Le cerveau :
C’est l’étage le plus élevé dans la hiérarchie structurale et
fonctionnelle du système nerveux central. C’est la région de
l’encéphale la plus développée.
Le cerveau est constitué de deux hémisphères cérébraux séparés
par un sillon inter-hémisphérique. Chaque hémisphère cérébral est
parcouru de nombreux sillons cérébraux délimitant des
circonvolutions cérébrales. Deux grands sillons visibles se
distinguent nettement des autres : la scissure de Rolando, séparant
le lobe frontal et le lobe pariétal ; et la scissure de Sylvius qui
délimite le lobe temporal.
Le cerveau est divisé anatomiquement en lobes et
fonctionnellement en des aires. Il est divisé en 5 lobes dans chaque hémisphère cérébral : lobe frontal, lobe
pariétal, lobe occipital, lobe temporal et le lobe insulaire. Le lobe insulaire ou insula ne se voit pas à
l’extérieur, il est recouvert par les lobes temporal et pariétal.
Thème I
Downloaded by Serigne DIALLO ([email protected])
lOMoARcPSD|58545447

M. NGOM, professeur au lycée Ahmadou Ndack Seck de thiès/:/ Cahier de SVT – Terminale S2 Page 73
2- Le Fonctionnement du pancréas :
Des expériences ont montré que le pancréas joue un rôle dans
la digestion des aliments en sécrétant le suc pancréatique.
a) La ligature des canaux pancréatiques d’un animal
provoque des troubles digestifs par dégénérescence des
acini. Les sucs pancréatiques sont élaborés par les acini et
déversés dans la lumière du tube digestif par
l’intermédiaire des canaux pancréatiques. Dans ce cas, le
pancréas est une glande exocrine.
b) Une pancréatectomie totale entraîne, en plus des
troubles digestifs, l’apparition des symptômes du diabète
et on note au niveau de cet individu une hyperglycémie,
c’est à dire le taux de glucose dans le sang dépasse
largement le taux normal (1g/l).
c) Sur le cou d’un chien pancréatectomisé, on greffe un
fragment de pancréas ; lorsque les connections vasculaires sont rétablies, les troubles du diabète
disparaissent.
d) Si on injecte régulièrement à un chien pancréatectomisé des extraits pancréatiques, on fait disparaître
les troubles du diabète.
Downloaded by Serigne DIALLO ([email protected])
lOMoARcPSD|58545447

M. NGOM, professeur au lycée Ahmadou Ndack Seck de thiès/:/ Cahier de SVT – Terminale S2 Page 74
Ces expériences confirment l’idée selon laquelle le pancréas joue un rôle dans la régulation de la glycémie. Il
agit par l’intermédiaire de substances déversées dans le sang : hormone.
Remarque : Pour mettre en évidence la fonction endocrine d’un organe, on procède à des expériences
d’ablation, des greffes et d’injections d’extraits de l’organe
e) La destruction des îlots de Langerhans entraîne l’apparition du diabète ou une hypoglycémie. On peut
en conclure que, dans le pancréas, ce sont ces îlots qui interviennent dans la régulation de la glycémie.
En effets ces îlots sécrètent deux hormones : l’insuline, hormone hypoglycémiante, et le glucagon qui
a une action hyperglycémiante.
f) La destruction sélective des cellules entraîne une hyperglycémie alors que celle des cellules est
suivie d’une hypoglycémie. Ces informations nous permettent de dire que les cellules sont
responsables de la sécrétion de l’insuline alors que les cellules sécrètent le glucagon.
Le pancréas est ainsi une glande à la fois endocrine et exocrine, c’est donc une glande mixte.
IV- Rôle du système nerveux dans la régulation de la glycémie
Un taux élevé de glucagon dans le sang provoque la stimulation de la sécrétion de l’insuline : on parle
d’« autorégulation ». C’est une régulation hormonale, mais qui est sous le contrôle du système nerveux
central.
Expériences :
Le sang du chien A perfuse
la tête du chien B qui n’est
reliée au reste de son
corps que par le nerf X. Le
sang du pancréas du chien
B passe dans la circulation
sanguine du chien C.
On ajoute du glucose dans
le sang du chien A et on
constate une hypoglycémie
chez le chien C.
Downloaded by Serigne DIALLO ([email protected])
lOMoARcPSD|58545447

M. NGOM, professeur au lycée Ahmadou Ndack Seck de thiès/:/ Cahier de SVT – Terminale S2 Page 75
Interprétation :
Le sang hyperglycémiant du chien A circulant dans la tête du chien B stimule les centres nerveux de l’insuline.
Par l’intermédiaire du nerf X, ces centres stimulent la sécrétion de l’insuline par le pancréas du chien B. Ainsi le
sang du pancréas du chien B riche en insuline en passant dans le chien C, provoque une hypoglycémie.
La destruction du Thalamus du chien B entraîne une hyperglycémie. Donc les centres insulino-sécréteurs sont
localisés au niveau du thalamus.
Cette expérience montre que le système nerveux intervient dans la régulation de la glycémie.
1. Action du système nerveux neuro-végétatif :
Une stimulation du nerf pneumogastrique (nerf X) (parasympathique) innervant le pancréas, entraine une
libération massive d’insuline qui provoque une hypoglycémie.
L’excitation de certaines zones bulbaire dites zones insulino-sécrétrices entraine une hypoglycémie. Ces
zones possèdent des cellules nerveuses ayant des récepteurs sensibles aux variations de la glycémie.
La stimulation du nerf splanchnique (nerf orthosympathique qui innerve les intestins) provoque une
hyperglycémie temporaire. Cette action s’explique par le fait que l’excitation de ce nerf entraine une
libération d’adrénaline (par la médullosurrénale) qui provoque une glycogénolyse hépatique faisant
augmenter le taux de glycose sanguin.
On remarque que la régulation nerveuse de la glycémie fait intervenir l’action d’hormone. On parle d’une
régulation neuro-hormonale.
2. Action du complexe hypothalamo-hypophysaire.
Chez un animal diabétique ou pancréatectomisé, on note une hyperglycémie. L’hypophysectomie corrige la
glycémie. Dans ce cas, tout se passe comme si l’absence de la fonction hypoglycémiante du pancréas est
compensée par l’absence de l’hypophyse. Cette dernière, de par sa présence, joue une fonction
hyperglycémiante. Une hyper-sécrétion d’hormone anté-hypophysaire entraine une hyperglycémie. C’est
ce qu’on observe chez les diabètes hypophysaires.
En effet l’antéhypophyse sécrète, sous l’effet de l’excitation de l’hypothalamus, une hormone capable de
favoriser la glycogénolyse. Cette hormone antéhypophysaire est appelée la STH (hormone somatotrope) ou
GH (growth hormone) = hormone de croissance.
La STH ou GH peut inhiber la fixation de l’insuline sur les cellules cibles mais en même temps elle favorise la
sécrétion de glucagon. C’est une hormone hyperglycémiante.
Pour ce qui concerne l’hypothalamus, son action sur la glycémie est indirecte. En effet il agit sur l’anté-
hypophyse ou le bulbe (contenant des zones insulino-sécrétrices)
Downloaded by Serigne DIALLO ([email protected])
lOMoARcPSD|58545447
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
1
/
150
100%