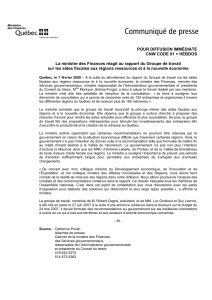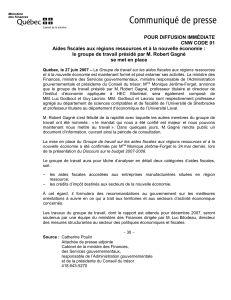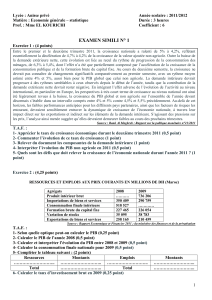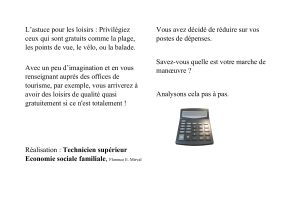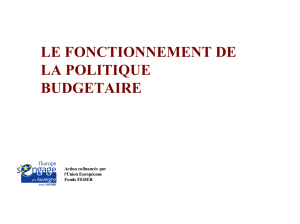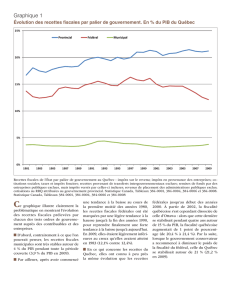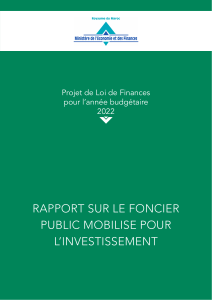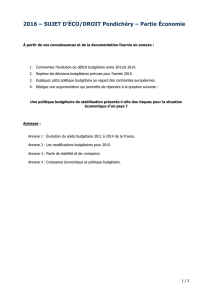Contribution des recettes non fiscales aux dépenses publiques en RDC
Telechargé par
ntambwetshibangu111

1
INTRODUCTION
1. Etat de la question
Les finances publiques peuvent être définies comme l’aspect des
sciences économiques qui s’occupe de la gestion des recettes et des dépenses
publiques. L’objectif fondamental d’une gestion rationnelle des finances publiques
est la maximisation des recettes publiques pour permettre à l’Etat de faire face à
ses obligations telles que les investissements en infrastructures publiques (routes,
écoles, aéroports…), la rémunération des agents de l’Administration Publique.
Il existe plusieurs sortes des recettes publiques. Ainsi, nous distinguons
les recettes fiscales, les recettes non fiscales et extraordinaires.
Les recettes fiscales sont reparties en recettes d’impôt dont la recette est
confiée à la Direction Générale des Impôts (DGI) et les recettes des douanes et
accises qui sont sous la responsabilité de la Direction Générale de Douane et
Accises (DGDA). La Direction Générale des Recettes Administrative, Domaniale,
judiciaire, et de participation s’occupe des recettes non fiscales.
L’ensemble des recettes fiscales et non fiscales constituent ce qu’on
appelle les recettes publiques courantes.
Il apparait ainsi que les recettes publiques courantes en République
Démocratique du Congo (RDC) sont sous la responsabilité de trois régies
financières qui sont : la DGI, DGDA, et DGRAD.
Elles ont comme mission commune la maximisation des recettes
publiques courantes dans le but de couvrir les dépenses publiques courantes.
En mars 2003, le Gouvernement congolais a procédé à la réforme fiscale
dans le but d’augmenter les recettes générées par la DGI. Ainsi, fut créé notamment
la Direction des Grandes Entreprises et l’instauration de la TVA en 2012 pour
rendre plus efficace la DGI. Il en est de même de l’instauration du guichet unique
au sein de la DGDA.
Ces différentes mesures ont eu pour conséquence l’augmentation des
recettes fiscales de la RDC.

2
2. Problématique et hypothèses de l’étude
2.1. Problématique
Le travail que nous proposons de réaliser voudrait analyser et
comprendre la place et l’importance des recettes non fiscales dans l’optique de
changement intervenu, en RDC, dans la gestion des finances publiques en général,
et plus particulièrement dans la gestion des recettes publiques courantes en
particulier.
Nous avons focalisé notre travail sur la DGRAD qui a la charge de
mobiliser les recettes non fiscales.
Il s’agit pour nous de répondre à la question principale suivante :
- Quel jugement pouvons-nous porter sur la contribution des recettes non
fiscales dans la couverture des dépenses publiques courantes en RDC ?
Cette question principale est accompagnée des questions secondaires
suivantes :
- comment les recettes non fiscales et les dépenses publiques courantes ont -
elles évolué ?
- comment le taux de couverture de dépenses publiques courantes par les
recettes non fiscales a - t- il évolué pendant la période sous étude ?
2.2. Hypothèse
L’hypothèse est une réponse ou une série des réponses provisoires aux
questions posées dans la problématique. Elle a pour but d’orienter le chercheur dans
sa démarche. Ainsi, elle sera confirmée ou infirmée au terme du travail.
Nous partons de l’hypothèse selon laquelle la contribution des recettes
fiscales dans la couverture des dépenses publiques courantes en RDC serait
significative.
En effet, les recettes non fiscales auraient augmenté plus que les dépenses
publiques courantes. Par conséquent, le taux de couverture de dépenses publiques
courantes par les recettes non fiscales serait en augmentation.

3
3. choix et intérêt du sujet
Le choix que nous avons porté sur ce sujet est motivé par deux raisons
fondamentales.
D’abord, sur le plan scientifique, ce travail constitue pour nous une
opportunité de mettre en pratique des théories que nous avons apprises tout au long
de notre parcours académique. Il s’agit notamment des théories sur la fiscalité et
les finances publiques.
Ensuite, sur le plan pratique, le présent travail répond à une
préoccupation actuelle que la RDC rencontre pour couvrir sont déficit budgétaire
chronique pendant ces dernières années.
En outre, cette dissertation scientifique pourrait servir tant soit peu de
base de données à d’autres chercheurs qui s’intéresseraient au même thème dans
l’avenir.
4. Délimitation spatio-temporelle du sujet
Pour mieux aborder notre sujet, il convient de spécifier le contour de
l’étude et de circonscrire sa sphère d’analyse dans l’espace et dans le temps. Ceci
d’autant plus que, l’espace mais aussi le temps, sont souvent des variables à part
entière qu’il faut prendre en considération.
1
Notre travail porte sur la RDC pour la période allant de 2008 à 2017, soit
dix ans que nous considérons comme nécessaires pour aboutir à des résultats
statistiquement significatifs et économiquement pertinents.
5. Méthodologie
La méthodologie correspond à l’ensemble des méthodes et techniques
auxquelles le chercheur fait recours pour confirmer ou infirmer ses hypothèses de
départ.
5.1. Méthodes utilisées
5.1.1. La méthode quantitative
La méthode quantitative nous a permis de procéder à des calculs pour
analyser et comparer les évolutions respectives de chaque variable que nous aurons
1
G.FRECON, Formuler une problématique : dissertation, mémoire, thèse, rapport de stage, éd. Dunod, Paris,
2006, p. 34.

4
retenue. Il s’agit des recettes non fiscales réalisées et des dépenses publiques
courantes de la RDC.
5.1.2. La méthode systémique
La méthode systémique nous a également permis de prendre en compte
la relation d’interdépendance qui existe entre les variables retenues et le taux de
couverture de dépenses publiques courantes par les recettes non fiscales.
5.2. Techniques utilisées
Le processus de l’élaboration du savoir passe nécessairement par la
collecte des données, laquelle se réalise par l’utilisation des techniques de
recherche.
Durand CHALET définit dans son ouvrage les techniques de recherche
comme « des procédés opératoires, des moyens concrets de collecter des données
intégrées par des méthodes de recherche »
2
.
5.2.1 Technique documentaire
Dans le cadre de notre travail, nous avons utilisé « la technique
documentaire » qui nous a permis de réaliser notre travail en consultant des notes
de cours, des ouvrages dans des bibliothèques, des articles et publications dans les
sites web, et d’autres documents en rapport avec notre étude.
5.2.2 Technique d’interview
Cette technique nous a facilité d’entrer en contact avec certains
responsables de la DGRAD pour obtenir des informations complémentaires
nécessaires à la réalisation de ce travail.
6. Difficultés rencontrées
La présente étude ne s’est pas faite sans heurte. La plus grande difficulté
est celle liée à la collecte des données. Cependant, notre perspicacité nous a permis
enfin d’entrer en possession de ces données auprès de l’autorité monétaire et
budgétaire de la RDC à savoir la Banque Centrale du Congo.
En outre le temps imparti entre les cours en salle, les moments de stage
et la rédaction n’a pas été facile à gérer.
2
D.CHALET, Méthodes et techniques de recherche scientifique, éd. Dalloz, Paris, 1983, p.23.

5
7. Canevas du travail
Hormis l’introduction et la conclusion, notre travail est subdivisé en trois
chapitres structurés de la manière ci-après :
Le premier traite de son cadre conceptuel ;
Le deuxième porte sur la présentation de la DGRAD, notre champ
d’investigation ;
Le troisième mesure la contribution des recettes non fiscales dans la
couverture des recettes publiques courantes de la RDC de 2008 à 2017.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
1
/
72
100%