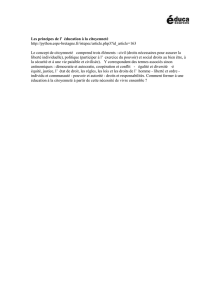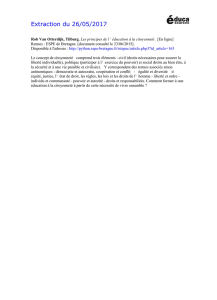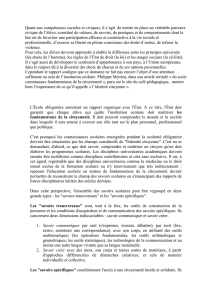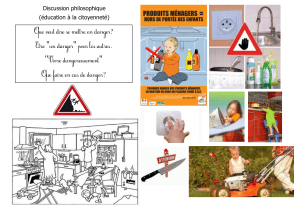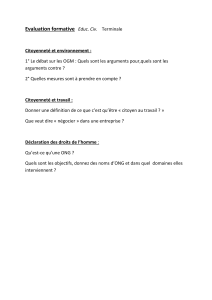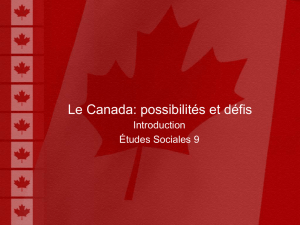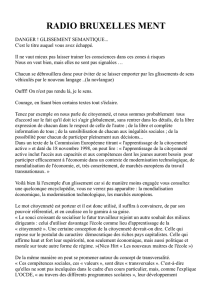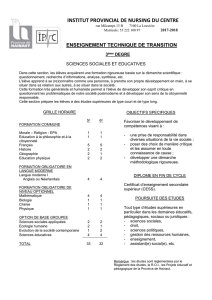Page | 1
Ministère de l’Education National REPUBLIQUE GABONAISE
Lycée d’Application Nelson Mandela
Département de français
Classe : Terminale C
Union - Travail - Justice

Page | 2
Introduction
I) DEFINITION ET ENJEUX DE LA CITOYENNETE
II) LA CITOYENNETE A TRAVERS LE PRISME DE LA PENSEE PHILOSOPHIQUE
1) Perspectives philosophiques africaines
2) Perspectives philosophiques occidentales
III) DEFITS COMTEMPORAINS LIES A LA CITOYENNETE
1) Inclusion et exclusion
2) Citoyenneté numérique
3) Montée du nationalisme
IV) UNE OUVERTURE PHILOSOPHIQUE : LA CITOYENNETE SELON KANT
V) DISCUSSION SUR : « Quelles sont les qualités d’un bon citoyen ? »
Conclusion

Page | 3
Introduction
« Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. » –
John F. Kennedy. Cette citation incite chacun à réfléchir sur l'engagement et la responsabilité inhérentes à la notion de
citoyenneté. La problématique se pose alors : Comment la citoyenneté permet-elle de concilier les droits individuels
avec les devoirs envers la société, dans un monde marqué par la diversité et les enjeux globaux ? Dans cet exposé,
nous explorons la définition de la citoyenneté, ses enjeux dans la société, ainsi que les diverses pensées philosophiques
qui l'éclairent. Nous examinons également les défis contemporains puis prendrons une figure emblématique telle que
Emmanuel Kant et enfin discuterons avec la salle sur la question : « Quelles sont les qualités d’un bon citoyen ? »

Page | 4
I) DEFINITION ET ENJEUX DE LA CITOYENNETE
Être citoyen, c’est plus que posséder une carte d’identité : c’est faire partie d’une communauté, avec des droits et des
devoirs.
Parmi les droits, on trouve le vote, la liberté d’expression, ou encore l’accès aux services publics. Ces droits nous
permettent de participer à la vie politique et de faire entendre notre voix. Mais en échange, on a aussi des
responsabilités : respecter les lois, s’impliquer dans la société, et contribuer au bien commun.
La citoyenneté, c’est donc un équilibre entre liberté et responsabilité. C’est ce qui permet à la démocratie de
fonctionner.
Mais attention : la citoyenneté évolue selon les époques, les pays et les cultures. Elle n’est pas figée. Ce qui ne change
pas, en revanche, ce sont les droits fondamentaux, comme le droit de vote ou la liberté d’expression, essentiels pour
que chacun puisse s’exprimer et s’engager.
Déjà en 1789, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen affirmait : « les hommes naissent libres et égaux en
droits ». Cela montre que la justice et l’égalité sont au cœur de la citoyenneté.
En contrepartie, la société attend un minimum d’engagement : voter, s’informer, débattre, ou même s’engager dans des
actions locales. Rousseau disait : « L’homme naît libre, et partout il est dans les fers ». Pour lui, la vraie liberté passe
par la participation à la vie de la cité.
II) LA CITOYENNETE A TRAVERS LE PRISME DE LA PENSEE PHILOSOPHIQUE
1) Perspectives philosophiques africaines
La philosophie africaine offre une approche profondément relationnelle et communautaire de la citoyenneté, centrée
sur l’idée que l’individu est inséparable du tissu social qui le porte. Cette vision se retrouve dans le concept d’Ubuntu,
un principe moral issu des cultures bantoues d’Afrique australe, signifiant littéralement : « Je suis parce que nous
sommes ». Ubuntu incarne l’idée que l’identité d’un individu se construit dans et par sa relation avec les autres,
valorisant la solidarité, le respect et la responsabilité collective.
Le penseur Léopold Sédar Senghor, dans Liberté I : Négritude et humanisme (1964), défend cette vision holistique de
l’être humain :
« La communauté africaine ne connaît pas l’individu isolé. L’homme ne se réalise que dans la communauté. »
Cette idée d’une citoyenneté enracinée dans le lien social fonde une éthique de la participation et du soin mutuel, où
chaque citoyen est appelé à œuvrer pour le bien commun.
De son côté, Frantz Fanon, dans Les Damnés de la terre (1961), propose une réflexion critique sur les conséquences du
colonialisme sur les structures sociales et l’idée même de citoyenneté. Il affirme :
« Pour le peuple colonisé, la valeur la plus essentielle, parce que la plus concrète, est d'abord la terre : la terre qui doit
lui assurer pain et dignité. »

Page | 5
Fanon plaide pour une citoyenneté décolonisée et émancipatrice, fondée sur la justice sociale et la reconstruction des
liens communautaires.
Enfin, la tradition orale occupe une place centrale dans les sociétés africaines. Elle véhicule les valeurs civiques, les
récits fondateurs et les règles morales à travers les générations. Elle constitue un vecteur essentiel de la mémoire
collective et de la transmission des principes de solidarité, de dialogue et de responsabilité citoyenne.
2) Perspectives philosophiques occidentales
Aristote, dans La Politique, considère la citoyenneté comme la pleine réalisation de l’homme dans la cité. Il déclare :
« L’homme est par nature un animal politique » (La Politique, Livre I, 1253a2).
Selon lui, la participation à la vie politique est une condition de l’épanouissement humain. La citoyenneté ne se limite pas
à un statut juridique ; elle implique un engagement actif dans les affaires publiques et une contribution au bien commun.
L’homme véritablement libre est celui qui participe à la délibération et à la gouvernance de la cité.
Hannah Arendt, dans La Condition de l’homme moderne (1958), distingue trois activités humaines fondamentales : le
travail, l’œuvre et l’action. C’est l’action politique, liée à la parole et à la délibération publique, qui permet aux individus
de se révéler pleinement en tant que citoyens. Elle écrit :
« Être libre et agir ne font qu’un. »
Dans Eichmann à Jérusalem (1963), elle développe la notion de banalité du mal, soulignant les dangers de l’inaction et
de la soumission bureaucratique. La citoyenneté, chez Arendt, implique donc une vigilance constante et une capacité à
juger et à agir face à l’injustice. L’engagement civique devient un rempart contre la déshumanisation et l’effacement de
la responsabilité individuelle.
III) DEFITS COMTEMPORAINS LIES A LA CITOYENNETE
1) Inclusion et exclusion
Les flux migratoires contemporains, qu’ils soient économiques, politiques ou climatiques, soulèvent des enjeux profonds
liés à l’intégration, à la reconnaissance culturelle et à la définition de la citoyenneté. Dans un monde globalisé, la
citoyenneté ne peut plus être pensée uniquement en termes de nationalité ou d’homogénéité culturelle. Elle devient un
outil d’inclusion, capable de garantir à chacun – quelle que soit son origine – des droits fondamentaux et la possibilité
de participer à la vie collective. La philosophe Étienne Balibar, dans Nous, citoyens d’Europe ? (2001), plaide pour une
citoyenneté "post-nationale", où l'appartenance ne repose plus exclusivement sur les frontières territoriales, mais sur
l'égalité des droits et la participation active.
2) Citoyenneté numérique
La révolution numérique transforme en profondeur la manière dont les citoyens s’informent, débattent et participent à
la vie démocratique. Grâce aux réseaux sociaux, de nouvelles formes de mobilisation citoyenne émergent : pétitions en
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%