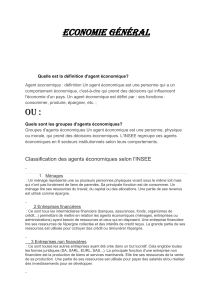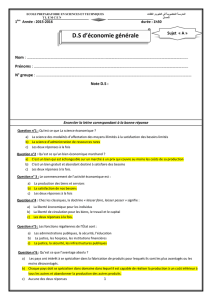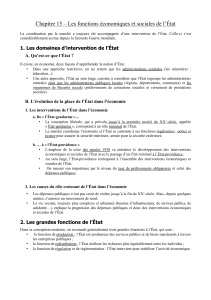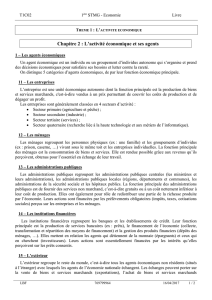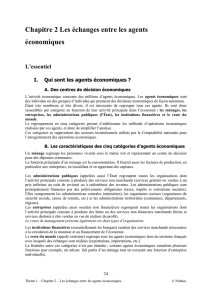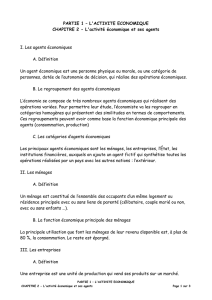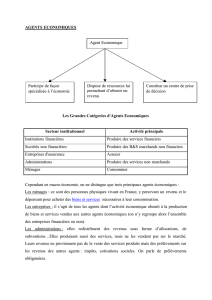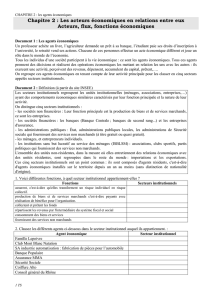Economie Politique
Dr. Momar Sylla DIENG
Séquence 1 : Introduction à l’Economie Politique
I. Définition et objet de l’Économie politique
L’économie politique, la politique économique ; qu’est-ce qui les différencie ?
La politique économique c’est l’ensemble des mesures et interventions prises par des
administrations publiques (dont l’État, la banque centrale, et les collectivités territoriales) dans
le sens jugé souhaitable. On distingue, usuellement, les politiques économiques conjoncturelles
qui visent à orienter l’activité économique à court terme et les politiques économiques
structurelles qui tendent à modifier le fonctionnement de l’économie sur le moyen ou long
terme.
L'économie politique, par contre, étudie la manière dont les richesses se forment, se distribuent
et consomment.
Pour Raymond BARRE (1959), « L’économie politique est la science de l’administration des
ressources rares dans une société, elle étudie les formes que prend le comportement humain
dans l’enseignement onéreux du monde extérieur, en raison de la tension qui existe entre les
désirs illimités et les moyens limités des sujets économiques »
Elle ne considère donc les activités économiques que dans le rapport qu’ils entretiennent avec
l’enrichissement ou la diminution des richesses de l’homme et non dans leur procédé
d’exécution. Par exemple, elle indique le cas où le commerce est véritablement productif,
profitable à une personne ou à tous. L’économie politique cherche à renseigner, pour chaque
phénomène (agriculture, industrie, administration, etc.), sa cause ; et ses résultats joignent, pour
chaque phénomène, l’étude des procédés de son art.
En économie politique, comme en toutes sciences, on fait des systèmes, avant d’établir des
vérités (c’est-à-dire de pures assertions). Par la suite, on applique à ces sciences les méthodes

expérimentales qui consistent à n’admettre comme vrais que les faits dont l’observation et
l’expérience ont démontré la véracité (réalité).
Les faits désignent à la fois, les choses qui existent et celles qui arrivent. Les choses qui existent
doivent être vues telles qu’elles sont, pour qu’elles puissent servir de base à des raisonnements
sûrs : c’est un fait que telle chose est ainsi.
Les choses qui arrivent consistent dans les phénomènes qui se manifestent lorsqu’on observe
comment les choses se passent. Par exemple : c’est un fait que lorsqu’on expose les métaux à
une certaine température, ils deviennent fluides. Ces deux notions (choses qui existent et qui
arrivent), qui constituent « La nature des Choses », sont l’unique fondement de toute vérité si
elle est bien observée.
De cette analyse, on peut distinguer les sciences « descriptives » qui consistent à observer et à
décrire le comportement d’un sujet sans aucune influence ; et les sciences « expérimentales »
qui consistent à tester la validité d’une hypothèse en reproduisant un phénomène ; étude de la
liaison des effets avec leurs causes.
L’économie politique est toute entière fondée sur des faits ; car la nature des choses est un fait,
aussi bien que l’événement qui en résulte. Les phénomènes dont elles cherchent à faire
connaître les causes et les résultats peuvent être considérés comme des faits généraux et
constants (qui sont toujours le même de tous les cas semblables) ou particuliers (qui dépendent
de lois générales).
On peut dire de ce fait que l’économie politique est établie sur des fondements solides
(incontestables) du moment que les principes qui lui servent de base sont des déductions
rigoureuses de ces faits généraux incontestables. Si les faits sont connus, l’étude des rapports
qui les lient permet d’envisager les questions sur tous les côtés. Cette dernière fait appel à la
théorie et/ou à la pratique. La théorie est la connaissance des lois qui lient les effets aux causes.
La pratique permet d’apporter à la théorie des justifications empiriques.
Les lois quant à elles, dérivent de la nature des choses : on ne les imagine pas, on les trouve.
Les lois générales qui règlent la marche des choses, se nomment des principes, du moment qu’il
s’agit de leur application, c’est-à-dire du moment qu’on s’en sert pour juger les circonstances
qui s’offrent et pour servir de règle à ses actions. L’économie politique de même que les
sciences exactes, se composent de quelques principes fondamentaux et de corollaires, ou
déductions de ces principes.

Historiquement, même si l’utilisation du terme « économie politique » est attribuée à
Montchrestien (1615) dans sa lettre « traitée d’économie politique », les écrivains de la
Grecque antique, comme Xénophon, Aristote ou Platon, se sont longtemps penché sur ce qui
fait la richesse des nations, sa répartition et sa consommation en partant du constat que « les
biens s’augmentent par l’économie et se diminuent par les dépenses (ou la consommation).
Pour Xénophon ([vers 426-354 av. J.-C.], l’ordre, l’activité [agricole] sont entre autres des
moyens de développer la richesse, en ne s’intéressant qu’à l’administration des domaines ruraux
et à la mise en évidence de l’agriculture dans la production de la richesse.
Platon
1
, pour sa part, développe dans ces récits les notions de justice sociale et de l’organisation
économique de la société en classe. Pour lui, aboutir à une « Cité idéale » [ordonnée,
harmonieuse] passe par un strict contrôle « collectif » des pratiques et des relations
économiques.
Aristote [384-322 avant notre ère], quant à lui, condamne le goût du profit et l’accumulation
des richesses. Il préconise une économie naturelle dans laquelle les échanges et la production
ne doivent servir qu’à satisfaire les besoins de chacun. Il fait la distinction entre deux types de
richesses, la « véritable richesse » qui concerne « les biens indispensables à la vie » et la « fausse
richesse » qui concerne les biens superflus.
Au moyen-âge, Thomas D’Aquin a cherché à définir la moralité de l’économie, leur caractère
licite ou illicite selon la morale chrétienne, et la recherche du juste prix dans les échanges.
La fin du Moyen Âge, entre XVIe et XVIIe siècles, est marquée par l’amélioration des
conditions de vie qui prévalait au cours des siècles passés. Sur les plans politiques, une
désagrégation de l’ordre féodal est observée pour la constitution progressive des États-nations
[apparition de pouvoirs centralisateurs, attachés à une population, limités par des frontières].
Sur le plan théologique, la réforme protestante a permis à chacun de lire les Écritures Saintes et
de prier Dieu dans sa langue. Ce qui a induit, avec la traduction de la Bible, le développement
des langues telles que l’Allemand, le Français, l’Anglais, etc.). On peut aussi mettre en exergue
les avancées dans les domaines techniques, avec l’invention de l’imprimerie favorise la
diffusion des idées, et économique (les grandes découvertes élargissant l’horizon des échanges,
l’arrivée des trésors du Nouveau Monde modifiant en profondeur l’équilibre monétaire du passé
et le regard porté sur la richesse, la prospérité des nations et leur origine, les pratiques
1
Livre II de sa République.

économiques, marchandes et financières en particulier). La conjugaison de ces phénomènes est
alors propice au développement d’une réflexion économique nouvelle, sur laquelle ne pèsent
plus les interdits moraux prévalant jusqu’alors et qui porte les marques de la modernité.
Avec cette levée des principes moraux portant sur les pratiques économiques, la réussite dans
les affaires et la recherche de profit sont encouragées en France, en Espagne et au Royaume-
Uni. La révolution marchande et monétaire, qui s’est produite en Europe, modifie la conception
jusque-là faite de la richesse (sa nature, ses causes, sa capacité à générer des excédents
commerciaux, etc.). Ce qui a entraîné, grâce au commerce et à la finance, l’apparition d’une
nouvelle classe sociale et leur enrichissement. On est à l’ère du mercantilisme où la puissance
et la richesse de la nation se mesurent en la capacité du Prince d’accumuler le plus de métaux
précieux (l’or). Ce dernier a donc intérêt à développer les pratiques économiques, à encourager
et à faciliter l’enrichissement des marchands et donc de la nation. Ainsi l’économie devient
politique. Dans ce sens, Antoine de Montchrestien
2
disait : « …on peut fort à propos maintenir,
contre l’opinion d’Aristote et de Xénophon, que l’on ne saurait diviser l’économie de la police,
sans démembrer la partie principale de son tout ; et que la science d’acquérir des biens, – qu’ils
nomment ainsi, est commune aux républiques, aussi bien qu’aux familles » [Montchrétien A.
de (1616) pp 43, 44.] ;. ».
Le début du XVIIIe siècle est marqué par l’émergence de la pensée libérale, avec la philosophie
des lumières, au sein de laquelle il est possible de distinguer un libéralisme politique et un
libéralisme économique, qui ne se recouvrent pas nécessairement. Le libéralisme économique,
en revendiquant la primauté de l’ordre économique « naturel » sur la volonté politique, constitue
« l’économique » en « science » autonome et sera porté par des auteurs tels que le baron de
Montesquieu (1689-1755)
3
, Diderot
4
, Voltaire (1694-1778)
5
, etc. le libéralisme économique
constitue aussi une critique au mercantilisme. Il considère que, dès lors que certaines libertés
économiques sont garanties (propriété privée, libre circulation, liberté du travail et
d’entreprendre…), il suffit à chacun de poursuivre son propre intérêt pour concourir à l’intérêt
général. Pour eux, le lien social est donc un lien économique. L’ordre naturel est un ordre
2
Antoine de Montchrestien, Traité d’économie politique, 1615
3
Lettres persanes (1721)
4
Lettre sur les aveugles, L’Encyclopédie de Diderot et de D’Alembert (1751)
5
Lettres philosophiques ou Lettres anglaises (1734)

économique et le politique doit lui être soumis
6
. Le Prince doit se soumettre à l’ordre
économique naturel qui lui est révélé.
C’est vers le milieu du XVIIIe siècle que le physiocrate François Quesnay (avec son tableau
économique
7
) fonde le premier courant de pensée organisé en économie politique, visant à
influencer le débat public à partir d’une conception rationnelle de la société. Même si la
représentation de l’économie de Quesnay est marquée par les caractéristiques de la société
française, à dominante agricole, elle a permis de voir cette représentation comme un système
structuré à la fois en classes sociales et en secteurs d’activité. ; la distinction entre le capital (les
avances) et le surplus (le produit net) ; la distinction entre travail productif et travail
improductif ; la conception de la circulation de flux de dépenses assurant la reproduction de la
société tout entière et dont le blocage dégénère en crises économiques.
La réflexion économique s’étend par la suite aux activités industrielles et à l’ensemble de
l’économie, grâce aux écrits des auteurs classiques tels que : de Adam Smith (1723-1790)
8
,
Jean-Baptiste Say (1767-1832)
9
, David Ricardo (1772-1823)
10
, Thomas Robert Malthus (1766-
1834)
11
, John Stuart Mill (1806-1873)
12
. Ils développent, entre autres, des concepts
microéconomiques (la théorie des prix : valeur travail, prix de production, gravitation ; théorie
de la répartition : relation inverse entre salaires et profits) ; macroéconomique (loi de Say et
neutralité de la monnaie) ; une vision du capitalisme (un ordre économique naturel, qui articule
une activité de production et une activité d’échange, où l’individu appartient par conséquent de
deux manières à la société : comme marchand et comme titulaire de revenu) ainsi qu’une
doctrine de libéralisme et de libre-échangisme des politiques à mener pour encourager la
croissance. Dans ce contexte, Say définit l’économie politique comme « l’exposition de la
manière dont se forment, se distribuent et se consomment les richesses ».
Partant de la conception de l’économie politique classique, deux courants de pensée
économique vont se constituer dans la seconde moitié du XIXe siècle : les courants marxiste et
néo-classique.
6
Message de Pierre le Pesant, seigneur de Boisguilbert (1646-1714), au prince Louis XIV, dans Le détail de la
France (1695) et Le factum de la France (1705)
7
« Tableau économique » : 1758
8
Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations (1776)
9
« Traité d’économie politique » 1803, et « Cours complet d’économie politique » 1829
10
Principes de l’économie politique et de l’impôt (1817)
11
Essai sur les principes de population (1795).
12
Traité d’économie politique (1848)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%