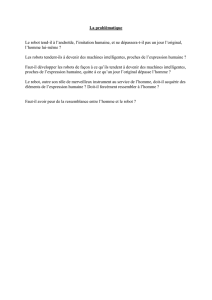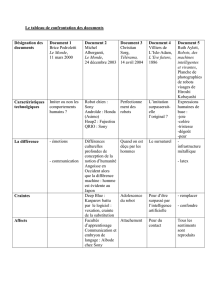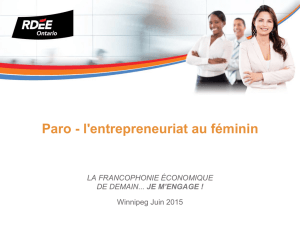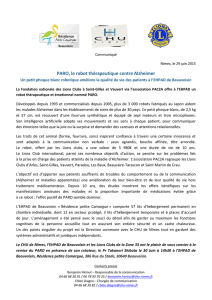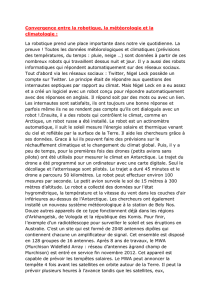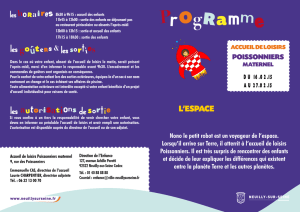Robot PARO®: Un collègue comme les autres? Enjeux et Expérience
Telechargé par
awaafayeeva

Date de publication :
10 août 2019
Mots-clés
robots sociaux | maladie
d’Alzheimer | hôpitaux |
organisation
Keywords
socio-bots | Alzheimer |
hospitals | organisation
Pour toute question :
Service Relation clientèle
Techniques de l’Ingénieur
Immeuble Pleyad 1
39, boulevard Ornano
93288 Saint-Denis Cedex
Par mail :
Par téléphone :
00 33 (0)1 53 35 20 20
Réf. : REX301 V1
Le robot PARO® : un
collègue comme les
autres ?
Cet article est issu de : Innovation | Éco-conception et innovation responsable
par Cécile DOLBEAU-BANDIN
Résumé Ce retour d’expérience essaie de comprendre les enjeux organisationnels,
professionnels et relationnels de l’introduction de la thérapie non médicamenteuse (TNM)
dans l’expérience du soignant en unité de soins hospitalière spécialisée dans la maladie
d’Alzheimer et les troubles apparentés.
Abstract This research seeks to understand the organizational, professional and
relational issues of the introduction of non-drug therapy (NMT) in the experience of the
caregivers in the hospital care unit specialised in Alzheimer’s disease and related
disorders.
Document téléchargé le : 15/04/2025
Pour le compte : 7200034507 - universite de lille // 194.254.129.28
© Techniques de l'Ingénieur | Tous droits réservés

© Editions T.I.
10-2019 REX 301 - 1
RETOUR D’EXPÉRIENCE
Le robot PARO® : un collègue
comme les autres ?
par Cécile DOLBEAU-BANDIN
Maître de conférences en Sciences de l’information et de la communication (UNICAEN)
Chercheure au CERReV EA 3918 (UNICAEN) (Centre d’étude et de recherche sur les
risques et les vulnérabilités)
Membre de la Chaire Unesco des pratiques journalistiques et médiatiques (Université
de Strasbourg)
Membre de l’IERHR (Paris) (Institut pour l’Étude des Relations Homme-Robot)
epuis les années 2000, la recherche en robotique a développé un
domaine appelé « thérapie assistée par robot » ou Robot Assisted
Activity (RAA) (Rialle, 2012). Qu’en est-il vraiment sur le terrain ? Cette
étude analyse les transformations induites par l’introduction d’un robot
social animaloïde en unité de soin hospitalière. L’objet d’étude est le robot
PARO® utilisé à l’Unité cognitivo-comportementale (UCC) et Soins de suite
et de réadaptation Alzheimer (SSRA) d’un centre hospitalier public de
Normandie au printemps-été 2016.
L’enquête qualitative combine cinq techniques de recueil de données :
– l’observation non participante du robot PARO® par un personnel soignant
auprès des patients de l’UCC et du SSRA ;
– des entretiens collectifs non directifs centrés auprès du personnel du
SSRA et de l’UCC ;
– des entretiens individuels semi-directifs centrés auprès du personnel du
SSRA et de l’UCC ;
– une grille d’observation et d’évaluation de PARO® réalisée par moi-même
et laissée à disposition du personnel lors de ma non-présence sur le
terrain ;
– l’observation non participante d’un groupe de travail réunissant 10 soi-
gnants autour de l’usage de PARO®.
Points clés
Domaines : Santé, robots sociaux, sciences de l’information et de la communication
Entreprise concernée : Centre hospitalier public de Valognes (Normandie)
Technologie impliquée : Robot PARO®
Secteur : Médical
D
Parution : août 2019 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200034507 - universite de lille // 194.254.129.28
Ce document a ete delivre pour le compte de 7200034507 - universite de lille // 194.254.129.28
Ce document a ete delivre pour le compte de 7200034507 - universite de lille // 194.254.129.28tiwekacontentpdf_rex301 v1

10-2019
© Editions T.I.
REX 301 - 2
RETOUR D’EXPÉRIENCE
1. Contexte et objectifs du projet
En France, les robots industriels, robots agricoles, robots de
télé-présence, robots éducatifs, robots militaires, robots logis-
tiques et robots de santé entrent progressivement dans notre
quotidien pour nous assister. La majorité d’entre eux répond à
une tâche bien spécifique (Oudeyer, 2014). Il existe aussi une
réelle stratégie française pour le développement de la robo-
tique de santé. Cette robotique inclut notamment les robots
sociaux au service de personnes dites « dépendantes ». Un
robot social ou socio-bot est qualifié d’« émotionnel » ou
d’« affectif » lorsqu’il est susceptible de manifester certains
états par ses expressions faciales, ses gestes, sa posture ou
ses paroles, ainsi que d’en susciter chez les humains, voire
d’adapter ses réponses et son comportement à ces derniers
(Baddoura, 2015). Une fois les réactions identifiées, ces
robots sociaux ou socio-bots y répondent avec des expres-
sions et gestuelles adaptées ; ils entretiennent l’illusion de
comprendre les états affectifs de l’homme et d’y être sensibles
(Tisseron, 2017). Ainsi, les robots NAO et PARO® sont pré-
sents dans certains hôpitaux et maisons de retraite médicali-
sées pour assister certains patients.
Le robot animaloïde PARO® est principalement utilisé dans
des unités hospitalières spécialisées dans la maladie
d’Alzheimer et troubles apparentés, des EPHAD et depuis peu
à l’hôpital auprès d’enfants hospitalisés. En Corse, il est utilisé
auprès d’enfants souffrant de troubles du spectre autistique
(TSA). Depuis 2017, il est utilisé comme outil de formation au
lycée privé professionnel de Sainte-Marie à Bagnols-sur-Cèze
(Gard). Et depuis quelque temps, les fabricants réfléchissent à
des robots sociaux humanoïdes dits « polyvalents » (Devillers,
2017). C’est le cas du robot humanoïde NAO qui se veut poly-
valent et interactif : ainsi, on peut l’utiliser à l’école (apprentis-
sage de l’informatique), dans l’enseignement supérieur
(programmation), en enseignement spécialisé (troubles à
spectres autistiques), dans la vente (conseils, animation), dans
l’accueil (guidage), dans les hôpitaux (gestion de la douleur
aux urgences), dans les EPHAD (animation, coaching sportif)
et à la maison (sécurité de la personne seule, maintien du lien
social et gestes du quotidien).
Ce retour d’expérience vise à présenter les enjeux organisa-
tionnels, professionnels et relationnels de l’introduction de la
thérapie non médicamenteuse (TNM) dans l’expérience du soi-
gnant en unité de soins hospitalière spécialisée dans la mala-
die d’Alzheimer et les troubles apparentés.
Deux entretiens viennent compléter cet article : le premier
avec Serge Tisseron, président de l’IERHR, le second avec
Anne-Sophie Rigaud, porteuse du projet Rosie. L’objectif de ce
dossier est bien de proposer une visibilité au retour d’expé-
rience : que se passe-t-il concrètement avec ces robots
sociaux dans des institutions hospitalières françaises ?
2. Mise en œuvre du projet
2.1 Aspects techniques
PARO® (personal robot) est un robot social émotionnel (ou
affectif) animaloïde en forme de bébé phoque harpé, qui inter-
agit avec autrui. Il n’a pas d’empathie artificielle : il simule
quand il montre de l’attention. Il n’est pas capable de ressen-
tir (Dolbeau-Bandin, 2018).
Figure 1 – Robot PARO®
Développé au Japon par le laboratoire AIST en 1993 sous
l’impulsion du professeur Takanori Shibata, il s’agit à ce jour de
la 9e génération de ce robot : 5000 PARO® sont présents dans
plus de 200 établissements de soins de 30 pays, principalement
dans le domaine gériatrique, mais depuis peu d’autres types
d’établissements l’utilisent dans les domaines du polyhandicap,
de la pédiatrie et des troubles du spectre autistique (TSA).
PARO® est recouvert d’une fourrure bactéricide, synthé-
tique, hypoallergénique, antibactérienne et peu salissante. Il
pèse 2,5 kg et mesure 57 cm. En Europe, il est disponible en
deux couleurs (blanc et jaune doré). C’est un robot station-
naire, non holonome. Il fonctionne à l’électricité. La durée
d’utilisation de la batterie est de 5 à 8 heures et son temps de
recharge de 2 à 3 heures.
Sa tête est renforcée en polycarbonate (utilisé pour les vitres
pare-balles) pour assurer un niveau de robustesse en adéqua-
tion avec son environnement d’utilisation. Il peut cligner des
yeux, remuer la queue et actionner ses deux nageoires laté-
rales. Le son de sa voix provient d’un enregistrement de vrai
bébé phoque harpé. Ce robot possède une douzaine de cap-
teurs (toucher, positionnement, lumière) et trois microphones
(détection de la provenance du son par triangulation) qui ren-
voient des informations sur l’interaction avec un individu à un
algorithme spécifique, lequel adapte en conséquence les mou-
vements et l’intonation du PARO® (Dolbeau-Bandin, 2018).
Ces capteurs tactiles (visuels, sonores, de mouvement, de
température) se situant sur la tête, le dos et les nageoires lui
permettent différentes actions bien déterminées.
2.2 Aspects financiers
Le coût d’achat et d’entretien du PARO® est assez élevé
(plus de 5 000 euros). Par ailleurs, la thérapie par robot peut
être contraignante car cette méthode exige la disponibilité d’un
intervenant, ce qui peut poser des problèmes d’organisation et
de moyens. Il ne libère pas du temps, il en demande (Dolbeau-
Bandin, 2018). Le manque de personnel, les difficultés rencon-
trées dans l’accompagnement de la personne âgée et les
raisons économiques des établissements, qui considèrent le
robot comme moins coûteux financièrement que la rémunéra-
tion d’un soignant, entraînent une course aux « nouvelles tech-
niques mêlant technologie mécanique mais aussi intelligence
artificielle et intelligence numérique » (De Broca, 2014).
Parution : août 2019 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200034507 - universite de lille // 194.254.129.28
Ce document a ete delivre pour le compte de 7200034507 - universite de lille // 194.254.129.28
Ce document a ete delivre pour le compte de 7200034507 - universite de lille // 194.254.129.28tiwekacontentpdf_rex301 v1

© Editions T.I. REX 301 - 3
10-2019
RETOUR D’EXPÉRIENCE
2.3 Aspects organisationnels
Les deux services se déploient sur 1 000 m2 et accueillent
22 patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés : 10 lits en SSRA, 10 lits en UCC et 2 lits de court
séjour gériatrique. L’unité SSRA reçoit des personnes âgées
nécessitant un suivi médical après une opération chirurgicale
importante ou un accident ayant entraîné des difficultés
motrices qu’il s’agit d’atténuer ou de faire disparaître. L’UCC
accueille pour une durée moyenne de quatre à cinq semaines
des patients âgés valides en période de crise (agitation,
déambulation…). Leur prise en charge, spécifique, est basée
notamment sur des TNM, associées le cas échéant à des trai-
tements médicamenteux (Dolbeau-Bandin, 2018).
Les patients sont pris en charge au quotidien par une équipe
pluridisciplinaire. L’UCC et le SRRA se partagent le même per-
sonnel, qui permute chaque mois. Sa moyenne d’âge est
d’environ 35 ans. Il comprend 2 gériatres, 1 interne, 1 infir-
mière cadre (IC), 1 infirmière coordinatrice (ICO), 1 neuropsy-
chologue (NP), 10 infirmiers (IDE), 21 aides-soignants (AS)
dont 4 aides médico-psychologiques (AMP), 1 ergothérapeute,
1 art-thérapeute, 1 psychomotricienne, 1 diététicienne, 1 ortho-
phoniste, 1 assistante sociale et quelques stagiaires. L’âge
moyen des patients est de 85 ans, les femmes sont plus nom-
breuses que les hommes. À leur entrée dans l’établissement, le
personnel rassemble des informations sur eux par des entre-
tiens, des questions à leurs proches et réalise un cahier retra-
çant leur vie (famille, histoire personnelle, de leur maladie,
goûts…). Ils sont répartis en trois catégories : troubles légers
(20 %), troubles modérés (30 %) et troubles sévères (50 %).
Certains patients sont totalement apathiques, repliés sur eux-
mêmes, d’autres très agités et/ou désinhibés.
L’utilisation du PARO® par les équipes soignantes se fait sur
la base du volontariat. Elle est plus fréquente à l’UCC qu’au
SSRA. La neuropsychologue et les aides-soignants sont ceux
qui l’emploient le plus souvent. Son utilisation spontanée reste
irrégulière : le robot sert le plus souvent en session indivi-
duelle, de 13 h 45 à 16 h, dans un espace ouvert et commun
qui facilite les interactions avec les autres patients. La durée
varie d’1 à 30
minutes. Un infirmier et la neuropsychologue
l’utilisent parfois dans les chambres. Une AS de nuit y a
recours une fois au moment du coucher ou de la toilette pour
faciliter les soins. La neuropsychologue en fait un usage de
plus en plus préparé et ciblé (Dolbeau-Bandin, 2018).
2.4 Aspects juridiques
Aux États-Unis, PARO® a obtenu la Certification FDA en tant
que robot thérapeutique en 2009. En France, il possède la
norme CE Jouet (par décret de septembre 1989, apposition
obligatoire du marquage CE sur tous les jouets vendus en
Europe). Mais cette mention n’apporte qu’une garantie relative
puisque la conformité aux normes légales est sous la seule
responsabilité du fabricant, sans recours obligatoire à un labo-
ratoire indépendant. La norme relative aux dispositifs médi-
caux est en cours d’évaluation. La Directive 93/42/CEE
relative aux dispositifs médicaux (DM), rédigée par le Conseil
de l’Union européenne, définit les rôles et obligations des dif-
férents acteurs du DM et des objectifs communs pour les Etats
membres, ceux-ci transcrivant les exigences dans leur droit
national. La classification d’un dispositif médical est de la res-
ponsabilité du fabricant ; celui-ci s’appuie sur des règles de
classification établies par la Directive DM, en fonction de la
finalité médicale que ce dernier revendique pour son produit.
Pour les DM de classe 1, il s’agit d’une auto-certification par le
fabricant, qui lui permet d’apposer le marquage CE sur son
dispositif.
2.5 Aspects humains
En pratique, le plus souvent le personnel soignant reste à
genoux à côté du patient, main sur son bras/épaule/main. Le
PARO® placé sur un meuble ou sur les genoux ou dans les
bras du patient, il engage un dialogue, reformule et maintient
les mots du patient.
Figure 2 – Triade personnel soignant/PARO®/patient
(M. Hernoë)
En général les soignés sont curieux, impatients de le toucher,
et se mettent à lui parler tout délicatement, à le choyer, à le
prendre dans les bras, voire à lui chantonner une berceuse.
Certains le rejettent. Les émotions des patients (joie, tristesse…)
sont variées, les réactions diverses (acceptation, rejet) et per-
mettent de discuter/parler, de sortir de leur apathie ou d’entrer
en contact soit avec le robot, soit avec le soignant ou d’autres
patients. Ils lui parlent et ont l’impression que PARO® les com-
prend. La discrimination n’a pas lieu : certains confondent la
machine avec un être vivant (4 patients sur 15) (Dolbeau-Ban-
din, 2018).
3. Bilan et perspectives
3.1 Points positifs
Les récentes études françaises et étrangères menées sur les
robots animaloïdes, principalement au Japon, montrent des
résultats encourageants pour la lutte contre le stress et l’aug-
mentation de la qualité de vie par le biais d’interactions fortes
entre la personne fragilisée, le robot et l’entourage (Sant’Anna,
Morat & Rigaud, 2011). Ici, l’étude montre que PARO® est à la
fois un indicateur temporel et un partenaire pour le soignant,
et se dirige vers des médiations robotiques simplifiées.
■Un indicateur temporel pour le soignant : il est à la fois un
témoin du passé (réminiscence des souvenirs) et du présent
(transfert de sentiments) (Dolbeau-Bandin, 2018). Cela permet
de soutenir et de faciliter à un moment précis le travail du per-
sonnel soignant. Il possède une fonction de témoin du passé en
permettant de récolter des informations sur le patient, pas
comme un traceur de données mais comme indicateur à la
manière de la madeleine de Proust. Cette expression fait allu-
sion à ces petits évènements (les odeurs, les sensations) qui
Parution : août 2019 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200034507 - universite de lille // 194.254.129.28
Ce document a ete delivre pour le compte de 7200034507 - universite de lille // 194.254.129.28
Ce document a ete delivre pour le compte de 7200034507 - universite de lille // 194.254.129.28tiwekacontentpdf_rex301 v1

10-2019
© Editions T.I.
REX 301 - 4
RETOUR D’EXPÉRIENCE
font soudainement ressurgir des soubassements de notre
mémoire de lointains souvenirs, chargés d’émotion. Il peut faci-
liter le travail des soignants en complétant ce qu’ils savent sur
le patient, en apprenant sur son parcours, en approfondissant
les données récoltées lors de l’histoire de vie. Pour aboutir à
une interaction satisfaisante, le personnel soignant doit être en
mesure d’initier, maintenir et surtout interpréter les signes
(gestes, mimiques…) de l’interlocuteur en les indexant à une
signification pertinente en contexte (Carrion-Martinaud, 2016).
■Un outil supplémentaire dans le quotidien du soignant : c’est
un médiateur pour le personnel soignant qui peut compléter
ces informations sur l’histoire et le vécu du patient transmis
en général par sa famille (Dolbeau-Bandin, 2018). Il permet
de découvrir d’autres facettes indispensables pour adapter la
thérapie non médicamenteuse. Au-delà du bénéfice clinique
qu’il peut procurer aux patients, l’étude montre qu’il a un
impact sur leur qualité de vie en permettant de limiter leur
agitation, leur déambulation, leur apathie et/ou leur agressi-
vité. Cela aide ces professionnels dans leur travail quotidien,
dans leurs relations avec les patients, et c’est bien en train de
transformer l’organisation de leur service. Leur expérience de
la maladie est favorable à l’intégration du robot et constitue
une ressource dans la création du contact médiatisé par la
gérontechnologie (Carrion-Martinaud, 2016). Ici, il n’y a pas
d’excès de technicisation et le soignant ne se centre pas uni-
quement sur le soin réalisé : il laisse la place à la relation.
Dans cette approche globale du patient, PARO® permet
notamment d’assurer le confort de vie et de redonner un sens
cohérent aux actes des soignants (Dolbeau-Bandin, 2018).
■Un nouveau support de médiation : PARO® reconnaît les émo-
tions, y répond de façon adaptée et interagit de manière simple
et naturelle avec autrui. Il propose « des mimiques et des into-
nations simplifiées ». Il faut voir les robots comme une technique
additionnelle (Baddoura, 2016) pour aider les soignants dans
leur travail. Il est souhaitable que les soignants restent toujours
présents et que les robots soient des « cobots » c’est-à-dire des
partenaires de soin (Dolbeau-Bandin, 2018). L’étude montre que
ce robot apporte dans certains cas des ressources nouvelles,
intéressantes, et qu’il en amplifie d’autres. Cette thérapie non
médicamenteuse doit être perçue comme un outil complémen-
taire au travail du personnel soignant (Baddoura, 2016).
3.2 Points négatifs
■L’effet de PARO® ne semble perdurer que sur la durée de
l’intervention et améliore à court terme l’état émotionnel des
patients (Dolbeau-Bandin, 2018). On peut s’interroger sur
l’efficacité limitée.
■On constate des cas de rejet de la part des soignants et des
soignés. Tous les soignants ne manifestent pas l’envie d’adopter
l’outil. D’autres sont aussi déstabilisés ; une AS était mal à l’aise
face à ce robot la première fois qu’elle l’a vu en marche. Certains
patients le rejettent, refusent de le toucher et évoquent des sou-
venirs douloureux avec des animaux ou de jeunes enfants.
■D’autres difficultés souvent évoquées sont en lien avec la
représentation du jeu, la peur de l’infantilisation toujours en
arrière-fond de la pensée des professionnels qui utilisent le jeu,
se détournant ainsi de toute une offre qui pourrait pourtant
être adaptée (Carrion-Martinaud, 2016). Certains soignants
trouvent infantilisant pour un adulte de parler à une peluche
interactive, surtout devant les membres de la famille. En géné-
ral, le personnel soignant évite l’infantilisation du patient en lui
parlant doucement et normalement. Une régression a souvent
lieu (souvenirs d’enfance) mais elle est bénéfique (souvenirs,
ressources pour affronter la réalité) et de courte durée.
■Les séances avec PARO® peuvent être régulièrement mises
à mal par la pathologie Alzheimer et une difficulté en lien avec
le manque de formation spécifique à son usage (Carrion-
Martinaud, 2016). Ces difficultés influent sur le personnel soi-
gnant dans son usage du robot auprès de personnes
démentes, et il s’agit souvent d’intervenir auprès des profes-
sionnels en première intention pour rendre compte d’une
situation de jeu adaptée au contexte d’intervention.
■D’autres points gênants sont relatifs à son maniement : il
pèse 2,5 kg et toutes les personnes âgées n’ont pas la force
de le porter. De plus, son poids peut être dangereux s’il tombe
sur le pied d’un malade. Il peut y avoir des allergies à la four-
rure synthétique. Son autonomie est limitée (2 heures) ; les
robots actuels ont, pour la plupart, une batterie particulière-
ment faible et passent parfois plus de temps en charge qu’en
activité. On peut l’utiliser branché mais le câble limite et com-
plexifie le bon déroulement des séances.
■L’intégration de ce robot social nécessite un entretien quoti-
dien et une supervision permanente. On recense en général
un PARO® pour un service ou des services, ce qui demande
beaucoup de temps aux soignants. Le lieu où on le stocke
peut constituer un frein à son usage : à Valognes, le person-
nel signale régulièrement qu’il est dans sa réserve, caché et
loin, ce qui les empêche de l’utiliser plus souvent. Des pro-
blèmes techniques peuvent compliquer cet usage : à
Valognes, une des nageoires du PARO® est endommagée et
chacun de ses mouvements s’accompagne d’un bruit méca-
nique, une sorte de grincement pouvant gêner certains soi-
gnants et soignés. Ce qui conduit à réduire son usage et à
l’envoyer en réparation, et les réparations sont assez longues
(plusieurs semaines) et coûteuses.
3.3 Axes d’amélioration
Les technologies telles que PARO® ne remplaceront pas le
personnel, mais elles constituent et constitueront des moyens
d’assistance complémentaires au travail des soignants, et
doivent être considérées comme tels (Dolbeau-Bandin, 2018).
Ces dispositifs ne peuvent être acceptés que s’ils permettent
d’offrir une meilleure qualité des soins ou des avantages
concrets dans le travail des soignants au quotidien, notam-
ment dans le soulagement de tâches physiquement difficiles
(Carrion-Martinaud, 2016). Le soignant peut s’approprier cet
outil facilement et en faire un usage adapté aux besoins des
patients et l’inscrire dans un projet thérapeutique global
(Dolbeau-Bandin, 2018). C’est bien une piste prometteuse qui
mérite le développement d’études plus standardisées portant
sur des échantillons plus larges (Sant’Anna, Morat & Rigaud,
2011).
Seulement, il faut rester vigilant au point de vue éthique :
pas de confusion, pour des personnes vulnérables… Il faut
connaître, repérer et structurer un cadre pour guider les pra-
tiques futures avec PARO® notamment en institutions géria-
triques (Dolbeau-Bandin, 2018). Il faut aussi repenser le cadre
et les enjeux éthiques de la robotique sociale en gériatrie en
conciliant la tension entre efficacité des unités hospitalières,
complémentarité et éthique du métier et amélioration des
soins pour les patients. Aujourd’hui et demain, pour vivre au
mieux la robotique de service et personnelle, il faut mener un
projet et une réflexion pluridisciplinaires ou communs.
Fiche entreprise
Nom de l’entreprise : Hôpital public de Valognes (Manche),
Normandie
Secteur d’activité : Santé
Nombre de collaborateurs : NC
Siège social : Valognes, Normandie
Site : http://www.ch-cotentin.fr/chpc/presentation-generale
Contact mail : NC
Parution : août 2019 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200034507 - universite de lille // 194.254.129.28
Ce document a ete delivre pour le compte de 7200034507 - universite de lille // 194.254.129.28
Ce document a ete delivre pour le compte de 7200034507 - universite de lille // 194.254.129.28tiwekacontentpdf_rex301 v1
 6
6
 7
7
1
/
7
100%