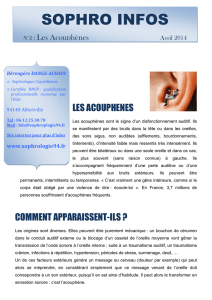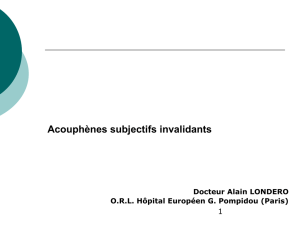Acouphène pulsatile : diagnostic et traitement.
Espace médecin > Les symptômes >
Professeur Emmanuel Houdart
L’acouphène pulsatile est dû à de nombreuses causes qui, traitées, permettent le plus
souvent, la disparition du symptôme. Il faut le diérencier de l'acouphène de timbre
continu qui n’a pas de traitement. Le diagnostic, fait en centre spécialisé, repose sur
l’IRM cérébrale et le scanner des rochers. Le traitement est le plus souvent
endovasculaire. Les sténoses carotidiennes sont une cause rare d’acouphènes
pulsatiles.
Acouphène continu ou acouphène pulsatile
L’acouphène se dénit comme une perception auditive simple non engendré par un
son extérieur. C’est donc un «bruit» que le patient est le seul à entendre. Ce
symptôme est très fréquent puisque 4 millions de français se plaignent d’un acouphène.
Dans 95 % des cas, l’acouphène est de timbre continu c’est-à-dire que le son perçu peut être
représenté comme une ligne horizontale, à type du siement ou de bourdonnement. Ce
symptôme ne reconnaît pas de cause et il n’est pas curable, c’est-à-dire qu’aucune action
thérapeutique ne peut le faire disparaitre.
Totalement diérent est l’acouphène pulsatile qui reconnait de nombreuses causes qui,
traitées, permettent la disparition du symptôme dans 70 % des cas.
Les mécanismes à l’origine du caractère pulsatile de l’acouphène
Les pathologies à l’origine d’un acouphène pulsatile sont nombreuses mais le plus
important est de comprendre les deux mécanismes qui président à l’apparition de ce
symptôme. Comprendre l’acouphène pulsatile suppose de savoir que tous les
«liquides» intracrâniens sont pulsatileset donc potentiellement à l’origine d’un son
pulsatile : le sang artériel, mais aussi le sang veineux et le liquide céphalo-rachidien.
Deux mécanismes expliquent l’apparition d’un acouphène pulsatile.
Le premier mécanisme est la survenue de turbulences dans un vaisseau (artère ou
veine) à proximité de l’oreille interne.

Représentation schématique des turbulences en aval d’une sténose vasculaire artérielle ou
veineuse
Représentation schématique des turbulences en aval d’une communication artério-veineuse
Un écoulement liquidien turbulent est sonore à la diérence d’un écoulement laminaire: la
cascade en montagne est turbulente (et donc sonore) alors que la Seine qui s’écoule de
façon laminaire n’occasionne aucun son. Des turbulences vasculaires sonores apparaissent
lorsqu’un vaisseau reçoit un ux accéléré (ce qui se produit en aval d’une sténose serrée ou
en aval de communications artério-veineuses).
Le second mécanisme est la déhiscence ou disparition de l’enveloppe osseuse qui
isole normalement l’oreille interne d’un uide intracrânien
Le ux reste alors insonore mais transmis en excès aux cellules ciliées de l’oreille interne.
Il découle de ces deux mécanismes que les explorations radiologiques dans l’acouphène
pulsatile devront s’intéresser aux vaisseaux intracrâniens passant à proximité de l’oreille
interne et à l’os temporal dans lequel est creusée l’oreille interne.
Diagnostic : j’entends battre mon cœur dans mon oreille
L’acouphène pulsatile se dénit comme la perception d’un son rythmé par les battements
cardiaques. L’écoute du patient permet souvent de le suspecter et des phrases comme:

«
j’entends, dans mon oreille, battre mon cœur
» ou encore
«c’est comme le son de
l’échographie pendant ma grossesse
» sont caractéristiques de ce symptôme. Qu’elles
aient été ou non prononcées, tout praticien devrait, lors d’une première consultation
pour acouphène, imiter deux types de sons: l’un horizontal (
vrrrrrrrrrr
) et l’autre
rythmé par la fréquence cardiaque (
pchit-pchit-pchit).
Si le patient reconnait le son pulsé, il faut adresser le patient en consultation auprès d’un
neuroradiologue interventionnel impliqué dans la prise en charge diagnostique et
thérapeutique de ce symptôme car le bilan fait appel à des examens très spécialisés.
Consultation neuroradiologique
La consultation neuroradiologique comporte de façon systématique une auscultation
crânienne et cervicale et une compression manuelle des vaisseaux cervicaux du côté de
l’acouphène pulsatile.
L’auscultationdoit concerner l’ensemble du crâne et du cou.
Le soue, s’il est présent, sera côté de 1/6 à 6/6 en précisant la zone où il est le plus
important. Cette auscultation n’a de valeur que positive car la majorité des acouphènes
pulsatiles n’entraînent aucun soue audible.
La compression des vaisseaux cervicaux est d’une grande valeur diagnostique.
Lorsque le patient perçoit son acouphène en consultation, elle recherche une interruption
du soue par la compression successive de la jugulaire interne puis de la carotide
commune du même côté que l’acouphène. En fonction du résultat, l’acouphène pulsatile
sera classé veineux, artériel ou neutre.
Examens radiologiques
L’IRM cérébrale est la première exploration à prescrire. Quatre séquences doivent ëtre
réaliséesdans l’ordre suivant :
Une séquence 3DTOF (time of ight) non injectée explorant du trou occipital au
vertex. Elle va analyser le ux dans les artères méningées de l’ensemble du crâne.
Une séquence T2 explorant les conduits auditifs internes.
Une séquence angiographique injectée sur les troncs supra-aortiques (Angio-IRM).
Une séquence T1 gadolinium écho de gradient destinée à explorer le contenu des
sinus duraux.
Ces séquences permettent de diagnostiquer toutes les causes de turbulences vasculaires.

Si cette IRM ne permet pas le diagnostic, elle est complétée par un scanner de l’os
temporal en coupes nes.
L’artériographie sélective à visée diagnostic qui était autrefois l’exploration de base des
acouphènes pulsatiles, n’a plus que de rares indications.
Indication thérapeutique
Au terme de ce bilan, lorsqu’une cause a été identiée, ce qui est le cas dans 75 % des cas, si
la pathologie n’expose pas le patient à un risque vital, l’indication du traitement dépend
exclusivement de la gêne ressentie. C’est dire que, dans l’immense majorité des cas, le
patient est le seul décideur de l’indication du traitement.
L'acouphène pulsatile veineux
Les acouphènes pulsatiles veineux sont de loin les plus fréquents. L’auscultation du
crâne est le plus souvent non contributive.
Ces acouphènes pulsatiles s’interrompent à la compression de la veine jugulaire
interne homolatérale. Les patients sourant d’un acouphène pulsatile veineux chronique
ont d’ailleurs souvent découvert par eux-mêmes qu’ils pouvaient obtenir un peu de «répit
sonore» en comprimant la région cervicale homolatérale, par un oreiller (ou un livre!) placé
sous la mandibule du côté de l’acouphène notamment lors de l’endormissement. Ce signe,
très souvent rapporté, oriente d’emblée le diagnostic.
Cette caractéristique clinique est très bien expliquée par l’anatomie: la compression
cervicale de la veine jugulaire interne interrompt l’écoulement du sang veineux dans le sinus
latéral homolatéral porteur de l’anomalie pour le redistribuer dans le sinus veineux
controlatéral, supprimant ainsi l’acouphène.
La sténose des sinus latéraux
La première cause d’acouphène pulsatile, est la sténose des sinus latéraux. Elle atteint
principalement les femmes entre 20 et 40 ans et est favorisée par le surpoids. L’acouphène
n’est en général perçu que d’un côté, habituellement du côté du sinus latéral dominant mais
les sténoses sont toujours bilatérales. Elles se situent toujours à la jonction entre le sinus
transverse et le sinus sigmoïde. Elles sont de deux types.

Séquence IRM T1 avec injection de gadolinium montrant une granulation hypertrophiée du
sinus latéral droit (èche blanche) responsable d’un acouphène pulsatile droit veineux
La sténose intrinsèque est due à l’hypertrophie d’une granulation sous-
arachnoïdienne qui bombe dans la lumière du sinus.
En angio-IRM avec injection de gadolinium, elle se présente, en hyposignal T1, comme une
masse arrondie située à l’intérieur du sinus.
La sténose extrinsèque est une sténose longue et elée du sinus sans obstacle
endoluminal. Elle est plus dicile à reconnaitre et est souvent méconnue des radiologues.
Le mécanisme de formation de ces sténoses reste pour l’instant inconnu.
En plus de l’acouphène pulsatile, ces sténoses sinusiennes peuvent aussi entraîner une
hypertension intracrânienne qualiée autrefois «d’idiopathique» avant l’avènement des
séquences angiographiques au scanner ou en angio-IRM. Les symptômes sont des
céphalées quotidiennes, de la fatigue chronique, des troubles visuels à type de ou visuel,
de diplopie, voire des pertes transitoires de la vue. On constate un œdème papillaire au
fond d’œil. La ponction lombaire ramène un LCR de composition normale dont la pression
est supérieure à 20 cm d’eau.
L’élévation de la pression intracrânienne est due à l’élévation de la pression en amont de la
sténose, dans le sinus sagittal supérieur, lieu habituel de la résorption du LCR. L’élévation de
la pression veineuse gêne la résorption du LCR dont la pression s’élève.
Qu’il existe ou non une hypertension intracrânienne, des voies de suppléances accessoire
du drainage du LCR s’installent de façon chronique. Ce circuit parallèle du LCR tend à «
inltrer» la selle turcique qui se creuse réalisant un aspect de selle turcique vide.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%