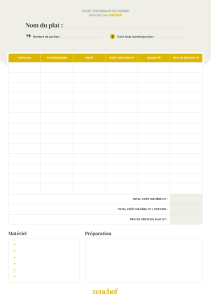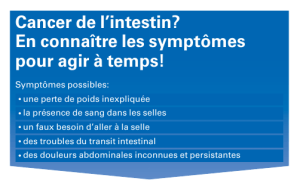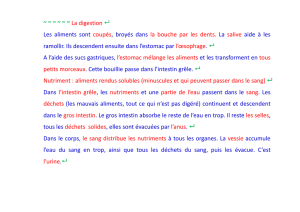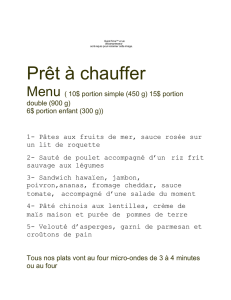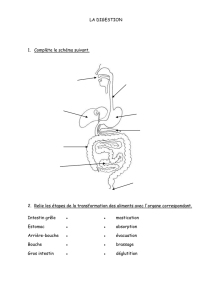EMBRYOLOGIE II
Université Quisqueya
Elisson Adrien
Abstract
Pendant la grossesse, plusieurs systèmes subissent des modifications physiologiques. Dans ce
document, on va voir quelques exemples comme l’appareil digestif, respiratoire, cardiovasculaire,
urinaire, et génital.

EMBRYOLOGIE II UNIVERSITE QUISQUEYA ADRIEN 2018J
1 Celui qui a étudié et a compris ce qu’il a étudié obtiendra de bonnes notes dans les épreuves d’examens s’il peut transmettre ce qu’il a appris.
APPAREIL DIGESTIF
L’appareil digestif provient du lécithocèle. En effet, a la 4e
semaine, lors de la délimitation, le lécithocèle se divise en 2
parties : une partie intra-embryonnaire qui est l’intestin
primitif et une partie extra embryonnaire qui est la vésicule
ombilicale.
L’intestin primitif comprend 3 portions: L’intestin
antérieur, l’intestin moyen en regard de la vésicule
ombilicale, et l’intestin postérieur.
L’intestin antérieur
Il va de la membrane pharyngienne à l’ébauche hépatique
(limite postérieure). Il est subdivisé en 2 parties : une partie
crâniale ou intestin pharyngien qui va de la membrane
pharyngienne au diverticule trachéal et une partie caudale
qui part du ventricule trachéal pour arriver au diverticule
hépatique.
Intestin Pharyngien ou Partie Crâniale
Il comprend un plafond, des faces latérales constituées par
l’appareil brachial et un plancher qui a pour dérivés la
thyroïde et la langue.
Faces Latérales
Au cours des 4e et 5e semaines du développement, une série
de sillons apparait le long des parois latérales de l’intestin
pharyngien : ce sont les poches entoblastiques orientées
dans le sens dorso-ventral. Elles sont au nombre de 5. En
regard des quatre premières au niveau de l’épiblaste
apparaissent quatre sillons : ce sont les poches brachiales
épiblastiques. Les massifs cellulaires pleins délimités par les
poches sont les arcs branchiaux.
DERIVEES DES POCHES ÉPIBLASTIQUES OU
POCHES ECTOBLASTIQUES.
La 1e poche s’invagine pour former le conduit auditif
externe. Son extrémité borgne constituera le feuillet externe
du tympan. Sur le bord de cette poche, des petits tubercules
bourgeonnent pour former le pavillon de l’oreille. Les
poches 2, 3, et 4 sont recouverts par le développement
important du 2e arc branchial. De ces poches subsistent
d’abord une partie cavité commune (le sinus cervical). Il
disparait par la suite.
DERIVES DES POCHES ENDOBLASTIQUES
La 1e poche se creuse, va à la rencontre de la première poche
épiblastique, s’accole à elle par son extrémité borgne. Ainsi
se forme le tympan, constitué d’un feuillet épiblastique, d’un
feuillet endoblastique, et un peu de mésenchyme entre les
deux. Le reste de la poche donne la caisse du tympan, les
cellules mastoïdiennes et la trompe d’eustache.
La deuxième donne naissance à l’amygdale palatine.
La 3e donne l’ébauche principale du thymus et les
parathyroïdes inferieures.
La 4e donne naissance à l’ébauche du thymus accessoire et
aux parathyroïdes supérieures.
A la 6e semaine, ces ébauches perdent leurs connections
avec la paroi pharyngienne et commence leur migration
caudale. Le thymus descend vers le thorax ou ces ébauches
droite et gauche fusionnent. Les parathyroïdes s’accrochent
à la thyroïde.
La 5e donne naissance aux cellules claires de la thyroïde.
DERIVEES DES ARCS BRANCHIAUX
1e arc : Le cartilage qui le parcourt est le cartilage de
MECKEL. Il induira la formation du maxillaire inferieur et
donne les deux premiers osselets de l’oreille moyenne : le
marteau et l’enclume. Le mésoblaste donnera les muscles
masticateurs et le petit marteau. L’épiblaste qui le recouvre
donnera presque la totalité de la moitié inférieure de la face.
2e arc : C’est l’arc du cartilage REICHERT, il donne l’étrier
(3e osselet), l’apophyse styloïde du temporal, le ligament
stylo hyoïdien, la petite corne et la partie supérieure de l’os
hyoïde. Le mésoblaste donne les muscles peauciers de la
face et le petit muscle de l’étrier. L’épiblaste donne
l’épiderme de la face antérieure du cou.
3e arc : Grande corne et la partie inférieure de l’os hyoïde.
4e arc : Les cartilages du larynx.
LA LANGUE
Elle apparait approximativement à la 4e semaine a partir de
3 ébauches et les deux autres impaires. Le premier arc
fournit l’ébauche paire sous forme de deux renflement
linguaux latéraux et une ébauche impaire médiane : le
tiberculum impair.
Ces ébauches fusionnent pour former le corps de la langue
en avant du V lingual. Les 3e et 4e arcs donnent une
formation commune impaire ; la copula qui constituera la
base de la langue et viendra se souder au corps au niveau du
V lingual. Toutes ces ébauches sont constituées de massifs
mésenchymateux recouvert d’entoblaste.

EMBRYOLOGIE II UNIVERSITE QUISQUEYA ADRIEN 2018J
2 Celui qui a étudié et a compris ce qu’il a étudié obtiendra de bonnes notes dans les épreuves d’examens s’il peut transmettre ce qu’il a appris.
LA THYROÏDE
Sur la ligne médiane la limite entre le 1e et du 2e arc,
l’entoblaste s’invagine dans le mésenchyme sous-jacent
sous forme d’un diverticule bilobé qui descendra en avant
de l’intestin antérieur. Ce diverticule bilobé est à l’origine
de la thyroïde. Il est d’abord relié au stomodeum par le canal
thyréoglosse qui disparait par la suite. Du diverticule bilobé
bourgeonnent des codons épithéliaux pleins qui se creusent
de cavité centrale. Ainsi se forment les vésicules
thyroïdiennes. La thyroïde commence à fonctionner à
partir du troisième mois.
PARTIE CAUDALE DE L’INTESTIN ANTÉRIEUR
La partie caudale de l’intestin antérieur donne naissance à :
l’œsophage, l’estomac, aux deux premières portions du
duodénum, au foie et au pancréas.
L’œsophage s’étend du bourgeon trachéal à la dilatation
fusiforme de l’estomac. Il s’allonge au cours du
développement.
L’estomac apparait à la 5e semaine sous l’aspect d’une
dilation fusiforme de l’intestin antérieur faisant suite à
l’œsophage. Cette dilatation est surtout nette au niveau de la
face postérieure. L’estomac est par ailleurs rattaché aux
parois du corps par deux mésos ; le mésogastre antérieur et
le mésogastre postérieur. Deux phénomènes vont se
produire pour donner à l’estomac sa morphologie et sa
position définitives :
1- Rotation autour d’un axe longitudinal (antéro-
postérieur)
2- Rotation autour d’un axe transversal.
Rotation autour d’un axe longitudinal
Primitivement sagittale, le plan de l’estomac subit une
rotation de 90o autour d’un axe longitudinal et devient alors
frontal. Sa face postérieure se place à gauche et sa face
antérieure est tournée vers la droite. Au cours de cette
rotation, le bord primitivement postérieur s’accroit plus vite
que le bord primitivement antérieur d’où la mise en place
d’une grande courbure. Le mésogastre dorsale est attiré vers
la gauche, ce qui entraine la formation d’une bourse
épiploïque.
Rotation autour d’un axe transversal
Primitivement les extrémités céphalique et caudale sont
situées sur la ligne médiane, puis la région céphalique et
cardiale se déplace à gauche et en bas, tan disque la région
caudale ou pylorique se dirige en haut et à droite.
LE FOIE
Vers la 4e semaine apparait à l’extrémité distale de l’intestin
antérieur le diverticule hépatique qui se divise bientôt en
deux bourgeons : un bourgeon supérieur, origine du canal
hépatique et du foie, un bourgeon inferieur a l’origine du
canal cystique, la vésicule biliaire. La portion commune a
ces deux bourgeons est le canal cholédoque. De la rotation
D1 et D2, le point d’abouchement du canal cholédoque au
départ antéro latéral droit sur D2 se retrouve latéral gauche
en contournant D2 par l’arrière. (lame mésoblastique épaisse
formant le plancher du péricarde, située entre l’aire
cardiaque et le canal vitellin), donne des lames épithéliales
qui induisent la formation d’un réseau capillaire sinusoïde.
LE PANCREAS
Il se forme à partir de deux ébauches : une ébauche dorsale
et une ébauche ventrale dérivant probablement du
diverticule hépatique.
L’ébauche ventrale migre en direction dorsale et se soude à
l’ébauche dorsale. Elle donne la moitie inferieure de la tête
du pancréas et le canal de Wirsung. L’ébauche dorsale
donne la moitie supérieure de la tête, le corps et la queue du
pancréas, ainsi qu’un canal accessoire appelé canal de
santorini.
INTESTIN MOYEN
Lors du rétrécissement progressif du canal vitellin, l’intestin
moyen s’allonge formant une anse intestinale primitive en
communication à son sommet avec le canal vitellin. Cette
anse fait saillie dans le cordon ombilical. Elle comprend
deux branches : une branche céphalique et une branche
caudale.la branche céphalique donne le segment distal du
duodénum, le jéjunum et la presque totalité de l’ileon.la
branche caudale donne la partie distale de l’iléon, le caecum,
l’appendice, le colon descendant et les 2/3 du colon
transverse.
L’évolution de cette anse met en jeu les processus suivants :
a- Un allongement portant essentiellement sur la
branche céphalique. Cette branche céphalique va
prendre un aspect ondulé et former un certain
nombre d’anses secondaires. La cavité abdominale
étant trop petite pour les contenir toutes, une grande
partie va élire domicile dans le cordon ombilical.
b- Simultanément s’effectue une rotation de l’anse
autour de son axe suivant un angle de 900. L’anse
place alors dans un plan horizontal, la branche
céphalique à droite et la branche caudale à gauche.

EMBRYOLOGIE II UNIVERSITE QUISQUEYA ADRIEN 2018J
3 Celui qui a étudié et a compris ce qu’il a étudié obtiendra de bonnes notes dans les épreuves d’examens s’il peut transmettre ce qu’il a appris.
c- Sous l’effet de la répression mésonéphros, du
ralentissement de l’augmentation du volume du foie
et de la cavité abdominale, toute la portion herniée
intègre la cavité abdominale, à commencer par la
portion proximale de la branche céphalique.
L’ébauche du caecum vient alors se placer sous le
foie. Secondairement le caecum descendra pour
occuper sa position définitive dans la fosse iliaque
droite.
INTESTIN POSTERIEUR
Dérivé du cul de sac postérieur, il est limité à son extrémité
distale par la membrane cloacale qui disparait à la neuvième
semaine. L’intestin postérieur donne 1/3 distal du colon
transverse, le colon descendant, le sigmoïde, le rectum et la
partie supérieure du canal anal.
Au début, dans sa portion la plus caudale, l’intestin
postérieur est en communication avec l’allantoïde. Le
confluent constitue le cloaque. Entre l’allantoïde et l’intestin
postérieur, il existe une cloison ento-mésoblastique
primitive incomplète qui s’allonge sous forme d’un éperon
progressant vers le bas. Cet éperon atteint la membrane
cloacale et sépare ainsi l’appareil digestif de l’appareil uro-
génital.
La membrane cloacale est également divisée en membrane
uro-génitale en avant et en membrane anale en arrière. Avant
de disparaitre, la membrane anale s’enfonce en profondeur,
il se forme ainsi une cavité, le proctodeum, entouré d’un
bourrelet. Le proctodeum est à l’origine de la portion
inferieure du canal anal. Cette portion est d’origine
épiblastique. Ainsi l’appareil digestif est d’origine
épiblastique à ses deux extrémités et entoblastiques pour
le reste.
APPAREIL RESPIRATOIRE
L’ébauche de l’appareil respiratoire apparait vers la fin de la
troisième semaine. C’est un diverticule de la face inferieure
de l’intestin primitif dans la région cervicale jusqu’en arrière
de la dernière poche entoblastiques. Cette ébauche est
appelée gouttière respiratoire, allongée dans le sens cranio-
caudale, s’accroit très rapidement dans le mésoblaste
environnant. Simultanément, elle va se détacher du tube
digestif cervical par cloisonnement. Il existe entre
l’œsophage et le bourgeon trachéal une gouttière qu’on
appelle oesophago-trachéal. Progressivement, les berges
de la gouttière se pincent, se rapprochent l’une de l’autre et
fusionnent. Il se forme ainsi une cloison : le septum
OESOPHAGO-TRACHEAL. Ainsi, le bourgeon trachéal
en avant se sépare de l’œsophage en arrière. Cependant, il
persiste de façon définitive une communication a la partie
supérieure. C’est l’ouverture de la trachée au niveau du
larynx.
EVOLUTION DE L’EBAUCHE RESPIRATOIRE
LE LARYNX
Il constitue la partie toute céphalique de l’ébauche
respiratoire. Les constituants épithéliaux ont une région
épiblastique. L’armature cartilagineuse et la musculature
intrinsèque se développent à partir du mésoblaste des 4e et 5e
arcs branchiaux.
TRACHEE-BRONCHE
Durant le cloisonnement, le bourgeon trachéal s’allonge en
direction trachéal et forme un tube médian a la trachée.
L’extrémité caudale du tube laryngo-trachéal donne
naissance à deux bourgeons, l’un à gauche et l’autre à droite,
ébauche des bronches souches.
Vers la 5e semaine, le bourgeon droit se divise en 3
esquissant ainsi les branches lobaires supérieur, moyen et
inferieur. Le bourgeon gauche se divise en deux : supérieure
et inferieur. Ces branches lobaires se ramifient ensuite très
activement et l’on aboutit vers 6e mois à la formation
d’environ 18 générations de bronches. Ce pouvoir de
division ne s’arrête pas à la naissance. Pour certains, il
continuerait même après la naissance et il se forme 6
nouvelles générations. Toutes ces bronches de division vont
constituer le revêtement épithélial trachéo-broncho-
alvéolaire pulmonaire.
L’épithélium respiratoire a donc une origine
entoblastique. On ne peut cependant isoler cette
prolifération entoblastique du mésoblaste splanchnopleural
dans lequel elle se fait.
ROLE DU MESOBLASTE
Le rôle du mésoblaste est primordial.
1. Il joue le rôle d’inducteur ; il est responsable de la
morphogenèse respiratoire, c’est-à-dire de la
division et de la différentiation du diverticule
respiratoire.
2. Le mésoblaste se différencie pour donner toutes les
dérivées conjonctives propres à l’appareil
respiratoire : tissus de soutien, cartilage, fibres
élastiques, cloison inter alvéolaire et plèvre.

EMBRYOLOGIE II UNIVERSITE QUISQUEYA ADRIEN 2018J
4 Celui qui a étudié et a compris ce qu’il a étudié obtiendra de bonnes notes dans les épreuves d’examens s’il peut transmettre ce qu’il a appris.
3. Le mésoblaste va permettre le développement de la
vascularisation
DIFFERENCIATION PULMONAIRE
Cette différentiation comprendra :
1. Une augmentation considérable de la
vascularisation. La prolifération vasculaire se fait au
cours des 5e et 6emois. Elle aboutit à la formation de
capillaires situés au contact de l’épithélium
pulmonaire.
2. Formation des alvéolaires. Il est actuellement admis
que les alvéoles se forment durant la vie fœtale.
L’épithélium alvéolaire provient seulement de
l’aplatissement extrême de l’épithélium
entoblastique qui revêt tout l’arbre respiratoire au
niveau des culs-de-sac bronchiques. Cette
alvéogenèse se ferait au 6e mois.
3. Maturation nerveuse. La maturation nerveuse est
tardive et postérieure à l’organogenèse respiratoire.
Le centre respiratoire bulbaire est fonctionnel a 5
mois et demi. Cette concordance dans le temps entre
la poussée vasculaire, l’alvéogenèse et la maturation
nerveuse assure la viabilité fœtale.
L’APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE
L’appareil cardio-vasculaire représente un système
hydraulique constitué par une succession d’organes creux
dans lesquels circule le sang. L’élément moteur de ce
système est le cœur. Les canalisations sont les vaisseaux
(artères et veines).
DEVELOPPEMENT EMBRYOLOGIQUE
Les éléments cellulaires dérivant du zygote ne peuvent vivre
sans apport extérieur, l’œuf humain étant un oligo- vitellin.
C’est par inhibition que se font les échanges entre le zygote
et la mère, et cela jusqu'à ce que s’établisse une circulation
intra-embryonnaire qui se raccorde à la circulation extra-
embryonnaire. Les échanges se font à travers la barrière
placentaire.
L’appareil cardio-vasculaire est le seul système permettant
d’assurer un apport nutritif et une élimination des déchets
dans toutes les cellules de l’embryon.
L’appareil cardiovasculaire se développe en plusieurs étapes
successives :
1. Différenciation vasculo-sanguine extra
embryonnaire.
2. Différentiation vasculaire intra embryonnaire
3. Réalisation de la circulation intra-extra
embryonnaire.
4. Établissement de la circulation néo-fœtale.
DIFFERENCIATION VASCULAIRE EXTRA-
EMBRYONNAIRE
Le premier secteur se caractérise par sa date d’apparition
précoce et sa localisation extra-embryonnaire. Le premier
signe de développement vasculaire apparait dans la
splanchnopleure entourant le lécithocèle aux environs de la
3esemaine. On observe des amas cellulaires, les ILOTS DE
WOLF ET DE PANDER, au contact du feuillet
endoblastique et du feuillet splanchnopleural, ces amas
cellulaires pleins, dans un premier temps, donnent naissance
à une double population cellulaire. Les cellules
périphériques, les angioblastes s’aplatissent et s’isolent des
cellules centrales. Elles deviennent alors de cellules
endothéliales des premiers conduits vasculaires. Les cellules
centrales s’arrondissent et se multiplient, un liquide
s’insinue entre elles, ce sont les cellules sanguine souches
baignées par du plasma. Ce premier réseau va proliférer
activement autour du lécithocèle, constituant le système
vasculaire vitellin.il s’étend vers le pédicule embryonnaire
formant le réseau vasculaire allantoïdien.
DIFFERENCIATION INTRA EMBRYONNAIRE
Vers le 18ejour, un peu plus tard que les ébauches extra
embryonnaires, le mésoblaste intra embryonnaire
différencie des amas cellulaires dans la future région
céphalique de l’embryon, amas uniquement angio-
formateurs. Ces amas très comparables aux amas de WOLF
et de PANDER en diffèrent par le fait qu’ils donnent
uniquement des conduits vasculaires. Ces vaisseaux
s’emplissent d’un liquide plasmatique acellulaire. Certains
amas situent de part et d’autre de la membrane pharyngienne
se réunissent pour former deux volumineux amas, l’un à
droite et l’autre à gauche. Ce sont les ébauches cardiaques
paires, chacune d’elles donne des angioblastes qui limitent
deux formations tubulaires : les tubes cardiaques pairs. Ces
deux tubes symétriques s’allongent et forment chacun une
artère en direction céphalique.
Ainsi au 20e et 21ejours, l’embryon perd son aspect discoïde
et planiforme pour s’arrondir, les deux tubes pairs se
rapprochent l’un de l’autre sur le plan sagittal et viennent en
position ventrale. Ils sont dès cette époque animés de
contractions. L’artère en avant de chaque tube cardiaque est
une aorte ventrale. Elle chemine dans le mésoblaste en
décrivant une courbe concave en arrière de l’arc aortique qui
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%