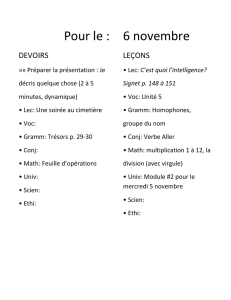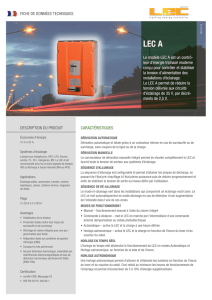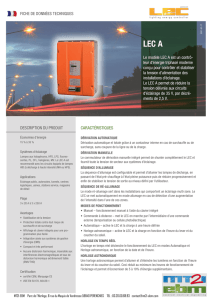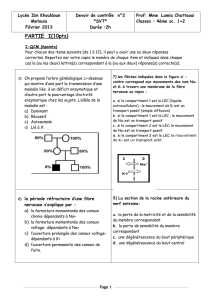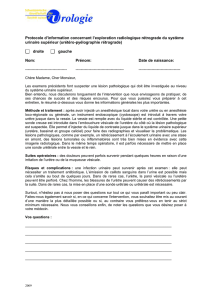Calculs rénaux et urétéraux : Épidémiologie et gestion
Telechargé par
Jean-Paul BARLAGUEL

375
DOSSIER
LA REVUE DU PRATICIEN MÉDECINE GÉNÉRALE l TOME 32 l N° 1001 l MAI 2018
SOMMAIRE
375
Épidémiologie
376
Gérer la crise
377
Quelle imagerie ?
Devenir des
calculs
Quand s’abstenir ?
378
Méthodes
instrumentales
380
Cas particuliers
CALCULS RÉNAUX ET URÉTÉRAUX
Par Paul Meria,
service d’urologie,
hôpital Saint-Louis,
AP-HP, 75475 Paris ;
Académie nationale de
chirurgie, 75006 Paris.
La maladie lithiasique urinaire (ou lithiase
urinaire) a pour conséquence la formation
de calculs dans les cavités urinaires. Cette
dernière résulte d’une cristallisation de substances
(calcium, phosphate, oxalate…) dont la concentra-
tion est excessive dans les urines en raison d’une
augmentation de leur quantité et/ou d’un volume
de diurèse insuffisant.
Depuis une trentaine d’années, grâce à la
miniaturisation du matériel et à des appareils
numériques d’endoscopie très performants, les
traitements ont évolué vers des procédés mini-
invasifs. La chirurgie à ciel ouvert a donc presque
disparu au profit des techniques extracorporelles
et endoscopiques, très efficaces et sûres.
La gestion des calculs doit s’accompagner d’une
prise en charge de la maladie lithiasique pour
réduire le risque de récidive.
ÉPIDÉMIOLOGIE
La prévalence de cette maladie est estimée en
France à 10 %. Les patients de sexe masculin sont
deux fois plus touchés, âge moyen de survenue :
entre 35 et 40 ans. Le taux de récidive des calculs
après traitement urologique est d’environ 50 %
à 5 ans et 75 % à 10 ans en l’absence de prise en
charge de la maladie. Si elle est correctement éva-
luée et traitée, ce taux est inférieur à 10 %.
L’incidence n’a pas cessé de croître depuis 50 ans
dans les pays occidentaux. Les apports sodés et
protéiques, qui ont augmenté au cours du XXe
siècle, majorent la calciurie et donc favorisent
la formation de calculs oxalocalciques (les plus
fréquents). Syndrome métabolique et diabète
sont des facteurs de risque, en particulier pour
la lithiase urique. On note une histoire familiale
dans près de 40 % des cas.
Les principales conséquences sont la morbidité
induite par les coliques néphrétiques (CN) et le
retentissement au niveau rénal : infections ou évo-
lution vers l’insuffisance rénale.
Connaître la composition du calcul est essen-
tiel : cela influence le traitement et contribue
aussi au diagnostic étiologique de la maladie
lithiasique (fig. 1). Dans 70 % des cas, les calculs
sont composés d’oxalate de calcium, dans 15 % de
phosphate de calcium et dans 11 % d’acide urique.
Moins fréquents sont ceux constitués de phos-
phate ammoniaco-magnésien ou de cystine.
Chaque année, plus de 100 000 font l’objet d’un traitement
urologique en France.
Olivier Bacquet - Flickr
!375!_MG1001_Dossier_Meria V2.indd 375 26/04/2018 16:04
TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN MEDECINE GENERALE

DOSSIER DOSSIER
376 377
LA REVUE DU PRATICIEN MÉDECINE GÉNÉRALE l TOME 32 l N° 1001 l MAI 2018 LA REVUE DU PRATICIEN MÉDECINE GÉNÉRALE l TOME 32 l N° 1001 l MAI 2018
Calculs rénaux et urétéraux
GÉRER LA CRISE3
Le mode de révélation le plus fréquent est la crise
de colique néphrétique, qui traduit généralement
le passage d’un calcul dans l’uretère. Cependant,
les calculs urinaires peuvent être asymptoma-
tiques et découverts fortuitement à l’imagerie
(ASP, échographie rénovésicale) ou lors du bilan
d’une insuffisance rénale chronique.
La colique néphrétique est un syndrome dou-
loureux aigu lombo-abdominal résultant de la
mise en tension brutale de la voie excrétrice du
haut appareil urinaire en amont d’un obstacle.
La douleur lombaire est unilatérale, brutale et
intense avec une irradiation antérieure et descen-
dante vers la fosse iliaque et les organes génitaux
externes. Elle diffuse parfois vers l’angle costo-
vertébral. Pollakiurie, brûlures mictionnelles,
mictions impérieuses, hématurie peuvent être
associées, ainsi que nausées et vomissements,
agitation, voire anxiété. La douleur peut se limiter
aux zones d’irradiation, en particulier à la phase
initiale.
Palpation et percussion de la fosse lombaire
sont douloureuses, sans défense abdominale.
Dans les formes simples, le patient est apyrétique.
La bandelette urinaire est recommandée et mon-
tre une hématurie microscopique dans 67 à 95 %
des cas. La présence de nitrites et de leucocytes
impose un ECBU. Il est également conseillé d’éva-
luer la fonction rénale en dosant la créatininémie.
Dans 5 % des cas, c’est une forme compliquée
liée au terrain ou à des signes de gravité pour
laquelle avis spécialisé et hospitalisation sont
nécessaires (encadré 1). Certains syndromes dou-
loureux abdominaux ou lombaires sont à éliminer
par des explorations complémentaires (encadré 2).
Il est important d’évaluer et soulager la douleur
rapidement, avant même l’imagerie. La restriction
hydrique n’a pas fait la preuve de son efficacité
1. Formes compliquées
Liées au terrain
– Grossesse
– Insuffisance rénale chronique
– Rein transplanté
– Rein unique
– Uropathie connue
– Patient VIH sous antiprotéases
Avec signes de gravité
– Fièvre
– Oligo-anurie/insuffisance rénale
– Douleur résistant au traitement bien
conduit
2. Diagnostics différentiels
Urologiques
– Pyélonéphrite aiguë
– Infarctus rénal
– Nécrose papillaire
– Torsion du cordon spermatique
Non urologiques
– Fissuration d’un anévrisme de l’aorte
ou de ses branches
–
Grossesse extra-utérine, torsion de kyste ovarien
– Affections coliques et appendiculaires
– Pancréatite aiguë, colique hépatique
– Pneumopathie basale
– Lombalgie aiguë
Fig. 1 – A : calculs d’oxalate de calcium monohydraté, ou whewellite, liés à une hyperoxalurie. B : calcul d’oxalate
de calcium monohydraté, induit par une hyperoxalurie primaire de type 1 par déficit hépatique en alanine glyoxylate
aminotransférase. C : calcul d’oxalate de calcium dihydraté, ou weddellite, associé à une hypercalciurie. D : calcul
de carbapatite provoqué par une hypercalciurie avec oxalate urinaire normal bas dans un contexte d’infection urinaire.
E : calcul de carbapatite chez un patient ayant une acidose tubulaire distale acquise (syndrome de Gougerot-Sjögren).
F : calcul de brushite (phosphate acide de calcium dihydraté), fréquent dans les hyperparathyroïdies primaires.
G : calcul d’acide urique couramment observé dans les syndromes d’insulinorésistance. H : calcul de cystine induit par
une cystinurie. Tous les calculs figurés mesurent entre 4 et 6 mm.
!375!_MG1001_Dossier_Meria V2.indd 376 26/04/2018 16:04
TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN MEDECINE GENERALE

DOSSIER DOSSIER
376 377
LA REVUE DU PRATICIEN MÉDECINE GÉNÉRALE l TOME 32 l N° 1001 l MAI 2018 LA REVUE DU PRATICIEN MÉDECINE GÉNÉRALE l TOME 32 l N° 1001 l MAI 2018
bien qu’elle soit encore préconisée par certains.
Un bain chaud ou encore une séance d’acupunc-
ture peuvent aider. Certains centres spécialisés
proposent également des blocs paravertébraux ou
l’injection de lidocaïne dans la fosse lombaire et
dans la portion profonde du muscle psoas.
Cependant, ces traitements ne sont pas toujours
reproductibles. De nombreux médicaments sont
utilisés par voie orale ou parentérale. Le phloro-
glucinol (Spasfon), encore largement prescrit car
bien toléré, n’a pas démontré son intérêt. Le para-
cétamol seul ou associé au tramadol peut s’avérer
efficace si les douleurs sont de faible intensité.
Les AINS sont le traitement de référence. Ils
agissent en bloquant les cyclo-oxygénases impli-
quées dans la réaction inflammatoire et diminuent
l’œdème local tout en provoquant une relaxation
des fibres musculaires lisses de l’uretère. Ils rédui-
sent également le débit de filtration glomérulaire
(sans conséquence si fonction rénale normale).
Parmi les molécules utilisables (diclofénac, indo-
métacine, kétoprofène), seul le kétoprofène a
une AMM pour l’administration IV. Il a l’avantage
d’être maniable et relativement sûr, et ne néces-
site pas de titration. Sa durée d’action est prolon-
gée. C’est le médicament de première intention,
en l’absence de contre-indication (insuffisance
cardiaque, rénale ou hépatique sévère, grossesse,
ulcère gastrique, hypersensibilité au produit).
O
n préfère la voie intraveineuse. En général,
100 mg en IV lente, au maximum 3 fois/24 heures.
Le kétoprofène est utilisable per os en l’absence de
vomissement (100-200 mg/j). La morphine titrée
peut être injectée en IV en cas de non-réponse
au traitement initial ou de contre-indication aux
AINS
.
QUELLE IMAGERIE ?
En urgence, les examens d’imagerie sont indiqués
pour affirmer le diagnostic, évaluer la gravité (rein
unique, urinome par rupture des cavités excré-
trices) et préciser les chances d’expulsion sponta-
née du calcul (taille, localisation et morphologie).
L’association ASP/échographie rénovésicale
a une sensibilité de 80 à 90 % pour identifier le
calcul et l’obstruction.
Le scanner sans injection est très performant
pour le diagnostic de colique néphrétique :
ses
sensibilité et spécificité sont élevées, comprises
entre 96 et 100 %. Outre le calcul (taille et densité
en unités Hounsfield, UH) et sa localisation précise,
il met en évidence une dilatation pyélocalicielle et
une néphromégalie avec infiltration de la graisse
périrénale et péri-urétérale (fig. 2). C’est l’explora-
tion de référence avant un traitement urologique
afin de préciser au mieux la morphologie des
voies urinaires et les caractéristiques du calcul. Un
examen des voies urinaires avec injection est éga-
lement recommandé avant de traiter un calcul. 2-4
En cas de doute sur la valeur fonctionnelle du
rein atteint, une scintigraphie au DMSA ou au
MAG 3 (traceurs diurétiques éliminés par voie
rénale) peut être nécessaire.
DEVENIR DES CALCULS
URÉTÉRAUX
Leur élimination spontanée est fréquente au
décours d’une crise, d’autant plus qu’ils sont petits
et bas situés. Statistiquement, ceux dont la taille
est inférieure à 5 mm sont expulsés dans 46 à 85 %
des cas ; ils le sont dans 36 à 59 % si la taille est
supérieure à 5 mm. Les calculs de l’uretère dis-
tal s’éliminent dans 71 % des cas contre 46 % pour
ceux de l’uretère moyen et 22 % pour ceux de
l’uretère proximal. Au-delà de 8-10 mm, il n’y a
quasiment jamais d’évacuation.
Les alphabloquants augmentent le taux d’ex-
pulsion. Dans une étude récente, la tamsulosine
ou la silodosine permettaient d’obtenir 82 à 88 %
d’expulsion spontanée pour des calculs mesurant
de 3 à 10 mm. Pour les recueillir, il faut demander
au patient de filtrer ses urines et faire une ana-
lyse morphoconstitutionnelle par spectrométrie
infrarouge.
Si le calcul est toujours en place dans l’uretère
à 4-6 semaines, il a peu de chances de s’éliminer
spontanément : un traitement urologique doit
être proposé.
QUELLE PRISE EN CHARGE ?
Elle dépend de plusieurs éléments (encadré 3).2-6
Les sociétés savantes suggèrent de ne pas trai-
ter les petits calculs rénaux asymptomatiques,
en sachant que le seuil se situe généralement au-
delà de 5, voire 10 mm.2, 6 Ceux asymptomatiques
situés dans le calice inférieur ou dans des zones
considérées comme exclues, telles que les diver-
ticules caliciels, peuvent également faire l’objet
d’une surveillance.6 Cette stratégie doit néanmoins
être discutée avec le patient.
Chez des malades très fragiles, aux lourdes co-
morbidités, la surveillance peut être proposée
quelle que soit la taille des calculs, si toutefois ils
sont asymptomatiques.6
L’abstention thérapeutique doit s’accompa-
gner d’un suivi par ASP et/ou échographie rénale
annuelle. Un bilan métabolique sanguin et uri-
naire est également souhaitable afin de ne pas
méconnaître un facteur de risque de croissance du
calcul. De même, les recommandations hygiéno-
diététiques (encadré 4) doivent être rappelées au
patient ainsi que les risques évolutifs. En cas de
complication douloureuse et/ou infectieuse, il doit
immédiatement consulter.
Chez certains sujets, les calculs rénaux sont trai-
tés même si leur taille est inférieure au seuil.6 C’est
le cas des aviateurs et des spationautes. Les marins
3. Critères de prise
en charge
Liés au calcul :
– taille
– topographie
– composition et dureté,
connues ou présumées
Liés au patient :
– caractéristiques anatomiques
– comorbidités éventuelles
– anatomie de la voie excrétrice
supérieure
– fonction rénale globale et
valeurs fonctionnelles
respectives de chaque rein
– certains impératifs personnels
ou professionnels (aviateurs)
Liés à l’urologue :
– plateau technique dont
il dispose
Fig. 2 – Scanner montrant un calcul
préméatique droit.
!375!_MG1001_Dossier_Meria V2.indd 377 26/04/2018 16:04
TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN MEDECINE GENERALE

DOSSIER DOSSIER
378 379
LA REVUE DU PRATICIEN MÉDECINE GÉNÉRALE l TOME 32 l N° 1001 l MAI 2018 LA REVUE DU PRATICIEN MÉDECINE GÉNÉRALE l TOME 32 l N° 1001 l MAI 2018
Calculs rénaux et urétéraux
au long cours et les professionnels exerçant dans
des zones éloignées de toute offre de soins peuvent
faire l’objet d’une prise en charge spécifique après
évaluation du rapport coût-bénéfice, ainsi que les
personnes vivant dans la précarité.
Traitements médicaux
La modification des caractéristiques physi-
cochimiques des urines a un effet uniquement
sur les calculs rénaux constitués d’acide urique
pur. Si ces derniers sont évoqués par une densi-
té au scanner de l’ordre de 250-350 UH dans un
contexte de pH urinaire acide (autour de 5), une
alcalinisation des urines est préconisée par la
consommation d’eaux bicarbonatées.2-4 Les eaux
gazeuses à forte teneur en bicarbonates (Vichy
Célestins, Vichy Saint-Yorre…) peuvent en effet
augmenter le pH urinaire.
L’objectif est d’obtenir des valeurs comprises
entre 6,5 et 7 (à contrôler par du papier réactif). Ne
pas dépasser 7, pour éviter la formation d’autres
types de calculs, induits par un pH alcalin.
En cas de contre-indications (ces eaux sont
riches en sodium), il est possible de prescrire du
citrate de potassium sous forme de compléments
alimentaires ou en préparation magistrale à une
dose de l’ordre de 4 grammes par jour à diluer
dans 1,5 litre d’eau. La consommation de citrons
pressés a aussi une certaine efficacité (l’acide ci-
trique induit une alcalinisation des urines). Ainsi,
une dissolution complète du calcul peut être obte-
nue dans un délai de quelques semaines.
Une correction des facteurs de risque doit être
proposée pour éviter les récidives : obésité, dia-
bète de type 2...2-4
Toutefois, les autres calculs ne sont pas dissous
par ces procédés et relèvent de techniques instru-
mentales.
MÉTHODES INSTRUMENTALES
Leurs indications concernent en général :
– les calculs urétéraux symptomatiques, quelle que
soit leur taille, ou non expulsés après 4-6 semaines
de traitement médical ;
– les calculs rénaux de taille >10 mm, voire 5 mm ;
–
les calculs symptomatiques ou à l’origine de
complications douloureuses ou infectieuses ;
– ceux responsables d’une altération de la fonction
rénale ;
– ceux dont la taille a progressé lors du suivi ;
– ceux survenant chez les patients à risque de
complications ou chez des enfants ;
– les calculs d’acide urique n’ayant pas répondu à
l’alcalinisation.
Les calculs urétéraux responsables de CN compli-
quée (encadré 1) imposent un drainage urgent de
la voie excrétrice par sonde JJ ou néphrostomie
percutanée dans un premier temps, le traitement
spécifique étant réalisé secondairement.
Les approches actuellement disponibles sont la
lithotritie extracorporelle (LEC), l’urétéroscopie
(URS), l’urétérorénoscopie (URSS), la néphrolitho-
tomie percutanée (NLPC) et, de façon plus anecdo-
tique, la chirurgie laparoscopique ou à ciel ouvert
(tableaux). Ces techniques sont complémentaires
et parfois concurrentes. Dans certains cas, elles
sont associées (successivement ou dans le même
temps opératoire) pour augmenter l’efficacité.2-4
L’ECBU doit être contrôlé dans les 5 à 10 jours
précédant toute intervention, quelle que soit la
méthode.2 Il doit être impérativement stérile.
Dans le cas contraire, on traite l’infection ou la
bactériurie avant tout geste thérapeutique.
Le recueil des fragments de calculs après traite-
ment (pour analyse morphoconstitutionnelle) est
indispensable afin de pouvoir porter le diagnostic
étiologique de la lithiase.
TRAITEMENTS INSTRUMENTAUX DES CALCULS RÉNAUX
Calcul < 2 cm > 2 cm Complexes
Première intention LEC NPLC Associations NLPC, URS, LEC
Alternative URS*, NLPC Associations NLPC,
URS, LEC
Remarques Pas plus de 2 séances
de LEC
Surveillance des
calculs < 5 mm
asymptomatiques
Jamais de LEC en
monothérapie.
Attendre 4-6 semaines
pour la LEC après
un autre traitement
La chirurgie à ciel ouvert est
possible dans certains cas
très complexes
* URS en première intention : troubles de la coagulation (AVK, antiagrégants plaquettaires) ; calculs
multiples ou urétéral associé ; durs (brushite, cystine, et/ou densité > 1 000 UH) ; IMC > 30 ; insuffisance
rénale chronique ; particularités anatomiques et malformations (rein unique, en fer à cheval ou pelvien,
diverticule caliciel) ; souhait du patient après information.
TABLEAU 1
4. Mesures générales pour traiter la lithiase
urinaire
• Diurèse > 2 000 mL/24 heures = premier objectif à atteindre
et à maintenir au long cours : évaluée sur le volume des urines
de 24 heures ou sur les urines du réveil avec mesure de la densité
(objectif < 1 015) ;
• Boissons à répartir tout au long de la journée ;
• Alimentation équilibrée/réajustement alimentaire :
– normalisée en calcium (800 mg-1 g/j), en sel (< 9 g/j) et en
protéines animales < 1,2 g/kg/j) ;
– limiter les prises excessives d’aliments riches en oxalate (chocolat,
fruits secs, épinards, oseille, rhubarbe, thé) ;
– limiter les boissons sucrées et sodas (fructose).
TRAITEMENTS INSTRUMENTAUX
DES CALCULS URÉTÉRAUX4
Taille < 10 mm > 10 mm
Uretère lombaire 1 : LEC ; 2 : URS URS ou LEC
Uretère ilio-pelvien LEC ou URS 1 : URS ; 2 : LEC
TABLEAU 2
!375!_MG1001_Dossier_Meria V2.indd 378 26/04/2018 16:04
TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN MEDECINE GENERALE

DOSSIER DOSSIER
378 379
LA REVUE DU PRATICIEN MÉDECINE GÉNÉRALE l TOME 32 l N° 1001 l MAI 2018 LA REVUE DU PRATICIEN MÉDECINE GÉNÉRALE l TOME 32 l N° 1001 l MAI 2018
La LEC fragmente les calculs via des ondes de
choc produites par un générateur extracorporel
et focalisées sur le calcul (repérage radiologique).
Objectif : obtenir des fragments de petite taille
susceptibles d’être éliminés dans les urines. C’est
le traitement de référence des calculs de moins
de 2 cm (densité < 1 000 UH). Elle a peu de compli-
cations et un taux de succès de l’ordre de 60 à 70 %
chez des patients bien sélectionnés (tableaux).2, 3
Il faut cependant éviter de multiplier les séances,
et opter pour une autre technique après l’échec de
2 tentatives.2 Elle est indiquée à tout âge, même
chez les enfants, et se pratique sous sédation-
analgésie, le plus souvent en ambulatoire.
Ses contre-indications doivent être respectées :
–
traitement antiagrégant ou anticoagulant en
cours et troubles de l’hémostase non corrigés ;
– infection urinaire non traitée ;
– grossesse ;
– anévrisme aortique ou rénal ;
– obésité morbide ;
– malformations orthopédiques sévères ;
– sténose de la voie excrétrice gênant l’évacuation
des fragments.
Les calculs dont la densité au scanner dépasse
1 000 UH, quelle que soit leur taille, sont plus ré-
sistants à la LEC.2-4 Cette dernière est également
peu efficace sur les calculs à dureté élevée (cys-
tine, par exemple) et ceux du calice inférieur qui,
même pulvérisés, s’éliminent mal (taux de succès
30 %). Il est néanmoins possible d’améliorer
l’évacuation des fragments résiduels caliciels in-
férieurs et moyens grâce à la posturothérapie ou
douche lombaire en position inversée : le patient
est placé à plat ventre sur une table basculante,
les pieds fixés par une jambière à crochets, puis il
est suspendu tête en bas et douché à la lance, sur
la région lombaire, pendant 4 à 5 minutes. Cette
méthode est pratiquée généralement dans des
stations thermales spécialisées (Vittel, Capvern)
et peut être prise en charge partiellement par
l’Assurance maladie.
L’URS est réalisée avec des urétéroscopes mé-
talliques de 2-3 mm de diamètre permettant
d’accéder à l’uretère. L’URSS est pratiquée avec
des urétéroscopes souples, fibrés ou numériques,
de moins de 3 mm de diamètre atteignant les cavi-
tés rénales par voie rétrograde afin d’extraire le
calcul à la pince. Associées à la fragmentation par
laser, elles sont très efficaces sur ceux de moins de
2 cm, quelles que soient leur composition et leur
densité au scanner (fig. 3 et 4).2-6 En effet, aucun
ne résiste à l’application intracorporelle d’un
laser, même si ceux dont la taille avoisine les 2 cm
requièrent parfois 2, voire 3 séances. Un drainage
par sonde JJ est souvent laissé en place en post-
opératoire.
L’URS et l’URSS se pratiquent sous anesthésie
générale et leurs indications chevauchent assez
souvent celles de la LEC, au prix d’une morbidité
un peu plus élevée, essentiellement infectieuse.
Ces techniques ont d’ailleurs dépassé la LEC en
volume d’activité depuis quelques années. Elles
ne sont pas contre-indiquées en cas d’obésité et
peuvent être proposées aux patients sous anti-
agrégants, voire anticoagulants.2, 5 L’URSS permet
également de traiter les calculs situés dans des
reins malformés.
La NLPC consiste à introduire un néphroscope
dans le rein à travers la paroi postérieure de
l’abdomen par un tunnel mesurant 5 à 10 mm de
diamètre. La fragmentation, effectuée par procé-
dé endocorporel (laser ou ultrasons) est suivie de
l’extraction. C’est le traitement de référence des
calculs volumineux, supérieurs à 2 cm, et plus gé-
néralement complexes et coralliformes (fig. 5 et 6).
Fig. 3 – Vue en urétéroscopie
d’un calcul rénal fragmenté
au laser.
Fig. 4 – Extraction des
fragments de calcul au panier
lors de l’URSS.
Fig. 5 – Calcul pyélique avant
fragmentation en NLPC.
Fig. 6 – Calcul complexe
pyélocaliciel droit traité par
NLPC. 6
5
4
3
!375!_MG1001_Dossier_Meria V2.indd 379 26/04/2018 16:04
TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN MEDECINE GENERALE
 6
6
1
/
6
100%