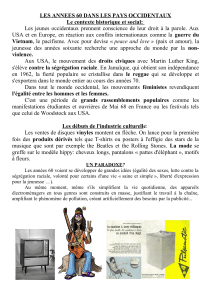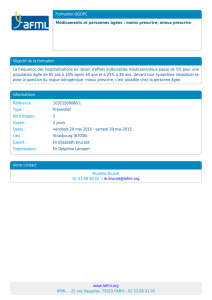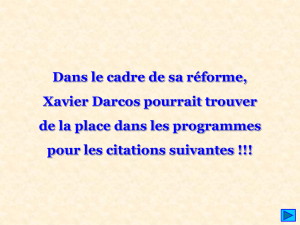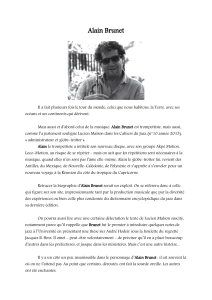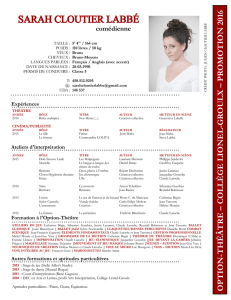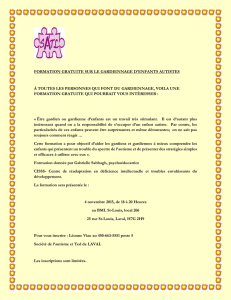La synthèse – préparation au CESS Juin 2024
Correctif
Un rêve qui tarde à se réaliser
« I can’t breathe »… La nuque écrasée par le genou d’un policier, Georges Floyd s’éteint après avoir
été privé d’oxygène durant une dizaine de minutes. Cet événement de 2020 vient raviver le souvenir
du « I have a dream » de Martin Luther King, figure de la lutte contre la ségrégation raciale, soixante
ans auparavant. Un rêve qui ne s’est apparemment toujours pas réalisé. À l’aide des textes de
Laroche, Sabbagh et Brunet, nous nous pencherons sur l’évolution de la fracture raciale depuis le
milieu du XXe Siècle aux Étas-Unis. Nous débuterons par évoquer la situation dans les années 60,
avant de nous pencher sur la situation actuelle et les avancées significatives à ce sujet.
Tout d’abord, retournons au début des années 60. Selon Laroche, la population afro-américaine est
alors victime de multiples discriminations dans la vie quotidienne : au logement, à l’embauche, à
l’éducation, etc. Les lieux publics sont partagés (ou pas) et les personnes de peau noire n’ont pas le
droit de vote. C’est à ce moment, comme l’expliquent Laroche et Sabbagh, que la lutte contre ces
inégalités se traduit en lois pour protéger les droits civiques de cette communauté, avec, en points
d’orgue, la marche de Martin Luther King et de 250 000 personnes le 28 aout 1963, ainsi que
l’adoption du célèbre « Civils Rights Act » en 1964.
Par la suite, la condition des Afro-Américains s’est théoriquement améliorée mais n’est toujours pas
idéale pour Sabbahg. Ainsi, les chiffres avancés par le journaliste mais aussi par Brunet dans son
article indiquent que les inégalités raciales restent significatives. Par exemple, 19% des noirs vivent
sous le seuil de pauvreté aux USA, alors que seulement 8 % des blancs sont dans cette situation. Un
autre constat alarmant, développé par Brunet et partagé par Sabbagh, est la différence de traitement
par la police et la justice américaines en fonction de la couleur de peau. En effet, si les Afro-
Américains représentent un huitième de la population américaine, ils sont surreprésentés dans les
statistiques traitant des victimes de violence policière (28%) et des effectifs pénitentiaires (38%).
Pour expliquer ces différents chiffres, Sabbagh met en avant la progression socio-économique très
inégale de la communauté noire, tandis que Brunet met en avant les paroles de Nancy Pelosi, qui
rappelait les siècles de racisme, systémique et institutionnalisé, traversés par les USA.
Enfin, ces constatations ont à nouveau été mises en lumière suite au décès de Georges Floyd, qui
aura finalement permis une réforme de la police suite au « Georges Floyd Justice in Policing Act »
adopté en mars 2021. Une autre avancée notable pour Branaa se remarque au plus haut niveau de
pouvoir où, après l’élection de Barack Obama comme président il y a quinze ans, c’est désormais
Kamala Haris qui se fait le porte-drapeau de la communauté noire, en tant que première femme
Vice-présidente des États-Unis.
En conclusion, la ségrégation raciale ancrée dans la société américaine et combattue depuis les
années 60 n’a pas encore disparu. Malgré tout, des avancées sont à souligner et la levée de boucliers
provoquée par la mort de Georges Floyd donne un nouvel élan à une lutte pour les droits civiques
des Afro-Américains qui, selon les dires de Branaa, reste pour l’instant inachevée…
1
/
1
100%