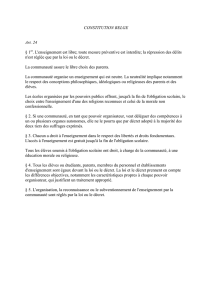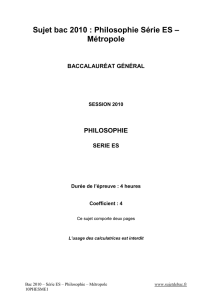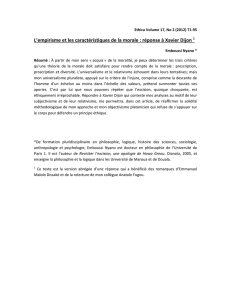!

Copyright 2013 © Implications philosophiques – ISSN 2105-0864
!"
Introduction*
! !
! "#!$%&'(!)*+,+#-./01/1'2!&3!#*('-!'+#'!)1%-(!/+'!&#%-&3(!)(!0+//(3(0!3(!-456(!)(!7(!)1''&(0!
&#-&-%38! 9!:*8-4&;%(! )+#'! -1%'! '('! 8-+-'!<2! +,+#-! )(! /08'(#-(0! /3%'! (#! )8-+&3'! 3('! 71#-0&=%-&1#'!
0+''(6=38('>!
! ?(3+! #*+%0+&-! /+'! $0+#)! '(#'! )(! /08-(#)0(! /01/1'(0! &7&! %#(! ,&'&1#! (@4+%'-&,(! )(! 3+!
/4&31'1/4&(! 610+3(! 71#-(6/10+&#(>! :('! )&6(#'&1#'! )%! )1''&(0! #(! /(06(--(#-! /+'! 7(! -0+,+&3!
/4+0+1#&;%(2!;%&!'(0+&-!)*+&33(%0'!A!0(B+&0(!A!/(&#(!+74(,8>!
! C1%-(B1&'2! 7(! )1''&(0! ('-! /3%'! ;%*%#! '&6/3(! 0+''(6=3(6(#-! 48-80173&-(! )(! 71#-0&=%-&1#'!
-0+&-+#-!)*8-4&;%(!)*%#(!6+#&50(!1%!)*%#(!+%-0(>!D1-0(!'1%4+&-!('-!/+0!7(!)1''&(02!)(!/01/1'(0!)('!
/&'-('!(-!)('!6+#&50('!)*+//084(#)(0!3('!6%-+-&1#'!)(!3*8-4&;%(2!A!-0+,(0'!%#(!'80&(!)*&33%'-0+-&1#'!
/01/0('!A!)&BB80(#-'!)16+&#('>!
! :+!;%('-&1#!('-!)1#7!,+'-(!6+&'!3('!8386(#-'!)(!08/1#'('!/08'(#-8'!)+#'!3('!71#-0&=%-&1#'!
1#-! +%''&! /1%0! ,17+-&1#! )(! '*+)0(''(0! A! -1%'2! '/87&+3&'-('! +,(0-&'2! 7%0&(%@! 873+&08'! (-! +6+-(%0'!
#81/4E-('>!
! F+#'!'+70&B&(0!3+!716/8-(#7(!(-!3('!71#7(/-'!;%&!=G-&''(#-!%#(!/(#'8(2!#1%'!+,1#'!,(&338!
+%-+#-! ;%(! /1''&=3(! A! #(! /+'! -0+#'B106(0! 7(-! ('/+7(! )(! /08'(#-+-&1#! (#! %#(! 1='7%0(! ;%(0(33(!
)*(@/(0-'>!
:('! '%H(-'! 7166(! 3('! +//0174('! /08'(#-8'! )+#'! 7(! )1''&(0! 0(B35-(#-! %#! 74+#$(6(#-! )+#'! 3+!
6+#&50(!)(!71#)%&0(!3+!0(74(074(!(#!8-4&;%(!6+&'!+%''&!)+#'!3+!6+#&50(!)1#-!#1%'!/1%,1#'!(#!
+--(#)0(!)('!08'%3-+-'>!
! :(!-&-0(!)(!7(!)1''&(0!9!:*8-4&;%(!)+#'!-1%'!'('!8-+-'!<!+!8-8!741&'&!/1%0!&#)&;%(0!7(--(!&)8(!
)(! 6%-+-&1#! ;%(! '%=&-2! 1%! /3%'! (@+7-(6(#-2! ;%(! ,&-! 3*8-4&;%(! 7('! )(0#&50('! +##8('>! ?(3+! ('-!
)*+%-+#-! /3%'! &#-80(''+#-! A! 1='(0,(0! ;%(! 3+! 0(74(074(! 8-4&;%(! 8,13%(! #+-%0(33(6(#-2! '+#'!
71##+I-0(! )(! 70&'(! 6+H(%0(>! ?(0-('! &3! E! +! )('! +770174+$('2! )('! )&'7%''&1#'2! )('! 71%0+#-'2! %#(!
$0+#)(!)&,(0'&-8!&#-(0#(!6+&'!3+!/4&31'1/4&(!610+3(!#(!71##+I-!/+'!)(!'74&'6(!(#!&#-(0#(2!#&!)(!
6+#;%(!)(!38$&-&6&-8!(@-(0#(>!J310'!;%(!7(0-+&#'!)16+&#('!)(!3+!'17&8-8!7166(!3*+0-2!3*8)%7+-&1#2!
3+!/13&-&;%(K!'(6=3(#-!/+0+3E'8'!/+0!%#(!70&'(!;%&!#*(#!B&#&-!/+'2!3(!)16+&#(!)(!3*8-4&;%(!71##+I-!
;%+#-!A!3%&!%#(!701&''+#7(!+='13%6(#-!0(6+0;%+=3(>!
! L#!/(%-!6M6(!/+03(0!)*%#(!(@/+#'&1#!'+#'!/0878)+#->!:+!/4&31'1/4&(!'(6=3(!0(;%&'(!)+#'!
)('!)16+&#('!'+#'!7(''(!#1%,(+%@>!N%(!7(!'1&-!3+!B&#+#7(2!3+!/13&-&;%(2!3*+$0&7%3-%0(2!3(!'/10-2!3+!
68)(7&#(2!3*(#,&01##(6(#-2!&3!#*('-!$%50(!)(!)16+&#('!;%&!874+//(#-!+%!0($+0)!)(!3*8-4&7&(#2!1%!

Copyright 2013 © Implications philosophiques – ISSN 2105-0864
#"
/1%0! 3(';%(3'! &3! #*(@&'-(! /+'! )8HA! %#(! 7166%#+%-8! )(! '/87&+3&'-('! &#B1068'! (-! 0(71##%'>! ?(!
61%,(6(#-! ('-! )*+&33(%0'! )1%=3(! 3+! /4&31'1/4&(! 610+3(! '*1%,0(! A! )*+%-0('! )&'7&/3&#('2! 6+&'! 3('!
)16+&#('!&#)&;%8'!7&.)(''%'!'(!6(--(#-!,131#-+&0(6(#-!(#!0(3+-&1#!+,(7!3*8-4&;%(>!
! ?(-! 83+0$&''(6(#-! #(! 0&';%(.-.&3! /+'! )(! #1%'! 71#)%&0(! A! 3+! 0%/-%0(! )%! 74+6/! )(! 3+!
/4&31'1/4&(!610+3(!O!P+0(!(#!(BB(-!A!#(!/+'!/0(#)0(!/1%0!8-4&;%(!+%!'(#'!/4&31'1/4&;%(!7(!;%(!
)*+%7%#'!B1#-!)(!3*8-4&;%(!Q!#(!71#B1#)1#'!/+'!!"##$%&'()$!!(-! !/4&31'1/4&(!(#,&01##(6(#-+3(!!R!
610+3&'+-&1#!)(!3+!/13&-&;%(!(-!)(!3+!B&#+#7(!(-!'31$+#'!/13&-&;%('!)(!7+6/+$#(!R!=1##('!/0+-&;%('!
/01B(''&1##(33('2! 71)&B&8('! (-! 08B3(@&1#! 70&-&;%(! '%0! 3+! 610+3&-8! )*%#(! /01B(''&1#! (-! )(! '('!
71#)&-&1#'!)*(@(07&7(>!
! :+! /4&31'1/4&(! 610+3(! (@/310(! )*+%-0('! 6+-80&+%@2! '*1%,0+#-! A! 3+! 3&--80+-%0(! 7166(! +%@!
#(%01.'7&(#7('>!S+&'!#(!0&';%(.-.1#!/+'!+310'!)(!B+&0(!=+'7%3(0!3+!/0+-&;%(!/4&31'1/4&;%(!)+#'!%#!
7+'! )+#'! 3(! 0($&'-0(! )(! 3*(@/0(''&1#2! )+#'! 3*+%-0(2! )(! )&''1%)0(! 3+! /4&31'1/4&(! )+#'! 3*(#;%M-(!
'7&(#-&B&;%(!O!
! ?('! )&BB80(#-('! ;%('-&1#'! /(%,(#-! '+#'! )1%-(! M-0(! 08%#&('! (#! %#(! '(%3(!Q! ;%*('-.7(! ;%&!
7+0+7-80&'(!(#710(!(#!/01/0(!3+!/4&31'1/4&(!610+3(!O!
!
! "#!(BB(-2!3('!7+0+7-80&'-&;%('!#1%,(33('!)(!3*8-4&;%(!;%&!'(!)(''&#(#-!(#!70(%@!'1#-!Q!'+!/0&'(!
)(!)&'-+#7(!+,(7!3+!/4&31'1/4&(!-0+)&-&1##(33(2!'1#!1%,(0-%0(!A!)*+%-0('!)&'7&/3&#('2!'1#!0(B%'!)(!
B+&0(!)(!3*8-4&;%(!3(!)16+&#(!08'(0,8!)(!'/87&+3&'-('>!?('!-0+&-'2!/+0-+$8'!/+0!)*+%-0('!'(7-&1#'!)(!
3+!/4&31'1/4&(!71#-(6/10+&#('2!#1%'!+65#(#-!A!/1'(0!7(--(!0()1%-+=3(!68-+.;%('-&1#!Q!(#!;%1&!
('-.7(!(#710(!)(!3+!/4&31'1/4&(!O!
! ?(--(!;%('-&1#!#(!'+%0+&-!M-0(!&7&!/1'8(!)(!6+#&50(!B01#-+3(!(-!=0%-+3(!6+&'!+7716/+$#(0+!
/(%-.M-0(! 3(! 3(7-(%0! A! 3*(@+6(#! )('! )&BB80(#-('! 71#-0&=%-&1#'2! 71#-0&=%-&1#'2! %#(! ;%('-&1#! ;%*&3!
+0-&7%3(0+!A!74+;%(!+0-&73(!+%-1%0!)(!'1#!)16+&#(!)*(@/(0-&'(!/01/0(!(-!;%&!/+071%00+!3*(#'(6=3(!
)%!)1''&(0>!
! T+#'!7(!71#'-+-!)*%#(!(@-(#'&1#!;%&!-1%74(!+%@!3&6&-('!)(!3+!/4&31'1/4&(2!&3!#(!B+%)0+&-!/+'!
,1&0!)(!#1-0(!/+0-!%#(!-(#-+-&,(!)(!-&0(0!)('!71#73%'&1#'!#106+-&,('>!U3!#(!'*+$&-!/+'!/1%0!#1%'!)(!
/3+&)(0!/1%0!%#(!B+V1#!/3%-W-!;%*%#(!+%-0(!)(!B+&0(!)(!3*8-4&;%(2!;%(!7(!'1&-!/1%0!%#(!'10-&(!)(!
3*8-4&;%(!410'!)(!3+!/4&31'1/4&(!1%!/1%0!3(!6+&#-&(#!)(!'1#!&#)&BB80(#7(!+%@!'7&(#7('!1%!A!-1%-!7(!
;%&! 3*(#-1%0(>! D1%'! ,1%31#'! '(%3(6(#-! 1='(0,(02! 716/0(#)0(! (-! /0(#)0(! 3+! 6('%0(! )('!
74+#$(6(#-'!&6/10-+#-'!;%&!'*1/50(#-!+%H1%0)*4%&>!

Copyright 2013 © Implications philosophiques – ISSN 2105-0864
$"
! ?*('-!)(!7(--(!6+#&50(!;%(!7(!)1''&(0!+!8-8!7110)1##8!(-!;%(!3('!71#-0&=%-&1#'!0(-(#%('!
1#-!8-8! 10$+#&'8('!Q! %#! /+#10+6+2!#1#! (@4+%'-&B>! D1%'! +,1#'!10$+#&'8! 3('! /%=3&7+-&1#'! (#! )(%@!
$0+#)'!74(6&#'2!0(/08'(#-+-&B'!)(!7('!10&(#-+-&1#'!Q!#1%'!+,1#'!0($01%/8!+%!'(&#!)*%#(!/0(6&50(!
'80&(! &#-&-%38(! 9!U#-(0'(7-&1#'!<! 3('! 71#-0&=%-&1#'! ;%&! #1%'! /+0+&''+&(#-2! 74+7%#(! A! 3(%0! 6+#&50(2!
6(--0(! (#! 0($+0)! )&BB80(#-('! -0+)&-&1#'! 1%!! )&'7&/3&#('!R! 3+! '(71#)(! '80&(2! &#-&-%38(2! 9!"-4&;%(!
/0+-&;%(!<! 0($01%/(! 3('! 71#-0&=%-&1#'! 0(3(,+#-! )(! 3*8-4&;%(! +//3&;%8(2! )(! 3+! =&18-4&;%(2! 1%! )(!
3*8-4&;%(! '17&+3(2! '%0! )('! -456('! -05'! )&,(0'>! ?('! )&BB80(#-'! 74(6&#'! '1#-! +%-+#-! )(! 61E(#'! )(!
'*831&$#(0!)(!3+!/4&31'1/4&(!+%!'(#'!-0+)&-&1##(3!)%!-(06(>!
! ?166(#-2!;%+#)!&3!B+%-!/1%0!08/1#)0(!A!)('!;%('-&1#'!X!)*8-4&;%(!68)&7+3(!/+0!(@(6/3(!X!
B+&0(! +//(3! +%! )01&-2! A! 3+! 68)(7&#(2! ,1&0(! A! 3+! 3&--80+-%0(2! (-! A! 3*(@/80&(#7(! )('! /0+-&7&(#'2! )('!
B+6&33('2! )('! /+-&(#-'! X!! 71#-&#%(0! A! )83&6&-(0! /1%0! 3*8-4&;%(! %#! )16+&#(! /01/0(!O! Y(%-.M-0(! 7(!
)1''&(0!#*E!08/1#).&3!/+'2!+%!71#-0+&0(>!U3!#1%'!(#!(BB(-!/+0%!/3%'!&#-80(''+#-!)(!)0(''(0!)('!(#H(%@2!
)('!)8B&'!(-!)('!/(0'/(7-&,('!;%(!)(!-&0(0!%#!=&3+#>!S+&'!(#!6M6(!-(6/'2!1#!/(%-!71#'&)80(0!;%(!
7('!,1&('!;%&!#1%'!831&$#(#-!)(!3+!/4&31'1/4&(!/(%,(#-!+%''&!M-0(!/+071%0%'!A!0(=01%''(.74(6!
(-!#1%'!B+&0(!71#,(0$(0!,(0'!%#(!/01=386+-&;%(!7166%#(2!7(33(!)%!3&(%2!/3%0&(3!(-!716/3(@(2!1Z!'(!
-&(#-!3*8-4&;%(>!
! :+! 7110)&#+-&1#! )(! 7(! )1''&(0! +! 8-8! %#! $0+#)! 616(#-! &#-(33(7-%(32! +,(7! '('! H1&('! (-! '('!
)871%,(0-('2! /+0B1&'! '('! )871#,(#%('2! (-! 8,&)(66(#-! %#! -0+,+&3! )(! '1%-&(0! /1%0! 3('! -05'!
#16=0(%@! 0(3(7-(%0'! (-! 7100(7-(%0'>! D1%'! 3('! 0(6(07&1#'! &7&! ,&,(6(#-! /1%0! 3(! -(6/'! /+''8'! (-!
3*(@/(0-&'(!)1#-!&3'!1#-!B+&-!/0(%,(!7+0!7(!)1''&(0!#(!'(0+&-!0&(#2!(-!(#!-1%-!7+'!/+'!-(3!;%*&3!('-2!'+#'!
3(%0!71#-0&=%-&1#!)87&'&,(>!
!
Première*série*:*«*Intersections*»*
! !
! S+035#(! [1%+#! )&'7%-(! )(! 3+! /(0-&#(#7(! +7-%(33(! )('! 9!+0$%6(#-'! -0+#'7(#)+#-+%@!<! (#!
/4&31'1/4&(! 610+3(2! A! -0+,(0'! %#(! )&'7%''&1#! '(008(! )('! 3(7-%0('! 71#-(6/10+&#('! )(! \+#-2!
#1-+66(#-!7(33(!)(!?40&'-&#(!\10'$++0)2!(-!'(!)(6+#)(!7(!;%(!#1%'!'166('!(#!)01&-!)*+--(#)0(!
)(! -(3'! +0$%6(#-'>! L/483&(! T('61#'! )8B(#)! 3*&#-80M-! )(! 3+! 68-+.8-4&;%(! /1%0! 3+! /4&31'1/4&(!
/13&-&;%(! (-! 3('! -4810&('! )(! 3+! H%'-&7(2! (#! /+0-&7%3&(0! 3*&#-80M-! )*%#! 71#'-0%7-&,&'6(! 68-+.8-4&;%(!
0('-0(&#-!(#!71#-(@-(!)(!/3%0+3&'6(>!:%7E!](0$(0(-!(@+6&#(!3+!)8B(#'(!)(!3*%'+$(!)(!3+!3&--80+-%0(!
(#!/4&31'1/4&(!610+3(2!,1&0(!7166(!/4&31'1/4&(!610+3(2!/01/1'8(!/+0!S+0-4+!D%''=+%6!(-!?10+!
T&+61#)! (-! +=10)(! ;%(3;%('.%#'! )('! /01=356('! ;%*(33(! 08'1%-! (-! 7(%@! ;%*(33(! '%'7&-(>! [80W6(!

Copyright 2013 © Implications philosophiques – ISSN 2105-0864
%"
^+,+-! '*&#-80(''(! A! 3*+//0174(! /'E741'17&+3(! )('! )8'+7710)'! 610+%@! (-! /1'(! )+#'! 7(! 7+)0(! 3('!
=+'('! )*%#! )&+31$%(! (#-0(! '+,1&0'! (6/&0&;%('! (-! /4&31'1/4&(! 610+3(2! )+#'! %#(! /(0'/(7-&,(!
/0+$6+-&;%(! (-! #106+-&,(!R! &3! 61#-0(! ;%(! 3*+#+3E'(! (6/&0&;%(! )('! )8'+7710)'! 610+%@! /1%00+&-!
=&(#!71#)%&0(!6%-+-&1#!)(!3+!/4&31'1/4&(!610+3(>!"#B!_310&+#!?1,+!/01/1'(!%#(!0(6&'(!+%!$1`-!
)%!H1%0!)*%#(!9!610+3(!/+0!/01,&'&1#!<!X!-(33(!;%*(#!'1#!-(6/'!T('7+0-('!(#!+,+&-!B106%38!%#(!X!A!
3*%'+$(! )('! 71#-(6/10+&#'! (#! '&-%+-&1#! )*(0-&-%)(! 610+3(2! ;%*&3! +//3&;%(! A! %#(! '80&(! )(!
;%('-&1#'!&33%'-0+-&,('!(-!)1#-!3+!/10-8(!('-!)*+//3&7+-&1#!$8#80+3(>!
!
&'()*+,"-.*)/"0"12'3+45"6477'/8.9"
!
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
1
/
113
100%