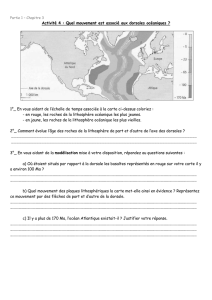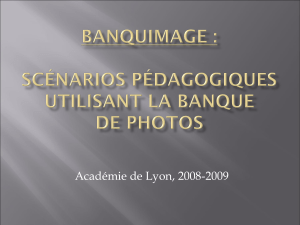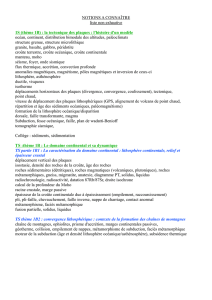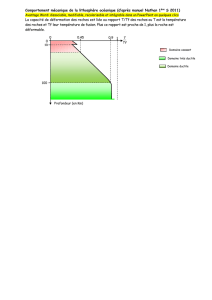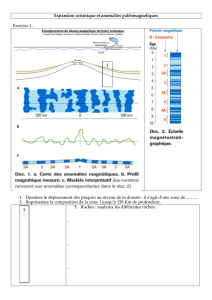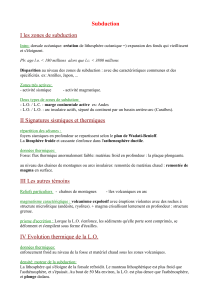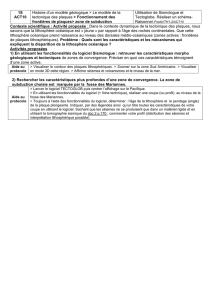Mouvement Lithosphère & Énergie Interne : Cours de Géologie
Telechargé par
Patient M'po KOUAGOU

SA 1 : Mouvement de la lithosphère et énergie interne du globe
Collection l’Excellence (00229)67845279
1
Auteur
DJESSOU Aimé
(00229) 67845279

SA 1 : Mouvement de la lithosphère et énergie interne du globe
Collection l’Excellence (00229)67845279
2
Aux utilisateurs
Cette SA 1 portant sur la géologie, nous exhortons les collègues, si les conditions le permettent :
-d’effectuer des sorties pédagogiques afin de permettre aux apprenants d’observer les affleurements
rocheux et autres indices témoignant des phénomènes géologiques
- d’effectuer des observations réelles d’échantillons de roches et si possible de lames minces
-de réaliser les modélisations requises pour certains phénomènes géologiques
-d’effectuer des projections vidéo sur les phénomènes géologiques difficilement modélisables
Vos remarques, corrections et suggestions sont attendues au (00229) 67 84 52 79

SA 1 : Mouvement de la lithosphère et énergie interne du globe
Collection l’Excellence (00229)67845279
3
Situation de départ
1- LA TECTONIQUE DES PLAQUES : L’HISTOIRE D’UN MODÈLE
Au XIXème siècle, le fonctionnement du globe terrestre fait l'objet de nombreuses discussions passionnées.
Des observations communes (présence de montagnes, d'océans) ou moins communes (chaleur interne de la
Terre, reculs et avancées de la mer) sont à l'origine des modèles explicatifs admis à l'époque. Un de ces
modèles défendu en particulier par le géologue Suess admet que l'intérieur de la Terre se refroidit et que ce
refroidissement provoque sa contraction. La couverture extérieure froide devient trop grande, se plisse dans
certaines zones (donnant naissance aux montagnes) et s'effondre par ailleurs (donnant naissance à des
océans). Le modèle de Suess est donc basé essentiellement sur des mouvements verticaux de la croûte.
Le modèle de Suess
La construction du modèle de la tectonique des plaques
Le modèle de Suess suppose une couche rigide de surface de même nature partout. Le constat d'une
distribution bimodale des altitudes va à l'encontre de cette nature uniforme (pour des raisons physiques, si
les roches de surface étaient toutes de même nature, les altitudes devraient osciller autour d’une seule valeur
moyenne).
La naissance de l’idée de déplacement horizontal
Au début du XXème siècle, les premières idées évoquant la mobilité horizontale de la surface
du globe sont formulées (Wegener en particulier). Elles s’appuient sur plusieurs constatations :
- la distribution bimodale des altitudes (continents/océans).
- les tracés des côtes (complémentaires dans certaines régions);
- la distribution géographique des paléoclimats (zones de même climat très séparées).
- la distribution géographique de certains fossiles (zones de mêmes fossiles très séparées)
- la distribution géographique de certains roches (zones de mêmes roches très séparées)
MOUVEMENT DE LA LITHOSPHERE
ET ENERGIE INTERNE DU GLOBE
SA 1
Fig.2 : Répartition des structures rocheuses
anciennes entre l’Afrique et l’Amérique du
Sud
Fig. 1 : Les bandes colorées traversant les continents indiquent
la présence du fossile sur tous ces continents.

SA 1 : Mouvement de la lithosphère et énergie interne du globe
Collection l’Excellence (00229)67845279
4
Selon Wegener, tous les continents étaient autrefois rassemblés en un seul continent, la Pangée
(Mégacontinent). La Pangée aurait été entourée par un océan, le Panthalassa. Selon sa théorie, l'écorce
terrestre se serait brisée et aurait dérivé pour former les continents que nous connaissons aujourd’hui.
Ces idées se heurtent au constat d’un état solide de la quasi-totalité du globe terrestre établi, à la même
époque, par les études sismiques. L’idée de mobilité horizontale est alors rejetée par l’ensemble de la
communauté scientifique.
2- ORIGINE ET AGE DE LA TERRE
De tout temps, la question de l'âge de la Terre et de son histoire a préoccupé les penseurs et les hommes de
Science. Les théologiens, s'appuyant sur la bible, situaient la création de la Terre à 4000 ans avant Jésus
Christ et pensaient que la configuration actuelle des paysages observables à la surface de la Terre sont
restées inchangées depuis lors. Il a fallu l'avènement de la sédimentologie, de la paléontologie et de la
géophysique pour bouleverser cette conception « fixiste » de 1'histoire de la Terre. En effet, plus personne
aujourd’hui ne met en doute l'idée que notre Terre actuelle, son atmosphère et ses paysages sont le produit
de transformations successives qui ont laissé des traces dans les matériaux constitutifs de l'écorce terrestre:
les roches.
Ainsi, l'une des plus grandes contributions de la Géologie à l'évolution de la pensée humaine est d'avoir
fixé l'âge de la Terre à environ 4.550.106 années et d'avoir montré que les paysages actuellement
observables à la surface de la Terre résultent de phénomènes cycliques qui ont laissé des traces dans les
roches.
Une telle évolution des idées dans le domaine de la connaissance de la Terre n'a été possible qu'à partir du
moment où le développement des sciences physico-chimiques a permis une meilleure connaissance des
propriétés de la matière grâce, en particulier, à la découverte de la radioactivité d'une part, et des lois du
magnétisme d'autre part. Biologie moderne OTTO TOWLE
Tâche : Elabore une explication aux problématiques soulevées par les faits de la situation problème
Procédure
• Exprimer sa perception et/ou ses interrogations sur les faits évoqués par la situation de départ
• Construire des réponses aux questions soulevées par la situation de départ en utilisant l’observation,
l’expérimentation ou l’exploitation des documents
• Structurer ses acquis en utilisant les concepts et le vocabulaire adéquats
• Utiliser les connaissances construites pour porter une appréciation sur les questions d’ordre historiques,
religieux et méthodologiques liés à l’origine de la terre
La terre, il y a 60 millions d’années
La terre, il y a 250 millions d’années

SA 1 : Mouvement de la lithosphère et énergie interne du globe
Collection l’Excellence (00229)67845279
5
La mise en situation représente la 1ère étape de la procédure. Elle permettra de partir des faits scientifiques
pertinents évoqués par la situation de départ pour exprimer notre perception et nos interrogations et
questions de recherches afin de formuler des problématiques auxquelles des réponses seront construites
dans la réalisation.
Support : Situation de départ
• Tâche : exploite la Situation de départ pour exprimer ta perception et tes interrogations sur les
faits évoqués afin de formuler des problématiques relatives aux mouvements de la lithosphère et
l’énergie interne du globe et d’ordre historiques, religieux et méthodologiques liés à l’origine de
la terre. Pour cela, tu suivras les indications ci-dessous :
✓ relève les faits scientifiques pertinents évoqués par la situation de départ et qui sont en relation avec
le titre de la SA.
✓ exprime ta perception des faits scientifiques relevés.
✓ formule des interrogations/questions de recherche en vue de mieux comprendre ces faits.
✓ regroupe puis hiérarchise au besoin certaines interrogations en des questions de recherche.
✓ regroupe ces questions de recherche en 2 grands groupes (problématique d’ordre scientifique et
problématique d’ordre historiques, religieux et méthodologiques liés à l’origine de la terre).
Activité introductive : Rappel des savoirs construits en classe de 4e
Objectif : rappel des savoirs construits en classe de 4e sur la structure interne de la terre
En classe de 4e, vous aviez étudié au cours de la SA2 dénommé la terre planète active, la structure interne
de la terre. Le document ci-dessous est mise à votre disposition pour vous aider à vous rappeler de
l’essentiel des savoirs construits sur la structure interne de la terre.
Document : Propagation des ondes sismiques dans les enveloppes de la terre
Vitesse des ondes Pet S en fonction de la profondeur
Les différentes couches composant la terre ont été mis en évidence par la propagation des ondes
sismiques. L’analyse plus détaillée des vitesses des ondes P et S en fonction de la profondeur a
mis en évidence l’existence d’une faible diminution de leur vitesse vers 100 km de profondeur.
Cette couche à faible vitesse ou LVZ (Low Velocity zone) s’étend d’environ 100 km jusqu’à 250
I-) MISE EN SITUATION
II- REALISATON
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
1
/
40
100%