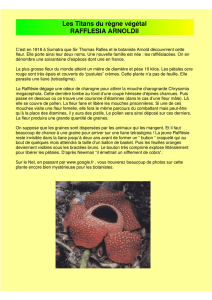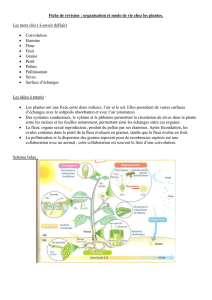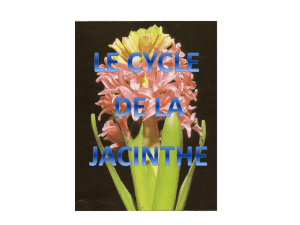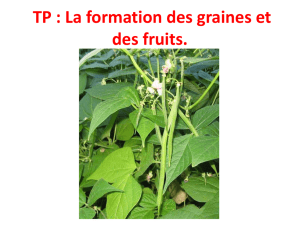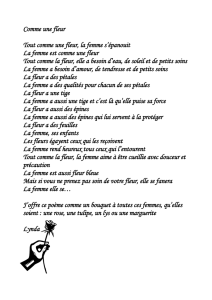Analyser les résultats d’une expérience
1° ST2S BPH
1/1
Méthodologie
Utilité de l’analyse de résultats expérimentaux
En biologie et physiopathologie, les expériences ont, le plus souvent, pour but d’identifier un rôle, une fonction d’une cellule, d’un tissu, d’un organe, et même d’une molécule.
En effet, la fonction d’un élément est identifiée en modifiant voire en retirant cet élément. Ainsi, les conséquences observées de cette modification témoignent de la fonction de
l’élément.
Méthodologie d’analyse de résultats expérimentaux
1° Identifier la problématique de l’expérience, c’est-à-dire le but de celle-ci, ce
qu’on cherche à montrer.
2° Identifier l’expérience témoin montrant une activité de l’élément étudié
lorsqu’il est sain, sans aucune modification ou ajout.
3° Pour l’expérience témoin, noter :
a. Le contexte expérimental mentionnant l’état de l’élément étudié (sa
présence, son état, …),
b. Le résultat, c’est-à-dire un élément observé, objectif (un nombre,
une couleur, une présence, …),
c. L’interprétation, autrement dit l’information déduite du résultat, en
lien avec la problématique.
4° Pour chacune des autres expériences, noter :
a. Le contexte expérimental,
b. Le résultat,
c. L’interprétation.
5° Conclure chaque expérience en comparant deux à deux les expériences (Le plus
souvent, on compare à l’expérience témoin).
On ne peut comparer deux expériences QUE si leur contexte
expérimental ne diffère que par un seul et unique paramètre.
Exemple
Un étudiant cherche observer le trajet de l’eau dans une plante. Il teste diverses
configurations.
Exp 1 : Une fleur blanche est posée dans un verre vide. Après une journée, la fleur est
fanée.
Exp 2 : Une fleur blanche est posée dans un verre rempli d’eau claire. Après une journée,
la fleur est blanche et intacte.
Exp 3 : Une fleur blanche est posée dans un verre rempli d’eau colorée par du bleu
patenté V (colorant alimentaire). Après une journée, la fleur est bleue.
Expérience
1
2
3
Contexte
expérimental
Fleur blanche dans
un verre ide
Fleur blanche dans
de l’eau claire
Fleur blanche dans
de l’eau bleue
Résultat
après 1 jour
Fleur fanée
Fleur blanche
Fleur bleue
Interprétation
La fleur ne survit pas
sans eau
La fleur survit avec
de l’eau
La fleur devient
bleue
Conclusion
La fleur a besoin d’eau pour
survivre.
Le pigment bleue contenu dans
l’eau est capable d’atteindre la
fleur.
1
/
1
100%