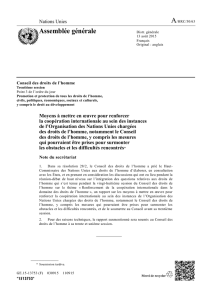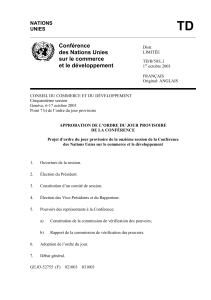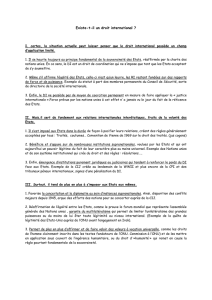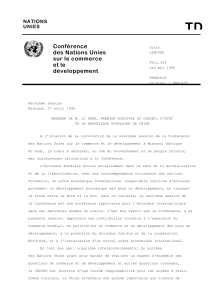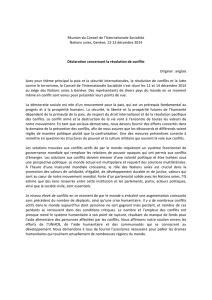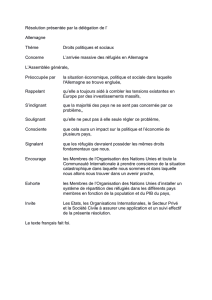COURS DES « DROITS DE L’HOMME »
Pour les étudiants de l’ISSEP en Ière LFEP – Semestre I
Sous la direction de DR. A A BELKHIRIA
INTRODUCTION A LA MATIERE
Les droits de l'homme se définissent comme étant les prérogatives, gouvernées par des règles
que la personne détient en propre dans ses relations avec d'autres personnes ou avec le
Pouvoir." (Mourgeon, 1998). La notion de "droits de l’homme et du citoyen" résulte d’une
construction historique et qui pourrait se caractériser en trois étapes :
I- L’Antiquité et les premières conceptions :
elles différencient entre « homme » et « citoyen » : elles se fondent sur « la citoyenneté »
et en font la référence principale, elles considèrent qu’ il n'y a de conception des droits que
celle qui se fonde sur la citoyenneté : "Seuls les citoyens sont des maîtres, seuls les maîtres
sont des citoyens" (Kriegel, 1998). La notion de "droits de l'homme" est étrangère aux Grecs
et aux Romains.
L’idée même de citoyen naît avec la Cité grecque. Elle repose sur le principe d’isonomie qui
fait de chaque citoyen le membre d’une communauté d’égaux. Le citoyen est celui qui obéit à
des lois, non à un homme.
Rome donne, par un processus d’extension progressive du droit de cité, une dimension
universelle à la notion de citoyenneté.
II- Le moyen âge et les notions « Sujet du roi » et « Citoyen clerc » :
Au moyen âge et pendant des siècles la notion de citoyen disparaît. C'est le temps du «
sujet du roi ». Le « Citoyen » est alors un terme employé par des clercs et si son
souvenir se conserve grâce à eux, il perd toute portée politique.
III- La modernité politique et l’apparition de la notion des "droits de
l’homme et du citoyen" :

Cette notion s'élabore lors de la lutte contre l'absolutisme. Elle est contemporaine des
grands changements qui, depuis le XVIIe siècle surtout, conduisent à l'invention de ce que D.
Schnapper appelle la modernité politique. L'adoption de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen le 26 août 1789 représente l'un des moments les plus forts de cette
entrée dans la modernité politique , elle est rappelée dans le préambule de la Constitution de
la Ve République et 'incorporée ainsi au droit positif français. et inspire même de nombreux
textes :-la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, etc
-
IV-Evolution de la notion de "droits de l’homme et du citoyen"
. Les droits de l'homme sont devenus une préoccupation universelle. Il n'y a plus
d'organisation politique dans le monde qui ne prétende donner à son action les droits de
l’homme et le maintien de la liberté économique et le droit à la subsistance a conduit à une
prise de conscience : un droit n'est rien sans les moyens d'existence qui permettent sa mise en
œuvre : des "droits économiques et sociaux défendus plus tard dans les doctrines socialistes et
le marxisme mais aussi dans le christianisme social ou le tiers-mondisme.
Dans le passé, l'Église catholique a longtemps défendu l'idée que "les vrais droits de l'homme
naissent précisément de ses devoirs envers Dieu" :aujourd'hui la papauté affirme que les
idées de liberté, d'égalité, de fraternité ne sont "Au fond que des idées chrétiennes" (Jean-Paul
II au rassemblement du Bourget, le 1er juin 1980).
Certains courants politiques, culturels, religieux et des États dans le monde contestent la
référence aux droits de l'homme. Ces contestations soulèvent la question de l'universalisme
des droits de l'homme. Pourquoi l'Occident qui a si longtemps ignoré les droits des
populations au moment de la colonisation met-il tant d'ardeur à défendre les droits de l'homme
maintenant que ces peuples ont recouvré leur souveraineté ? Les droits de l'homme ne
constituent-ils pas une forme moderne de la domination de l'Occident sur le reste du monde ?

La Déclaration des Droits de l'Homme et
du Citoyen du 26 août 1789
I. INTRODUCTION
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 est le texte qui marque
l’apogée de l’idéologie de la révolution française. Il concentre en quelques lignes toutes les
principales revendications d’un peuple en lutte contre le régime auquel il est soumis. Ce texte
représente aussi une des premières pierres du droit constitutionnel moderne, basé
essentiellement sur la description des libertés que l’homme doit pouvoir faire valoir à
l’encontre de l’Etat.
A. CONTEXTE
1. L’Ancien Régime
L’Ancien Régime est l’organisation politique et sociale des Etats de l’Europe occidentale
et centrale aux XVIIème et XVIIIème siècles. Les souverains règnent en monarques absolus.
La noblesse et le clergé jouissent d’une situation privilégiée. Le commerce à l’intérieur des
pays et entre les pays est relativement peu développé. Artisans et négociants sont pour la
plupart groupés en corporations qui réglementent la fabrication et la vente, entravant le
développement industriel. Les paysans, qui forment la majeure partie de la population,
paient presque tous les impôts. Les sujets ne bénéficient pleinement ni de la liberté
d’opinion, ni de la liberté économique, ni de la liberté individuelle.
L’Ancien Régime est personnifié par le roi de France, chef du Royaume et monarque
absolu de droit divin. Contrairement aux principes qui seront développés par la révolution, le
pouvoir du roi est issu directement de Dieu. C’est notamment contre cette conception
spirituelle du pouvoir que les révolutionnaires opposeront celui du peuple. Ajoutées aux
impôts, taxes et redevances excessives, les différences régionales paralysent le développement
du commerce et finalement l’économie toute entière.
La noblesse composée d’environ 400’000 personnes, dont 80’000 possédait un quart du sol et
continuait à percevoir les droits féodaux, elle assurait la sécurité dans les territoires et
protégeait les vassaux et les paysans. En échange, ces derniers payaient diverses redevances
En plus les nobles remettent des vieux privilèges en vigueur, alors qu’ils étaient tombés dans
l’oubli. Cette réaction augmentera encore le mécontentement face à eux.
. L’Eglise ne paie presque pas d’impôt, mais prélève en revanche la dîme des récoltes.
. Le tiers état ;Le tiers état regroupe 98% de la population. Il s’agit d’une classe de la société
méprisée, qui n’a presque aucun droit et qui est plus ou moins seule à payer des impôts. Le
tiers état est composé de trois différentes catégories de personnes :
- Les paysans sont environs 16 millions,

-Les artisans qui clament l’abolition des corporations. Les petits ateliers font place de plus
en plus à de petites usines, qui témoignent de l’aube de la révolution industrielle.
- les bourgeois représentent la catégorie de gens qui seront les plus actifs dans la révolution
qui suivra l’Ancien Régime. Ils occupent les professions libérales, commerçantes et
industrielles. Ils sont particulièrement tributaires du développement économique du pays,
mais constamment mis à l’écart des grandes décisions politiques. La réaction nobiliaire, les
excès des aristocrates et le refus du roi devant toute réforme pousseront les bourgeois à faire
la révolution.
2. Les causes de la révolution française
L’idée révolutionnaire est née d’une volonté de changements structurels profonds: il s’agissait
de « rendre » le pouvoir à ceux qui étaient gouvernés. La révolution a éclaté à cause de
l’incapacité du pouvoir à s’adapter à des conditions nouvelles. Alors que la plupart des
bourgeois de l’époque désiraient une adaptation du pouvoir à une monarchie parlementaire
(comme cela s’était fait en Angleterre), la révolution a été une sorte d’accident, dû aux crises
économiques (mauvaises récoltes, disettes, etc.) et aux mauvais choix des dirigeants
politiques. On peut distinguer plusieurs causes de la révolution: causes philosophiques,
économiques et politiques.
a. Causes philosophiques
Avec l’avènement du Siècle des Lumières, la raison se substitue à l’autoritarisme et à la
tradition. On retrouve la foi dans le progrès et on réclame la liberté dans tous les domaines.
-Descartes proclame la supériorité du rationalisme et de l’esprit critique
-. Montesquieu met au point une nouvelle gestion de l’autorité fondée sur trois pouvoirs
indépendants les uns des autres: le législatif (assemblée élue, qui représenterait le peuple),
l’exécutif (le roi et ses ministres) et le judiciaire (magistrats).
- Voltaire prône un système parlementaire à l’anglaise, où le roi règne, mais ne gouverne pas.
- . Jean-Jacques Rousseau croit fermement à l’égalité des hommes. Il considère que la
majorité du peuple est bonne par nature, et a donc le droit d’imposer sa volonté sur la minorité
(doctrine de la volonté générale).
- Les Encyclopédistes, tels Diderot, d’Alembert et d’autres, réclament la liberté de pensée,
d’expression et l’égalité devant la loi.
- Des mouvements revendiquent des formes de pouvoir républicain, tels la Franc-maçonnerie
ou d’autres « clubs » parisiens.
- l’influence anglo-saxonne joue aussi un grand rôle: monarchie parlementaire en Angleterre,
préambule de la Déclaration d’indépendance en Amérique, et plusieurs philosophes comme
John Locke ou encore Adam Smith (prônant le libéralisme économique dans son célèbre
ouvrage: « La richesse des nations »).

b. Causes économiques et financières
. La réaction nobiliaire ruine les paysans. L’accroissement démographique crée un surplus de
bouches à nourrir et des jeunes improductifs. Les mauvaises récoltes de 1787 et 1788
entraînent des disettes. Ce cercle infernal provoque une crise économique: le trésor royal est
vide,.
c. Causes politiques
-Malgré les revendications et la crise économique, le pouvoir royal et la noblesse font la
sourde oreille devant toute réforme et continuent à s’octroyer des dépenses somptuaires,.
-Plusieurs parlementaires sont arrêtés de force
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
1
/
50
100%