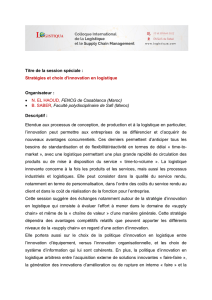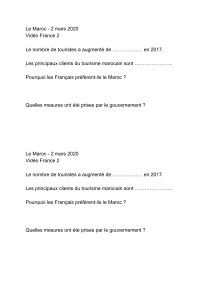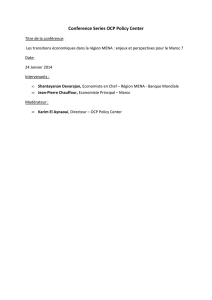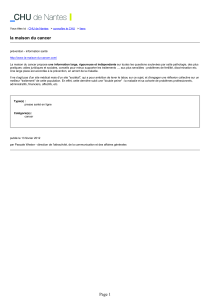Comptabilité générale dans les CHU au Maroc : Facteurs de succès
Telechargé par
mindlight10

L’INTRODUCTION D’UNE COMPTABILITE GENERALE AU SEIN DES CENTRES
HOSPITALO-UNIVERSITAIRES (CHU) AU MAROC : CARACTERISTIQUES ET ANALYSE DES
FACTEURS DE SUCCES
REVUE MAROCAINE DE RECHERCHE EN MANAGEMENT ET MARKETING, N°16, JANVIER-JUIN 2017 Page 460
AZIZ HANTEM
Doctorant
Laboratoire de recherche : Etudes comptables et fiscales
Université Hassan II- Casablanca- Maroc
MOHAMMED ABOU ELJAOUAD
Professeur - Chercheur
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et sociales- Casablanca
Laboratoire de recherche : Etudes comptables et fiscales
Université Hassan II- Casablanca- Maroc
Résumé
Selon (Bartoli, 2005), la comptabilité privée possède depuis longtemps un caractère complet
que la comptabilité publique ne possède pas encore. Aussi la comptabilité publique n’a-t-elle
longtemps été qu’une comptabilité de caisse. Le système de gestion financière publique est
toujours caractérisé de centralisé de lourd, et d’inadapté.
L’enjeu économique de recherches de recettes ou de sources de financement nouvelles selon
plusieurs auteurs, (Allison, 1987; Bozec, 2004; Bozeman, 1987; Gibert, 2002; Parenteau,
1992; Thoening, 2000), représente une cause principale justifiant l’inadaptation de la
comptabilité générale ou tout autres outils de gestion privée dans un contexte public.
Cependant, la tenue de la comptabilité générale et la comptabilité analytique au lieu de la
comptabilité publique peut contribuer à un meilleur contrôle de la gestion de l’entité publique.
Ainsi, la plupart des innovations en SI incluent et les technologies d’information et les
méthodes de gestion administrative, mais pas nécessairement dans les mêmes proportions. En
effet, certaines innovations ont plus d’aspects technologiques (implantation d’une base de
données), tandis que d’autres au contraire, ont plus d’impact sur le travail administratif
(implantation d’un système de planification stratégique). Plusieurs constats ont mis en
évidence la trop lente diffusion des outils modernes de gestion dans les organisations
publiques malgré leurs avantages par rapport aux outils traditionnelles.
Dans cette communication, nous avons tenté d’apporter de nouveaux éléments de réponse à ce
paradoxe, en examinant le volet de diffusion des outils de la comptabilité générale et puis le
volet du succès ou de blocage dans son implantation.
Nous avons donc construit un modèle théorique global qui porte sur les facteurs de succès ou
blocage d’implantation des outils modernes de la gestion comptable dans les établissements
publics à caractère administratif, à partir d’une analyse des apports théoriques et les résultats
de notre enquête empirique.
Mots clés : Etablissement public, Innovation, Adoption de la CG, succès de l’implantation de
la CG.

L’INTRODUCTION D’UNE COMPTABILITE GENERALE AU SEIN DES CENTRES
HOSPITALO-UNIVERSITAIRES (CHU) AU MAROC : CARACTERISTIQUES ET ANALYSE DES
FACTEURS DE SUCCES
REVUE MAROCAINE DE RECHERCHE EN MANAGEMENT ET MARKETING, N°16, JANVIER-JUIN 2017 Page 461
Introduction
Ces dernières années, la modernisation des pratiques des organisations publiques connaît un
essor extraordinaire face à des transformations majeures de l’environnement et des nouvelles
approches du management. Ces approches sont de plus en plus mises en œuvre en vue
d’améliorer la performance et la qualité des services publics.
Dance ce sens, la bonne gouvernance des affaires publiques constitue un défi crucial pour
tous les pays notamment en voie de développement en vue de soutenir le développement et
surtout de rationaliser la gestion publique. Ainsi, plus que l’introduction de nouvelles
techniques de gestion, l’adaptation des établissements publics aux nouvelles exigences de
bonne gouvernance, de productivité, de qualité et de performance dans le contexte actuel de la
mondialisation, dépend de la place qui y est accordée au système d’information comptable.
En revanche, la plupart des organisations relevant de la fonction publique doivent faire face
aujourd’hui à des contraintes nouvelles et sont conduites à se justifier de façon accrue devant
les opinions publiques, qu’il s’agisse de qualité, d’équité, de transparence des coûts,
d’efficacité à l’égard des objectifs qui leur sont fixés.
De surcroît, le contexte économique actuel conditionne de nouveaux comportements :
- Recherche de plus de rationalité économique ;
- Exigence d’objectivité dans les arbitrages budgétaires ;
- Concentration de moyens sur des priorités plutôt qu’éparpillement des ressources.
Tous ces facteurs conduisent les politiques comme les gestionnaires de l’action publique à
mettre en œuvre des outils stratégiques dont la comptabilité générale fait partie.
I. Problématique de recherche
Le système comptable actuel des centres hospitaliers universitaires (CHU), entant
qu’établissements publics administratifs, au Maroc est régi par le décret royal 330-66 du 21
avril 1967, complété par le décret n° 2-76-576 du 30 septembre 1976. Ce décret fait référence
à une comptabilité budgétaire dont le but recherché est tout simplement de suivre l’exécution
des budgets tout en respectant les autorisations budgétaires de crédit par rubrique budgétaire.
Or, les comptes administratifs ou de gestion n’informent que sur cet aspect. Par conséquent,
les informations fournies par la comptabilité budgétaire ne satisfont plus les besoins croissants
des ces établissements publics et de leurs partenaires en informations comptables pertinentes,
utiles à la gestion et nécessaires à la prise de décision.
Or, la connaissance par l’Etat de la composition et de la valeur du patrimoine des
établissements publics est très souvent restée lacunaire. Ainsi, la fiabilité des informations
s’apprécie au regard du principe de la sincérité des comptes qui renvoie à l’approche
patrimoniale de la gestion comptable publique qui pourrait être garantit par la comptabilité
inspirée du secteur privé.
Dans le but d’améliorer la qualité de l’information financière et les mécanismes nécessaires à
une bonne gouvernance, le Maroc a démarré depuis peu des réformes du secteur publique en
accélérant la mise en place de la comptabilité générale pour garder une traçabilité et une

L’INTRODUCTION D’UNE COMPTABILITE GENERALE AU SEIN DES CENTRES
HOSPITALO-UNIVERSITAIRES (CHU) AU MAROC : CARACTERISTIQUES ET ANALYSE DES
FACTEURS DE SUCCES
REVUE MAROCAINE DE RECHERCHE EN MANAGEMENT ET MARKETING, N°16, JANVIER-JUIN 2017 Page 462
continuité dans l’enregistrement des opérations financières effectuées par les établissements
publics. Ainsi , l’avènement de la constitution du 1er juillet 2011 et le programme
gouvernemental actuel ont donné une nouvelle impulsion et un appui politique fort à
la réforme de la comptabilité de l’Etat, comme levier fondamental de modernisation
des modes de gestion des affaires publiques.
Ces dispositifs mis en place s’inscrit dans le mouvement de convergence de l’information
comptable publique avec les règles applicables au secteur privé. On observe donc
l’introduction dans le secteur public d’une comptabilité d’engagement, de droits constatés,
d’une approche patrimoniale et d’une approche par les résultats basés sur le principe
comptable de séparation des exercices en leur rattachant leurs propres produits et charges.
Techniquement, le passage d’une comptabilité budgétaire traditionnelle basée sur des
écritures budgétaires à une comptabilité générale basée sur les résultats et la situation
financière et patrimoniale se heurte à deux grandes contraintes à savoir :
1. La détermination des règles normalisées des enregistrements comptables des opérations
réalisées par les organismes publics ;
2. L’élaboration d’une situation de départ qui n’est autre que le bilan d’ouverture du
premier exercice.
Notre problématique de recherche émerge des travaux sur la diffusion de la comptabilité. La
mise en place d’une comptabilité générale (CG) et sa diffusion au sein des établissements
publics notamment administratifs demeure une problématique complexe qui reste sans
réponse et mérite ainsi plusieurs recherches consécutives dans des contextes différents. Le
paradoxe de la comptabilité reflète « l’écart mis à jour entre la façon dont la méthode est
traitée dans la littérature, qui laisserait supposer une diffusion élevée, et les taux d’adoption
obtenus » qui sont souvent trop faibles par rapport aux espérances (Alcouffe, 2004, p. 391). Si
la CG a démontré son utilité et son grand intérêt pour les organismes publics, pourquoi alors
ne trouve-t-on pas beaucoup plus d’organisme qui l’utilisent ?
Au Maroc, l’adoption d’une comptabilité d’exercice par les centres hospitalo-universitaires, à
l’instar des établissements publics, s’inscrit dans le cadre de la réforme de la comptabilité de
l’Etat. Cette réforme comptable, au-delà de son caractère technique, constitue, en réalité un
outil de modernisation de l’Etat et de secteur public en raison des changements et des
mutations profondes qu’elle implique en matière d’amélioration de la bonne gouvernance
dans la sphère publique. Le nouveau système régissant la comptabilité des établissements
publics constitue à ce titre, un véritable pari de l’innovation/créativité au sein de
l’administration publique, et participe à la création d’un nouvel état d’esprit devant dés lors,
animer les différents intervenants dans le processus de préparation, d’exécution et de contrôle
des finances publiques.
La mise en place d’une véritable comptabilité d’exercice privilégiant la constatation des droits
et des obligations des établissements publics offre une opportunité à tous ceux qui veulent
connaitre les prestations rendues par l’appareil productif du secteur public de se faire une idée
précise sur la réalité financière et patrimoniale. Cette dimension de transparence se trouve

L’INTRODUCTION D’UNE COMPTABILITE GENERALE AU SEIN DES CENTRES
HOSPITALO-UNIVERSITAIRES (CHU) AU MAROC : CARACTERISTIQUES ET ANALYSE DES
FACTEURS DE SUCCES
REVUE MAROCAINE DE RECHERCHE EN MANAGEMENT ET MARKETING, N°16, JANVIER-JUIN 2017 Page 463
consolidée à travers le large spectre d’informations financières que la nouvelle comptabilité
permet de dégager, dès lors qu’il ne s’agit plus seulement de savoir ce que l’établissement
public (Un CHU) a dans ses caisses mais d’apprécier et d’évaluer ce que sont ses richesses,
ses dettes et les engagements qu’il peut être amené à honorer afin de mieux appréhender les
résultats dégagés et la situation financière à moyen et à long termes des finances publiques.
A partir de ce qui précède, nous formulons notre problématique de recherche comme suit :
« Quel est le degré d’adoption de la CG au sein des CHU au Maroc? Et quels sont les
facteurs clés de réussite ou de blocage de son introduction ? »
II. Objectifs de la recherche
Plusieurs questions jalonnent notre problématique : Pourquoi certains établissements publics
administratifs mettent en œuvre la CG et d’autres non ? Quels sont les facteurs qui
déterminent l’adoption de la CG ? Pourquoi certains établissements publics réussissent la
mise en œuvre de la CG tandis que d’autres échouent ?
Pour répondre à ces différentes questions et tenter d’expliquer le paradoxe évoqué, nous
avons fixé quatre objectifs à notre recherche :
- Identifier les principales raisons de l’adoption de la CG par les CHU : avec cet objectif, nous
chercherons à examiner les différents facteurs susceptibles d’influencer le choix d’adoption de
la CG,
- Rechercher les facteurs qui influencent le succès de mise en œuvre de la CG,
- Expliquer le paradoxe de la CG à la base de notre problématique : l’atteinte des deux
objectifs précédents nous permettra d’apporter de nouveaux éléments de réponse au paradoxe
de la CG. En d’autres termes, nous allons rechercher l’explication de ce paradoxe dans le
contexte de mise en œuvre de la CG. Les causes de son implantation et les facteurs qui
influencent sa mise en œuvre sont peut-être déterminants dans son adoption définitive ;
- Et apporter aux CHU une aide à l’amélioration de leurs performances comptables grâce à la
CG : à travers des données empiriques, nous tenterons dans ce travail d’identifier l’apport de
la CG aux centres hospitaliers qui l’adoptent.
III. Revue de littérature et Cadre conceptuel :
1. Innovation, caractéristiques et typologie
Depuis le début des recherches sur la diffusion de la CA, les différents chercheurs se sont
fondés sur des approches qui ont la même ambition : expliquer la diffusion des innovations. Il
s’agit de la théorie de diffusion des innovations et du courant de recherche sur la diffusion des
innovations en systèmes d’information.. La théorie de diffusion des innovations s’intéresse à
l’étude de la diffusion des innovations dans les différents types des organisations. Elle vise à
comprendre le processus de diffusion des innovations afin d’identifier un certains nombre de

L’INTRODUCTION D’UNE COMPTABILITE GENERALE AU SEIN DES CENTRES
HOSPITALO-UNIVERSITAIRES (CHU) AU MAROC : CARACTERISTIQUES ET ANALYSE DES
FACTEURS DE SUCCES
REVUE MAROCAINE DE RECHERCHE EN MANAGEMENT ET MARKETING, N°16, JANVIER-JUIN 2017 Page 464
facteurs qui influencent leur introduction et diffusion. Cette théorie a fourni les premiers
développements sur les concepts de base et a construit un corpus empirique riche sur les
déterminants de la diffusion, elle a ainsi constitué une référence pour le développement du
courant de recherche sur la diffusion des innovations en systèmes d’information. Ce dernier
vise de même à étudier le taux de diffusion des systèmes d’information et à identifier les
facteurs qui influencent l’adoption et l’implantation des innovations dans ce domaine.
• L’innovation
Les premiers chercheurs qui se sont intéressés à l’étude des innovations en sciences sociales
sont les économistes (Alcouffe, 2004). Pour eux, l’innovation est considérée comme le
moteur de la croissance économique (Schumpeter, 1939), après une innovation majeure
souvent qualifiée d’innovation de rupture, l’économie entre dans une phase de croissance. En
sciences de gestion, ce concept a suscité l’intérêt des chercheurs depuis le début des années
60, qui est marqué par la publication d’un ouvrage intéressant de Burns et Stalker
1
sur la
gestion de l’innovation7. De nombreux travaux sur la diffusion des innovations se sont
succédés dans le courant des années 60 et 70, ces travaux considèrent l’innovation comme
l’adoption d’une nouvelle idée par l’organisation.
Backer et Rogers (1998) et Rogers et Scott (1997), considèrent une innovation comme une
idée, une pratique ou un objet perçu comme nouveau par les membres d’un système social.
Elle peut être un mécanisme, un système, une politique, un programme, un processus, un
produit ou service, généré à l’intérieur de l’entreprise ou procuré de l’extérieur (Damanpour et
Evan, 1984 ; Daft, 1982 et Zaltman, Duncan et Holbeck, 1973). Cependant les innovations ne
sont pas toutes identiques, elles diffèrent selon un ensemble de critères.
• Les caractéristiques d’une innovation
Backer et Rogers (1998) et Rogers et Scott (1997) notent que, ce sont les caractéristiques de
l’innovation qui déterminent son rythme d’adoption par le système social. Ces caractéristiques
sont au nombre de cinq :
L’avantage relatif /La compatibilité /La complexité/La possibilité de test /Le caractère «
observable »
• Typologie des innovations
L’étude des types d’innovations est indispensable pour comprendre le comportement
d’adoption des innovations et identifier les déterminants des innovations dans les entreprises
(Downs et Mohr, 1976 ; Damanpour 1991). Damanpour (1991) distingue dans sa revue de la
littérature trois paires de types d’innovations :
Technique vs. Managériale, Produit vs. Processus et Radicale vs. Incrémentale.
• Typologie des innovations en SI
En examinant les concepts de base sur les approches de diffusion des innovations, Swanson
(1994) distingue trois grands types d’innovations en SI :
1
Burns et Stalker, 1961, « The Management of Innovation », Tavistock Publications, Londres.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%