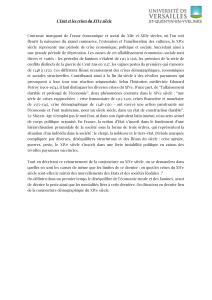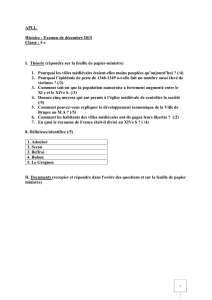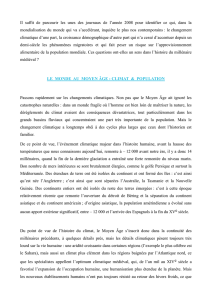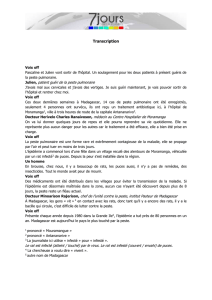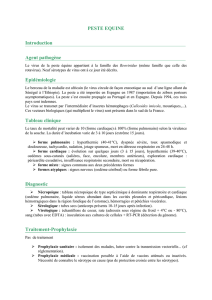L’Etat et les crises du XIVe siècle
Contraste marquant de l’essor économique et social du XIIe et XIIIe siècles, où l’on voit
fleurir la naissance du grand commerce, l’extension et l’amélioration des cultures, le XIVe
siècle représente une période de crise économique, politique et sociale. Succédant ainsi à
une grande période de dépression. Les causes de cet affaiblissement économico-sociale sont
divers et variés : les périodes de famines s’étalent de 1315 à 1316, les prémices de la série de
conflits distincts de la guerre de Cent Ans en 1337, les vagues pestes (la première qui s’amorce
de 1348 à 1353). Ces différents fléaux occasionnent des crises démographiques, économiques
et sociales structurelles. Contribuant ainsi à la fin du siècle à des révoltes paysannes qui
provoquent à leur tour une réaction seigneuriale. Selon l’historien médiéviste Edouard
Perroy (1901-1974), il faut distinguer les diverses crises du XIVe. D’une part, de “l’affaissement
durable et prolongé de l’économie”, deux phénomènes courants dans le XIVe siècle : “une
série de crises rapprochées - crise frumentaire de 1315-1320, crises financière et monétaire
de 1335-1345, crise démographique de 1348-1350 - ont exercé une action paralysante sur
l’économie et l’ont maintenue, pour un siècle siècle, dans un état de construction durable”.
Le Moyen-Age n’emploi pas le mot Etat, ni dans son équivalent latin (status
), ni au sens actuel
de corps politique organisé. En France, la notion d’Etat s’inscrit dans le fondement d’une
hiérarchisation pyramidale de la société sous la forme de trois ordres, qui représentent la
situation d’un individu dans la société : le clergé, la noblesse et le tiers-état. Période marquée
compliquée par diverses, déséquilibres structuraux et des fléaux du siècle : crise agraire,
guerres, peste, le XIVe siècle s’inscrit dans une forte instabilité politique en raison des
révoltes paysannes succinctes.
Tout en décrivant ce retournement de la conjoncture au XIVe siècle, on se demandera dans
quelles en sont les causes de même que les limites de ce dernier : en quoi les crises du XIVe
siècle sont-elles le miroir des morcellements des Etats et des sociétés féodales ?
On définira dans un premier temps le déséquilibre de l’économie rurale et des famines, avant
de décrire la peste ainsi que les mentalités liées à cette dernière. On discutera en dernier lieu
de la conjoncture démographique du XIVe siècle.

L’Etat et les crises du XIVe siècle
La peste avait délaissé l’Europe occidentale depuis plus longtemps que la famine : la dernière
grande épidémie de peste remontait du VIe siècle. Cette dernière réapparaît subitement sous
deux formes distinctes à la fin de 1347 : la peste bubonique et la peste pulmonaire. La première
a un taux de mortalité avoisinant les 80 % et la seconde, un taux de 100%. Pour la peste
bubonique, communément appelée la “Peste noire”, proviendrait d’une épidémie qui faisait
alors rage en Asie centrale, et des navires transportant dans leurs cales des rats contaminés de
la bactérie causant ainsi le fléau des comptoirs de la mer Noire aux ports méditerranéens par
des groupes mongoles en 1346. Se propageant dans un premier temps dans le Moyen-Orient
avant de s’étendre dans tout le reste de l’Europe en empruntant des circuits commerciaux de
l’époque : décembre 1347, elle était à Marseille, en juin 1347 à Paris et à Venise; en décembre 1349
elle avait infecté Londres et Francfort, pour atteindre la Suède en 1350. Difficile de connaître
avec exactitude le nombre de décès : en raison de la propagation progressive de l’épidémie, les
régions de l'Europe ne furent pas atteintes au même degré. On peut considérablement
supposés que les villes furent sans doute nettement plus impactées que les campagnes en
raison de la densité de population. L’effet démographique de la première vague de la peste
bubonique (1347-1350) fut intensifié par les diverses périodes successives sévissant l’Europe
jusqu’au XVIIIe siècle. La répétition des épidémies de peste a eu pour effet d’abaisser
durablement et dans des proportions importantes la démographie européenne; les épisodes de
famines et de guerres ont également contribué à cette décroissance démographique en Europe.
Les effets de la peste sur les mentalités sont non négligeables. Deux faits frappent
particulièrement, les pogroms et l'apparition des flagellants. Pour le premier, le terme de
pogrom n’est pas médiéval. Il peut toutefois désigner les flambées de persécution dont
certaines communautés juives ont fait l’objet en cette période épidémique. Le second, dépeint
les membres de confréries pénitentes au sein desquelles on se livre en commun à la
flagellation. Ces derniers dérivent dans des sentences publiques à caractère violent et
antisémites. Les Juifs, rendus en bien des endroits responsables de l’épidémies, furent accusés
d’avoir empoisonnés les puits. En Espagne, ce sont les pogrom eurent plus de violence,
toutefois les Juifs furent également massacrés à Strasbourg mais aussi dans d’autres villes en
Europe.
1
/
2
100%