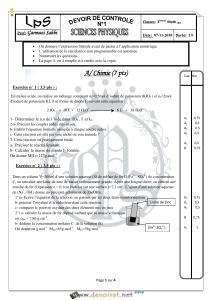Infiltration articulaire : Techniques et indications en rhumatologie
Telechargé par
abanezakarya

Rhumatos • Septembre 2014 • vol. 11 • numéro 99 181
Écho des congrès
OPTIMISER
LES TECHNIQUES
D’INFILTRATION
ÉPIDURALES
D’après une intervention
du Dr Christian Cautiello et coll.
(Aix-en-Provence)
Le but est d’augmenter le nombre
de bons résultats, de diminuer
les complications, de sélection-
ner les techniques les plus fiables
pour l’appréciation de résultats.
Un sondage auprès d’un panel de
praticiens a permis de recueillir
49réponses sur les techniques pra-
tiquées: les infiltrations intra-arti-
culaires postérieures recueillent
les surages de 41 praticiens, dont
37qui les pratiquent sous contrôle
radiographique. 50 % des utilisa-
teurs sont favorables aux péri-
radiculaires ; 64 % les pratiquent
eux-mêmes, les autres les envoient
chez un radiologue ou à l’hôpital.
34/42 utilisent les péridurales,
dans la majorité des cas sous radio-
guidage. 9/34 utilisent la voie inter-
lamaire, 15/34 la voie interépineuse,
8/34 l’une ou l’autre. 5/41 infiltrent
par le 1er trou sacré, 15/41 par le hia-
tus sacro-coccygien. Les auteurs
ont procédé à une autoévaluation
de leur technique, avec recours
à une opacification de la région
infiltrée et contrôle radiographique
de profil. 80% de bons résultats sont
obtenus en épidurale, 10 à 20% en
intrathécal par voie interlamaire,
10 à 20% en extrarachidien par voie
interépineuse. Ces résultats ont peu
de valeur au plan statistique, mais
sont toutefois probants (66 épi-
durales/77 injections). En fait, les
praticiens qui réalisent des épidu-
rales sans opacification obtiennent
80 % de bonnes localisations. Les
diverses techniques ont été passées
en revue. Selon les diérents para-
mètres (localisation du ligament
jaune, morphologie vertébrale, etc.)
et l’expérience du praticien, l’injec-
tion péridurale semble donner les
meilleurs résultats avec repérage
radiographique, avec ou sans opaci-
fication. Une étude de son ecacité
en rhumatologie, dans une popula-
tion homogène, paraît possible. Le
biais de la mauvaise technique est
ainsi écarté grâce à nos mesures.
INFILTRATIONS ACROMIO-
CLAVICULAIRES
D’après une intervention
du Dr Maurizio Carteni
(St-Pierre-de-Coutances)
Les infiltrations acromio-clavi-
culaires sont indiquées en cas
d’arthropathie douloureuse de cette
articulation, caractérisée par une
tuméfaction souvent visible et dou-
loureuse à la palpation. Un cliché
bien centré met facilement en évi-
dence l’interligne articulaire entre
l’acromion et l’extrémité distale de
la clavicule
(Fig. 1)
. L’image échogra-
phique et l’IRM sont en règle géné-
rale facilement obtenues et claire-
ment lisibles. L’infiltration se fait sur
un malade en décubitus dorsal
(Fig. 2)
,
L’infiltration dans tous ses états
Compte rendu du 10e congrès du GRRIF
n
Pour sa 10e édition, le congrès du GRRIF s’est tenu au Port-du-Crouesty,
en Bretagne Sud, du 16 au 18 mai 2014. Les techniques d’infiltration ont
été à l’honneur. Un point sur les risques thrombotique et hémorragique des
gestes percutanés chez les patients coronariens a également été fait.
Dr Michel Bodin*
*Rhumatologue, Griselles
Figure 1 - Radiographie montrant
l’interligne articulaire entre l’acromion
et l’extrémité distale de la clavicule.
Figure 2 - Infiltration acromio-claviculaire
sur une patiente en décubitus dorsal.

Écho des congrès
182 Rhumatos • Septembre 2014 • vol. 11 • numéro 99
sous asepsie rigoureuse. On repère
l’interligne par palpation de la par-
tie supérieure de l’épaule, et l’on
pique avec l’aiguille dirigée obli-
quement en bas et en avant.
On peut pratiquer une injection
radioguidée ou échoguidée en
fonction des préférences person-
nelles et de l’expérience de l’opé-
rateur. Une opacification par une
minime injection d’un produit de
contraste peut être très utile si l’on
choisit la première technique. En
échographie, l’asepsie est plus dif-
ficile à obtenir et la visualisation
de l’aiguille moins évidente. Le
coût des 2 techniques est équiva-
lent.
INFILTRATIONS
ÉPIDURALES PAR
LE HIATUS SACRO-
COCCYGIEN
D’après une intervention
du Dr Alain Zagala (Grenoble)
et du Dr Benoît Legoff (Nantes)
Comparativement aux voies plus
classiques, elles sont relativement
peu employées. Elles présentent
pourtant un certain nombre
d’avantages : la voie basse réduit
considérablement le risque de
brèche épidurale et l’intervention
reste possible sur un rachis opéré.
Le niveau du produit dépend de la
quantité injectée. La sélectivité est
cependant moins bonne et la mise
en place correcte de l’aiguille va-
rie, selon les études, de 15 à 90%.
Facile à réaliser au cabinet, elle est
particulièrement indiquée dans
les canaux lombaires étroits, sous
contrôle échographique. L’injec-
tion se pratique en procubitus, le
pelvis relevé par un coussin
(Fig. 3)
;
on repère le hiatus, les cornes
sacrées et la ligne des épineuses.
Avec une aiguille à PL22 g 90/0 ou
une aiguille IM “verte” 21 g 50 mm,
on pique perpendiculairement à la
peau, on passe le ligament sacro-
coccygien, puis on oriente l’ai-
guille vers le haut avec un angle de
20 à 30° par rapport à la peau. On
injecte des corticoïdes ± 10 cc de
sérum physiologique. L’échorepé-
rage, facilement réalisable au cabi-
net, limite les dicultés d’asep-
sie par rapport à l’échoguidage et
améliore de beaucoup la préci-
sion obtenue par le repérage pal-
patoire. L’échographie peut être
rendue dicile en cas d’anomalie
morphologique et ne permet pas
de dépister le passage endopelvien
par les trous sacrés ou un éventuel
passage vasculaire. Pour Banchais
et al., sur une série de 30 patients,
l’infiltration est réussie dans 93%
des cas, avec un reflux de sang dans
9 cas (31%) (1).
INFILTRATIONS
ÉCHO- ET RADIOGUIDÉES
DES SACRO-ILIAQUES
D’après une intervention
du Dr Benoît Legoff (Nantes)
La sacro-iliaque est parti-
culièrement dicile à infil-
trer : il s’agit d’une articulation
complexe, très enfouie (> 3 cm),
sans repère clinique fiable, et
sujette à de nombreuses varia-
tions anatomiques déroutantes.
Si l’on se fie au seul repérage cli-
nique, 22 % seulement des injec-
tions sont intra-articulaires et
24 % aboutissent dans l’espace
épidural. La “fenêtre” de ponc-
tion pour l’interligne ne dépasse
pas 2 cm. Un écho- ou un radio-
guidage est donc pratiquement
incontournable
(Fig. 4)
. L’injection
radioguidée se fait en procubitus,
sous anesthésie locale réalisée
avec une aiguille à PL 20 ou 22g.
Une seringue de faible volume
permet une plus grande pression.
La capacité articulaire ne dépasse
pas 0,8 à 1,7 ml. Le nerf sciatique
passe sous l’articulation et peut
être lésé.
L’infiltration échoguidée n’est
réalisable que si l’on a une bonne
connaissance anatomique des
structures osseuses et ligamen-
taires de l’articulation
(Fig. 5)
. Les
coupes scanner permettent de
dépister les anomalies morpholo-
giques. Les trous sacrés peuvent
Figure 3 - Infiltration épidurale par le hiatus sacro-coccygien.
Figure 4 - Infiltration des sacro-iliaques.
Espace subarachnoïdien
Dure-mère
Espace
épidural
(extradural)
Filum
terminal
Sac dural
Coupe médiane

L’infiLtration dans tous ses états
Rhumatos • Septembre 2014 • vol. 11 • numéro 99 183
aider au repérage. Il existe 2 mé-
thodes pour repérer la sacro-
iliaque en échographie:
• Du haut vers le bas: repérer la
crête iliaque et l’épine iliaque an-
téro-supérieure, repérer le sacrum
comme une ligne hyperéchogène
à sa partie médiale, déplacer la
sonde vers le bas jusqu’à ce qu’elle
s’abaisse à la hauteur du sacrum.
Le trou à ce niveau correspond au
pied de l’articulation.
• Du bas vers le haut: repérer le
hiatus sacro-coccygien, se dépla-
cer en latéral pour visualiser la
partie latérale du sacrum, se dé-
placer vers le haut jusqu’à l’appari-
tion de l’aile iliaque.
Plusieurs études ont fait état de
bons ou très bons résultats avec
le contrôle par échographie
(Fig. 6)
.
Toutefois, certains travaux ont
montré un résultat similaire, que
l’injection soit intra-articulaire ou
périligamentaire. En fait, si l’injec-
tion sous contrôle radio en intra-
articulaire apporte un bon résultat
dans 90 % des cas si l’opérateur
est entraîné, l’échographie consti-
tue une option alternative mieux
adaptée aux injections ligamen-
taires périarticulaires.
INFILTRATIONS
DES PETITES
ARTICULATIONS DU PIED
D’après une intervention
du Dr Henri Lellouche (Paris)
Quelques exemples d’articula-
tions pouvant être traitées par
infiltration. Il s’agit le plus souvent
d’arthropathie mécanique.
L’infiltration de la métatarso-
phalangienne (MTP) du gros
orteil pour hallux valgus
(Fig. 7)
ou
pour hallux rigidus n’est pas sans
danger. Le risque infectieux est
d’autant plus élevé que la peau en
regard de l’articulation est souvent
fragilisée par une bursite sous-
cutanée.
Quelques publications sur des
toutes petites séries ont mon-
tré des résultats équivalents sur
la douleur à 3 mois après corti-
coïdes ou viscosupplément intra-
articulaire (2)
L’infiltration cortisonée de la MTP
du 2e orteil est déconseillée, car elle
peut aggraver une déformation
avec orteil en crochet ou subluxa-
tion de l’articulation. L’intérêt de la
viscosupplémentation n’est ici pas
démontré.
L’articulation sous-talienne est
souvent le siège d’une atteinte
arthrosique ou inflammatoire. Elle
est particulièrement dicile à in-
jecter. Les résultats d’une étude de
viscosupplémentation sur 20 cas
d’arthrose sont considérés comme
satisfaisants par les auteurs dans
18cas (3).
Enfin, la tarso-métatarsienne du
1er orteil est parfois le siège d’une
arthrose et peut être infiltrée.
Dans l’ensemble, ces techniques
d’infiltration sont diciles et ces
gestes doivent être appris à partir
de repères anatomiques, radiosco-
piques ou échographiques. La place
de la viscosupplémentation reste à
déterminer.
INFILTRATIONS
ÉCHOGUIDÉES
DE L’ÉPAULE
D’après une intervention
du Dr Bernard Maillet (Moulins)
et du Dr Pascal Pillon (Fontaine)
Les gestes interventionnels à
l’épaule sont multiples : infiltra-
tion et/ou ponction de la bourse
sous-acromiale, infiltration du
long biceps, infiltration, ponc-
tion ou viscosupplémentation
de la gléno-humérale, ponction-
lavage de calcifications, infiltration
Figure 5 - Partie ligamentaire de l’articulation sacro-iliaque (repérée par un *).
Figure 6 - Contrôle par échographie
de la mise en place de l’aiguille. Figure 7 - Infiltration métatarso-phalangienne du 1er orteil d’un hallux valgus.

Écho des congrès
184 Rhumatos • Septembre 2014 • vol. 11 • numéro 99
acromio-claviculaire, infiltration
sterno-claviculaire.
Les indications de l’infiltration
de la bourse sous-acromiale
sont variables : bursite sous-acro-
miale, épanchement, rupture de
coie douloureuse, tendinopathie
sans bursite avérée en échographie.
L’infiltration constitue en outre un
bon test diagnostique. L’injection
sous échographie est recomman-
dée en 1re intention si l’on dispose
du matériel. On peut injecter Al-
tim® ou Diprostène®, 1 ampoule,
±Xylocaïne® 2 à 5 cc, Hydrocortan-
cyl 125®.
Au niveau de la gléno-humérale,
l’infiltration peut être justifiée
par la présence d’une omarthrose,
d’une arthrite ou d’une capsulite.
Sous échographie, la ponction
par voie postérieure, moins dou-
loureuse que la voie antérieure
classique, est facilitée
(Fig. 8)
. Elle
se fait en décubitus latéral ou en
position assise. Le bon positionne-
ment est au contact du cartilage.
Un temps arthrographique permet
de le vérifier. On injecte Altim® ou
Diprostène®, voire Hexatrione®
ou viscosupplément ± corticoïdes.
Pour les mêmes indications, et
en cas de ténosynovite du long
biceps, on peut infiltrer le réces-
sus bicipital. Le patient est cou-
ché, le bras le long du corps, ou
assis
(Fig. 9)
. La ponction-lavage
de calcifications se pratique sur le
patient couché, la main en prona-
tion ou en supination selon le chef
musculo-tendineux intéressé. Le
guidage échographique facilite le
positionnement de l’aiguille pour
les atteintes de tous les tendons de
la coie, particulièrement le sous-
scapulaire ou le repérage radiolo-
gique est très dicile
(Fig. 10)
. Une
anesthésie locale avec aiguille de
25g dans l’axe de la sonde est en gé-
néral susante. Pour la ponction-
lavage, on utilise une aiguille de 18 à
21g. Après pénétration de l’aiguille
dans la calcification, on lave par
petits mouvements du piston de la
seringue, avec du sérum physiolo-
gique ou de la Xylocaïne®. On doit
purger régulièrement la seringue
du “lait” calcique aspiré. En cas
d’échec, on peut procéder à une
légère et prudente fragmentation
de la calcification. En fin d’inter-
vention, on infiltre la bourse sous-
acromiale.
Les indications de l’infiltration
acromio-claviculaire sont les
arthropathies post-traumatiques
ou microtraumatiques, les kystes
acromio-claviculaires et les at-
teintes inflammatoires. La sonde
peut être placée en position frontale
ou sagittale; dans ce cas, le position-
nement de l’aiguille est plus dicile.
L’articulation sterno-claviculaire
peut être infiltrée en cas d’atteinte
dégénérative. Le positionnement
de l’aiguille est préférable sous
échographie. L’injection à l’aveugle
est souvent périarticulaire.
BONNES ET MAUVAISES
INDICATIONS DE
L’INJECTION DE PRP
(PLASMA RICHE EN
PLAQUETTES) DANS
LE CADRE DES
TENDINOPATHIES
CHRONIQUES DU SPORTIF
D’après une intervention
du Dr Olivier Fichez et du Dr Hervé
Zakarian (Saint-Raphaël)
RATIONNEL DE L’EMPLOI
DES PRP DANS LE CADRE
DES TENDINOPATHIES
CHRONIQUES DU SPORTIF
Le tendon est soumis à un équi-
libre dynamique entre anabolisme
Figure 8 - Infiltration gléno-humérale sous échographie.
Figure 9 - Infiltration du récessus bicipital.
Figure 10 - Ponction-lavage de calcifications (a) sus- et sous-épineux (b) et sous-scapulaire (c).
a b c

L’infiLtration dans tous ses états
Rhumatos • Septembre 2014 • vol. 11 • numéro 99 185
et catabolisme. Parmi les facteurs
cataboliques, il y a la libération
après une agression de cytokines,
de TNFa, d’IL-1, d’IL-6. Parmi les
facteurs anaboliques, on compte
les facteurs de croissance induisant
la réparation tissulaire. L’injection
de PRP apporte les divers éléments
nécessaires à la cicatrisation.
TECHNIQUE DE PRÉPARATION
Sont prélevés 27ml de sang, com-
plétés par 3 ml de citrate, le tout
centrifugé à 3200tours/min pen-
dant 15min. Après élimination du
plasma pauvre en plaquettes, les
PRP sont prélevés et mélangés à
0,20ml de bicarbonate de sodium
(neutralisation du pH).
INDICATIONS
Les bonnes indications de l’injec-
tion de PRP doivent se discuter en
fonction :
• de l’anatomopathologie (toutes
les tendinopathies ne répondent
pas à ces traitements);
• du mode d’agression : lésion in-
trinsèque et lésion extrinsèque ;
• du ratio entre l’atteinte tendi-
neuse et l’atteinte osseuse. Doivent
être éliminées les atteintes de dé-
terminisme particulier : les insta-
bilités tendineuses, les ténosyno-
vites, les bursites.
QUI INJECTER ?
Les patients porteurs de tendino-
pathies corporéales qui résultent
d’un processus dégénératif, en
raison de la faiblesse de leur pro-
cessus métabolique de recons-
truction. Il convient toutefois de
faire la part des atteintes extrin-
sèques par conflit osseux (le ren-
forcement de certains tendons
frottant sur une saillie osseuse
peut conduire à leur rupture),
et d’établir un ratio au niveau de
l’enthèse entre l’atteinte osseuse
et l’atteinte tendineuse : si le
tendon est atteint de manière
dominante, l’indication de PRP
est excellente, car elle permet de
renforcer la qualité de celui-ci ; si
l’os est atteint de manière domi-
nante, le renforcement du tendon
peut majorer la douleur et, au
pire, conduire à un arrachement.
❚Les bonnes indications :
• Les épicondylites médianes ou
latérales, en éliminant une souf-
france du nerf ulnaire.
• La pathologie des adducteurs
en tenant compte du ratio entre
l’atteinte tendineuse et l’atteinte
osseuse.
• Les aponévrosites plantaires.
• La tendinopathie corporéale
d’Achille, en évaluant les dié-
rents niveaux lésionnels au niveau
de ce tendon.
• Les tendinopathies rotuliennes,
en utilisant l’imagerie pour faire
la part entre ce qui revient à l’os et
au tendon (par IRM si possible ou
à défaut par échographie).
RÉSULTATS
Les résultats, sur une série per-
sonnelle de 65 cas concernent
21 genoux, 23 coudes (15 épi-
condylites et 8 épitrochléites,
16 tendons d’Achille, 2 aponé-
vrosites et 1 biceps fémoral)
chez 46 sportifs, 9 non-sportifs,
et 7 travailleurs manuels. Sur le
bilan global, l’EVA avant l’injec-
tion se situait à 7,4. L’évaluation
à 6semaines post-injection mon-
trait une EVA à 0,8. La douleur à la
pression se situait à 7,8 avant l’in-
jection et à 0,7 six semaines après
l’injection. Les douleurs aux tes-
tings isométriques se situaient à
7,1 avant injection, 0,9après injec-
tion. Tous les sportifs ont repris
la compétition. Ces injections
sont légalement autorisées et
ne sont pas concernées par les
lois antidopage.
De nombreuses variables concer-
nant aussi bien l’état cellulaire que
les modes d’action des facteurs de
croissance expliquent les résul-
tats discordants des séries pu-
bliées. Ces facteurs de croissance
n’ont aucun caractère sélectif au
niveau du tendon ni des struc-
tures cellulaires et il convient
d’être extrêmement rigoureux
sur les localisations par rapport à
la réparation tissulaire en cause.
L’encadrement de cette tech-
nique, en en précisant les bonnes
et les mauvaises indications, est le
seul garant de son intérêt.
LE RISQUE
THROMBOTIQUE ET
HÉMORRAGIQUE POUR
LES GESTES PERCUTANÉS
CHEZ LE CORONARIEN
D’après une intervention
du Dr Antoine Lesort (Paris)
et du Dr Bernard Maillet (Moulins)
Ces données ont été établies selon
les recommandations de la HAS
(novembre 2013).
Chez le coronarien sous antiagré-
gant, la pratique d’un geste invasif
augmente le risque hémorragique,
et l’arrêt des AAP induit un risque
majeur d’accident thromboembo-
lique. C’est dire l’importance de la
définition d’une stratégie d’équi-
libre entre ces 2 risques, adaptée
en fonction de l’acte envisagé.
Dans tous les cas, informer le pa-
tient est indispensable. Un geste
invasif sous prasugrel ou ticagré-
lor n’est pas recommandé; en cas
d’arrêt imposé de tous les AAP, au-
cun relais par HBPM n’est recom-
mandé.
Les
tableaux 1 et 2
donnent les stra-
tégies recommandées dans les
diérents cas de figure. La reprise
du traitement AAP est possible
très précocement après le geste
invasif si possible le jour même.
Le patient doit recevoir une
information écrite. n
 6
6
1
/
6
100%