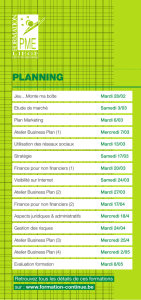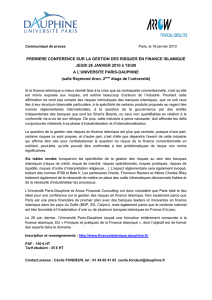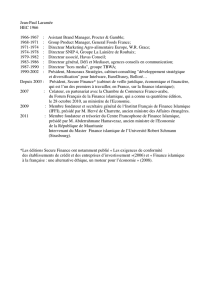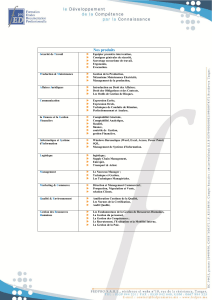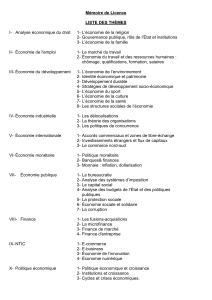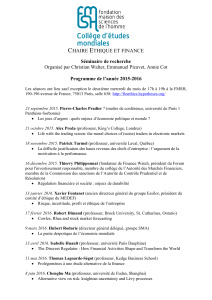See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/320666107
La Finance Islamique au Maroc : L'Alternative Ethique
Article · January 2016
DOI: 10.12816/0040378
CITATIONS
0
READS
9,421
1 author:
Some of the authors of this publication are also working on these related projects:
Responsabilité Sociétale des Entreprises au Maroc View project
Gouvernance des entreprises au Maroc View project
Adil Cherkaoui
Université Hassan II de Casablanca
27 PUBLICATIONS25 CITATIONS
SEE PROFILE
All content following this page was uploaded by Adil Cherkaoui on 02 December 2017.
The user has requested enhancement of the downloaded file.

Finance & Finance Internationale N°2 janvier 2016
1
La Finance Islamique au Maroc : l’Alternative Ethique
Adil CHERKAOUI
Chercheur ès Sciences de Gestion, Laboratoire de Recherche en Gestion des Compétences, de
l’Innovation et des Aspects Sociaux des Organisations et des Economies (GECIAS), Faculté
des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales – Ain Chock, Université Hassan II –
Casablanca.
Résumé :
La finance islamique est désormais une composante essentielle de la finance mondiale. Elle
connait une croissance vertigineuse dans plusieurs pays musulmans à l’instar des pays du
Golfe et de l’Asie sud-est. Elle a fait preuve d’innovation et a pu s’implanter dans plusieurs
pays non musulmans où elle cohabite avec la finance conventionnelle. En effet, la demande
accrue des produits financiers islamiques a fait qu’elle est devenue de nos jours un acteur
primordial qu’aucun pays ne peut plus négliger. C’est ainsi que nous essayerons de mettre un
focus sur la dimension éthique de la finance islamique. Avant d’expliciter les éventuels
enjeux qu’elle présenterait pour l’ensemble des opérateurs socio-économiques au Maroc,
particulièrement aux banques commerciales, Bank Al -Maghrib, le Trésor et les acteurs du
marché financier local. Ensuite, nous aborderons les opportunités qu’elle offrirait en matière
de sa contribution au financement des secteurs prioritaires pour le Maroc, la bancarisation de
sa population et la promotion de la solidarité sociale à travers la mise en place des fonds de la
ZAKAT.
Mots clés : banques islamiques, développement économique, bancarisation, solidarité sociale,
sukuks.
Abstract :
Islamic finance is now an essential component of global finance. She knows a dizzying
growth in several Muslim countries like the Gulf countries and South East Asia. She made
innovation and was able to locate evidence in several non-Muslim countries where it coexists
with conventional finance.
Indeed, increased demand for Islamic financial products has made it has become nowadays a
key actor that no country can be neglected. Thus we will try to put a focus on the ethical
dimension of Islamic finance. Before explaining potential issues that it would present for all
socio-economic operators in Morocco, especially commercial banks, Bank Al -Maghrib, the
Treasury and the actors of the local financial market. Then we will discuss the opportunities it
would offer for its contribution to the financing of the priority sectors for Morocco, banking
services of its population and the promotion of social solidarity through the establishment of
funds ZAKAT.
Keywords: Islamic banks, economic development, banking, social solidarity, sukuk.

Finance & Finance Internationale N°2 janvier 2016
2
Introduction :
Le Maroc dispose d’atouts considérables qui lui permettent de se positionner comme un pôle
financier pouvant drainer des financements islamiques conséquents. D’abord, le Maroc jouit
d’une stabilité politique et d’une situation géopolitique lui conférant un statut de plateforme
entre l’Europe et l’Afrique. Il dispose, également, du système financier le plus performant
dans la région MENA : un marché des capitaux compétitif et très élaboré, un secteur
d’assurance qui se positionne comme le deuxième en Afrique et un secteur bancaire mature et
très développé qui fait ses preuves dans plusieurs pays africains.
En plus, le pays a mis en chantier plusieurs projets d’investissements lancés dans le cadre des
stratégies sectorielles. Il ambitionne de développer des secteurs prioritaires particulièrement
dans les domaines de l’infrastructure (autoroutes, barrages, chantiers navales...), du tourisme,
de l’énergétique, de l’agriculture, de l’industrie agro-alimentaire, de l’immobilier, et de ses
nouveaux métiers mondiaux. Ceux-ci étant en quête de financements et par conséquent, sont
susceptibles d’attirer les capitaux islamiques. D’autant que le Maroc peut avoir une longueur
d’avance sur tous ses concurrents en matière d’attractivité de ces capitaux et ce de par ses
liens historiques et politiques privilégiés avec les pays du Golfe, liens scellés dernièrement
par l’invitation du Maroc à rejoindre le conseil de coopération du Golfe. Ceci se concrétise
par l’intérêt affiché par plusieurs grandes banques de la place à l’instar de Qatar Islamic Bank,
Kuweit Finance House, Dubaï Islamic Bank, Islamic Bank of Bahreïn… qui ont affiché aux
autorités marocaines leurs intérêts à s’implanter au Maroc.
Enfin, le Maroc, qui ambitionne de faire de la place financière de Casablanca (à travers la
mise en place du projet « Casablanca Finance City ») une plateforme incontournable au
carrefour des continents, a tout intérêt à saisir ces opportunités en capitalisant sur ses atouts.
Ainsi, le Maroc est-il conscient de telles opportunités ? Quels sont les enjeux et les
opportunités que la finance islamique pourrait apportée à l’économie marocaine ? En quoi la
finance islamique pourrait être appréhendée comme une alternative dite « éthique » ?
Dans ce sens, notre article apportera des éclaircissements sur la dimension éthique de la
finance islamique. Avant, de proposer quelques pistes de réflexions sur les enjeux et les
opportunités de la finance islamique pour le Maroc sur la base d’une étude exploratoire.
1. L’alternative éthique :
La désintermédiation, la déréglementation et le décloisonnement des marchés financiers ont
été à l’origine du développement spectaculaire du système financier conventionnel. Toutefois,
la récurrence des crises financières dont la plus récente est celle des « SUBPRIMES » a révélé
la complexité du système et sa vulnérabilité, dues principalement aux innovations financières
et à la libéralisation démesurée de l’économie. Les défaillances observées, ont été liées en
partie aux problèmes d’ordres éthiques et moraux ainsi qu’à la nature du système de
financement qui encourage l’endettement à travers les systèmes du crédit et de la titrisation.

Finance & Finance Internationale N°2 janvier 2016
3
Dès lors, la recherche des profits optimums à travers le financement à effet de levier, la vente
à découverte et le comportement spéculatif des acteurs des marchés ont entrainé une
détérioration éthique des systèmes bancaires et financiers conventionnels. L’opacité au niveau
de l’information financière, l’avidité, la cupidité, la corruption, l’asymétrie de l’information et
le manque de transparence ont caractérisé le comportement des institutions conventionnelles
et des intervenants des marchés financiers.1
De là, ces pratiques sont belles et bien inappropriées et contraires à l’éthique des affaires étant
donné qu’elles encouragent les opérations à caractère spéculatif au détriment des celles
orientées vers l’investissement productif et réel dans les sociétés. Les principales causes
expliquant cette situation sont :
- Une titrisation qui a été utilisée d’une manière abusive ;
- La complicité des agences de notation ;
- Des crédits octroyés sur des bases peu saines eu égard aux risques qui n’ont pas été
bien mesurés vu l’existence d’une possibilité de les transférer à travers le
mécanisme de la titrisation ;
- La réévaluation des actifs par les banques au prix des marchés afin d’accorder plus
de crédits aux consommateurs ;
- L’asymétrie de l’information et le manque de transparence.
L’apparition de cette crise, avec les différentes causes citées, souligne la présence d’un
problème d’ordre éthique dans les pratiques des banques conventionnelles et des
comportements des acteurs des marchés financiers qui ne sont nullement conformes à la
déontologie professionnelle : spéculation, titrisation des crédits non performants, effet de
levier excessif, fraudes financières…etc.
Ceci dit, la nécessité d’adopter des règles de bonnes conduites permettant de consolider le
capital - confiance afin de surmonter cette crise demeure impérative. En plus, il est
recommandé d’ancrer les principes de la concurrence déloyale sur le marché, d’établir un
comportement sur la base d’un couple rendement-éthique afin d’assurer la survie et la
pérennité de ces institutions et enfin, de recourir à une intermédiation bancaire fortement
ancrée dans l’économie réelle en se basant sur un partage réel des profits et des pertes dans un
souci d’équité et de justice plutôt que de rester dans une optique de contrats de dettes.
Toutes ces solutions constituent, le socle et les fondements de base de la finance islamique qui
présente à l’heure actuelle une alternative plus éthique capable d’apporter une correction aux
lacunes du système conventionnel. En effet, « les banques islamiques sont considérées comme
un refuge relativement sûr contre les turbulences des marchés financières mondiaux, et elles
1 HAMZA H. et GUERMAZI-BOUASSIDA S. « Financement bancaire islamique : une solution éthique
à la crise financière », La Revue des Sciences de Gestion, 2012/3 n° 255-256, p. 163.

Finance & Finance Internationale N°2 janvier 2016
4
incarnent un certain esprit d’équité et de justice par rapport à l’univers souvent impitoyable
de la finance occidentale ».2 [OCDE 2009]
L’islam repose sur des principes à la fois éthiques, moraux, sociaux, et religieux pour
défendre l’égalité, l’équité et le bien-être de toute la société. Elle incite à l’honnêteté, à la
confiance, au respect de l’autrui et à la justice sociale. La finance islamique, elle, puise ses
fondements des préceptes de la Charia et offre un modèle à la fois rentable et éthique3.
Dans le système capitaliste moderne, le fait économique est tout à fait autonome de toute
considération religieuse. En revanche, pour l’économie islamique, la religion est tout à fait
présente dans tout processus économique ou financier. Dès lors, l’acte économique ne peut
pas s’effectuer en dehors du champ de la religion islamique. En effet, « la culture islamique
ne peut intégrer l’utopie occidentale d’un marché autonome […] qui suppose que l’Homme
n’agit qu’en fonction de son intérêt individuel et de la possession des biens économiques.
Tout à l’opposé, l’économie s’insère en islam dans une rationalité qui n’est ni individuelle, ni
collective, mais essentiellement réglée par le besoin de sauvegarder l’intégration sociale »4.
Le but de l’activité financière islamique est d’établir un équilibre social, éthique et moral au
niveau des relations économiques. La banque islamique a pour mission d’offrir aux sociétés
des modes de financement alternatifs conformes aux préceptes de la Charia. De là, la relation
entre la banque et ses clients repose sur la confiance mutuelle renforcée par des convictions
religieuses communes.
Les principes de la Charia appliqués par la banque islamique mettent l’accent sur
l’interdiction des facteurs majeurs liés aux crises financières tels que les taux d’intérêt, la
spéculation, la titrisation, le manque de transparence, l’asymétrie de l’information et la prise
des risques excessives dans les opérations financières. Dans ce sens, la titrisation qui consiste
à transférer un risque d’une société à une autre, est rejetée par la finance islamique étant
donné que la banque doit assumer pleinement le risque lié à n’importe quelle opération
qu’elle effectue.
La doctrine économique islamique interdit le transfert des dettes et des risques puisqu’elle se
fonde sur le principe de partage des profits et des risques. Elle incite le banquier à mieux
analyser les risques avant d’effectuer de telle ou telle opération parce qu’il est censé l’assumer
pleinement. Dans le cadre de l’ingénierie financière islamique, seule la titrisation basée sur un
transfert de la propriété du bien tangible sur la base duquel repose l’opération en question est
2 Organisation de la coopération et du développement économique : OCDE, » rapport annuel 2009 »,
consultable sur : www.oecd.org, consulté le 10/05/2013.
3 L’islam est la religion qui incite l’homme à s’engager davantage dans le processus du développement
économique et social visant le bien être individuel et collectif. Pour l’islam, l’Homme est investi d’une
mission par Dieu consistant à animer toute activité de création, de mise en valeur, de protection, de
développement des ressources mises à la disposition de l’humanité. (Cette mission est appelée
ISTIKHLAF et l’œuvre humaine est qualifiée AL IIMAR ).
4 Isabelle CHAPELLIERE, « éthique et finance en islam », édition Koutoubia, Novembre 2009, P : 55.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%