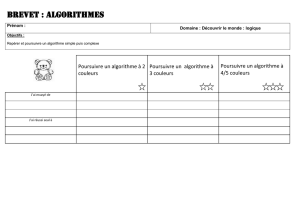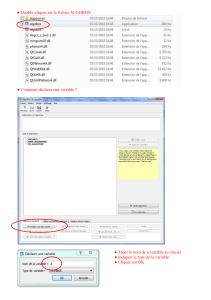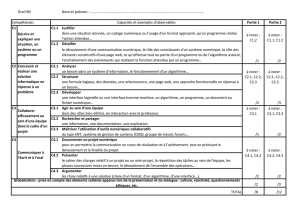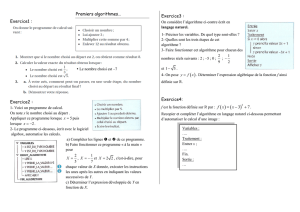Algorithme de Ford : Théorie des graphes et chemin le plus court
Telechargé par
morganalexandre

Algorithme de Ford
Lourdel Nicolas
Sergent Nicolas
Juin 2019

Table des matières
I. Théorie des graphes .......................................................................................................................... 3
a) Définition .............................................................................................................................................. 3
b) Origines ................................................................................................................................................. 4
II. Algorithme ........................................................................................................................................ 6
c) Définition d’un algorithme .................................................................................................................... 6
d) Définition générale ............................................................................................................................... 6
e) Quelques définitions connexes : ........................................................................................................... 7
f) Algorithme numérique .......................................................................................................................... 8
g) Algorithme non numérique .................................................................................................................. 8
h) Algorithme dans la vie quotidienne ...................................................................................................... 8
III. Recherche du chemin le plus court ............................................................................................. 10
i) Algorithme utilisé ................................................................................................................................ 10
IV. Implémentation de l’algorithme ................................................................................................. 12
j) Choix du langage ................................................................................................................................. 12
k) Traduction du problème ..................................................................................................................... 12
l) Traduction du graphe en langage informatique ................................................................................. 12
m) Traduction de l’algorithme ............................................................................................................. 14
V. Interface Graphique ........................................................................................................................ 16
n) Description et utilisation de l’application ........................................................................................... 16
o) Conclusion ........................................................................................................................................... 17

I. Théorie des graphes
a) Définition
La théorie des graphes est la discipline mathématique et informatique qui
étudie les graphes, lesquels sont des modèles abstraits de dessins de
réseaux reliant des objets1. Ces modèles sont constitués par la donnée de
sommets (aussi appelés nœuds ou points, en référence aux polyèdres), et
d'arrêtes (aussi appelées liens ou lignes) entre ces sommets ; ces arêtes
sont parfois non-symétriques (les graphes sont alors dits orientés) et sont
appelés des flèches.
Les algorithmes élaborés pour résoudre des problèmes concernant les
objets de cette théorie ont de nombreuses applications dans tous les
domaines liés à la notion de réseau (réseau social, réseau informatique,
télécommunications, etc.) et dans bien d'autres domaines (par exemple
génétique) tant le concept de graphe, à peu près équivalent à celui de
relation binaire (à ne pas confondre donc avec graphe d'une fonction), est
général. De grands théorèmes difficiles, comme le théorème des quatre
couleurs, le théorème des graphes parfaits, ou encore le théorème de
Robertson-Seymour, ont contribué à asseoir cette matière auprès des
mathématiciens, et les questions qu'elle laisse ouvertes, comme la
conjecture de Hadwiger, en font une branche vivace des mathématiques
discrètes.

b) Origines
Un article du mathématicien suisse Leonhard Euler, présenté à l'Académie
de Saint-Pétersbourg en 1735 puis publié en 1741, traitait du problème des
sept ponts de Königsberg, ainsi que schématisé ci-dessous. Le problème
consistait à trouver une promenade à partir d'un point donné qui fasse
revenir à ce point en passant une fois et une seule par chacun des sept
ponts de la ville de Königsberg. Un chemin passant par toute arête
exactement une fois fut nommé chemin eulérien, ou circuit eulérien s'il finit
là où il a commencé. Par extension, un graphe admettant un circuit eulérien
est dit graphe eulérien, ce qui constitue donc le premier cas de propriété
d'un graphe. Euler avait formulé7 qu'un graphe n'est eulérien que si chaque
sommet a un nombre pair d'arêtes. L'usage est de s'y référer comme
théorème d'Euler, bien que la preuve n'en ait été apportée que 130 ans plus
tard par le mathématicien allemand Carl Hierholzer. Un problème similaire
consiste à passer par chaque sommet exactement une fois, et fut d'abord
résolu avec le cas particulier d'un cavalier devant visiter chaque case d'un
échiquier par le théoricien d'échecs arabe Al-Adli dans son ouvrage
Kitabash-shatranj paru vers 840 et perdu depuis. Ce problème du cavalier
fut étudié plus en détail au XVIIIe siècle par les mathématiciens français
Alexandre-Théophile Vandermonde, Pierre Rémond de Montmort et
Abraham de Moivre; le mathématicien britanniqueThomas Kirkman étudia
le problème plus général du parcours où on ne peut passer par un sommet
qu'une fois, mais un tel parcours prit finalement le nom de chemin
hamiltonien d'après le mathématicien irlandaisWilliam Rowan Hamilton, et
bien que ce dernier n'en ait étudié qu'un cas particulier. On accorde donc à
Euler l'origine de la théorie des graphes parce qu'il fut le premier à
proposer un traitement mathématique de la question, suivi par
Vandermonde.
Un des problèmes les plus connus de théorie des graphes vient de la
coloration de graphe, où le but est de déterminer combien de couleurs
différentes suffisent pour colorer entièrement un graphe de telle façon
qu'aucun sommet n'ait la même couleur que ses voisins. En 1852, le
mathématicien sud-africain Francis Guthrie énonça le problème des quatre

couleurs par une discussion à son frère, qui demandera à son professeur
Auguste De Morgan si toute carte peut être coloriée avec quatre couleurs
de façon que des pays voisins aient des couleurs différentes. De Morgan
envoya d'abord une lettre au mathématicien irlandais William Rowan
Hamilton, qui n'était pas intéressé, puis le mathématicien anglais Alfred
Kempe publia une preuve erronée dans l’American Journal of Mathematics,
qui venait d'être fondé par Sylvester. L'étude de ce problème entraîna de
nombreux développements en théorie des graphes, par Peter Guthrie Tait,
Percy John Heawood, Frank Ramsey et Hugo Hadwiger.
Les problèmes de factorisation de graphe émergèrent ainsi à la fin du
XIXe siècle en s'intéressant aux sous-graphes couvrants, c'est-à-dire aux
graphes contenant tous les sommets mais seulement une partie des arêtes.
Un sous-graphe couvrant est appelé un k-facteur si chacun de ses sommets
a k arêtes et les premiers théorèmes furent donnés par Julius Petersen ; par
exemple, il montra qu'un graphe peut être séparé en 2-facteurs si et
seulement si tous les sommets ont un nombre pair d'arêtes (mais il fallut
attendre 50 ans pour que Bäbler traite le cas impair). Les travaux de
Ramsey sur la coloration, et en particulier les résultats du mathématicien
hongrois Pal Turan, permirent le développement de la théorie des graphes
extrémaux s'intéressant aux graphes atteignant le maximum d'une quantité
particulière (par exemple le nombre d'arêtes) avec des contraintes
données, telles que l'absence de certains sous-graphes.
Dans la seconde moitié du XXe siècle, le mathématicien français Claude
Berge contribue au développement de la théorie des graphes par ses
contributions sur les graphes parfaits et l'introduction du terme
d’hypergraphe (suite à la remarque de Jean-Marie Pla l'ayant utilisé dans un
séminaire) avec un monographe sur le sujet. Son ouvrage d'introduction à
la théorie des graphes proposa également une alternative originale,
consistant plus en une promenade personnelle qu'une description
complète. Il marquera également la recherche française en ce domaine, par
la création conjointe avec Marcel-Paul Schützenberger d'un séminaire
hebdomadaire à l'Institut Henri Poincaré, des réunions le lundi à la Maison
des Sciences de l'Homme, et la direction de l'équipe Combinatoire de Paris
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%