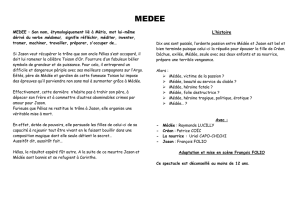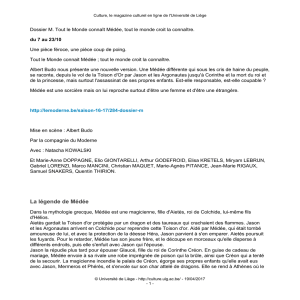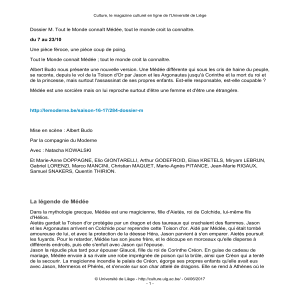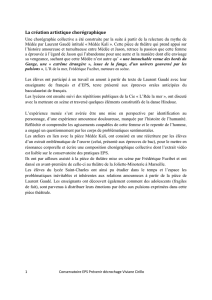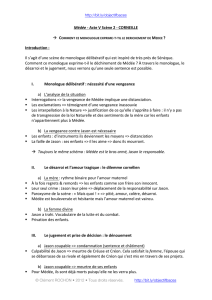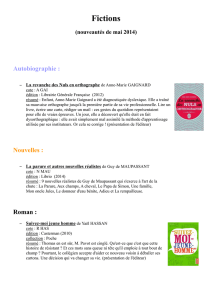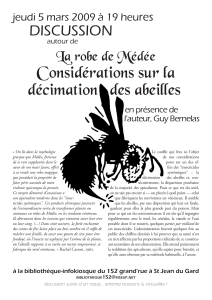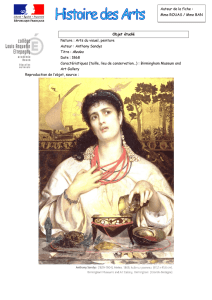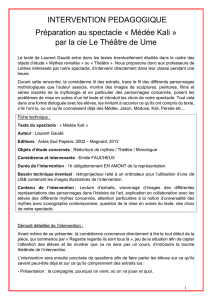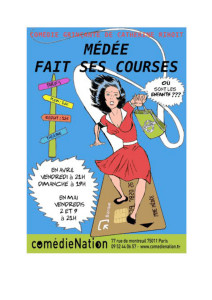Médée d'Anouilh: Solitude et Absurde

Jean Anouilh, Médée : la solitude contre le sens du monde
Jean Anouilh,
Médée
, Éditions de la Table ronde, 1947 (rééd. 1997, coll. La Petite Vermillon)
Création de la pièce : 1946
Le mythe de Médée est un des plus terribles, et un des plus profonds qu'ait engendrés
l'imagination. Il s'est transmis jusqu'au vingtième siècle par la littérature (avec les mythologues ou
poètes antiques comme Ovide ou Hygin, Chaucer, etc.), le théâtre (Euripide, Sénèque, La Péruse,
Catulle Mendès, Pierre Corneille, Anouilh, etc.), l'opéra (Thomas Corneille et Marc-Antoine
Charpentier, Cherubini, Darius Milhaud, ...), la danse (
Le Songe de Médée
d'Angelin Preljocaj) ou
le cinéma (Pasolini). Et, au seuil du XXIe siècle, Médée n'a sans doute pas dit son dernier mot.
Ce succès étonnant s'explique à la fois par l'ancrage de ce mythe dans l'inconscient
individuel et dans l'inconscient collectif, mais aussi par sa fécondité artistique : figure
traditionnelle
de la
transgression
, la figure de Médée, défiant toutes les règles,
provoque
(dans
tous les sens du terme) la création artistique.
Comme Giraudoux (
Électre
,
La Guerre de Troie n'aura pas lieu
), Cocteau (
Antigone
,
La
Machine infernale
, etc.) ou Sartre (
Les Mouches
,
Les Troyennes
), Anouilh ressuscite sur scène un
mythe antique qui interroge la conscience contemporaine. Médée, comme Antigone, ou comme
Œdipe, est l'emblème d'une solitude radicale, celle de l'individu devant l'histoire. C'est un
personnage en exil, une émigrée, étrangère partout même chez elle. C'est l'affirmation tragique
d'une existence réduite à un pur présent, quand le passé et l'avenir d'avèrent impossibles. C'est,
enfin, le contraire d'une figure chrétienne : l'expression d'une volonté qui ne repose que sur soi-
même, et qui se montre dans sa vérité aveuglante. Cette vérité exposée et imposée
contre les autres
dévoile du coup, sous les feux de la rampe, la vérité des autres : leurs intérêts dissimulés par les
mensonges politiques, moraux, ou rhétoriques.
Médée et Antigone
Médée
est créée en 1946, peu après
Antigone
. Les deux pièces sont proches non seulement
chronologiquement, mais aussi d'inspiration.
•Dans les deux pièces, Anouilh recourt à un sujet d'origine grecque, bien représenté dans la
tradition théâtrale. Il y a eu plusieurs
Médée
depuis celle d'Euripide (Ve s. av. J.-C.) : la
Médée
de Sénèque (Ier s. ap. J.-C.), celle de La Péruse (1556) celle de Pierre Corneille
(1635) – à laquelle on peut ajouter une « tragédie en musique » de Thomas Corneille

(1693), entre autres...
•Les deux tragédies mettent en scène un héroïsme du refus, de la résistance, du
non
: dans
Antigone
(La Table ronde, coll. la Petite Vermillon, p. 78 sq., p. 93 et 104) s'opposent le
non
d'Antigone et le
oui
de Créon ; dans
Médée
, où les mots « oui » et « non » apparaissent
souvent, s'oppose le camp de l'acceptation (Créon, Jason, la nourrice) et celui du refus
(Médée, seule).
•Les deux héroïnes, Antigone et Médée, refusent également le bonheur (
Antigone
p. 92, p.
96 par exemple ;
Médée
p. 16 : « Quelque chose bouge dans moi [...], c'est quelque chose
qui dit non au bonheur. »)
•Les deux héroïnes affirment leur autonomie jusqu'à une solitude radicale – qui n'est pas
l'isolement, mais au contraire le
spectacle
de leur irréductible différence. « Pour personne.
Pour moi » (
Antigone
, p. 73, et dans
Médée
il y a de nombreuses affirmations de cette
sorte).
•Les dialogues rendent palpable l'hétéronomie entre l'héroïne et les autres, jusqu'à la surdité
ou la demande à l'autre de se taire (
Antigone
p. 25-26 : « Je ne t'écoute pas. » ; « tais-toi »
demande Créon à plusieurs reprises ; « Tu ne sais plus ce que tu dis. — Si, je sais ce que je
dis. » De telles répliques se trouvent aussi dans
Médée
, voir ci-dessous).
•le poids du passé, de l'enfance, est commun à Antigone et à Médée : enfance royale,
jalousies et rivalités dans le cas d'Antigone (mises à jour par son dialogue avec Ismène ;voir
p. 32, 50-51, 63) ; dans le cas de Médée, une enfance royale également, et le rôle de
prêtresse qui fut le sien. Le présent porte le poids du passé. Ce passé est représenté sur la
scène d'
Antigone
par la nourrice et par Ismène, la soeur d'Antigone. Dans
Médée
c'est la
nourrice, qui exprime une certaine nostalgie, mais qui incarne surtout l'idée que
le temps
passe
, qu'il y a
un avant
et
un après
, et que rien, fondamentalement, ne change.
•Médée et Antigone sont infantilisées : Antigone est perçue comme un enfant (p. 50-51 :
c'est un
enfant
qu'on voit enterrer Polynice), et la nourrice adresse à Médée des noms
affectueux, d'ailleurs lourds d'ambiguïté (« ma chatte » p. 12, « Mon aigle fier, mon petit
vautour... » p. 20 « ma louve » p. 22, ...). Jason, lui aussi, infantilise Médée, en faisant écho
aux surnoms de la nourrice : « Tu as l'air d'une
petite bête
éventrée... »
•Le poids de la génération : dans
Médée
trois générations sont représentées (celle des
« vieux », celle de Créon et de la nourrice ; celle de Jason, de Médée et de Créuse ; enfin,
celle des enfants), et les figures paternelles ou maternelles sont relativement nombreuses :
Créon, Jason, Médée, la nourrice... et il est fait allusion à Pélias, au père de Jason, Éson, au
père de Médée, Éétès, et à son aïeul le soleil. Créon, dans
Antigone
, dit à son fils :
« Regarde-moi, c'est cela devenir un homme, voir le visage de son père en face, un jour. »
Hémon le regarde, recule en criant, et s'enfuit... Dans
Médée
, les personnages de pères, sur
la scène, sont Jason et Créon, qui veulent le bonheur de leurs enfants, et pour cette raison
précipitent la catastrophe. Dans les paroles de Jason et de Médée apparaissent Pélias
(l'usurpateur, roi de Iolchos, tué par ses propres enfants, à cause d'une ruse de Médée),

Éson, le père de Jason, pour lequel celui-ci s'est mis en quête de la toison d'or, Éétès, le père
de Médée, volé et trahi par celle-ci, et le soleil. Aïeul de Médée, le soleil symbolise la
lumière aveuglante du jour tragique, et Médée lui adresse un reproche : « O soleil [...]
pourquoi m'as-tu faite amputée ? Pourquoi m'as-tu faite une fille ? Pourquoi ces seins,
cette faiblesse, cette plaie ouverte au milieu de moi ? ». La lumière tragique accentue le
conflit entre les générations, jusqu'à l'extrême (Médée tue ses propres enfants).
•Humanité et bestialité se rapprochent : Antigone est comparée à plusieurs reprises à un
animal ; (moineau, gibier, etc.), et les hommes apparaissent comme des animaux (voir p.
82-83). Dans
Médée, ces métaphores sont nombreuses
.
•Le rapprochement du début et de la fin, de la naissance et de la mort, de l'amour et de la
haine, dans une lumière qui transcende ces contradictions : « je veux être sûre de tout
aujourd'hui et que cela soit aussi beau que quand j'étais petite – ou mourir. » (
Antigone
, p.
95)
•Dans les deux pièces, mais surtout dans
Médée
où la dimension érotique est plus évidente,
la lumière tragique naît du choc entre un amour fou et une lucidité aveuglante. La
cohabitation du lumière et de l'ombre, de la lucidité et de l'aveuglement,
sous le même jour
tragique
, fait du moment tragique un moment absolument singulier.
Une différence entre les deux pièces doit être signalée : dans
Médée
, il n'y a pas de choeur.
Cette différence n'est pas négligeable : car cette absence de chœur accentue la solitude de l'héroïne
tragique.
L’espace tragique
C'est un lieu de passage pour les nomades que sont Médée, Jason, et la nourrice. Mais c’est, plus
encore, un lieu de fuite : Médée fuit parce qu’elle est chassée (« Je fuis, Jason ! Je fuis. », p. 44),
Jason fuit Médée (« Tout ce que je veux fuir ! », p. 49), et la nourrice fuit parce qu’il faut fuir
(« Fuir, toujours fuir, depuis ! », p. 14). Toutefois, ces trois personnages refusent cette fuite, à des
degrés divers : la nourrice est lasse de ces départs, et exprime à la fin de la pièce des
préoccupations de femme sédentaire. Jason met fin à son errance en épousant Créuse. Quant à
Médée, elle souhaite marquer ce lieu du souvenir éternel de a présence.
La scène est un point d'aboutissement, mais aussi un point de départ. C'est un rivage, lieu
d'embarquement et de débarquement. Elle se trouve tout près d'un lieu habité (Corinthe, désigné
comme un « village »), mais il est situé à l'écart – à la lisière entre le monde civilisé et le monde
sauvage, c'est un lieu intermédiaire, limite, où tout peut basculer dans un sens ou dans un autre.
C'est un lieu d'exil : Médée n'y est pas chez elle. La scène est une métonymie du personnage de
Médée, qui y est présente sans interruption, du début à la fin de la pièce. « Médée innocente a été
choisie pour être la proie et le lieu de la lutte » (p. 85). « Médée est le lieu où les dieux se
rencontrent et jouent. » (p. 86). À la fin de la tragédie, Médée
est
la scène, elle-même.

La scène est un lieu d’enfermement : « Tous les chemins que je t’ai ouverts, je me les suis
fermés. », dit Médée à Jason (p. 51). Médée est l’incarnation au théâtre du tragique de l’existence
dans la pensée de Heidegger : les portes se ferment une à une, jusqu’à ce qu’il n’en reste enfin
qu’une. Le moment tragique est celui de
la dernière porte qui se ferme
.
Contrairement à Médée, la nourrice tente, elle, de
banaliser
ce lieu : c'est pour elle un lieu de
passage comme un autre.
Le temps tragique
Le temps du spectacle est lui aussi un temps de
passage
. S'il est, certes, possible de faire une
explication symbolique des dernières paroles de la pièce (la vie l’emporte sur la mort, après la
pluie le beau temps, etc.), une telle explication sera sans doute incertaine ; mais d’un point de vue
théâtral
, le dialogue entre la nourrice et le garde signale le temps de la tragédie comme un temps
de
transition
, comme un simple passage. « Je veux vivre ! » répète la nourrice, au début et à la fin
de la tragédie : le moment de la catastrophe est une fin
dans le temps
, et non la fin des temps.
Aussi horrible soit-il, un crime n'est jamais inoubliable pour tout le monde : en 1946 la leçon n'est
pas anodine. Cette fin n’est sans doute pas dépourvue d’ironie : il y a des personnages assez
attachés à leur « pauvre bonheur » (p. 74) pour oublier l'inoubliable..
Le temps tragique est le temps du soir, qui s'achève dans la nuit (le second monologue de Médée,
p. 78-80, est une belle évocation onirique de la nuit). « Ils sont chez eux, eux. Leur journée est
finie. », dit la nourrice non sans un peu d'envie (p. 13). Mais c’est aussi le temps d’une fête : le
temps d’« entendre » et de « sentir » une fête qui se déroule non sur scène, mais près de là (« Ils
chantent au village. C’est peut-être une fête chez eux, aujourd’hui. », p. 9) ; le temps de se
souvenir des fêtes passées, des fêtes de Colchide (« Chez nous c’est plus tôt, en juin, la fête. », p.
10) ; le temps, enfin, d’une solennité unique, d'un sacrifice unique, terrible. Dès la visite du garçon
au début de la pièce, Médée entre dans la fête, et petit à petit elle se met au centre, devient à son
tour l'épouse et la prêtresse à la fois ; ainsi, ce n’est que rétrospectivement que ces répliques
peuvent se comprendre pleinement, par une forme d’ironie tragique :
D’ailleurs, c’est plutôt une bonne nouvelle puisqu’on danse.
Merci, petit ! Va danser maintenant avec les filles de Corinthe. Danse de toutes
tes forces, danse toute la nuit. (p. 19)
Ce garçon préfigure ainsi le sacrifice final, celui des enfants par leur mère. Peu avant ce sacrifice,
le garçon vient retrouver Médée, qui lui crie :
Merci, petit, merci pour la seconde fois ! Fuis, toi ! Il vaut mieux ne pas me
connaître. (p. 82-83)
Le temps tragique redevient ce qu’il était aux origines : une fête sacrificielle, une fête dionysiaque.

Le présent de la représentation est
situé
, entre un passé et un avenir. La nourrice se raccroche
au passé, donc à la répétition, comme elle se raccroche à la vie (« Je veux vivre, Médée ! », p. 29 ;
« Je veux vivre ! », p. 83) et à la quotidienneté (« le soleil sur le banc à la halte, la soupe chaude à
midi, les petites pièces qu’on a gagnées de sa main, la goutte qui fait chaud au cœur avant de
dormir », p. 29). « Te rappelles-tu ? Le palais était blanc au bout de l'allée des cyprès quand on
rentrait des longues promenades… » (p. 13). Le passé, la vie, la répétition ne font qu'un. Le temps
de Médée, au contraire, est un temps d’après la vie. Médée traite la nourrice de « carcasse », avant
de se désigner elle-même par ce terme (« cette carcasse de Médée », p. 51). « Médée est morte » (p.
52), et en même temps « Médée est là, […] montant la garde »... Médée incarne la mort, et lui
donne une présence, elle lui donne
chair
.
Jason, lui, assume la généalogie, autre forme de répétition : « Faire sans illusions peut-être,
comme ceux que nous méprisons ; ce qu’ont fait mon père et le père de mon père et tous ceux qui
ont accepté avant nous » (p. 70). Ce choix est aussi le choix de l’avenir : « Elle (Créuse) est
neuve
,
elle est simple, elle est pure.
Je vais
la recevoir sans sourire de la main de son père et de sa mère... »
(p. 74). Le passé et la répétition qu'il refuse sont précisément ceux que la nourrice accepte, par
résignation : c'est celui de l'errance, et du désamour (« Mais pourquoi redire ce qui est mort ? Ma
haine aussi est morte... », p. 68).
Le personnage de Médée s'enracine, lui, dans le présent de la scène. Contrairement à la nourrice,
et contrairement à Jason, elle refuse à la fois le passé et la répétition, la reproduction. « Crois-tu
que c’est bon de toujours redire les choses ? » (p. 11) ; elle affirme à la fois son unicité –
indépendante de toute ascendance – et l'unicité du moment et du lieu présents.
Oh ! tu en auras d’autres femmes, rassure-toi, tu en auras mille maintenant, toi
qui n’en pouvais plus de n’en avoir qu’une. Tu n’en auras jamais assez pour chercher
ce reflet dans leurs yeux, ce goût sur leurs lèvres, cette odeur de Médée sur elles.
(p. 48)
Médée tue le passé et la répétition (« Je l’attendais tout le jour […] il me quittait chaque matin
[…] », p. 21-22) pour renaître à elle-même, dans un présent sans avenir ; Anouilh (comme
Sénèque) ne reprend pas le personnage d’Egée, qui lui donnait, dans l'œuvre d'Euripide et dans
celle de Corneille, la perspective d'un avenir – personnage maudit, elle devenait protectrice du roi
d'Athènes, selon une logique comparable à celle d'
Œdipe à Colone
. Ici, elle s’inscrit dans un
présent isolé : sa solitude s'inscrit donc dans le temps autant que dans l'espace.
Au contraire de Jason – qui se marie, et fait, lui, le choix de la vie – Médée rejette donc la
procréation, comme toute forme de reproduction ou de répétition. Les enfants de sa chair vont
mourir ; en méprisant sa nourrice, Médée méprise la fécondité, et la vie elle-même. « Ce n’est pas
de lait que Médée a grandi. » Le sexe féminin est une blessure par où le mâle a pénétré en elle :
pour être enfin elle-même, pure de toute soumission, Médée dit non à l'amour, le rejetant dans un
passé révolu (« Honte ! Mes joues me brûlent, nourrice. Je l'attendais tout le jour, les jambes
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%