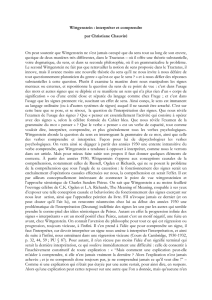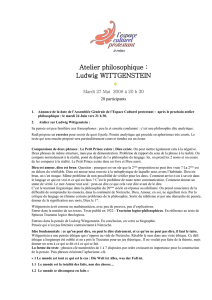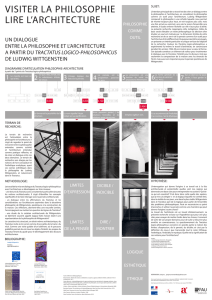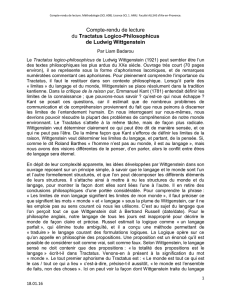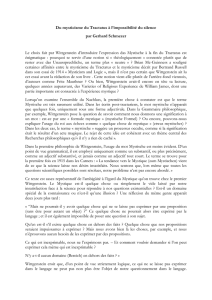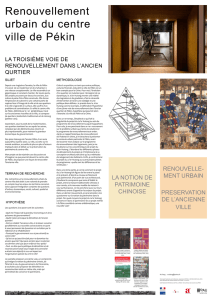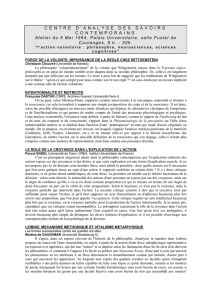« LE MONDE EST... ». LECTURES DU TRACTATUS PAR BLUMENBERG
Jean-Claude Monod
Centre Sèvres | « Archives de Philosophie »
2016/1 Tome 79 | pages 121 à 134
ISSN 0003-9632
Article disponible en ligne à l'adresse :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-2016-1-page-121.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Centre Sèvres.
© Centre Sèvres. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les
limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la
licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie,
sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de
l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage
dans une base de données est également interdit.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 105.158.204.130 - 07/01/2020 23:05 - © Centre Sèvres
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 105.158.204.130 - 07/01/2020 23:05 - © Centre Sèvres

«Le monde est…»
Lectures du Tractatus par Blumenberg
JEAN-CLAUDE MONOD
École Normale Supérieure, Paris
Le Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein présente ce paradoxe
d’être à la fois une des œuvres philosophiques les plus influentes du
XX
e
siè-
cle et un livre dont la difficulté d’interprétation est si notoire que la plupart
de ces influences peuvent apparaître comme fondées sur des malentendus,
voire sur des contresens. La structure du livre réserve, comme on sait, une
surprise finale qui en modifie rétrospectivement le sens d’ensemble. On peut
comparer la situation du lecteur à celle du spectateur du film Sixième sens,
de M. Night Shyamalan (1999). Dans ce film, l’enfant médium voit et com-
munique avec des morts, des dead people qui, eux, ne savent pas qu’ils sont
morts; il est suivi par un médecin psychiatre, joué par Bruce Willis; ce n’est
qu’à la fin du film que l’on comprend que ce personnage, l’autre personnage
principal avec l’enfant, le psychiatre, est lui-même… l’un de ces morts qui
ignore qu’il est mort, et avec lequel seul l’enfant pouvait communiquer. Il
fau(drai)t revoir le film pour réinterpréter chaque séquence armé de cette
nouvelle perspective. Cette comparaison fait bien sûr allusion à l’avant-der-
nière proposition du Tractatus (6. 54): «Mes propositions sont éclairantes
en ceci que celui qui me comprend les reconnaît à la fin comme dépourvues
de sens (…), lorsque par leur moyen – ou à travers elles – il les a surmontées
(il doit pour ainsi dire jeter l’échelle après y être monté)».
Cette remarquable métaphore philosophique de l’échelle s’applique donc
à l’ensemble des propositions précédentes, qui doivent être reconnues à la
fin pour «sinnlos» et cependant «éclairantes». Comment des propositions
dénuées de sens peuvent-elles être éclairantes? Cette question vaut pour la
première proposition: «Die Welt ist alles, was der Fall ist» (Le monde est
tout ce qui est le cas). Selon le mode de lecture indiqué au § 6.54, cette pro-
position doit-elle apparaître finalement comme dépourvue de sens, et pour-
tant comme éclairante dans le moment même où nous la comprenons
comme dépourvue de sens?
Archives de Philosophie 79, 2016, 121-134
* jean-claude.monod@ens.fr
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 105.158.204.130 - 07/01/2020 23:05 - © Centre Sèvres
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 105.158.204.130 - 07/01/2020 23:05 - © Centre Sèvres

On parle parfois d’«auto-réfutation» pour le Tractatus, mais cette expres-
sion ne rend pas justice à la démarche. Blumenberg l’a plusieurs fois appro-
chée, comme on va le voir, en s’attachant plutôt à certaines expressions et
réflexions de Wittgenstein, dans le Tractatus et autour du Tractatus, sur la
limite (Grenze), sur un travail de délimitation de l’expression de l’intérieur
de l’expression. Wittgenstein a indiqué dans une lettre que le Tractatus était
une œuvre philosophique et en même temps littéraire. Ce serait une œuvre
dont on ne peut pas détacher et paraphraser «sans perte» des propositions,
dont on ne peut séparer le propos de la composition et de la «frappe» de
l’expression. De ce fait, la tâche d’écrire une préface, dont Bertrand Russell
s’est acquittée pour faire connaître cette œuvre de son étudiant dont le génie
ne faisait à ses yeux aucun doute, était sans doute une tâche impossible. Dans
cette préface, Russell présentait comme «la thèse essentielle» du livre l’idée
suivante: «il est impossible de dire quoi que ce soit au sujet du monde consi-
déré comme un tout, de telle sorte que tout ce que l’on pourra dire concer-
nera des portions limitées du monde
1
».
Wittgenstein, on le sait, n’appréciait pas du tout cette préface de Russell –
au point de la qualifier de «mélasse» dans une lettre à Paul Engelmann (jus-
tement peut-être parce qu’il trouvait que c’était une paraphrase éventuelle-
ment fidèle, mais malhabile). Admettons cependant (au moins provisoire-
ment) que cette formulation de la «thèse fondamentale» soit juste, que faire
alors de la proposition «Die Welt ist alles, was der Fall ist »? Elle est évidem-
ment contradictoire avec ladite thèse fondamentale, puisqu’elle porte sur le
monde considéré comme un tout ; mais cette contradiction se justifie et
s’éclaire rétrospectivement: la proposition est un exemple de quelque chose
qu’en toute rigueur «on ne peut dire », c’est-à-dire qui dépasse un certain
régime rigoureux du «dire», au sens d’énoncer des propositions qui ont un
sens, qui décrivent des faits, etc.
L’interrogation se déplace alors: que signifie ce fameux «interdit» final –
septième et dernier Hauptsatz du Tractatus – «Wovon man nicht sprechen
kann, darüber muss man schweigen» (ce dont on ne peut parler, il faut le
taire)? Que signifie la prescription de renoncer à «dire» ce que, pourtant,
on «peut» assurément «dire»? Et comment peut alors «se montrer» ce qui
ne peut se dire, suivant le § 4.1212: «Was gezeigt werden kann, kann nicht
gesagt werden»? La phrase est parfaite dans sa symétrie brisée (brisée par
la différence phonologiquement mince mais sémantiquement décisive entre
gezeigt, montré et gesagt, dit), mais littéralement soulignée par
Wittgenstein qui souligne le double kann central. On perd évidemment cet
1. Bertrand R
USSELL
, préface à Ludwig W
ITTGENSTEIN
, Tractatus logico-philosophicus,
trad. P. Klossowski, Paris, Gallimard (Idées), 1972, p. 24.
122 Jean-Claude Monod
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 105.158.204.130 - 07/01/2020 23:05 - © Centre Sèvres
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 105.158.204.130 - 07/01/2020 23:05 - © Centre Sèvres

effet stylistique en français: «Ce qui peut être montré, ne peut être dit
2
».
Que signifie dès lors l’intention du livre telle que la présente Wittgenstein
dans l’avant-propos? «Ce livre veut en effet tracer une limite à la pensée, ou
plutôt, non pas à la pensée, mais à l’expression des pensées » : une limite au-
delà de laquelle on pourrait croire exprimer quelque chose, alors qu’on n’ex-
primerait en fait que des non-sens?
Ne rien dire du «monde»? Le Tractatus relu par Neurath et Blumenberg
Blumenberg est souvent revenu sur la proposition «die Welt ist alles was
der Fall ist». Il le fait notamment dans le texte «Ausblick auf einer Theorie
der Unbegrifflichkeit», d’abord paru en appendice à l’essai Schiffbruch mit
Zuschauer (Naufrage avec spectateur)
3
. En 2007, différentes variantes beau-
coup plus développées de cet essai ont été publiées sous le titre Theorie der
Unbegrifflichkeit. Certaines parties de ce texte avaient été utilisées par
Blumenberg dans le grand chapitre «Im Fliegenglas» de Höhlenausgänge
consacré à Wittgenstein.
Blumenberg évoque ainsi, dans Theorie der Unbegrifflichkeit, son
embarras par rapport à l’énoncé canonique de Wittgenstein, sur un mode
d’une étonnante précision autobiographique : «le 11 juin 1967, après une
conférence, on me demande de quel droit et suivant quelles règles d’intro-
duction (Einführungsregeln) je m’étais servi de l’expression “monde”. Je
ne pus me servir de la définition wittgensteinienne (“le monde est tout ce
qui est le cas”) parce que je voyais clairement et avec effroi dans quelle dis-
cussion sans fin j’aurais été ainsi entraîné». Blumenberg se demande si son
embarras tenait à une «insuffisance personnelle» – et sans exclure modes-
tement cette possibilité, il note cependant que cet embarras «avait aussi un
fondement dans la chose même
4
». La chose même, c’est-à-dire ici la ques-
tion de savoir comment fournir une définition satisfaisante du monde, et la
question connexe de savoir si en l’absence d’une telle définition nous (du
moins nous, philosophes) n’aurions plus le droit d’utiliser cette expression.
Il est clair que depuis les Paradigmes pour une métaphorologie, au
moins, Blumenberg a récusé l’idée que, d’une part, tout dans le langage doit
pouvoir être strictement défini et déterminé, mais aussi, d’autre part, que
2. Cet exemple suffit à éclairer et à confirmer l’affirmation de Wittgenstein déjà citée selon
laquelle le Tractatus était un livre «philosophique et en même temps littéraire».
3. Puis republié par Anselm Haverkamp dans le volume des écrits esthétiques et métapho-
rologiques.
4. Hans B
LUMENBERG
, Theorie der Unbegrifflichkeit, Francfort, Suhrkamp, 2007, p. 37.
Le monde est... 123
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 105.158.204.130 - 07/01/2020 23:05 - © Centre Sèvres
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 105.158.204.130 - 07/01/2020 23:05 - © Centre Sèvres

la philosophie devrait se fixer pour tâche unique une telle «terminologisa-
tion» définitive (i. e. la thèse que Blumenberg réfère à Descartes, selon
laquelle «tout peut être défini, tout doit être défini»).
Blumenberg s’écarte par là résolument des positions du Cercle de
Vienne, par exemple telles qu’Otto Neurath les formule dans un texte de
1932, «La sociologie dans le physicalisme
5
». «“Monde”, soutient Neurath,
est un terme absent de la langue scientifique
6
». Ce qui est amusant, c’est
que Neurath souligne ce point pour proposer de débaptiser ce qui s’était
d’abord auto-désigné comme «Cercle de Vienne de la conception scienti-
fique du monde », l’idée de wissenschaftliche Weltauffassung étant abon-
damment mise en avant dans les premières publications du Cercle. On se
heurterait alors, dans la perspective de Neurath, à une contradiction ou du
moins à une «équivoque», puisque «monde» est un terme non-scientifique
– il s’agirait plutôt de construire une «science sans vision du monde ».
Neurath doit cependant alors s’écarter de celui qu’il désigne en même temps
comme un des «représentants de la conception scientifique du monde, qui
ont beaucoup contribué à faire reculer la métaphysique et à éliminer les
propositions dépourvues de sens
7
» – Wittgenstein, bien sûr. Neurath s’en
écarte précisément à propos de ces propositions «métaphysiques» que l’on
trouve au début du Tractatus au moins, sur le «monde», et qui devraient
servir d’«échelle» ou d’éclaircissements préalables, selon la proposition 6.54.
Neurath reprend l’image de l’échelle en suggérant que celle-ci, avec sa
méthode de «l’éclaircissement», semble devoir être constamment remise en
place et rejetée, et que ce n’est pas là une bonne méthode: «Cette proposi-
tion [7: «ce dont on ne peut parler, il faut le taire»] semble suggérer que l’on
devrait sans cesse se livrer à une espèce de purification des propositions
dépourvues de sens, c’est-à-dire métaphysiques, que l’on devrait pour ainsi
dire sans cesse réutiliser cette échelle et la rejeter. Ce n’est qu’à l’aide de tels
éclaircissements qui consistent en une succession de mots voués à être ulté-
rieurement reconnus comme dépourvus de sens, que l’on pourrait parvenir
à une langue unitaire» – la langue unitaire de la science, purifiée des élé-
ments métaphysiques. Or Neurath rejette expressément cette méthode :
«nous n’avons pas besoin d’une échelle d’éclaircissement métaphysique
8
».
(Par là, Neurath s’oppose aussi à Schlick qui, s’inspirant de Wittgenstein,
considérait que la philosophie gardait une fonction dans le programme néo-
5. Otto N
EURATH
, «La sociologie dans le physicalisme», trad. par R. de Calan in Christian
Bonnet & Pierre Wagner éd., L’âge d’or de l’empirisme logique, Paris, Gallimard (Bibliothèque
de philosophie).
6. Ibid., p. 264.
7. Ibid., p. 266.
8. Ibid., p. 266-267.
124 Jean-Claude Monod
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 105.158.204.130 - 07/01/2020 23:05 - © Centre Sèvres
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 105.158.204.130 - 07/01/2020 23:05 - © Centre Sèvres
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%