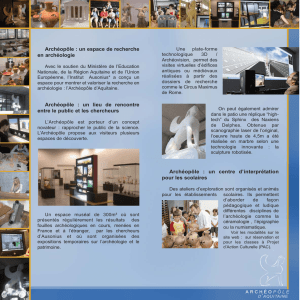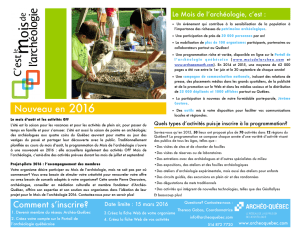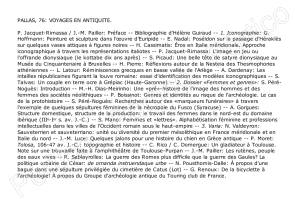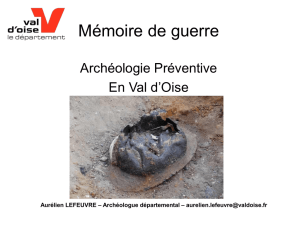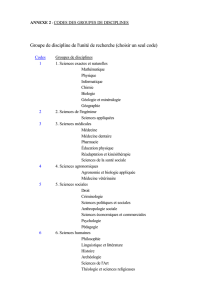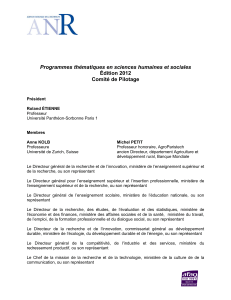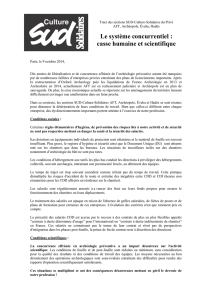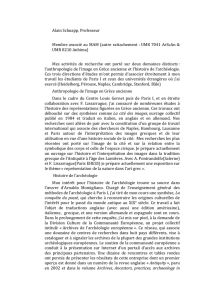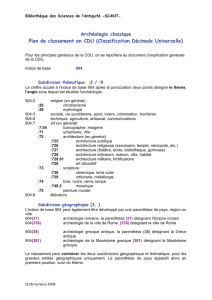Archéologie industrielle: Histoire et développement en France
Telechargé par
FD ABADM

Revue d'histoire des sciences
A propos de l'archéologie industrielle
M Jacques Payen
Citer ce document / Cite this document :
Payen Jacques. A propos de l'archéologie industrielle. In: Revue d'histoire des sciences, tome 35, n°2, 1982. pp. 158-162;
doi : https://doi.org/10.3406/rhs.1982.1822
https://www.persee.fr/doc/rhs_0151-4105_1982_num_35_2_1822
Fichier pdf généré le 08/04/2018

A
propos
de
l'archéologie
industrielle*
L'archéologie
industrielle
est
née
en
Angleterre
il
y
a
une
vingtaine
d'années
;
elle
a
pris
dans
ce
pays
l'ampleur
d'un
véritable
mouvement
populaire.
Son
objectif
est
avant
tout
le
recensement
des
témoignages
matériels
(présents
ou
connus
par
des
documents)
des
deux
ou
trois
derniers
siècles
d'activité
productrice
:
sites
de
hauts
fourneaux,
forges,
manufactures,
usines,
chevalement
de
mines,
ponts,
équipements
de
canaux
sont
autant
de
monuments
dotés
souvent
d'un
puissant
pouvoir évocateur
et
représentatifs
d'une
part
trop
mal
connue
de
l'histoire
nationale.
L'archéologie
industrielle
élargit
la
notion
de
patrimoine
culturel,
elle
y
introduit
de
nouveaux
objets
de
curiosité
et
de
contemplation
non
moins
du
reste
que
de
recherche.
Ces
objets
nouveaux
commencent
à
s'insérer
dans la
trame
des
monuments
historiques
traditionnels
et
l'archéologie
industrielle
cherche
également,
si
c'est
encore
possible,
à
en
assurer
la
sauvegarde
et
la
réhabilitation.
Cette
nouvelle
discipline
historique
a
pris
maintenant
un
bon
départ
en
France,
le
fait
est
avéré.
Peut-être
certaines
personnes
s'attardent-elles
encore
à
chercher
des
définitions
ou
à
édifier
des
théories.
Mais
fort
heureusement
le
nombre
de
plus
en
plus
élevé
de
gens
qui
pratiquent
l'archéologie
industrielle
n'ont
jamais
eu
à
se
poser
d'aussi
délicates
questions.
Le
mouvement
n'a
démarré
dans
notre
pays
qu'avec
une
certaine
lenteur.
La
belle
exposition
organisée
par
Vincent
Grenier
au
Pavillon
de
Marsan
dans
le
cadre
du
cci
«
Usine,
travail
et
architecture
»
remonte
*
Les
bâtiments
à
usage
industriel
aux
XVIIIe
et
XIXe
siècles
en
France
(par
Claudine
Fontanon,
Gérard
Jigaudon,
Dominique
Larroque,
Madeleine
Maille-
bouis,
sous
la
direction
de
Maurice
Daumas),
Paris,
cdht,
1978,
24
x
15
cm,
436
p.
188
phot,
48
pi.
—
L'archéologie
industrielle
en
France
(Bulletin
de
liaison
de
la
section
d'archéologie
industrielle
du
cdht).
Publication
sans
périodicité
régulière
;
diffusion
non
commerciale.
7
numéros
publiés
de
mars
1976
à
décembre
1980.
—
Colloque
d'archéologie
industrielle,
in
Comptes
rendus
du
CFVe
Congrès
national
des
Sociétés
savantes,
Bordeaux,
1919.
Section
des
Sciences,
fasc.
V,
Paris,
1979,
15,5
x
24
cm,
216
p.
—
Histoire
des
sciences
et
des
techniques.
Colloque
d'archéologie
industrielle,
in
Comptes
rendus
du
CVe
Congrès
national
des
Sociétés
savantes,
Caen,
1980,
Section
des
Sciences,
fasc
V,
Paris,
1980,
15,5
x
24
cm,
328
p.
—
Maurice
Daumas,
L'archéologie
industrielle
en
France,
Paris,
Robert
Laffont,
1980,
16
x
25
cm,
464
p.,
nombr.
phot.
(Coll.
«
Les
hommes
et
l'histoire
»).
—
«
L'archéologie
industrielle
».
Dossier
établi
par
Jacques
Payen.
Textes
et
Documents
pour
la
classe,
n°
263,
28
mai
1981,
p.
3-8
et
25-32,
phot,
couleurs
(Centre
national
de
Documentation
pédagogique,
Promotion
et
Diffusion,
29,
rue
d'Ulm,
75320
Paris
Cedex
05).
Rev.
Hist.
Set.,
1982,
xxxv/2

A
propos
de
V
archéologie
industrielle
159
déjà
à
1973.
Malheureusement
le
cci
n'a
pas
cru
devoir
profiter
de
l'occasion
pour
mettre
en
place
un
organisme stable
consacré
à
l'archéologie
industrielle,
chose
qui
aurait
pu
se
concevoir.
Un
peu
plus
tard,
en
janvier
1975,
le
Centre
de
Documentation
d'Histoire
des
Techniques
obtenait
une
aide
financière
du
Comité
de
la
Recherche
et
du
Développement
en
Architecture
(corda), dépendant
de
la
Direction
de
l'architecture
(Secrétariat
d'Etat
à
la
Culture),
pour
une
recherche
dirigée
par
Maurice
Damnas
sur
«
l'évolution de l'architecture
en
France depuis
les
manufactures
royales
à
l'époque
de
Colbert
jusqu'aux
usines
du
début
de
la
seconde
révolution
industrielle
».
L'aboutissement
en
fut
la
publication
du
rapport
de
1978.
Mais
aucune
enquête
systématique
n'ayant
alors
été
effectuée
en
France
dans
ce
domaine,
sa
phase
essentielle
consista
dans
la
réunion
d'informations
sur
les
bâtiments
industriels
pendant
la
période
définie
et
dans la
constitution
d'un
fichier
de
documents
descriptifs.
De
là
le
déclenchement
d'une
sorte
de
réaction
en
chaîne
:
l'enquête
fut
lancée
sous
forme
d'une
diffusion
de
formules
imprimées
;
ses
résultats
ayant
été
très
positifs,
un
réseau
de
correspondants
se
trouva
ipso
facto
constitué.
Dès
le
début de
1976,
l'idée d'un
bulletin
de
liaison
avait
pris
corps
et
en mars
de
cette
année
le
premier
numéro
de
L'archéologie
industrielle
en
France
fut
diffusé.
Simple
fascicule
réalisé
«
avec
les
moyens
du
bord
»,
ce
bulletin
est
aujourd'hui
à
son
numéro
7.
Nous
espérons
que
la
publication
pourra
continuer
sous
une
forme
si
possible
élargie
et
régularisée.
Le
rapport
de
1978,
pour
en
revenir
à
lui,
est
donc
une
publication
de
fin
de
recherche,
basée
sur
l'essentiel
de
la
documentation
recueillie
au
cours
de
l'enquête.
Une
demi-douzaine
d'aspects caractéristiques
du
sujet
y
sont
dégagés
:
I
:
La
pérennité
des
structures
fonctionnelles
(les
forges,
les
autres
établissements
traditionnels,
les
logements
ouvriers
aux
hautes
époques,
les
grands
établissements
industriels
du
xcc
siècle,
architecture
de
transition
dans la
métallurgie,
bâtiments
des
autres
types
d'activité).
—
II
:
L'influence
régionale.
—
III
:
L'emploi
du
métal
dans
les
bâtiments
à
usage
industriels.
—
-
IV
:
L'autonomie
d'architecture
d'éléments
d'ensembles
industriels
(fours
à
chaux
et
haut
fourneaux,
cheminées
d'usine).
—
V
:
Typologie
d'ensembles
particuliers
(chevalements
et
équipements
au
jour
des
houillères,
manufactures
de
soie,
des
moulins
de
marée
aux
moulins
industriels).
—
IV
:
Le
monumental
et
l'ornemental
dans
l'architecture
industrielle.
Il
est
évident
qu'un
semblable
rapport
ne
pouvait
faire
un
usage
exhaustif
des
dossiers
documentaires
constitués
lors
de
l'enquête.
On
a
seulement
fait
état
des
cas
les
plus
typiques
pour
étayer
d'exemples
la
structure
provisoire
ainsi
dégagée.
Mais,
et
c'est
cela
le
fait
important,
le
cadre de classement
mis
en
place
à
cette
occasion
est
conservé
de
façon
définitive
par
le
cdht
et
ce
cadre
est
ouvert
:
c'est-à-dire
qu'il
ne

160
Jacques
Pay
en
cesse
de
s'enrichir
de nouveaux
renseignements.
Il
ne
s'agit
pas
de
chercher
à
constituer
un
fichier
exhaustif,
ce
qui
est
probablement
impossible
à
l'échelon national.
Mais
le
fonds
documentaire
du
cdht
constitue
un
canevas
de
départ
pour
les
spécialistes
menant
une
enquête
régionale
de
caractère
approfondi
et
c'est
en
ce
sens
qu'il
est
le
plus
fréquemment
consulté.
Au
moment
même
où
paraissait
le
rapport
de
1978,
plusieurs
groupes
et
collectivités
qui
avaient
été
amenés
par
des
voies
différentes
à
l'archéologie
industrielle se
rapprochèrent
et
prirent
une
décision
expresse
de
collaboration.
Ainsi
se
constitua
un
groupe
initial
comprenant
le
Centre
de
Recherches historiques
de
l'Ecole
des
Hautes
Etudes
en
Sciences
sociales
(ehess),
le
Centre
de Documentation
d'Histoire
des
Techniques
(cnam-ehss),
l'Association
pour
l'Histoire
matérielle
de
la
Civilisation
industrielle,
l'Ecomusée
de
la
communauté
urbaine
Le
Creusot-Montceau-les-
Mines
et
l'Institut
de
l'entreprise.
Le
groupe
prit
pour
dénomination
le
sigle
силе,
contraction
de
:
Comité
d'information
et
de
liaison
pour
l'étude
du
patrimoine
et
de
l'archéologie
industrielle.
Un
peu
plus
tard
le
спас
s'est
constitué
en
une
association
déclarée
dont
le
président
actuel
est
M.
Yves
Malecot,
ancien
directeur
de
la
Caisse
nationale
des
Monuments
historiques.
Son
siège
social
est
48,
rue
Saint-Lambert,
75015
Paris
(tél.
:
532-24-94
;
533-72-60).
C'est
au
ciLAC
qu'a
été
confiée
au
niveau
national
l'organisation
de
icciH
81,
quatrième
conférence
internationale
pour
l'étude
et
la
mise
en
valeur
du
patrimoine
industriel
qui
a
eu
lieu
dans
notre
pays
du
14
au
20
septembre
1981.
L'intérêt
pour
l'archéologie
industrielle
s'est
également
manifesté
au
sein de
la
Commission
d'histoire
des
sciences
et
des
techniques
du
Comité
des
Travaux
historiques
et
scientifiques
(eras).
En
ce
sens
trois
colloques
d'archéologie
industrielle
ont
eu
lieu
dans
le
cadre
des
ciV,
cv"
et
evr
Congrès
nationaux
des
Sociétés
savantes,
à
Bordeaux
en
1979,
à
Caen
en
1980
et
à
Perpignan
en
1981.
Les
actes
des
deux
premiers
de ces
colloques
ont
déjà
été
publiés
et
renferment
les
communications
suivantes
:
COLLOQUE
DE
BORDEAUX
(1979).
Ph.
Bruneau
et
P.-Y.
Balut,
La
place
de
l'archéologie
industrielle
dans
l'archéologie
du
monde
moderne.
La
recherche
en
archéologie
industrielle
:
P.-C.
Guiollard,
Les
sièges
d'extraction
des
mines
de
Carmaux
(Tarn).
—
P.
Daniou,
Quelques
aspects
de
l'ancien
artisanat de
la
céramique dans
les
Landes
du
sud
de
la
Charente.
—
A.
Joubert,
Fours
à
chaux
et
tuileries
en
Anjou.
—
J.
Cubelier
de
Beynac,
Installations
industrielles
métallurgiques
des
vallées
du

A
propos
de
V
archéologie
industrielle
161
Vimont,
du
Manaurie,
de
la Beune
et
du
ruisseau du
Bugue.
—
J.
Pinard,
Les
bâtiments
industriels
de
l'ancien
Arsenal
de
Rochefort.
La
sauvegarde,
la
rénovation
et
la
réutilisation
des
sites
anciens
:
R.
Colas,
Les
forges
royales
de
La
Chaussade
à
Guérigny
(Nièvre).
—
G.
Beigbeder,
Le
bilan
d'une
décennie
de préservation de
chemins
de
fer
secondaires.
—
Ph.
Damay,
Sur
la
réutilisation
des
forges
et
fourneaux
du
Châtillonnais
et
leur
sauvegarde.
—
D.
Hays,
L'atelier
de
produits
résineux
Jacques
et
Louis
Vidal
à
Luxey
(Landes).
—
J.-P.
Beney,
Les
forges
de
Savignac-Lédrier
(Dordogne).
—
A.
Joubert,
Le
patrimoine
industriel
dans
le
parc
naturel
régional
de
Brotonne.
—
H.
Masurel
et
P.
Bourty,
L'écluse
à
ascenseur
des
Fontinettes
(Arques,
Pas-de-Calais).
Le
contenu
scientifique
de
l'archéologie
industrielle
et
ses
liens
avec
l'histoire
économique
et
sociale
:
J.-F.
Belhoste
et
J.-M.
Chaplain,
Les
manufactures
textiles
à
Louviers
de
1680
à
1830
:
architectures
traditionnelles
et
Révolution
industrielle.
—
S.
Chassagne,
La
création
du
grand
bâtiment
de
la
manufacture
d'Oberkampf
à
Jouy
en
1792.
—
J.-P.
Poisson,
Archéologie
industrielle
et
actes
notariés.
—
M.
Steiner,
Découverte
d'une
industrie
sidérurgique
de
type
archaïque
à
Lajoux
(Suisse,
canton
du
Jura).
—
Ph.
Duboy,
La
création
d'un
paysage
productif
en
Bretagne
au
xix"
siècle.
—
J.-C.
Garcias
et
J.-J.
Treuttel,
Elargissement
du
patrimoine
industriel.
Evolution
du
concept
de
monument
historique.
—
J.-C.
Garcias
et
J.-J.
Treuttel,
Quelle
conservation
pour
les
édifices
ferroviaires
de
la
fin
du
xix*
siècle?
COLLOQUE
DE
CAEN
(1980).
Histoire
des
techniques
:
L.-C.
Courtois,
Etude
des
techniques
anciennes
et
recherches
sur
l'altération
des
céramiques. —
M.
Marchai-Jacob
et
P.
Priest,
Contribution
à
l'étude
de
la
composition
des
mortiers
du
Moyen
Age
par
activation
neutronique.
—
P.
Gourdin,
Un
précurseur
oublié
de
la
chimie
des
ciments,
Denis
Bernard
Quatremère
d'Isjonval
(1754-1830).
—
J.
Michel
et
A.
Samba,
Archives
et
fonds
ancien de
l'Ecole
nationale
des
Ponts
et
Chaussées.
Une
source
documentaire
à
découvrir.
—
A.
Fage,
Histoire
et
évolution
de
la
photographie.
—
A.
Poupée,
Moulins
à
blé
à
roue
horizontale.
Localisation
en
France
en
1809.
—
J.
Payen,
Aspects
de
la
mécanisation
de
l'industrie
en
France
au
milieu
du
xix"
siècle.
La
recherche
en
archéologie
industrielle
:
M.
Damnas, L'archéologie
industrielle
dans
le
courant
de
recherches
sur
le
patrimoine
industriel.
—
M.
Aubrun,
Présentation
d'une
exposition
sur
les
industries
disparues
du
pays
chauvinois.
—
H.
Letouzey
et
B.
Edeine,
L'ancienne
filature
de
laine
de
Tinchebray
(Orne).
—
J.
Pinard,
L'ancienne
fonderie
royale
de
Ruelle
(Charente)
et
ses
transformations.
Des
projets
aux
réalisations
des
xviir
et
xix*
siècles.
BHS
6
 6
6
1
/
6
100%