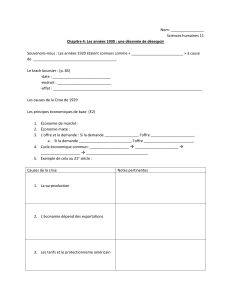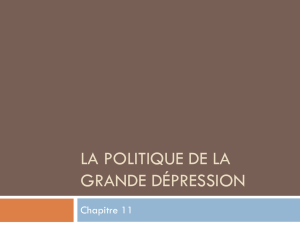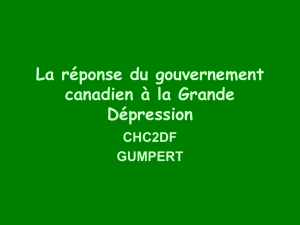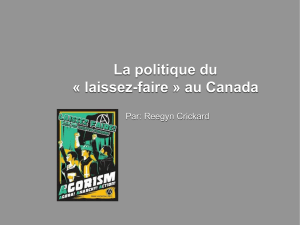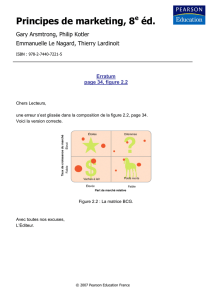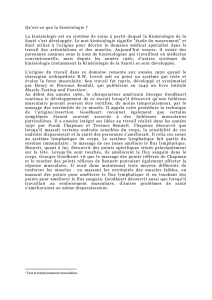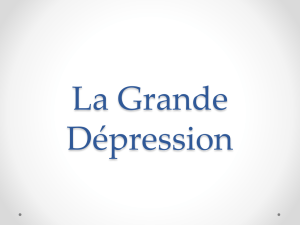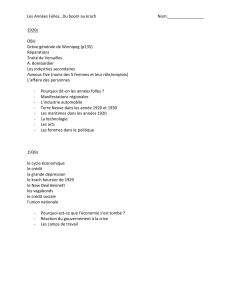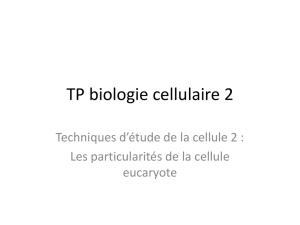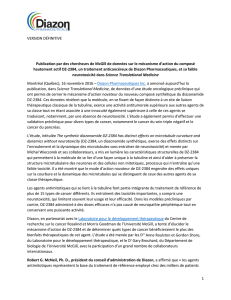QPRN Coin Recherche Juin 2009

«Le job d’un oncologue qui administre
une chimiothérapie, c’est d’amener
son patient aussi proche de la mort
que possible, sans pour autant le
tuer. Le médecin sait pertinemment
qu’en s’attaquant à la tumeur, il va
rendre son patient très malade :
chambouler son système digestif,
faire tomber ses cheveux, miner son
système immunitaire. Il doit fermer les
yeux sur ces effets secondaires.
C’est terrible, mais c’est exactement
ce que tout bon oncologue doit faire.»
Après tout, la plupart de ces effets
secondaires ne sont que temporaires,
poursuit Gary Bennett, professeur à
l’Université McGill et titulaire de la
Chaire de recherche du Canada en
contrôle de la douleur. Une fois la
chimio terminée, les systèmes diges-
tifs et immunitaires reprennent leurs
droits et les cheveux finissent par
repousser.
Le hic, c’est que certains effets
secondaires refusent obstinément
de disparaître avec le temps. Nombre
de survivants du cancer restent aux
prises avec des douleurs neu-
ropathiques pour le restant de leurs
jours. Un fléau auquel Gary Bennett
rêve de mettre fin.
Une douleur irréversible
Les quatre grandes classes de
médicaments utilisées en chimio-
thérapie — les taxanes (qui compren-
nent entre autres le paclitaxel), les
vinca-alcaloïdes (comme la vin-
cristine), les inhibiteurs du protéa-
some (dont le bortezomib) ainsi que
les agents à base de platine (comme
l’oxaliplatine) – endommagent les
nerfs du système nerveux
périphérique. Ils attaquent plus spéci-
fiquement les axones, ces longs pro-
longements des cellules nerveuses
qui conduisent l’influx nerveux du bout
des doigts ou des orteils jusqu’à la
moelle épinière.
Les dommages causés aux nerfs et
les douleurs qu’ils provoquent sont si
sévères qu’ils limitent la dose de
chimiothérapie que l’on peut admin-
istrer à un patient. «Très souvent, les
oncologues voient la tumeur se
réduire au fil des traitements, mais
sont forcés d’arrêter la thérapie», se
désole Gary Bennett.
Une fois les patients exposés à la
douleur neuropathique, impossible de
revenir en arrière. Même après des
mois de repos, les douleurs restent
vives. Ces patients ne pourront jamais
subir un autre traitement chimio-
thérapeutique.
Les rats pour modèles
Gary Bennett était déjà réputé dans le
domaine de la recherche sur la
douleur quand il a décidé de s’atta-
quer au problème. En 1987, alors
qu’il était chercheur au National
Institutes of Health des États-Unis, il
avait réussi à reproduire chez le rat
les douleurs neuropathiques qui affli-
gent certains humains à la suite de
blessures. Ce modèle animal, qui a
ouvert la voie à tout un champ de
recherche, est connu mondialement
sous le nom de «modèle de Bennett».
Une dizaine d’années plus tard, alors
qu’il était professeur à l’université
Hahnemann de Philadelphie, Gary
Bennett a répété l’exploit avec son
étudiante au doctorat Rosemary
Polomano. «Rosemary était infirmière
spécialisée en oncologie, se rappelle-
t-il. Elle connaissait les douleurs avec
lesquelles luttaient les patients can-
céreux. Pour explorer des pistes de
solution, elle voulait créer un modèle
animal qui reproduirait la pathologie.»
Mission accomplie ! Les deux
chercheurs ont découvert qu’en
administrant de très faibles doses de
paclitaxel à des rats, ils pouvaient
provoquer chez l’animal les mêmes
symptômes que ceux observés chez
les humains. Une fois à l’Université
McGill, Gary Bennett a obtenu des
résultats similaires en administrant
aux rats deux autres agents
chimithérapeutiques : la vincristine et
la l’oxaliplatine. Restait le gros du
boulot : expliquer comment les
médicaments endommagent les
axones et envisager comment
prévenir les dommages.
Une fausse piste
On sait que les agents chimio-
thérapeutiques agissent en prévenant
la division des cellules tumorales.
Plus spécifiquement, les molécules
médicamenteuses s’attachent aux
microtubules du fuseau mitotique.
Plus spécifiquement aux protéines
beta-tubulines, qui sont à la base des
Quand la
c h i m i o t h é r a p i e
laisse des
s é q u e l l e s

microtubules «Ce fuseau apparaît
lorsque la cellule est sur le point de se
d i v i s e r, explique le professeur
Bennett. Il s’assure en quelque sorte
que chaque cellule ‘fille’ sur le point
de naître reçoive le bagage génétique
qui lui est nécessaire. Une fois la
tâche accomplie, le fuseau mitotique
disparaît.» Les agents chimio-
thérapeutiques, en se liant aux micro-
tubules, nuisent à ce travail et
empêchent les cellules cancéreuses
(parmi d’autres) de se diviser nor-
malement.
La communauté scientifique croyait
avoir fait une percée importante il y a
quelques années, en montrant que les
axones des cellules nerveuses étaient
aussi équipés de micro-
tubules. Non pas pour la
division cellulaire. Les
cellules nerveuses, après
tout, ne se divisent pas.
«Dans les axones, les
microtubules agissent
plutôt comme un chemin
de fer, précise Gary
Bennett. Ils permettent le
transport de molécules
entre le système nerveux
central et les extrémités
des axones.»
Les chercheurs ont
déduit que les agents
c h i m i o t h é r a p e u t i q u e s
devaient s’attacher aux protéines
beta-tubulines des microtubules des
axones et nuire à leur opération.
D’où l’apparition des douleurs neu-
ropathiques. La théorie semblait par-
faitement plausible… jusqu’à ce que
Gary Bennett démontre le contraire.
Les mitochondries sous la loupe
À l’aide d’un microscope électron-
ique, l’étudiante postdoctorale Sarah
Flatters a photographié des coupes
transversales de nerfs de rats qui
souffraient de neuropathie induite par
la chimiothérapie. Avec un facteur de
grossissement de 30 000x, l’équipe a
assemblé une image de plus de 2
mètres carrés montrant tout le nerf. À
genou sur la photo placée sur le sol
du laboratoire de McGill, Sarah
Flatters a compté un à un les axones.
«Tous étaient en vie est semblaient
parfaitement normaux», raconte Gary
Bennett.
Sur une autre image, dont le facteur
de grossissement était cette fois de
44 000x, l’étudiante a toutefois fait un
constat marquant. Les mitochondries
présentes par milliers à l’intérieur des
axones étaient enflées. Plusieurs
étaient même trouées de vacuoles.
«Les mitochondries sont respons-
ables de la fabrication de l’énergie à
l’intérieur des cellules, rappelle le pro-
fesseur. Elles prennent les sucres et
les graisses, les brûlent et fabriquent
de l’adénosine triphosphate (AT P ) ,
une molécule qui fournit l’énergie à
toutes les cellules du corps humain.»
En fouillant dans la littérature, l’équipe
de McGill a découvert un article expli-
quant que de la beta-tubuline (la pro-
téine qui sert de base à la fabrication
de microtubules) se trouvait à la sur-
face des mitochondries. Elle servirait
à ouvrir et fermer un canal ionique
responsable du passage de molé-
cules à travers la membrane du mito-
chondrie.
Le chercheur croit que lorsque les
agents chimiothérapeutiques se lient
à cette beta-tubuline, la porte reste
constamment ouverte. La production
d’ATP est déstabilisée. En outre, les
mitochondries se gonflent peu à peu.
Prévenir les dommages
Le professeur Bennett étudie présen-
tement deux médicaments qui, il l’e-
spère, pourraient aider à tenir la
«porte» fermée : l’acetyl-L-carnitin et
le Trophos 19622. Des essais prélim-
inaires chez les rats ont montré que
dans les deux cas, on pouvait renvers-
er les dommages causés par les
agents chimiothérapeutiques et
soulager la douleur. En donnant les
molécules avant l’administration de la
chimiothérapie, il semble
qu’on puisse même
prévenir les dégâts.
Reste à savoir si les
deux molécules pour-
raient nuire au traite-
ment chimiothérapeu-
tique. «C’est la grande
question. Si on pro-
tège les cellules
nerveuses, mais que
du même coup, on
favorise la multiplica-
tion des cellules can-
céreuses, on aura raté
la cible. Pour l’instant,
nous avons quelques
indices prometteurs pour le Trophos.
Ça reste à confirmer.»
Ces résultats suscitent-ils de l’espoir
chez les oncologues? «C’est encore
trop tôt, répond Gary Bennett. Mais si
nos prochains travaux sont conclu-
ants, c’est certain qu’ils seront
intéressés. Surtout si ça leur permet
d’augmenter la dose de chimio-
thérapie administrée à leurs patients.
Si on peut prévenir les neuropathies,
ce sera un pas de géant vers des
traitements plus efficaces.»
Le RQRD est l'un des réseaux
de recherches financés par
Auteur: Dominique Forget
Conception: Solutions Ink
©iStockphoto.com/drliwa
1
/
2
100%