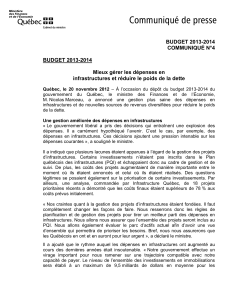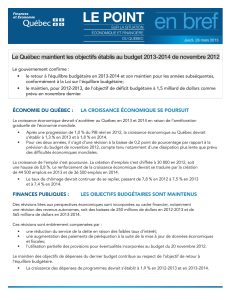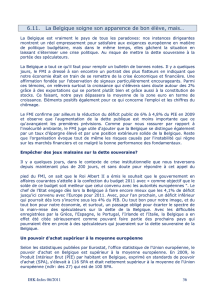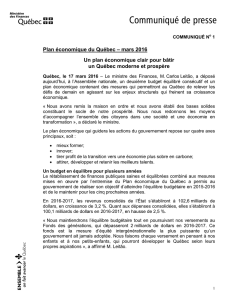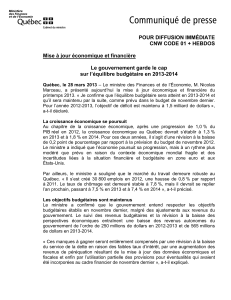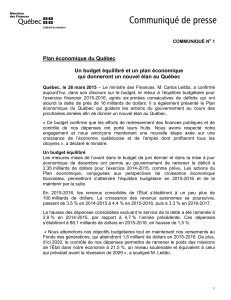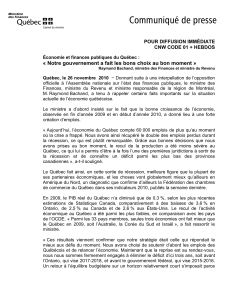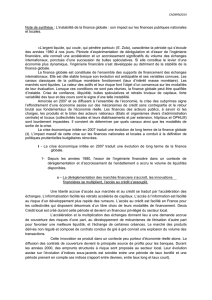texte-developpement-mis-en-forme

DEVELOPPEMENT, MONDIALISATION ET CRISE DU DEVELOPPEMENT
Extraits des Dossiers de la Documentation française (site web)
Introduction
L'indicateur de développement humain en 2001 : l'IDH, calculé par les Nations unies, permet de mesurer les
inégalités de développement.
Au cours de la dernière décennie, l'insertion des pays du Sud dans la mondialisation a dû faire face aux
crises financières, au fardeau grandissant de la dette extérieure et à la paupérisation des populations dans
les pays les moins développés. Premiers financiers du monde "en développement", la Banque mondiale et
le Fonds monétaire international sont parfois accusés d'être responsables des échecs du développement.
Prenant acte de ces échecs, de nouvelles stratégies de développement émergent, axées notamment sur la
lutte contre la pauvreté.
Que reste-t-il de la division du monde Nord-Sud et Est-Ouest telle qu'elle se présentait dans les années 80 ?
La fin de l'antagonisme Est-Ouest, l'irruption des pays émergents dans les relations économiques
internationales, l'aggravation de la situation des pays les plus pauvres ont changé la donne. De
considérables écarts de développement différencient aujourd'hui les pays qualifiés auparavant de "sous-
développés."
Dans le même temps, le système international se caractérise par une forte aggravation des inégalités : un
des problèmes cruciaux, selon Amartya Sen, prix Nobel d'économie 1998, est celui du partage des bénéfices
potentiels de la mondialisation, entre pays riches et pauvres, mais aussi entre les divers groupes humains à
l'intérieur des nations.
Les institutions financières internationales, Banque mondiale et FMI sont au cœur de ces contradictions.
Crises financières mettant à mal l'othodoxie financière, dette pharaonique de certains pays, crise de l'aide,
difficultés économiques des pays industrialisés revoyant leur aide publique au développement à la baisse,

les années 2000 voient les pays du Sud confrontés à de nouveaux bouleversements nés de la
mondialisation.
Devant les conséquences souvent dramatiques des plans drastiques d'ajustement structurel mis en place
dans les années 80, les institutions financières internationales ont dû chercher une nouvelle approche
socio-économique, en adoptant notamment une politique de lutte prioritaire contre la pauvreté.
Les politiques du FMI et de la Banque mondiale sont, depuis quelques années, soumises à des critiques, de
la part des réformateurs et des conservateurs, critiques relayées par les organisations non
gouvernementales, mais aussi par les pays émergents, demandeurs de plus en plus insistants de réformes
structurelles.
Nombre de millions de personnes
ayant moins de 1$ par jour pour vivre
Source : Banque mondiale
1990 1999 Evolution
Asie de l'est et
Pacifique
486 279 -42,6%
(Chine non
comprise)
110 57 -48,2%
Europe de l'est et
Asie centrale
624 300,0%
Amérique latine et
Caraïbes
48 57 18,8%
Moyen Orient et
Afrique du nord
5 6 20,0%
Asie du sud 506 488 -3,6%
Afrique
subsaharienne
241 315 30,7%
Total 1402 1226 -12,6%

Développement et mondialisation
Développement et mondialisation : une nouvelle donne
En 1961, l'Assemblée générale des Nations unies lançait la première décennie du développement. Tout
juste sortis de la décolonisation, les nouveaux pays indépendants aspirent à rattraper les pays
industrialisés. Les années 60 concoivent alors le développement comme la transformation de sociétés
traditionnelles en sociétés modernes et industrielles, transposables à l'ensemble du "tiers monde".
La décennie 70 ouvre le débat sur le nouvel ordre économique international mené par les pays non alignés,
revendiquant le partage des bénéfices de la croissance entre les Etats de la planète.
Les crises financières des années 1980 clôturent brutalement cet épisode. Les questions structurelles du
développement disparaissent au profit du règlement de la crise de l'endettement et de la remise en ordre
des finances publiques via les programmes d'ajustement structurel.
On assiste également à une diversification des voies empruntées par les pays du Sud.
L'Asie du Sud-Est s'engage dans la voie d'un développement accéléré, suivie dans les années 90 par la Chine
et l'Inde. L'Amérique latine, doit, quant à elle, gérer de nombreuses crises financières, pendant que
l'Afrique reste à l'écart du développement mondial.
En réponse aux crises financières, la fin des années 80 voit le triomphe des théories économiques
formalisées dans le Consensus de Washington, et approuvées par les deux institutions financières
internationales.
Le libéralisme prend le pas sur les voix revendicatives des forums des Nations unies telles la CNUCED
(Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement), qui se retrouvent, de fait,
marginalisés.
A partir de 1995, on assiste à une montée en puissance des instances économiques internationales, avec
l'avènement de l'Organisation mondiale du commerce, et la consécration du "directoire mondial" : Groupe
des Sept (G7), FMI, Banque mondiale, OMC...
La seconde vague des crises financières de la fin des années 90 va conduire à une remise en cause du
Consensus de Washington.
Le libéralisme, présenté comme une alternative aux théories du développement basées sur aide publique
et protectionnisme, a montré ses limites dans les différentes crises de la décennie.
Le déclenchement de la crise asiatique en 1997, la stagnation du continent sud-américain, la catastrophe
argentine en 2001, et la dérive des pays les moins avancés (PMA) conduisent à repenser la question du
développement.
La notion même de développement a implosé, laissant la place au développement humain, au
développement durable, au microdéveloppement.
A partir de 2007, le système financier international traverse une des plus graves crises depuis 1929.
L'internationalisation de la crise des crédits immobiliers américains à risque ("subprime mortgages")
entraine une forte baisse des grandes bourses mondiales dès l'été 2007, puis provoque, à partir de la faillite
de la banque américaine Lehman Brothers le 14 septembre 2008, une crise financière majeure qui affecte
l'ensemble de la planète.
Quel développement ? Du développement humain au développement durable
Les deux dernières décennies ont été caractérisées par une réorientation fondamentale de la théorie et de
la pratique en matière de développement.

Développement humain : repenser le développement
Les années 90 : une décennie perdue pour le développement ?
C'est la conclusion du PNUD (Programme des Nations unies pour le développement), dans son Rapport
2003 sur le développement humain.
Le monde est confronté à une grave crise du développement, caractérisée par des reculs socio-
économiques substantiels et durables dans de nombreux pays pauvres.
Afin de mesurer le développement tant social qu'économique, le PNUD a élaboré en 1990 un nouvel outil
de mesure du développement, l'Indicateur de développement humain (IDH), qui prend en compte , en plus
du PIB (produit intérieur brut), l'espérance de vie à la naissance, et le niveau d'instruction.
Le Rapport 2003 montre que 21 pays ont accusé un recul au cours des années quatre-vingt-dix. Lors de la
décennie précédente, seuls quatre des pays pris en compte par cet indicateur avaient connu une telle
évolution.
En 2003,
presque tous les pays "à faible développement humain", sont situés en Afrique,
près de la moitié des pays d’Amérique latine et des Caraïbes ont vu leur revenu reculer ou stagner au cours
des années quatre-vingt-dix,
on constate un recul général du développement humain en Europe de l’Est et en Asie centrale.
Imputable à une diminution du revenu par habitant, cette régression est particulièrement marquée en
République de Moldavie, au Tadjikistan, en Ukraine et en Russie.
"Ces régressions sur l'échelle de l'IDH sont très inhabituelles, car les indicateurs de cette nature ont
naturellement tendance à progresser sur la durée", déclare Mark Malloch Brown, administrateur du PNUD.
"Le fait que 21 d'entre eux affichent une baisse, dans certains cas, spectaculaire, sur les années quatre-
vingt-dix montre à quel point il est urgent d'agir pour permettre d'y relever les niveaux de santé,
d'instruction, et aussi de revenu."
1
Les objectifs du Millénaire des Nations unies pour le développement : une nouvelle charte internationale
du développement
Le sommet des Nations unies du Millénaire a repris à son compte la philosophie du PNUD. "Civiliser
l'économie mondialisée ou garantir que la mondialisation devienne une force positive pour tous les peuples
du monde" préconise la Déclaration du Millenaire.
Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), adoptés par les 191 Etats membres des Nations
unies, constituent un agenda ambitieux pour réduire la pauvreté, ainsi que ses causes et manifestations.
En 2004, les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs sont mitigés. Certains pays sont en voie de
réaliser une partie des objectifs, mais aucun des objectifs du Millénaire pour le développement ne devrait
être atteint, au rythme où les progrès sont accomplis à l'heure actuelle au niveau mondial. Les raisons,
nombreuses, comprennent de manière récurrente l'insuffisance et l'inefficacité des dépenses publiques, un
fardeau de la dette écrasant, un accès insuffisant aux marchés dans les pays développés, et une diminution
de l'aide publique au développement.
Développement durable : une remise en cause du développement ?
1
Source PNUD, 2003

La notion de développement durable, lancée par le rapport de la Commission mondiale sur
l'environnement et le développement (dit rapport Brundtland) de 1987, a été généralisée depuis le
Sommet de la terre à Rio en 1992.
Les effets négatifs du développement ont en effet conduits à préconiser un "développement durable",
(sustainable development), au moment où la libéralisation est "l'horizon nécessaire et suffisant" des
politiques économiques.
Les grandes lignes de ce concept ont été définies dans l'Agenda 21, Programme d'action pour le XXIème
siècle adopté à Rio en 1992.
Il s'agit du développement que la planète peut "soutenir" en tenant compte des besoins générés par la
croissance économique et la démographie, cela sans peser sur les générations à venir.
Pourtant, du Sommet de la terre au Sommet de Johannesburg sur le développement durable en 2002, la
situation de la planète n'a fait qu'empirer du point de vue du développement durable : le PNUE,
Programme des Nations unies pour l'environnement lançait un cri d'alarme à la veille de Johannesburg en
septembre 2002. Même si la notion s'est imposée comme un référent commun aux organisations
internationales, aux Etats et aux ONG (organisations non gouvernementales).
Le développement durable a-t-il un sens pour les pays du Sud ?
Il s'organise, en effet, autour de la contradiction entre croissance et préservation de l'environnement. Dans
ce débat, les pays pauvres défendent leur droit à la croissance et soulignent la responsabilité historique des
pays industrialisés dans la dégradation des "biens publics environnementaux". En contrepartie, ils
réclament des ressources supplémentaires en termes d'aide publique (APD), promesses faites lors de la
Conférence de Rio et qui n'ont pas été tenues, bien au contraire, puisque la décennie 9O a vu la baisse de
l'APD.
Quels pays en développement ?
Du tiers monde aux PED (pays en développement), en passant par les PVD (pays en voie de
développement), les termes ne manquent pas pour qualifier cet ensemble qui accueille plus des trois
quarts de la population mondiale.
En 1964, la première Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) voit
l'émergence d'un bloc du Sud avec le Groupe des 77 (qui regroupe 133 pays aujourd'hui), groupe qui
oeuvrera pour un Nouvel ordre économique international (NOEI) au cours des années 60 et 70.
Aujourd'hui les pays en développement constituent un groupe de plus en plus hétérogène : les écarts de
revenu y sont considérables, et la convergence d'intérêts toute relative.
Un groupe de pays hétérogènes
"Le tiers monde du début du XXIème siècle offre une vision contrastée entre, d'une part, des pays
émergents, au sommet de l'échelle en termes de revenus, mais à la merci des fluctuations erratiques des
capitaux privés, donc marqués par le poids de crises financières récurrentes (Asie de l'Est et Amérique
latine émergente surtout), d'autre part, des pays très pauvres au contraire, situés tout en bas de l'échelle
en termes de revenus, (PNB inférieur à 900 dollars par an), qui sont d'autant plus vulnérables qu'ils
dépendent de mono-exportations de matières premières et d'une aide publique au développement de plus
en plus chichement accordée (Afrique subsaharienne surtout). Entre les deux, un ensemple fourre-tout et
hétéroclite de pays dits à revenus intermédiaires regroupe à la fois des pays importateurs de pétrole (Côte
d'Ivoire) et des pays exportateurs (Congo), des pays géants (Nigéria) et des micro-Etats (ceux du Pacifique
par exemple), des pays qui sont sur le point d'entrer dans le clan des pays émergents (Indonésie) et
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%