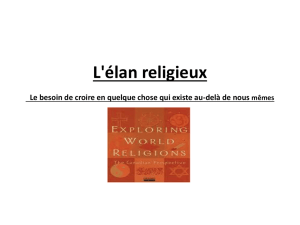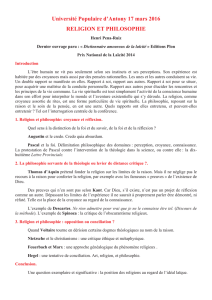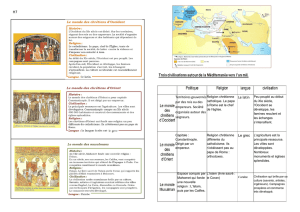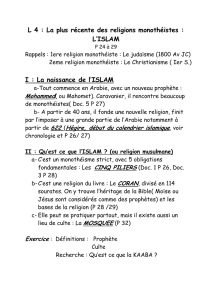Cours sur la religion : Phénoménologie, sacré et philosophie
Telechargé par
Lourdy Louis

LA RE
LIGIO
N
La
religion est
d'abord
un
lien d'
un
ty
pe particulier
(re-
/ego:
attach
er).
Ce
lien
est
manifes
te
dans
la
cérémonie de fondation
d'uni'
ville romaine : un
prêtre
consacré, à l'
aide
d'un
baton
recourbé
(
liluus),
délimi
te
dans le ciel
un
espace
(lemplum)
.
Cet espace co
nstitue
le •
terri
toire consacré •, le
sanctuaire,
pu
is le • temple •.
Le
li
en
est donc
d'abord
étab
li
entre
le ciel
ct
la
te
rre, l'au-delà
et
ici-bas.
Mals
le
lien a
été
senti de
manière
différente comme
pr
écision absolue
et
contr
a
ignante
d'un
rite
auque
l la religion ast
re
int.
La
religion
devient donc,
étymo
logiquement , le • sc
rupu
le religieux •. Un pro-
blème dès lors se
poserait
:
la
religion
permet
-elle
la
créativ
it
t?
Roger Ba.çlide
l'afOrme, en
étud
ia
nt
les réponses diverses à u
ne
même
situ
atio
n. Certai
ns
Afr
icains
au
Brésil résis
te
ront
au
travai
l servile
en
restructurant
le
ur
religion
et
en lui
donnant
une
signification
de
révolte.
D'autres
la
laisser
ont
te
ll
e que
ll
e, et profiteront
de
tout
es
l
es
possibilités d'ascension
qui
l
eur
sont o
tT
ertes. Chaque
indiv
idu
interprète
donc
pour
son
comp
te
la
sy
ntaxe
el
la
sémantique
rcli·
gieuse,
et
donne un sens
au
• lien •.
-1 -
Ph
énomé
nol
og
ie d e
la
re
li
gio
n.
JI
y a
une
expérience religieuse
dont
le
mod
e
d'èlre
est
d'une
part
intuitif
et
affectif,
d'autre
part
existentiel. C'est ce dernier aspect
qui
nous intéresse : quelle
est
la
manière d
'ê
tre
-au-monde de • l
'homo
religiosus •
(M.
Elialie),
quel sens donne-t-il
à
ce
qui
l
'e
n
to
ure, quels
sont
les axes s
tru
cl urels
de
son
comportement?
Nous distinguerons
le
• sacer • ou • sacré •,
et
l
'•
espace-
temps
• religieux.
1 -
Le
sacré.
Antér
ieureme
nt
à
tout
conce
pt,
qu'e
st-ce
que
le
Sacré?
Le
sacré forme couple
auu
le profane.
Le
sacré
est
•
station
de
la
divinité •,
le
profane ,
néant
actif
• :
c'est-à-dire
qu
'
Il
peut
faire
disparattre
le
sacré.
Ce
dernier
est
une énergie
très
volatile, fluide.
très
dangereuse el efllcace. Le
sacré
est
•
tabou
•
(interdit,
en
poly-
nésien), le profane
anoa
•
(libu).
Il
faudra
donc des
rites
précis
d'en
trée
el
de sortie, des sacrifices de purification
et
de désacrali-
sati
on, fonctionnant co
mm
e un sas e
nt
re deux éléments rliiTérents,
pour
que
le sacrt\ et le prorane
aient
des
contacts.

Le
sacré est
à
la fois
pur
el Impur,
saint
~~souillé
(même
mot
dans
plusieurs langues, en grec • agios
•)
.
La
pureté
est
conçue comme
guérison possible, accroissement
de
la vie. L
'impureté
détruit.
Le
cô
té
droit
dans
la
repr
ése
ntation
du
monde
est
associé à
la
pur
et
é,
ln
droiture,
l'adresse (avec les
connota
tions de
clarté,
sécheresse,
al
titude)
. Le côté gauche
est
associé
à
l'Impuret
é
par
la •
ga
u
cherie
•
(avec l
es
connota
ti
ons d'obsc
urité,
h
um
idité, bassesse).
Il
existe
chez l
es
p
rimitif
s une géographie
de
la
puret
é ; le cen
tre
du village
co
mporte
tout
le sacré, l'épau
le
dr
oite
doit ê
tr
e
tournée
vers
lui ;
la gauche vers
la
jungle, source
de
tout
es
les impuretés (Canaques).
On
peul essayer d'expliquer cette bipolurité du sacré en la rappro-
c
hant
de
dichotomi~s
f
ondamen
tales :
la
dichotomie sociale (les
deux
p
hratr
ies avec
chacune
un
totem),
la
dichotomie physio-
logi
que
(les
deux
sexes),
1:1
dichotomie
nntu
œlle (les
deu
x saisons,
été
-hiver).
En
fait ces dil'holomies sont
touj
ours
données ensemble
et
intervienn
ent
(selon les
rites,
les f
êtes,
les événements)
en
pro-
portion
var
iable.
Mai
s un sacré
de
type
parti
culier, le sacré de
J'i
nterdit
(d
u respe
ct)
provient
directement
de la dichotomie
sociale:
on
doit
respecter
les femm
es
de son clan (cxol!nmic
et
prohibition
de l'inceste)
et
ne
chercher femme
que
dans l'
autre
clan
dépendant
d'une
autre
ph
ratrie
(est profane t
out
ce
quj
est
sacré
pour
l'autre
tribu). Cel
ui
qu
i y
rontrevient
est
•
maudit
•.
Cette
règle
permet
l'échange généralisé
(voir
c
hap
itre
Les
f:cbanges), el renforce les
liens
dans
ln
tribu
qui
n'est
pas
originellement
un
e
dans
tous les cas.
En
conséquence
de
ce
sacré
de
l'interdit,
il
y
a
un
's
acré
de
violence
tl
de
lrrmsgression • (R. Caillois). Il
ap
p
aralt
nota
mment
l
ors
de lu
f
ête.
Le
temps
usé
(chrono
..
qui
use)
doit
êt
re remplacé, rajeu
ni.
JI
fnut
revenir
au
tem
ps
de
la création
du
mond
e
par
les • ancê
tr
es •
ou les • dieux •.
JI
en
résulte une
mascarade
(les officiants
ont
par
le
masque
les mêmes pouvoirs de
métamorph
ose que les
ancêtres
;
voir
Carnava
l). De
plu
s
tout
doit
être
inversé
:
li
cences ritueUes,
débauche, pillage,
meurtres
(Brésil
),
unions Incestueuses rituelles.
En conséquence le sacré
est
double, en
deux
s
ens
.
D'une
part
il
est
sa
int
eté
et
souillure,
d'autre
part
inhibition
(Interd
it
)
et
stimu-
lation
(transg
ression), féminin
et
masculin
(pa
r exemple les
tote
ms
sont du côté mat
ernel,
l
es
di
eux
,
du
côté
paternel).
2 -
Espace
et
temp
s
re
ligieux
.
La
religion sous
sa
l
orme
primi-
tive
(sens du sacré)
imprégnait
tout
acte
de
la vie ; nous
ne
pouvons
plus nous en rend
re
compte clairement. Certes
il
y a
encore
pour
nous des • chifTres • (Jaspers), ou élém
ents
du
monde
qui
•
par
l
ent
• ;
mais le monde
n'est
pus
str
uc
turé
sel
on
le
sacré. Au co
ntraire,
à
l
'or
ig
ine,
l'Espace
et
le Temps
sont
saturés
de
sacré, forme
parti-
culière
du
rapport
du
primitif
au
monde. C'est
que
le passage
du
chaos
au
cosmos e
st
l
'acte
même
du
sac
r
é,
et cu
me
me
temps
consiste
en
l'appar
ition des
ordre
s temporels
et
sp
atiaux.
L'
es
pace religieux. Le lieu sacré est
un
pont
entre
Je
ciel
et
la
te
tT
e.
Quelles
que
soient ses fonctions,
il
n'y a
pas
d'
espace homogène
pour
l'homme
religieux. L'espace
présente
des
ruptures
:
un
espace

• tor t •
s'oppo
se
à
un
espace
di
l
u~
rai
ble
: •
il
ne
s'agit
pas
d'un
espa
ce
géomé
trique
. mals
d'u
n
espac
e
existe
nti
el
et
sacré
•
(M.
Hliade).
A -
11
pré~
ente
etes
cmlr<'s
dont
la
répartition
i
mpo~c
la
distri
-
bution
des
ru•
liyités
de
la vie <·ourantc
..
\ insi
tout
sanctuaire,
toute
maison,
est
uu
de ces •
ccn
l
rr
s •.
!.a
métaphy
s
ique
n'est
rien
d'
autre
que
le
désir
de
coïncider
avec ces
ren
tr
es
(vo
ir
ch
apitr
e
La
:\!êta-
phys
i
que).
El
ou
les
retro
u
ye
<lans
la
rlH!it·alisat.ion
ph
il
osophique,
la " rédue
li
on
<l
es
romrncnccmcnts
•.
B-
Cf
emi
r•
t.
<l
un
fJ
O
inl
dël!er{Jil'
rayo
nnant
de
fa
ço
n
ordonn
ée,
s~ lon
les
quatre
ou
s
ix
point
s •
ca
rdinaux
•.
D'où
le
mo
c
li
•l
t>
roma
in
de
to
n
st
ru
rlion
des Yilles cl
dt's
t•a
mps.
C -
Pour
fonda
une
cons
lruclion,
il
faut suuveut
répé
l<'r
les
11CI1
•
.<
fl
t's
ancêtre.~
crlateurs
du
moll(/e
(
danse
du 13arong
dan
s l'lie
de
Bali).
Le
maçon
ind
ien
rëpNe
le
sac
rifi<'e
du
sNpe
nt
(le
chaos)
en p
lantant
nn
pieu
à
l'endroit
où
la
!N
e
du
serp<'nl
~e
trouYail.
D -
Le
ce11
lrP
est
tm
lieu
de
commlllli('(lfion
rwec
Ir
sucré.
T
out
Objet éleY
é:
m
on
t
agne
(du
Décalogue),
po
t
eau
(<
l
e~
Az
untu
). to
tem.
c
:o
l
oune
(d
u
temple
d'.-\n
gkO
I
'),
t
our
(
<l
e
Hahel).
él.'
he
tl
c
(<le:
.Jm·oh),
piliers
qui
so
utiennent
le monde
....
toul
obj
et
élev.;
donc
P~
l
un
pas
sage possible
du
prorane
au
sacré
.
de
la
Terre
au
Ci~l.
Le
temp
.
~
rl'ligieux
.
Il
s'agil
d'un
temr>s
qui
revient.
qui
peul
sc
r
égénérer
pnr
lg rète. ,, Réi
ntégrer
le te
mps
sac
ré
des
origin
t>s,
t"('Sl
!\
Ire le cont
empora
in
des
Dieux
"·
D'où
les
mythes
de l
'éternel
reto
ur
,
et
l
es
cos
mo
gonies
qui
sem
blent
l.'on
s
tl
t
ue
r la
preml~re
préofcu
·
pation
int
ellec
tu
elle
des
primltirs.
f
ondatri
ce
de
la
sodét(!
pour
eux.
L'homm
e relig
it>n
x
vit
donc
dans
un
milieu
satur
é
de
sar
rl'.
Il
-
Philosophi
e
et
religion
: le «
dis
co
ur
s
sur
)J
la
re
ligion.
Le
modèle
théologique
du
dieu
comme
•
point
d
'é
ner
gie infinie
qui
tem
l à
s'exprimer
• est.
étudié
dans
le ch
api
t
re
• la :\l
étap
hy
-
sique
•· On
dira
s
implement
i
ci
que
le
Sacré
.
dan
s son
aspec
t • n
umi
-
nc
ux •
(pu
issance
terr
ibl
e)
.
dev
ie
nt
en
t
an
t
qu'
o
bjet
d'u
ne
pens
ée,
lhéos,
dieu
per
s
onnel
,
log
os
ou
tran
scendance.
Il
re
sle à
voir
k s
rapports
de
la philosophit'
ct
de
la
reli~:~ion
,
et
les
problèmes
du
philosophe
chr
étien
.
1 -
Les
rapports
de
la
p
hiloso
ph
ie
et
de
la
reli
gion.
A
l'
époq
ue
médié
va
le,
la
philosophie
est
so
us la
dépendance
du"
prineipr.
cl'autorité
• :
Arist
ote,
Sain/
Thomas.
so
n t l
es
mall•
·cs à
penser
de
la
scolastique.
La
grande
pr
é
occupation
de
la
philosophie
théolo
-
gique
est
de
fonder
l'existence
de
Dif.'u
en
ra
ison. Nouvf.'au
té
de

celle
entrepr
ise :
d'abord
Il
ue
vient
pas
à
l'Idée du pr
imiti
f
de
t>rouver
\'exislen~e
des
âme~
des
anc
êlr
es,
car
personne
n'en
doute
.
Don<' prouYer l'existence
de
Oieu
ne
convainc
que
celui q
ui
est
déjà
convaln(·u.
D'au
tr
e
part,
il
y
a
co
nt
ra
di
ctio
n entre
la
foi
et
la raison
(-.
fi(/P$
quaercns
inlellec
i
wn
.,
dil
Sa
int .
1n
se/
me
).
En
11n la forme des
preuves
(sy
ll
ogis
ti
que)
cl
leur no
mbr
e
jouent
cont
re e
ll
es.
S'il
y
en
a
l>
lusiem s, au
cun
e
n'est
déc'lsive ;
51
elles
sont
de ty
pe
log
ique
.
comment
po
urr
aient-e
ll
es
s'ap
pliqu
er
au
mystère?
On
assiste
à
des
compo
rt
em
ents
réflexes, du t
yp
e du •
C{)mme
si •· qui se
perpét
uent
:1
propo
~
d'un
sacré nbscn
l.
Ce qui
donne
uux
pre
uves un
caractè
re
trop
humain
: ainsi la première
pr
e
uve
aristot
ëlil'icnnc
1>ar
la pre-
mihe
cause (•
il
faut
bien
s'a
rrèter
quelque
p:-ort
•,
dit
la
preuve:
et
c'es
t
Dieu,
premi~rc
cuuse
de
la
chaîne
causale
).
1\
l
ais
ce
so
uel
de tlnitutle
es
t
h
uma
in
el
ne concerne
peut
-è
tre
en
rien
le
sacr
é,
le
div
in.
Fina
l
emen
t.
la pensée philoso
ph
iq
ue
ùu
:\l
oycn
Age
a
pp
aralt
comme
un
t'
ol
onia
lisme
de ln pen
sée
religieu
se,
q
ui
nnn
exe
la Rai
so
n
d la
cl
c
ll
e de
sa
défense.
noppclo
n
~
t
c~
pr
euves
de
t'exi
ste
nce
et
e Di
eu,
<'h
l·z A
ri.~/o/e
E'
t
Sain/
7'hf>mo.
•:
flUUIJr.~
ûe
/'
e.r/.~lenrr
ti
f
/J
Îfll
(tou
te
~h
o
se
~sl
mouvun
tc
ct
mue
: \
~
par
le
premier
moteur
s
t>
ul Dieu est
mo
t
eur)
?
~
11ar
la
pre
mière
cause
(Il faut un
être
néccs~uire)
(quelque chose est le plus pn
rfnit
}
(mène les
cho
ses
à
l
eu
r On)
~
par
J
r~
~onli
n
ge
n
ce
du
mo
nd
!'
~
p
ar
lu gr
nr
ln
lion
des
ètr
cs
~
·
par l'c\trc
int
elligent
A - Avec
Descarlts
,
Dieu
n'es
t p
lu
s
l'uni
<j
ue fondemen
t.
possible
du monde. D
an
s l'ordrt: des raisons, on
va
du
rogiio
à
Dieu ;
dans
l'ordre
de
la
réalité,
de
Dieu
au
cogilu.
f.e
qui
donne
le sché
ma
su
ivant
(circuit
à
rlouhle
entrée)
:
c·ug
i
to
(ordn
des raisons)
Q
Dieu
(or
ctre
de~
réa
lit
és}
L'ord
l'e des raisons est
évidemment
(
mai
s
11011
manifesteme
nt,
va
r
crainte
de
l'
[nquisilion)
privil
ég
ié
chez
Des
rar
irs.
Le
cngilo
semble
un
rri
rie
vk\.{)ire
de
l
'esp
ri
t qui
tro
u
Ye
un
rondement
universel
en
un
princ
i
pe
t>urement
rationne
l non en
co
m
hré de
théologie ni
rie
révêlation.
l)'a
ill
e
u
r~
la première
l\
lédit
atio
n
op
pose
<\
Dieu un
an
tHIIc
u (i
mag
iné
certes,
rnnis
c'e
st
sig
nil
kuti
f),
~·est
-
il-d ir
e
le
:\
la
lin
Gé
nie, Créat
eur
malfuis
ant
. A p
artir
de
Orscflri
l's,
on
commence
à
rro
ire possible
l'
idéal
d'une
th
éologie
rationne
ll
e,
ce que
\\'
ui
ff
essaier
·a
cie
dével
opper
avec une t'o
smolog
ic ct
un<'
psychol
ogi<'

rat
ionnelle
formant
u
ne
science
métaphysique.
Le
systè
me des
preuves de l'existence
de
Dieu
est
épuré :
·-- preuve « pllysicothèo/oqique
•:
je
c
onnais
le
parfait;
je
ne me
suis
pas
donné
l'
êt
re,
car
je me serais créé
parfait.
C'est
donc Dieu
qui... ;
-
pre
uve «cosmologique
•:
de ce
que
je
suis mai
ntenan
t,
il
ne
s'ensuit
pas
qu
e
je
sois
to
uj
ours
(création continuée) ;
-preuve •
par
les cflels • :
j'ai
en moi 1 'idée de perfec
ti
on,
celui
q
ui
me
l'a
donné
est
au
moins aussi
parfait
(la cause égale au moins
l'efTe
t) ;
·--
preuve • onloloyique
•:
Dieu
est
parfait
(Saint
Anselme: « ce
par
r
appo
rt
à quoi on ne
peul
imaginer quelque chose de plus grand >
);
il
existe
donc.
B -
Rani
. L'illusion
d'une
réconciliation
de
l'amour
et
de
la
' raison en
une
communauté
chréti
enne
organisée (comme idéal
méta
-
physique) en
la
main de Dieu (cf.
chapitre
La
J\létaphysique)
s'ef
-
. fondre. L'es
poir
d'un
mond
e coïneidant
ave
.c lui-même
par
la
sup
er-
position de la religion
et
de la philosophie, tombe ' ainsi
que
la
colombe vol
ant
dans le vide •.
Pour
[{ant,
je
ne peux savoir si quelque
chose existe
avant
d'y
être
allé
voir
(e:q>~rience)
.
Pour
Descartes,
le
jug
e
ment
«Dieu
est
•
est
analyt
i
que,
puisque,
pour
lui,
l'•
idée •
de
Dieu iml>lique son exi
stence
: ùe l'idée de Dieu à son existence,
on
peut
conclure.
Rani
di
t : < pour conclure
que
Dieu exis
te,
il
faut
cons
ta
ter
la
Perfection
et
l'Existence de
celte
perfection.
re
qui
exige
un
ju
gement
synthéti
qu
e,
en
plus des
deux
con
sta
ts. "
On peut en somme se
demander
si le 11robkme
1lcs
preuves de
l'existence de Dieu
ne
provient
pas
de
la confusion
constante
de
deux niveaux : le niveau philosophique
et
l
'instançe
rationnelle
d'une
part,
qui
remar
quent
que
l'on
parle
sur
quelctue chose,
qui, puisqu'il n
'y
a
pas
d'expérience,
peut
avoir
été
seulement ima-
giné ; ct
le
niv
eau
existentiel
et
religieux
d'au
tre
part,
re
stes
d'une
mentalité
primitive
po
ur laquelle ee même Dieu ue
peut
poser de
problème
quant
à son existence,
puisqu'il
est
l'origine de
tou
te
existence possible. Kant, plus éloigné de l'
ambiance
religieuse primi-
tive, représente presque
purement
la
tendance
rallonnelle. Mais,
avec l'exception de la philosophie de
/lege/,
le
processus
V>l
se ren-
forcer et la philosophie va
devenir
criliqur
rit
lrt
reliÇtimL
C - Hegel.
T.a
t>hilosophie englobe la religion ; elles o
nt
to
utes
deux même fin, même
contenu.
l.
a religion
est
identique
à la philo-
sophie, sous
l'aspect
non
de la pensée, mais <le la
représentation
(image).
La
philosophie
es
t donc supérieure à la religion.
To
ut
d'abord,
la
distinction
entre
foi
et
savoir
est
vide;
Dieu se
eommunique à la pensée
cl
non sculcrnenl au cœur. Hegel fustige
les
phi
losophies (ou religions)
du
se
ntiment
pur.
Car alors
la
religion
ne p
ourra
it être universelle, mais personnelle
et
incommunkable.
Le
dénominateur
commun chez
Hrgf/
est
I'E~prit
en marche
dans
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%