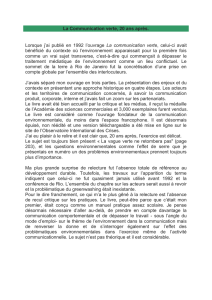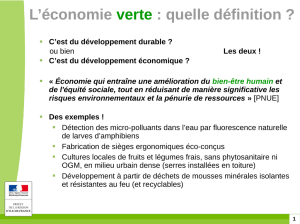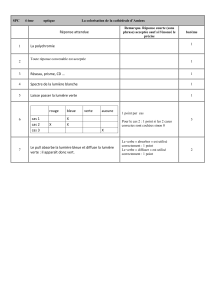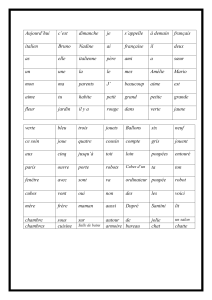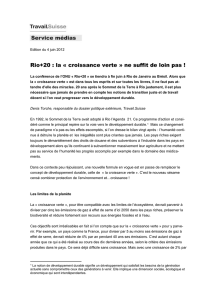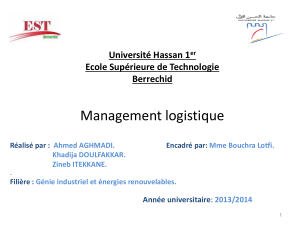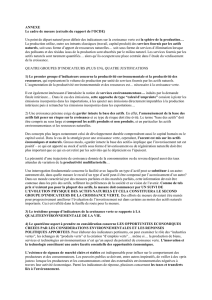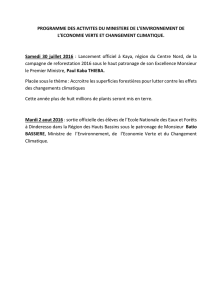Comment concilier développement économique et environnement ?

Conseil économique pour le dév
eloppement durable
www.developpement-durable.gouv.fr
Comment concilier
développement économique
et environnement ?
Philippe Aghion, Richard Baron, Dominique
Bureau, Jean-Pierre Bompard, Patricia Crifo,
Patrick Criqui, Nathalie Girouard, Matthieu
Glachant, Yann Kervinio, Alain Quinet, Katheline
Schubert, Nicolas Treich, Claire Tutenuit


Conseil économique pour le développement durable
|
3
COMMENT CONCILIER DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENT ?
AVANT-PROPOS
Depuis une dizaine d’années, les cadres d’action pour une croissance verte se sont développés,
reconnaissant le rôle du « capital naturel » dans une perspective de long-terme. Leurs
recommandations combinent des enseignements issus de l’économie de l’environnement et des
ressources naturelles, notamment la priorité à donner aux instruments incitatifs pour responsabiliser
les agents économiques aux dommages de leurs pollutions, mais aussi en économie du
développement car les transitions à réaliser sont structurelles, et en économie de l’innovation ou
financière, compte tenu de l’importance des investissements à réaliser pour décarboner l’économie.
Au sein des entreprises, les directions « développement durable » se sont renforcées et les principes
de responsabilité sociale et environnementale, l’éco-conception, se sont diffusés. L’innovation verte
constitue maintenant un aspect essentiel des stratégies des entreprises qui reconnaissent par ailleurs
la nécessité d’un prix du carbone suivant une trajectoire progressive et prévisible. Enfin, les politiques
de transition écologique ont continué à progresser malgré la crise économique, notamment dans les
secteurs les plus directement concernés par les enjeux climatiques. Cependant, le degré de cette
intégration apparaît très déséquilibré encore entre, d’un côté le domaine de la production d’électricité,
et de l’autre tout ce qui concerne les usages de l’énergie, l’alimentation, la biodiversité…
Surtout, alors que le sentiment qui semblait dominer était que l’intégration « social-environnement »
était plus délicate que celle entre économie et environnement, les politiques environnementales se
trouvent aujourd’hui confrontées à des conflits aigus entre, d’un côté les parties se réclamant du
développement économique et, de l’autre, celles de la protection de l’environnement.
A cet égard, sont significatives les controverses sur les projets locaux (barrages, aéroports, centres de
traitement de déchets….) et la cristallisation des blocages sur certains choix à forte dimension
technologique (OGM, gaz de schiste, nucléaire), malgré le renforcement des agences de sécurité
indépendantes. Par ailleurs il y a un débat récurrent sur l’excès de réglementation environnementale,
notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’urbanisme et de la construction. D’un côté,
certains objectifs fixés dans les plans d’action pour la transition écologique sont jugés excessivement
coûteux à atteindre et il est mis en avant que les études d’impacts n’intégreraient pas assez les
contraintes de la compétition économique. De l’autre, il y a encore beaucoup de « green-washing » et,
plus fondamentalement, d’évolutions alarmantes, dans le domaine des sols ou de la qualité des eaux
par exemple, où les progrès apparaissent bien lents.
Souvent, l’impression qui domine ainsi « vu des tranchées » est l’importance des blocages, les
politiques environnementales se retrouvant in fine sur la défensive. Ceci se trouve renforcé par le
doute qui résulte des controverses entre experts, par exemple à propos de l’hypothèse dite de Porter.
Celle-ci table sur l’essor et le succès de stratégies d’entreprises « gagnant-gagnant », où la bonne
anticipation des enjeux environnementaux permettrait de créer de nouvelles activités. Mais elle
demeure critiquée sur le plan empirique.
Cependant, ceci n’empêche pas que les enseignements les études de cas souvent plus favorables
méritent l’attention, pour identifier des facteurs de succès, notamment l’importance des politiques
mises en œuvre. De même, si l’opposition entre croissance et protection de l’environnement nourrit
beaucoup de débats dans le public, la logique d’intégration entre économie et environnement tend à
prévaloir.
Comment stimuler le développement économique en veillant à ce que les actifs naturels continuent de
fournir les ressources et services environnementaux essentiels au développement humain ?
Comment repenser les modes de production et de consommation pour la croissance verte ? Peut-on
concevoir des politiques environnementales « pro-business » (ou pro-emplois) ? A quelles conditions,
notamment en termes de gouvernance et d’institutions pour les conduire ?

4
|
Conseil économique pour le développement durable
Beaucoup de travaux passés du CEDD ont déjà cherché à éclairer ces questions
1
en s’attachant en
premier lieu à préciser la nature des problèmes à résoudre, ou à mieux dessiner les contours de la
croissance verte et ses liens avec les autres transformations de notre développement. L’objet de ce
rapport est de les revisiter dans une perspective plus opérationnelle, sachant que l’essor des
politiques environnementales se trouve conditionné aujourd’hui à l’amélioration de leur légitimation
dans la dimension économique.
Il intègre de nombreuses contributions. Evidemment, ceci ne signifie pas que tous les membres du
CEDD aient strictement la même appréciation sur tous les sujets : certains croient plus à la possibilité
de solutions « gagnant-gagnant » et font confiance à la responsabilité sociale et environnementale
des entreprises alors que d’autres pointent plutôt les risques de « greenwashing » ; de même, la
capacité à mener des politiques publiques complexes, comme cela serait souhaitable en théorie, fait
débat, eu égard notamment aux méfaits de politiques volatiles ou au risque de mauvaise articulation
entre instruments si ceux-ci sont trop nombreux ; enfin, confrontés aux cas concrets, les arbitrages
entre le risque d’innover trop vite, sans mesurer les risques ou sans assurer suffisamment leur
acceptabilité sociale, et celui de ne pas assez inciter à l’innovation verte peuvent sensiblement
différer. Le rapport n’a donc pas cherché à gommer ces débats, ce qui in fine fait ressortir le socle
partagé.
Le fil directeur est que productivité globale ou compétitivité, progrès social et politiques
environnementales ambitieuses peuvent aller de pair, mais que cela ne se fait pas spontanément.
Il faut pour cela un cadre propice de politiques publiques. Celles-ci sont nécessaires, mais elles
doivent aussi être bien conçues, cohérentes et privilégiant l’incitation sur la norme rigide; s’attachant
absolument à réduire « l’incertitude régulatoire », génératrice de primes de risque élevées pour les
investisseurs.
Les questions de qualité du droit de l’environnement ne doivent donc pas être taboues, au contraire,
puisque celle-ci conditionne en fait l’ambition des objectifs environnementaux qui pourront être visés.
Le rapport insiste sur la dimension « investissement », notamment l’innovation, y compris les besoins
d’innovation « radicale », et sur les obstacles à lever à cet égard. Dans cette perspective, il souligne
comment les procédures administratives doivent être organisées de manière à ne pas créer de
barrière à l’émergence des nouvelles technologies « propres » et à leur déploiement.
Ceci impose notamment de ne pas maintenir d’avantages indus aux entreprises en place, par rapport
aux entrantes potentielles.
En d’autres termes, l’évaluation des impacts en termes de soutenabilité et de ceux sur le bon
fonctionnement des marchés doivent aller de pair, pour trouver les meilleures solutions conciliant
économique, social et environnemental.
L’interview de Philippe Aghion en introduction précise ces principes généraux. Leur mise en œuvre
nécessite de mieux « aligner les politiques » (première partie), notion que l’on examine ensuite en
considérant le côté des entreprises (deuxième partie) puis celui du rôle de l’Etat (troisième partie). A
ce titre, sont notamment passées en revue ses fonctions de régulation, de mise en place des
infrastructures du développement économique, ainsi que les politiques d’innovation. La conclusion
esquisse un plan d’action pour réaliser ce meilleur alignement, les annexes rappelant quelques points
de repères concrets pour élargir le recours aux instruments incitatifs, incontournable de la conciliation
entre développement économique et environnement.
Sommaire
1
cf. « Les économistes et la croissance verte », 2012
Le CEDD a pour mission de mobiliser des références économiques pour élaborer
les politiques de développement durable. Sa composition reflète la diversité de la
recherche académique et de l’expertise des parties prenantes sur les thématiques
liées à la transition écologique. Ses travaux visant à éclairer les choix, ils se doivent
de refléter la diversité des points de vue. Les contributions à ses rapports
n’engagent donc que leurs auteurs, donc ni le CEDD, ni les organismes dans
lesquels ils exercent par ailleurs des responsabilités.

Conseil économique pour le développement durable
|
5
SOMMAIRE
Préface : Innovation et environnement. P.7
Interview de Philippe Aghion, professeur au Collège de France
PREMIERE PARTIE : L’ALIGNEMENT DES POLITIQUES P.13
I-Opportunités économiques et efficacité des politiques.
A- Les enseignements de la stratégie pour une croissance verte de l’OCDE.
B- Les obstacles économiques à lever
II- Clivages idéologiques à surmonter
A- Le rôle du progrès technique
B- Economie de marché, crises et développement durable
DEUXIEME PARTIE : LES ENTREPRISES ET L’ENVIRONNEMENT P.45
I- Comment saisir les opportunités ?
A- Environnement et prospérité : la perception des entreprises
B- Vers une quatrième révolution industrielle…verte ?
II- La Responsabilité sociale et environnementale des entreprises
A- RSE et performance des entreprises
B- L’évolution nécessaire du « Rapport annuel pour la soutenabilité des entreprises »
TROISIEME PARTIE : LES POLITIQUES PUBLIQUES DANS LE CONTEXTE DE LA
MODERNISATION DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT P.67
I- Les enjeux de régulations environnementales efficaces
A- Le coût économique des normes environnementales : leçons du Clean Air Act
B- La qualité économique des réglementations
II- Le cas des projets d’infrastructure
A- Comment concilier exigence environnementale et efficacité économique ?
B- L’économie du « NIMBY »
III- Qu’est-ce qu’une politique d’innovation industrielle et écologique ?
A- La nécessité de politiques de soutien à l’innovation verte
B- L’innovation verte en France
CONCLUSION : ELEMENTS POUR UN PLAN D’ACTION P.93
ANNEXES: COMPLEMENTS SUR LE RECOURS AUX INSTRUMENTS ECONOMIQUES P.99
1-Fiscalité verte et compétitivité : la démonstration suédoise
2-Les instruments d’une agriculture doublement verte et compétitive.
3-La réparation du préjudice écologique
RESUME P.119
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
1
/
124
100%