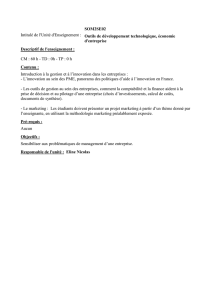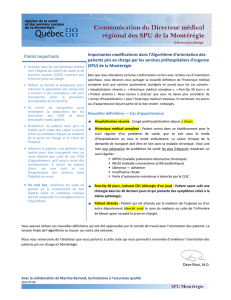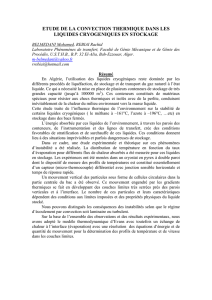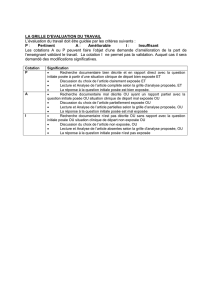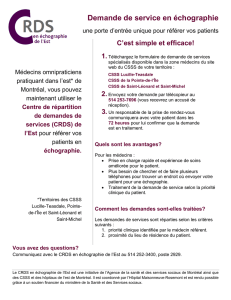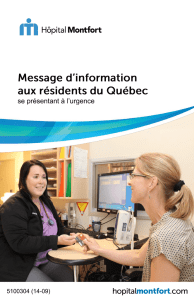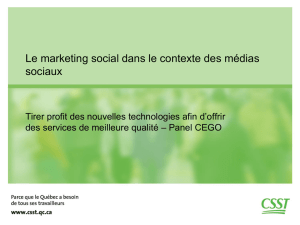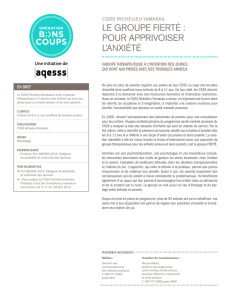Prise en charge d`une exposition au sang et aux autres

Prise en charge des personnes lors
d’une exposition au sang et aux autres
liquides biologiques
Prophylaxie post exposition
Direction de santé publique de la Montérégie
Programme maladies transmissibles
Mai 2014
À noter que les images des guides de prophylaxie, des dépliants de même
que le logo de l’Agence de la Santé et des Services Sociaux de la
Montérégie ont été retirés du document le 14 mai 2015

Auteurs
* Serge Dufresne, médecin-conseil, programme maladies transmissibles, DSP de la Montérégie
* Nathalie Dumas, agente de planification, programmation et recherche en ITSS, programme
maladies transmissibles, DSP de la Montérégie
* Stéphane Roy, médecin-conseil, programme maladies transmissibles, DSP de la Montérégie
Nous tenons à remercier, pour leurs précieux conseils :
* Louise De La Boissière, chef de service Vigie-ITSS, programme maladies transmissibles, DSP de
la Montérégie
* France Janelle, médecin-conseil, programme maladies transmissibles, DSP de la Montérégie
* Élisabeth Lajoie, médecin-conseil, programme santé au travail, DSP de la Montérégie
* Sandra Moretti, agente de planification, programmation et recherche en SST, Programme santé
au travail, DSP de la Montérégie
* Sylvie Ouellet, médecin-conseil, programme maladies transmissibles, DSP de la Montérégie
* Mireille Plamondon, microbiologiste-infectiologue, CSSS Haut-Richelieu Rouville
* Nicole Trudeau, agente de planification, programmation et recherche, programme maladies
transmissibles, DSP de la Montérégie
Mise en page
* Josée Lafontaine, agente administrative, programme maladies transmissibles, DSP de la
Montérégie
Répondants locaux pour le dossier PPE en Montérégie
* Guylaine Auger, coordonnatrice des programmes de santé publique et de santé au travail, CSSS
Haut-Richelieu-Rouville
* Dominique Beaudry, ASI en enfance jeunesse, CSSS de la Haute-Yamaska
* Lise M Desautels, chef de programmes de santé publique, CSSS Richelieu-Yamaska
* Benoît F Bouffard, coordonnateur à la santé des communautés et au bénévolat, CSSS La
Pommeraie
* Linda Haworth, directrice adjointe réseau famille, services généraux, développement des
communautés, CSSS du Suroît
* Manon Laplante, coordonnatrice première ligne, direction première ligne et maintien de
l’autonomie, CSSS Jardins-Roussillon
* Sophie Leduc, conseillère-cadre à la programmation, direction des services généraux et
spécifiques, de santé publique et des services multidisciplinaires, CSSS de Vaudreuil-Soulanges
* Annie Lemoine, directrice des services multidisciplinaires et directrice des soins infirmiers, CSSS
Pierre-De Saurel
* Guy Levesque, coordonnateur en santé physique médecine 1ere ligne, CSSS Pierre-Boucher
* JoAnn McClintock, chef des soins infirmiers, médecine et chirurgie, CSSS du Haut-Saint-Laurent
* Dawn Montour, gestionnaire de santé communautaire, Centre Hospitalier Kateri-Memorial
* Nathalie Ruest, CSSS Champlain-Charles-Le Moyne
La traduction et la reproduction totales ou partielles de ce document sont autorisées à la
condition que la source soit mentionnée.
Dans ce document, le générique masculin est utilisé sans intention discriminatoire et uniquement
dans le but d’alléger le texte.
Ce document est disponible sur le site de l’Agence :
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/mi-itss/outil-
clinicien-prophylaxie.fr.html

Avant-propos
La Direction de santé publique (DSP) de la Montérégie a produit en 2001 le document
« Exposition professionnelle au sang et autres liquides biologiques ». Celui-ci a été adapté
en 2006 afin de produire un nouveau document « Recommandations et outils visant la prise
en charge des personnes lors d’une exposition accidentelle au sang et aux autres liquides
biologiques ».
Le présent document « Prise en charge des personnes lors d’une exposition au sang et aux
autres liquides biologiques » est inspiré par et remplace les documents précédents. Il
englobe la mise à jour de 2011 des nouvelles recommandations provinciales.


Direction de santé publique de la Montérégie 5
Table des matières
Avant-propos ..................................................................................................................... 3
Liste des annexes ............................................................................................................. 7
Introduction ....................................................................................................................... 9
1. Aspects organisationnels .......................................................................................11
2. Rôles et responsabilités de la DSP, des CSSS de la Montérégie et des différents
partenaires ...............................................................................................................13
3. Mesures de prévention primaire .............................................................................15
4. Prise en charge d’une exposition au sang et aux autres liquides biologiques...17
4.1. Algorithme « Premiers soins et évaluation de l’exposition » ........................................... 17
4.1.1. Premiers soins ............................................................................................................... 17
4.1.2. Évaluation de l’exposition .............................................................................................. 17
4.1.3. Évaluation de la personne source (si connue) .............................................................. 18
4.1.4. Évaluation de la personne exposée .............................................................................. 19
4.2. Algorithme « Évaluation et suivi médical » ......................................................................... 19
4.2.1. Premiers soins ............................................................................................................... 19
4.2.2. Évaluation de l’exposition .............................................................................................. 19
4.2.3. Investigation initiale ....................................................................................................... 20
4.2.3.1. Évaluation de la personne source (si connue) .............................................................. 20
4.2.3.2. Évaluation de la personne exposée .............................................................................. 20
4.2.4. Prophylaxie de la personne exposée ............................................................................ 20
4.2.5. Counseling ..................................................................................................................... 21
4.2.6. Suivi de la personne exposée ....................................................................................... 21
4.2.7. Santé-sécurité au travail ................................................................................................ 22
Conclusion .......................................................................................................................23
Bibliographie ....................................................................................................................83
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
1
/
83
100%