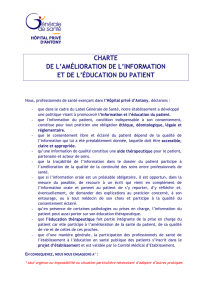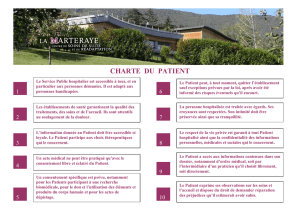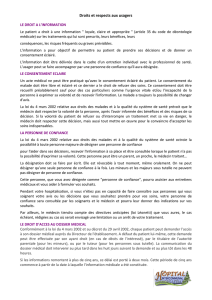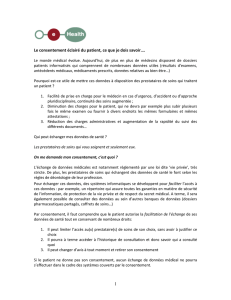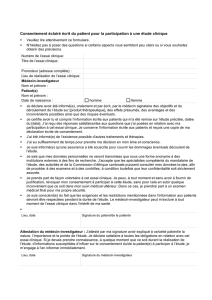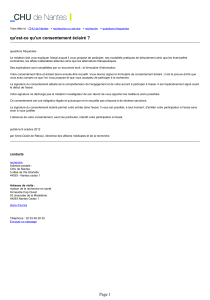Consentement informé et signé I

Article ayant fait l’objet d’une communication aux dernières
Journées européennes de la Société française de cardiologie,
janvier 2006, Palais des Congrès, Paris.
HISTORIQUE ET ENJEUX ÉTHIQUES
DU CONSENTEMENT DANS LA RELATION
MÉDECIN-PATIENT
La recherche du consentement éclairé est un acte banal et quoti-
dien dans la pratique médicale, que ce soit lors des soins, d’une
exploration à visée diagnostique, d’un acte thérapeutique ou, plus
rarement, avant un protocole de recherche médicale. Pourtant,
cette banalisation masque une complexité croissante sur le fond
et la forme que doit prendre ce consentement, et sur la place qu’il
doit tenir dans la relation que nous avons avec les patients. La
compréhension de ce rôle passe habituellement par une triple
approche médicale, juridique, et également éthique et philoso-
phique en regard de la notion de respect de la personne et de ses
droits fondamentaux. Le présent travail traitera des évolutions
dans le cadre des démarches de soins, celui de la recherche étant
différent et faisant référence à d’autres règles.
Avec son corollaire, l’information du patient, le consentement
constitue donc l’un des points les plus sensibles de la relation
médecin-patient. Comme le soulignait le Pr J. Hamburger dans
l’ouvrage L’aventure humaine, publié en 1992, le consentement
s’inscrit dans la complexité d’une médecine de plus en plus
moderne et de plus en plus performante confrontée à l’incerti-
tude du progrès et de la maladie. Il souligne que la codécision
entre le médecin et le patient est de plus en plus essentielle, le
médecin devant accepter de se mettre à la place du patient et réci-
proquement pour bien appréhender toutes les facettes des choix :
“Art de réflexion et de conjecture en 1900, la médecine est deve-
nue une discipline d’action qui détient aujourd’hui mille pou-
voirs de vie et de mort sur les malades qui lui sont confiés. Puis-
sance merveilleuse et salvatrice, mais aussi puissance qui va
doubler chaque problème technique d’un problème moral et
contraindre le médecin à repenser toute l’éthique de son métier
à chacun des nouveaux gestes d’audace. [...] Toute décision grave
doit être celle de deux hommes, chacun se mettant à la place de
l’autre. Le médecin n’a pas à imposer autoritairement ses propres
vues ; les désirs profonds du malade comptent autant que les
impératifs techniques pour la stratégie du traitement.”
Cette modernité de la relation médecin-patient désormais acquise
par tout professionnel de santé est une évolution notable de ces
vingt dernières années et tranche notablement avec certaines atti-
tudes du passé. Ainsi, on est loin des propos du Dr L. Portes, pré-
sident du conseil de l’ordre des médecins, qui, dans sa commu-
nication à l’Académie des sciences morales et politiques dans les
années 1950, exposait que : “Le consentement éclairé du malade
n’est, en fait, qu’une notion mythique. Le patient, à aucun
moment, ne connaissant au sens exact du terme vraiment sa
misère, ne peut vraiment consentir ni à ce qui lui est affirmé ni
à ce qui lui est proposé, si du moins, nous donnons à ce mot de
consentement sa signification habituelle, d’acquiescement averti,
raisonné, lucide et libre.”
Ces propos qui, aujourd’hui, pourraient être qualifiés de pater-
nalistes et excessifs, préfiguraient néanmoins le débat d’aujour-
d’hui et avaient le mérite de poser clairement la question : quelle
est la nature réelle du consentement que formule un patient en
état de maladie, donc de vulnérabilité ?
Sur le plan des concepts, soulignons que le processus d’infor-
mation et de consentement puise sa légitimité dans les fonde-
ments philosophiques de notre société issus du siècle des
Lumières, des principes démocratiques et du respect de la liberté
de choix de chacun. Le concept d’autonomie découle, en effet,
de notre tradition politique puisant son origine chez Descartes
INFORMATIONS
●
G. Moutel*
* Laboratoire d’éthique médicale et de médecine légale, Faculté de méde-
cine Paris 5 et Sffem, Société française et francophone d’éthique médicale,
www.ethique.inserm.fr
Consentement informé et signé
dans les pratiques de soins : le médecin
est-il préservé de poursuites ?
Où en est-on et quelles sont les places
respectives de l’oralité et de l’écrit
dans la relation médecin-patient en 2006 ?
La Lettre du Cardiologue - n° 394 - avril 2006
18

La Lettre du Cardiologue - n° 394 - avril 2006
19
puis, entre autres, chez Rousseau (Du contrat social, 1762) et
chez Kant (Fondements de la métaphysique des mœurs, 1785).
Pour le premier, le sujet pensant s’assure de son existence per-
sonnelle ; il en découvre la certitude au terme du doute métho-
dique ; et dans l’action, le sujet cartésien exerce son libre arbitre,
cette liberté de la volonté. Pour le second, l’homme se libère des
lois divines ou des lois de la nature, en se soumettant à la
contrainte de sa raison législatrice universalisante, dans le cadre
d’un contrat social. Chez Kant, l’autonomie forge la personna-
lité du sujet moral, assure sa dignité, le rendant capable de se
constituer législateur de sa propre loi. Ces fondements vont ame-
ner peu à peu la médecine à considérer le patient (qu’il soit psy-
chiquement apte, ou non) comme un partenaire et un acteur du
soin. Avant le
XX
esiècle, la question n’est pas posée en termes de
consentement, mais d’appel à l’intelligence du sujet et à son acti-
vité d’être raisonnable (au sens d’être capable de raison et de
choix). C’est pourquoi la question de la relation est au cœur du
rapport entre soignant et soigné, relation faite d’explications
nécessaires, mais adaptées à chaque situation clinique. Bien que
non généralisée à l’ensemble de la médecine, des praticiens, dès
la première moitié du
XX
esiècle, développent une réflexion sur
la nature des rapports avec les patients et sur le degré d’implica-
tion de ces derniers dans les choix médicaux. Il faudra cependant
attendre la seconde moitié du siècle dernier et l’avancée fulgu-
rante de la recherche médicale pour que ces interrogations débou-
chent, effectivement, sur de nouvelles pratiques.
La seconde moitié du
XX
esiècle sera décisive : le progrès médi-
cal et les pratiques de soins avancent à grands pas. On découvre
les antibiotiques, les psychotropes ; la pharmacopée recense un
nombre croissant de médicaments efficaces ; les techniques
d’imagerie et de chirurgie progressent. De nouveaux domaines
sont explorés : la biologie moléculaire, la cancérologie, la géné-
tique, l’immunologie, etc. La médecine devient de plus en plus
efficace. Les médecins soignent et guérissent un nombre crois-
sant de maladies. Le médecin lui-même apparaît comme un fai-
seur de miracle, symbole d’une société en pleine évolution socio-
économique. Mais parallèlement, et très rapidement, de nouvelles
questions sont soulevées. La collectivité et les patients prennent
conscience des nouveaux enjeux de la médecine qui les concer-
nent directement : la nécessité de comprendre les avantages et
les inconvénients des choix thérapeutiques, le droit à accéder aux
progrès en termes de prévention, de dépistage et de soins, la pos-
sibilité de participer à la recherche clinique, moteur essentiel du
progrès mais aussi source de risques et de nouvelles incertitudes.
Par ailleurs, la médecine pose de nouveaux problèmes qui dépas-
sent largement le cadre scientifique et touchent directement à la
nature et au devenir de l’Homme : la procréation médicalement
assistée, les greffes, les tests génétiques, la prolongation de la
vie, etc. La société veut participer à des débats qui ont leur pro-
longement au sein de la relation médecin-patient. Quelle est la
place du malade dans la décision ? Comment le médecin doit-il
informer ses patients ? C’est-à-dire, in fine, quel est le véritable
rôle du médecin, acteur essentiel de la santé, dans la société de
demain, dans les processus d’information des patients ?
Cette évolution explique pourquoi désormais chacun souhaite
légitimement pour lui ou un proche, non seulement l’accès aux
meilleurs soins, mais également à la meilleure connaissance des
choix qui sont offerts, à travers leurs avantages et leurs risques,
à travers une information individuelle de qualité. Dans le cadre
particulier du débat sur le risque en médecine, soulignons que
les études montrent que les personnes ne refusent pas la notion
de risque (dont elles comprennent l’existence incontournable liée
à certaines pratiques médicales), mais refusent la notion de risque
caché et de non-dit. Elles souhaitent une explication des risques
afn de pouvoir faire un choix éclairé.
Ainsi, la médecine est très liée aux évolutions de la société, et la
maîtrise que le médecin a acquise en termes de savoir et de tech-
nologie accroît le poids de ses responsabilités. Ainsi, lorsqu’un
médecin prend une décision, il doit en évaluer les avantages, les
risques et les dérives éventuelles. Il doit partager ce questionne-
ment au sein de la relation médecin-patient. Les choix se situent
entre les risques présentés par la maladie et ceux que peuvent
comporter un traitement, une recherche ou une démarche de pré-
vention. Il doit partager cela avec le patient, mais en restant celui
qui guide et qui rassure, sans laisser le patient choisir seul sur-
tout face à des états de fragilité et de vulnérabilité. Le médecin
est en effet, à côté des patients, un des premiers à ressentir et à
connaître les angoisses de ces derniers, leurs doutes et leurs
attentes. C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, le médecin sera
le garant d’une vigilance accrue et qu’il pourra parfois revendi-
quer de se substituer au libre choix du patient, après discussion
avec les proches, lorsqu’il estimera que le consentement du
patient n’est pas possible du fait de vulnérabilités physiques ou
psychiques trop importantes.
ÉVOLUTION MÉDICO-LÉGALE
DE L’INFORMATION ET DU CONSENTEMENT
DANS LES PRATIQUES DE SOINS
Jusqu’en 1936, la relation médecin-malade était considérée
comme une simple rencontre entre deux particuliers et l’on en
référait à deux articles du code civil qui précisaient que :
– “tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dom-
mage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer” ;
– “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement
par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence”.
La notion de contrat en médecine n’apparaît en tant que telle d’un
point de vue juridique qu’en 1936. À ce moment, la chambre
civile de la Cour de cassation (arrêt du 20 mai 1936, dit arrêt Mer-
cier) expose clairement que : “Il se forme entre le médecin et son
client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l’en-
gagement, sinon bien évidemment de guérir le malade du moins
de lui donner des soins non pas quelconques, mais consciencieux,
attentifs et, réserve faite des circonstances exceptionnelles,
conformes aux données acquises de la science. La violation même
involontaire de cette obligation contractuelle est sanctionnée par
une responsabilité de même nature, également contractuelle.”
Du fait de la définition désormais contractuelle de la relation
médecin-patient, la responsabilité du médecin peut dès lors être
engagée en cas de violation du contrat liant le médecin à son
INFORMATIONS

La Lettre du Cardiologue - n° 394 - avril 2006
20
malade. Dans les critères de validité du contrat, définis par le
code civil, figurent entre autres :
– le consentement de la partie qui s’oblige ;
– la capacité de contracter (médecin diplômé, inscrit au conseil
de l’ordre d’une part, et patient majeur juridiquement capable
d’autre part) ;
– la cause licite dans l’obligation : le but thérapeutique qui légi-
time le pouvoir du médecin de porter atteinte à l’intégrité phy-
sique du patient.
ÉVOLUTION DE LA NATURE ET DE LA FORME
DE L’INFORMATION À DÉLIVRER
En 1961, un arrêt de la Cour de cassation précise que “dans la
recherche du consentement, le médecin doit employer une expres-
sion simple, approximative, intelligible et loyale, permettant au
malade de prendre la décision qui s’impose”.
Il s’agit là d’une orientation sur la nature de l’information à déli-
vrer dans le cadre de la relation avec le patient, sans se pronon-
cer sur sa forme orale ou écrite. Néanmoins, dans l’esprit de cette
décision, il faut entendre que cet arrêt qualifie l’information orale,
ce qui n’exclut pas qu’elle soit complétée par un support écrit
(mais qui ne saurait remplacer ni se substituer à l’échange ver-
bal lors de la consultation).
Mais le terme “approximative” n’apparaissait pas satisfaisant.
On comprend bien qu’il avait été choisi par les magistrats pour
ne pas imposer une information trop technique, trop complexe,
en laissant entendre qu’une information délivrée à un patient ne
pouvait être complète (au sens où aucun patient ne peut atteindre
un niveau de compétence médicale suffisant pour comprendre
une information de trop haute complexité). Néanmoins, ce terme
pouvait laisser planer un certain esprit de suspicion et de non-
qualité.
C’est pourquoi, en 1995, les médecins à travers la rédaction du
code de déontologie médicale (article 35) ont préféré le terme
“appropriée” plutôt que le terme “approximative” qui laisse trop
de place à l’arbitraire. Ce nouveau terme laisse bien entendre que
l’information, dans sa forme, dans son fond, dans son moment
de délivrance, doit être pensée et personnalisée en fonction de la
situation d’un patient. Pour cette raison, on comprend également
que le code de déontologie, depuis 1995, situe toujours l’infor-
mation dans l’oralité et dans la relation. L’information du patient
constitue donc un acte médical dont le médecin a le devoir, acte
qui est de sa responsabilité et qu’il ne peut déléguer.
En 1997, on assiste à la renaissance du débat sur l’information
des patients à la suite de la décision de la Cour de cassation qui
bouleverse la doctrine antérieure en faisant désormais peser sur
le médecin la charge de la preuve que l’information a été déli-
vrée, se référant au code civil et à la nature d’un contrat (second
article alinéa de l’article 1315 du code civil motivant cette inno-
vation jurisprudentielle) :
“[...] celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une
obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de
l’exécution de cette obligation…”
Face à cette décision, les médecins et leurs sociétés savantes vont
s’interroger sur cette contrainte imposée et vont comprendre cette
décision comme une obligation d’apporter la preuve que l’in-
formation a été donnée à travers un support écrit, signé par le
patient. Nous verrons que cette vision n’est que partiellement
juste et que l’écrit signé d’un patient n’est ni la seule garantie ni
toujours la juste garantie d’une information de qualité.
En 1998, la Cour de cassation complexifie la question et formule
que l’information doit être complète sur tous les risques graves,
même exceptionnels : il convient de signaler les complications
“d’une particulière gravité” même lorsqu’elles sont exception-
nelles. La jurisprudence administrative en 2002 a eu pour objet
l’alignement de la jurisprudence du Conseil d’État sur celle de
la Cour de cassation. Le juge administratif a rejoint le juge judi-
ciaire en affichant clairement la nécessité d’unifier les règles qui
s’appliquent aux médecins du secteur public hospitalier sur celles
qui sont appliquées pour les médecins du secteur privé.
Cette jurisprudence dite Hédreul (à la suite d’un accident de colo-
scopie) est reprise dans la loi du 4 mars 2002, dite loi des droits
des patients. Elle en modifie un peu les termes en précisant que
seuls les risques fréquents ou graves, normalement prévisibles,
doivent être portés à la connaissance du patient. La question
demeure néanmoins complexe en pratique pour savoir où est la
limite entendue par l’expression “normalement prévisibles”.
Les professions médicales dans leur ensemble, bien que sou-
cieuses de bien informer les patients, soulignent le caractère com-
plexe d’une telle décision et son inapplicabilité en pratique, sauf
à dresser un catalogue exhaustif remis au patient, catalogue plus
à même d’angoisser ce dernier et de complexifier les prises de
décision que d’aider à la prise en charge sereine de sa souffrance,
de son anxiété et parfois de son désarroi.
Du coup, à côté des décisions de justice, un débat de nature
éthique voit le jour : comment certes mieux informer, mieux éclai-
rer, sans tomber dans des excès ou des pratiques contraires à
l’exercice de la médecine ? Ce débat n’est toujours pas refermé,
car il nécessite que chaque spécialité travaille cette question pour
définir jusqu’où doit aller ou non l’exhaustivité, comment le dire
et comment accompagner les personnes au décours de cette ava-
lanche d’informations. Comment parler d’aléas, de complica-
tions rares bien que graves, voire de mort, alors que le patient
attend également et avant tout un discours d’espoir et de réassu-
rance ? C’est ce chemin qu’il convient de construire.
COMMENT TRAVAILLER LA QUESTION
DE L’INFORMATION ?
QUELLES SONT LES PLACES
RESPECTIVES DE L’ORAL ET DE L’ÉCRIT ?
QUEL DEGRÉ D’EXHAUSTIVITÉ ATTEINDRE ?
Rappelons tout d’abord que ce débat concerne essentiellement
les pratiques médicales dites à risque important. Bien entendu
tout acte médical comprend un niveau de risque, mais il est clair
qu’une information complète écrite et a fortiori une signature du
patient n’est pas à mettre en œuvre pour la majeure partie des
consultations et des prescriptions (infections urinaires simples,
angines, crises d’asthme, vaccinations, prise en charge d’une
hypertension artérielle, prescription d’un anxiolytique, réalisa-
INFORMATIONS

La Lettre du Cardiologue - n° 394 - avril 2006
21
tion d’une radiographie de thorax, etc.). Continuer la liste serait
fastidieux, mais cela pose néanmoins une question de fond : où
l’oralité de l’information (requise pour toutes les situations) doit-
elle être complétée par l’écrit ?
Il faut ici se référer à l’esprit de la Loi du 4 mars sur les droits
des patients et à la jurisprudence antérieure. Il paraît désormais
évident que lorsqu’un risque est fréquent ou grave et normale-
ment prévisible il faut en informer clairement le patient.
Une des premières règles est de rappeler que cette information
doit avant tout être orale, et que cette oralité repose sur deux prin-
cipes :
– être réalisée par un médecin,
– bénéficier d’un temps de consultation suffisant (une ou plu-
sieurs rencontres).
Cette oralité peut être complétée par un document pédagogique
rédigé pour les patients et adapté à leur compréhension (dans les
mots choisis et dans les tournures). Rappelons ici que s’il s’agit
d’un patient étranger, tant l’oralité que l’écrit posent la question
de la traduction, dès lors que l’on veut que le consentement soit
légitime.
Il convient de distinguer ce document d’information, du docu-
ment que l’on conseille désormais de faire signer attestant que
le patient a bien reçu l’information. Ce document signé certifiera
que le patient a bien été informé et détaillera les modalités de
cette information (consultation, remise de brochure, autres formes
pédagogiques, etc.). Il engagera dès lors le professionnel à les
avoir mises en œuvre. Puis ce document signé et daté sera
conservé dans le dossier médical avec un double remis au patient.
Mais il faut bien souligner que ce document seul ne peut attes-
ter de la qualité d’une information délivrée. En effet, d’autres cri-
tères seront pris en compte pour juger de la qualité des procé-
dures d’information des patients :
– le temps consacré par le professionnel pour informer le patient ;
– la traçabilité dans le dossier médical, du moment de délivrance
de l’information, des grands thèmes abordés, mais aussi des dif-
ficultés éventuelles rencontrées et des points à revoir et à préci-
ser si besoin ;
– les courriers adressés aux correspondants médicaux et en par-
ticulier au médecin traitant reprenant ce qui a été expliqué au
patient (ce qui permet à ces personnes relais de reprendre ces
informations avec l’intéressé, améliorant ainsi le processus de
compréhension) ;
– la remise d’un double de ces courriers au patient, avec éven-
tuellement des éléments du dossier médical en rapport (le patient
ayant désormais droit à la communication des éléments de son
dossier).
Avec l’ensemble de ces démarches, que de nombreux médecins
mettent déjà en œuvre, le professionnel atteste de sa qualité péda-
gogique et relationnelle. Avant de vouloir se protéger, par la signa-
ture d’un formulaire par les patients, il assoit la légitimité de la
pratique médicale sur une réelle “démarche qualité” dans ce
domaine si sensible des rapports entre la médecine et les usagers.
Signalons à ce propos qu’un formulaire signé par un patient (d’ac-
ceptation d’un geste diagnostique ou thérapeutique, d’un refus
de soin, etc.) alors qu’aucune autre preuve de processus d’infor-
mation ne serait retrouvée dans le dossier ou dans des courriers
(exemple, lettre au médecin traitant avec double au patient en cas
de refus de soins, ou en cas de programmation d’un geste à
risque), pourrait être considéré comme une pratique de non-qua-
lité. En effet, il importe de souligner que, dans le domaine de la
protection des personnes et de leur liberté de choix, le processus
d’information est plus important que le recueil signé d’une adhé-
sion. C’est tout le sens même de l’expression “consentement
éclairé”.
Concernant le contenu des documents remis aux patients (docu-
ments pédagogiques et formulaires à signer), l’ensemble des per-
sonnes compétentes sur ce sujet incite les sociétés savantes et les
collèges professionnels à mettre au point des brochures et des
fiches d’information exposant la procédure médicale, son inté-
rêt, les risques, mais aussi les risques de la refuser. Dans ce
contexte, l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en
santé (Anaes), en 2000, a produit des recommandations géné-
rales que chaque discipline devra adapter à ses pathologies et à
ses pratiques. Cette agence réaffirmait la primauté de l’informa-
tion orale sur l’écrit, puis énonçait pour l’orale et l’écrit (ou pour
d’autres supports visuels, audiovisuels ou multimédia) que l’in-
formation devait :
– être hiérarchisée ;
– reposer sur des données validées ;
– présenter les bénéfices attendus avant leurs inconvénients et
risques éventuels ;
– préciser les risques graves (ceux qui menacent la vie du patient
ou l’une de ses fonctions vitales) ;
– être compréhensible pour tous ;
– inciter à poser des questions complémentaires et à en parler
avec son médecin.
Il est également proposé que les documents écrits soient testés
sur des patients, en lien avec des équipes ayant des compétences
de recherche et d’évaluation en éthique médicale et médecine
légale dans le domaine de la relation médecin-patient.
Soulignons enfin qu’une telle information consensuelle produite
par les représentants des disciplines aura l’avantage de produire
un référentiel médical, issu d’experts. De tels référentiels
devraient avoir deux avantages :
– d’une part, de permettre de trancher la discussion sur la néces-
sité ou non de signaler tel ou tel risque (puisque c’est l’ensemble
de la profession qui porte alors la responsabilité du choix de l’in-
formation à donner et non un individu isolé) ;
– d’autre part, de donner une information officielle à la société
qui permettrait de donner la vision réelle de la médecine, de par-
ler d’acceptation de risques inhérents à toute pratique, et d’évi-
ter les abus d’optimisme et les fausses croyances dans l’infailli-
bilité des techniques mises en œuvre. ■
Pour en savoir plus...
❏Moutel G. Le consentement dans les pratiques de soins et de recherche : entre
idéalismes et réalités cliniques. Paris : Éd. L’Harmattan, 2003.
❏Anaes. Information des patients : recommandations destinées aux médecins.
Paris : Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (Anaes), mars
2000.
❏Conseil d’État. Réflexions du Conseil d’État sur le droit de la santé. Troisième
partie, déontologie et droits du patient. In : Rapport public 1998 : jurisprudence
et avis de 1997, réflexions sur le droit de la santé. Paris : La Documentation
Française, 1998:295-319.
INFORMATIONS

❏Guérot C. À propos de l’information donnée au patient : présentation des
résultats de l’enquête menée par la FSNSM auprès des sociétés savantes.
L’Entreprise médicale 2000 (17 avril 2000):7-8.
❏Sargos P. Information et consentement du patient. Bull Ordre Med 1999:10-2.
❏Guigne J, Esper C. Le juge judiciaire et le juge administratif se prononcent sur
l’information médicale du malade. Convergences ou divergences jurispruden-
tielles. Gaz Palais 1997:3.
❏Moutel G, Duchange N, Raffi F et al. APROCO-COPILOTE Study Group.
Communication of pharmacogenetic research results to HIV-infected treated
patients: standpoints of professionals and patients. Eur J Hum Genet 2005;
13(9):1055-62.
❏Boixiere A, Hergon E, Duchange N et al. Informing the transfused patient of
the possible transmission of variant Creutzfeldt-Jakob disease by blood transfu-
sion. Presse Med 2004;33(21):1533-7.
❏Moutard ML, Fauriel I, Moutel G et al. Parent’s information and prenatal dia-
gnosis of cerebral malformation with an uncertain prognosis. Arch Pediatr 2004;
11(5):423-8.
❏Danino A, Chahraoui K, Frachebois L et al. Effects of an informational CD-
ROM on anxiety and knowledge before aesthetic surgery: a randomised trial. Br
J Plast Surg 2005;58(3):379-83.
❏Manaouil C, Moutel G. The person of trust, a new tool in the physician-patient
relationship. Presse médicale 2004;33:1465-8.
❏Moutel G, François I, Moutard ML, Hervé C. L’arrêt Perruche, une occasion
de nous interroger sur l’acceptation du handicap et sur les rapports entre méde-
cine, justice et société. Press Med 2002;31(14):632-5.
❏Moutel G, Hervé C, Corviole K. Information des patients cancéreux sur la sté-
rilité induite par les traitements stérilisants et sur l’autoconservation de sperme.
Presse médicale 1994;23(36):1637-41.
❏Hazebroucq V. L’information du patient et le consentement éclairé. J Radiol
1999;80:411-2.
❏Sargos P. Le radiologue est désormais tenu de rapporter la preuve qu’il a
informé son patient des investigations ou du traitement proposés. La tribune juri-
dique 1997;2:1-3.
❏Savornin C, Clappaz P, Arvers P et al. Le devoir d’information et la pratique
quotidienne. Le concours médical 2000;122(17-18):1219-22.
INFORMATIONS
Bandeau Inspra, p. 22
1
/
5
100%