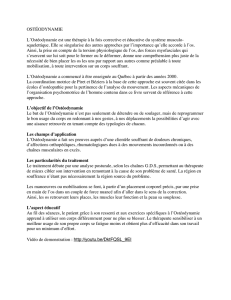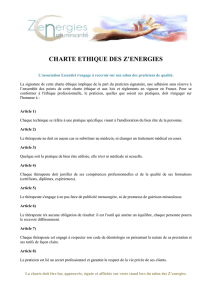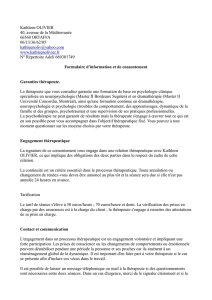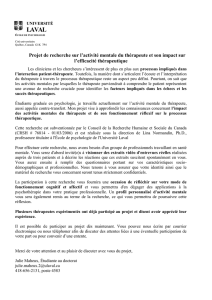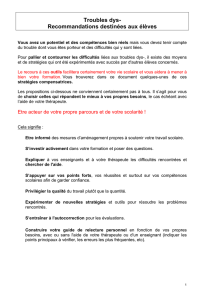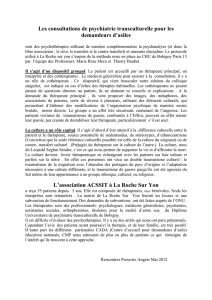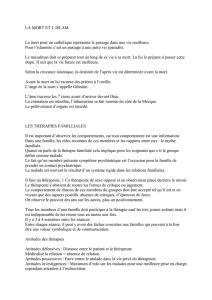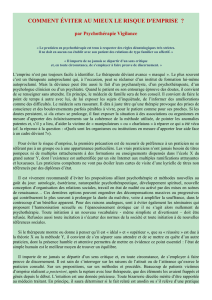C a s c l i n i... Au-delà du modèle

Act. Méd. Int. - Psychiatrie (16) - n° 4 - avril 1999
132
Cas clinique
En reprenant cette observation et en
abordant la question de la thérapeutique,
j’essayais de m’imaginer les questions
que mes confrères à orientation biolo-
gique ou psychanalytique pourraient me
poser. Quelle était la posologie de
l’Anafranil®? Combien de temps en
avait-il pris ? Quel type de psychothéra-
pie avait-il tenté et à quel rythme ?
Quelle était sa demande ? Y avait-il une
participation financière de sa part ? Il
faut bien tenter d’expliquer l’échec de
ces traitements éprouvés. Je dois recon-
naître que je n’ai pas de réponse à ces
questions, car, à cette époque, elles ne
m’étaient pas venues à l’esprit. En
revanche, j’avais alors un confrère orienté
vers les thérapies comportementales qui
m’affirmait que ce type de prise en charge
pouvait être efficace dans les cas de
névrose obsessionnelle. Je décidai donc
de lui adresser ce patient tout en écrivant
au médecin traitant que le pronostic était
réservé et que l’avenir me paraissait bien
sombre.
Je revis ce patient le 29 novembre 1989.
Il me dit alors : “Je suis transformé à
cent pour cent, je n’ai plus d’obsession.”
La conjonction d’une thérapie compor-
tementale et d’une chimiothérapie psy-
chotrope avait eu raison de ses symp-
tômes. La question du médecin traitant
concernait alors la réduction des médica-
ments puisque ce patient prenait un com-
primé de Laroxyl®50 ainsi qu’un com-
primé de Tercian®25 au coucher et un
comprimé de Survector®100 le matin. Je
commençais par interrompre le
Survector®et, par la suite, j’arrêtais éga-
lement le Tercian®. Actuellement, M. S.
va bien et il prend toujours un comprimé
* Service de psychiatrie des adultes,
hôpital Robert-Debré, Reims
Au-delà du modèle
J.M. Havet*
Je reçus pour la première fois en consultation, à la demande de son médecin traitant, M. S., le 20 juillet
1988.Cet homme de 35 ans,marié et père de deux enfants de deux et quatre ans,savait de quoi il souf-
frait.“J’ai des obsessions depuis 1986. Quand je croise quelqu’un, surtout s’il est fragile – comme une
femme enceinte,un enfant ou un vieillard –,je me retourne pour voir s’ils ne sont pas tombés et j’attends
jusqu’à ce que je ne les voie plus. Quand je conduis ma voiture, je me demande si je n’ai pas écrasé un
cycliste ; alors je reviens sur mes pas et, comme il y a chaque fois quelqu’un, je recommence parce que
j’ai des doutes.J’ai peur d’avoir dénudé un fil électrique et que quelqu’un s’électrocute.Même si je ne fais
que l’enjamber, je ne suis pas sûr de moi, je crois que j’ai marché dessus.Au travail,je vérifie les fils élec-
triques du distributeur de boissons pour m’assurer qu’ils ne sont pas dénudés. Mais comme je les ai
secoués, je me dis que c’est peut-être moi qui les ai dénudés lors de ma vérification et je retourne voir
comment ils sont.Quand je passe près d’une voiture en stationnement,je crains d’avoir déréglé le rétro-
viseur et ainsi de devenir responsable d’un accident.Alors, je m’assure qu’il est bien en place.Tout cela
m’épuise. Je sais que c’est absurde,mais je ne peux m’en empêcher.Cela ne me permet plus de travailler
comme conducteur de train. On m’a mis au balayage. Du fait de mes idées, je n’ai plus de relations
sexuelles avec mon épouse.” Il était alors en hospitalisation de nuit et traité par Tranxène®50 (un com-
primé le matin),Tercian®100 (un demi-comprimé trois fois par jour) et Ludiomil®(quarante gouttes au
coucher).Auparavant,il avait été traité,sans résultat,par Anafranil®en perfusion, sismothérapie et psycho-
thérapie.

133
de Laroxyl®25 au coucher. Il est devenu
un adepte du comportementalisme et
adresse, chaque fois qu’il le peut, des
patients à celui qu’il considère comme
son sauveur.
Cette histoire, si elle s’arrêtait là, serait
sans grand intérêt. Il ne s’agirait que d’un
cas parmi d’autres, démontrant les vertus
des thérapies comportementales dans le
traitement des névroses obsessionnelles
(ou des TOC, comme l’on dit mainte-
nant...), à condition d’y adjoindre des
médicaments pourrait-on se hâter d’ajou-
ter (même si ceux qui furent prescrits à
ce patient ne relèvent pas de la plus stricte
orthodoxie en la matière).
Toutefois, d’autres éléments méritent
d’être rapportés. En effet, un an après
notre seconde rencontre, M. S. m’apprit
qu’il était en instance de divorce. Son
épouse avait menacé de le quitter à
l’époque où ses symptômes étaient flo-
rissants parce que, disait-il, elle en avait
assez de l’entendre raconter ses obses-
sions. Cependant, assez curieusement,
c’est au moment où il fut débarrassé de
celles-ci qu’elle demanda le divorce.
Après coup, il se souvenait que, lorsqu’il
était rentré chez lui après sa première
consultation chez mon confrère compor-
tementaliste, il avait pris son épouse
dans les bras et lui avait dit : “Le docteur
m’a dit que je serai guéri dans six mois.”
Il avait alors été surpris par sa réaction
dont la froideur contrastait avec les
espoirs qui naissaient en lui. Ces événe-
ments s’intègrent parfaitement à la théo-
rie systémique qui veut que les symp-
tômes contribuent à l’homéostasie du
groupe familial et permettent d’éviter la
crise sous-jacente. De la même manière,
le surgissement de la symptomatologie
peu de temps après la naissance de son
second fils correspond parfaitement à
l’idée que les troubles apparaissent le
plus souvent lors des différentes étapes
du cycle de la vie familiale qui se carac-
térisent par l’entrée ou la sortie d’un
membre de la famille nucléaire (naissance,
adolescence, mariage, décès, etc.), mou-
vement qui, chaque fois, exige une réor-
ganisation des relations au sein de la
famille. Toujours est-il qu’avec la dispa-
rition des symptômes l’équilibre se
modifia. Il divorça et se remaria quelque
temps plus tard avec une femme qui,
n’ayant elle-même pas d’enfant, fut
ravie de pouvoir “adopter” les siens.
Cette nouvelle existence est, à ce qu’il
en dit, très satisfaisante pour lui, son
épouse et ses enfants. Même la venue à
la maison de sa maman âgée ne semble
avoir posé aucun problème. Une thérapie
familiale aurait-elle permis une aussi
bonne évolution ?
Enfin, ces neuf années de suivi furent
marquées par la survenue de “problèmes
digestifs”. M. S. se plaignit de grouille-
ments et de spasmes intestinaux, de gaz,
de douleurs abdominales, de diarrhées,
de tiraillements dans l’anus et de suinte-
ments à l’anus après les selles l’obligeant
à s’essuyer plusieurs fois. Ces troubles
qui furent, après les examens d’usage,
étiquetés “colopathie fonctionnelle”
cédèrent avec la prise d’un traitement
symptomatique (Duspatalin®, Bedelix®,
Débridat®, Smecta®) alors qu’il avait
craint d’avoir un cancer. Il fut parfois
nécessaire d’y adjoindre trois gélules de
Dogmatil®50 par jour, mais il n’y était
pas favorable car ce traitement lui faisait
prendre du poids. Actuellement, il ne ren-
contre plus aucun problème, il surveille
son alimentation en évitant les plats épi-
cés et il est satisfait d’avoir de “belles
selles”. Tout cela n’est pas sans nous rap-
peler l’analité caractéristique des obses-
sionnels, fort justement décrite par les
psychanalystes. Aurait-il été possible de
travailler cela en psychothérapie indivi-
duelle avec ce patient ?
Je voudrais revenir sur le traitement com-
portemental de ce patient, car compte
tenu des multiples pistes qu’il aurait été
possible de suivre, je me suis demandé ce
qui avait été opératoire dans cette prise
en charge. Était-ce la théorie en elle-
même, ou d’autres facteurs pouvaient-ils
être isolés ?
Il est certain que le modèle du thérapeute
a rencontré celui du patient qui a parfai-
tement intégré, sur le plan cognitif, les
concepts qui lui étaient proposés, puis-
qu’il lui arrive d’imaginer pour d’autres
ce qu’il faudrait faire dans des circons-
tances analogues à celles qu’il a connues
(par exemple, il m’a dit qu’il conseillerait
à quelqu’un qui vérifie plusieurs fois s’il
a bien fermé à clef sa boîte aux lettres de
la laisser ouverte volontairement).
Par ailleurs, il rapporte qu’ayant dit à son
thérapeute qu’il n’arriverait jamais à réa-
liser les tâches que ce dernier lui deman-
dait d’exécuter, celui-ci s’était levé et lui
avait dit en le regardant droit dans les
yeux : “Voulez-vous guérir ou non ?” Il
avait ainsi mis dans sa voix la conviction
de celui qui est certain de l’efficacité de
sa méthode. Or, les études sur le placebo
ont démontré que celui-ci est d’autant
plus actif que celui qui le prescrit est
convaincu du bien-fondé de sa prescrip-
tion. En outre, il entrait certainement
dans ses propos une part de suggestion
renforcée par l’asymétrie de la relation
médecin-malade.
Enfin, comme le patient hésitait à aller
volontairement dans la rue dérégler sys-
tématiquement tous les rétroviseurs des
voitures en stationnement ainsi qu’il le
lui avait demandé, le thérapeute l’accom-
pagna et commença lui-même à le faire
ce qui l’encouragea à poursuivre. Cet
engagement physique du thérapeute dans
la prise en charge contribua sans doute à
son engagement personnel vers le chan-
gement : il pouvait s’aventurer vers ce
qu’il redoutait le plus, car il avait
confiance dans le soutien que son théra-
peute lui apporterait puisque celui-ci
n’hésitait pas à se comporter comme il
lui demandait de le faire.
1
/
2
100%