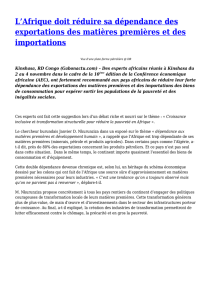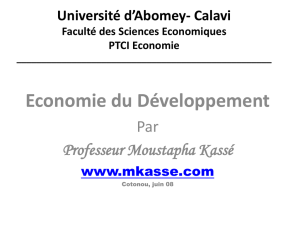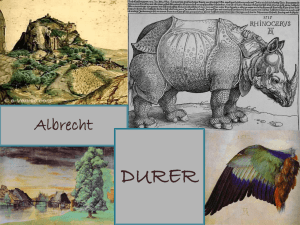ECODEV versfinale- Mai.doc
publicité

Economie du Développement Références africaines. Professeur Moustapha Kassé 1 ACRONYMES ET ABREVIATIONS ACDI : ACP : ACR : AFL : AGOA : AID : AIE : ALENA : AOC : APD : APE : ASEAN : ATTAC : Agence Canadienne de Développement International Afrique, Caraïbes et Pacifique Accords de Coopération Régionale Acte final de Lagos African Growth and Opportunity Act. Association International de Développement Agence Internationale l’Énergie Accord de Libre Échange Nord-américain Afrique de l'Ouest et du Centre Aide Publique au Développement Accords de Partenariat Économique Association des Pays du Sud-Est Asiatique Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Aide aux Citoyens BAD : Banque Africaine de Développement BCE : Banque Centrale Européenne BCEAO : Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest BEI : Banque européenne d’investissement BIRD : Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement BM : Banque Mondiale BRI : Banque des Règlements Internationaux BRVM : Bourse des Valeurs Mobilières d’Afrique de l’Ouest BVA : Bourse de Valeurs d’Abidjan CAD : Comité d’Aide au Développement CADTM : Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers-monde CAPC : Centre Africain de Politique Commerciale, Projet de la CEA, Adis CARPAS : Cadre de Référence pour les Politiques d’Ajustement Structurel CCCI : Conseil Consultatif International sur le coton CEA : Communauté Économique pour l’Afrique de l’Est CEDEAO : Communauté Économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest CEEAC : Communauté Économique des Etats de l’Afrique Centrale CEPAL : Commission Économique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes CEMAC : Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale CEPGL : Communauté Économique des Pays des Grands Lacs CER : Communautés Économiques Régionales CN : Comptabilité Nationale CNUCED : Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement CODESRIA : Conseil pour le Développement de la Recherche en Sciences sociales en Afrique COMESA : Marché Commun des Etats de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe CPCM : Comité Consultatif Permanent du Maghreb DIT : Division Internationale du Travail DRT : Division Régionale du Travail DSRP : Documents Stratégiques de Réduction de la Pauvreté DTS : Droits de Tirage Spéciaux EBE : Excédent Brut d’Exploitation ECOMOG: Economic Community of West African States Cease-Fire Monitoring FAO : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 2 FASR : FBCF : FCFA : Facilité d’Ajustement Structurel Renforcé Formation Brute de Capital Fixe Initialement Franc des Colonies Françaises d'Afrique actuellement Franc de la Communauté Franco-africaine. FED : Fonds européen de développement FMI : Fonds monétaire International FTN: Firmes Transnationales GATT: General Agreement on Tariffs and Trade GEAO : Groupe Économique d’Asie Orientale IADM : Allègement de la Dette Multilatérale IDE : Investissement Direct Étranger IDEP : Institut Africain de Développement Économique et de Planification IDH : Indice du Développement Humain IES : Infrastructures Économiques et Sociales IFAN : Institut Fondamental d’Afrique Noire IFI : Institutions Financières Internationales IPE : Industrialisation par Promotion des Exportations ISI : Industrialisation par Substitution aux Importations MAP: Millennium Partnership for the African Recovery Programme MAEP : Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs MCA : Millennium Challenge Account MERCOSUR : Marché commun Sud-américain NEP : Nouvelle politique économique NEPAD : Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique NPI : Nouveaux Pays Industrialisés NOEI : Nouvel Ordre Économique International OCDE : Comité d’Aide au Développement OIT : Organisation Internationale du Travail OMC : Organisation Mondiale pour le Commerce OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement OGM : Organismes Génétiques Modifiés ONG : Organisation Non Gouvernementale ONU : Organisation des Nations Unies ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel OPEP : Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole OUA : Organisation de l'Unité Africaine PAB : Plan d'Action de Beijing PAC : Politique Agricole Commune PANPP : Pays Africains Non Producteurs de Pétrole PAL : Plan d’Action de Lagos PAS : Politiques d’Ajustements Structurels PAZF : Pays Africains de la Zone Franc PDB : Produit Domestique Brut PDN : Produit Domestique Net PED : Pays en Développement PIB : Produit Intérieur Brut PIN : Produit Intérieur Net PL : Plus Value PLOM : Plan Omega PMA : Pays les Moins Avancés 3 PME : PMI : PNB : PNUD : PPA : PPTE : PSD : PST : PVD : RN : SACU : SADC : SEBC : SFD : SME : SMI : SMR : SGP : TCEN : TCER : TEE : TEP : TIC : TPE : TSA : UA : UDAA : UE : UEM : UEMOA : UFM : UMA : UNFPA : USAID : VAB : VAN : ZEP : ZMO : Petites et Moyennes Entreprises Petites et Moyennes Industries Produit National Brut Programme des Nations Unies pour le Développement Parité de Pouvoir d'achat Pays Pauvres Très Endettés Pays Sous-développés Politique Scientifique et Technique Pays en Voie de Développement Revenu National Union douanière d'Afrique Australe Communauté pour le Développement de l’Afrique Australe Système Européen de Banques Centrales Systèmes Financiers Décentralisés Système Monétaire Européen Système Monétaire International Système Monétaire Régional Système Généralisé de Préférences Taux de Change Effectif Nominal Taux de Change Effectif Réel Tableau Économique d’Ensemble Tonne Équivalent Pétrole Technologies de l’Information et de la Communication Taux de Protection Effective Tous Sauf les Armes Union Africaine Union Douanière de l’Afrique Union Européenne Union Économique et Monétaire Union Économique et Monétaire Ouest-Africain Union du Fleuve Mano Union du Maghreb Arabe Fonds des Nations Unis pour la Population United States Aid Valeur Ajoutée Brute Valeur Actualisée Nette Zone d’Échanges Préférentiels Zone Monétaire Optimale 4 Avant propos L’offre des économistes a du mal à répondre à cette amplification de la demande sociale d’où des interrogations de la communauté scientifique sur sa propre aptitude à tenir honorablement son rôle : Incontestablement, la crise est intellectuelle. Après son âge d’or, la science économique a connu des années noires : après trente années de certitude, l’heure des incertitudes s’est ouverte1 : « On ne sait plus prévoir, on ne sait plus agir, on ne sait plus interpréter. Crise de la prévision, tout d’abord face aux fluctuations spectaculaires et erratiques des marchés et des monnaies… Crise de la politique économique, ensuite, face au chômage et aux désordres monétaires… Crise de la pensée économique, enfin : s’il y a crise de la politique économique, c’est que l’on ne sait plus très bien analyser ce qui se passe, si l’on ne sait plus quoi faire, c’est que l’on ne sait plus lire »2 A.Geledan J’ai enseigné l’Economie du Développement à plusieurs générations d’étudiants depuis une trentaine d’années. L’évolution de cette discipline de la science économique n’a pas été un fleuve tranquille de sa phase ascendante, à son rejet brutal et, aujourd’hui à sa réhabilitation. Le référentiel théorique, les méthodologies d’approche des questions, les stratégies et politiques économiques et mêmes les instruments et techniques d’évaluation ont souvent varié et je les ai toujours diversement appréciés au gré de mes propres convictions et certitudes d’économiste engagé. J’ai plusieurs fois envisagé de systématiser les polycopies et notes de cours de mes étudiants en un ouvrage. Deux événements m’ont alors dissuadé : l’avènement à la fin des années 70 des Programmes d’Ajustement Structurel à l’élaboration desquels mon ami Eliot BERG3 avait généreusement voulu m’associer et la chute, au début des années 90, du socialisme réel en Europe de l’Est au moment où j’avais initié une évaluation critique et une rupture avec certaines visions de l’orthodoxie marxiste. Durant ces deux périodes historiques l'économie du développement est quasiment vouée aux gémonies par la domination écrasante de la pensée néoclassique4 et la prééminence de sa vision, de ses méthodes et de ses politiques. L’expérience nous apprend que lorsqu’ une théorie est dans cette phase ascendante, elle ne supporte ni contestation, ni réfutation, ni falsifiabilité. C’était le cas de l’analyse néo-classique dominante portée par la Banque mondiale qui est devenue un « maître à penser » de type nouveau puisque gardienne d’une épure décrétée « infaillible » et vigoureusement défendue par une armada de 6500 fonctionnaires qui s’appuient sur les services d’universitaires certainement parmi les plus A.GELEDAN : Histoire des pensées économiques, Édit. Sirey, 1988 C. STOFFAES : Fins de monde, Odile Jacob, 1987 3 Il était en charge d’élaborer pour la Banque mondiale les contre-propositions au Plan de Lagos. Il a alors produit le Rapport qui deviendra le justificatif des Programmes d’Ajustement Structurel : « Le développement accéléré en Afrique au Sud du Sahara- Programme indicatif d’action ». 4 Il est vrai que l’on confond sans nuance et à tort l'économie néoclassique à la pensée libérale ou ultralibérale. Des précisions seront apportées ultérieurement lorsque l’on étudiera les articulations de l’analyse économique néo-classique. 1 2 5 prestigieux, puisqu’appartenant à l’environnement des fameux prix Nobel. Alors, il s’est installé un manichéisme rarement vu dans l’histoire de la pensée sociale : d’un côté ceux qui croient au dogme dominant et de l’autre ceux qui n’y croient pas qui se voient refuser, au nom de la pertinence et de l’efficacité, toute distanciation critique. On a complètement oublié que l’économie pouvait se lire et s’écrire sur plusieurs modes puisqu’elle est la servante des sociétés. La science économique est réduite à 10 énoncés irréfutables justifiés par les gardiens du dogme : 1) la mondialisation est la voie inéluctable du bien-être, 2) l’intervention publique est moins efficace que celle du privé, 3) la primauté de l’économie sur le politique, 4) l’impératif de l’ouverture extérieur pour un commerce sans entrave, 5) la baisse des taux d’intérêt pour faciliter la croissance, 6) l’indispensable éradication de l’inflation, 7) le combat acharné contre le nuisible déficit public 8) la baisse de l’impôt des sociétés condition sine qua non de la venue massive des IDE, 9), la suppression de la législation protectrice du travail et du salaire minimum,10) l’apologie de l’Asie qui est la dernière frontière du monde. C’est le poncif de ceux qui dirigent la mondialisation. La science économique est transformée en une sorte de scholastique savamment habillée brillantine par des modèles quantitatifs qui ont réponse à tout. Des moyens énormes sont mobilisés par les parrains de tous bords pour assurer la diffusion de cette pensée unique. Dans pareil contexte, les « Nouveaux Maîtres » possèdent de fortes certitudes et des vérités éternelles et disposent de puissants moyens pour les imposer : stratégie médiatique et communication, forte emprise sur la recherche et les chercheurs particulièrement ceux des PSD. Ils ne souffrent ni controverses ni compétition des méthodes et des réponses. « Intellectuels et Chercheurs africains, surtout ceux au Sud du Sahara, dormez tranquilles, la Banque mondiale pense pour vous et placera vos pays sur le chemin d’une croissance vertueuse ».5 Avec cette exclusion, la politique économique, comme le veut la théorie de l’agence, va se jouer à deux : les Institutions Financières Internationales d’un côté et les Gouvernements africains de l’autre. Les premiers sont tantôt professeurs, médecins et gendarmes et les seconds sont les sujets, il leur est demandé d’appliquer les recettes tout en étant seuls comptables des résultats. Les universitaires et chercheurs ne sont intégrés dans le jeu qu’au niveau des schémas d’apprentissage : il leur est dévolu le travail de renforcement des capacités, recyclage etc.) des nouveaux modèles et des nouveaux instruments. En somme, ils sont appelés à disséminer les nouvelles options dans leur espace par le biais de leurs enseignements, des séminaires de formation, des forums, et ateliers etc. Tout le monde est enfermé dans le nouveau champ d’apprentissage et on a vite fait d’oublier comme l’observe J. P. FITOUSSI que seule la controverse est source des enrichissements et des progrès importants qui ont été réalisés, dans la science économique. D’importants progrès ont été réalisés grâce à la vivacité des controverses. Pou sûr, une science sans débats internes cessera de vivre. Au bout de vingt ans d’application des Programmes d’Ajustement, mon ami Eliot BERG est revenu m’inviter à la restitution d’une recherche intitulée « l’Ajustement ajourné »6. Quel énorme aveu d’échec : comme le note le proverbe Wolof « le fétu de paille restera un siècle dans le marigot, qu’il ne deviendra jamais L’efficacité des PAS ont fait l’objet de sévères critiques au sein même de la littérature orthodoxe. L’argument essentiel formulé par des auteurs comme KILLIL, DORNBUSCH, TAYLOR et FISHLOW, est que les PAS ont souvent pour effet d’aggraver les problèmes qu’ils sont supposés résoudre, ou de créer de sérieux effets secondaires indésirables. Les économistes les moins orthodoxes ont été les plus virulents dans leurs critiques. 6 Eliot BERG : l’Ajustement ajourné, Conférence patronnée par l’US-AID Sénégal 1998 5 6 un caïman». À l’évidence, ces politiques d’ajustement ont échoué dans ce qui était leur objectif principal : l’instauration d’un processus vertueux et irréversible de croissance économique. Les faibles performances de ces politiques dites du Consensus de Washington proviennent, comme le remarque J. E. STIGLITZ7, de la confusion des moyens avec les fins : la libéralisation, la recherche des grands équilibres, les privatisations sont prises comme des fins plutôt que comme des moyens d’une croissance durable, équitable et démocratique. Ensuite, elles se sont «beaucoup trop focalisées sur la stabilité des prix plutôt que la croissance et la stabilité de la production. En outre, elles n’ont pas su reconnaître que le renforcement des institutions financières est aussi important pour la stabilité économique que la maîtrise des déficits budgétaires et de la masse monétaire. Enfin, elles se sont concentrées sur les privatisations, mais n’ont guère attaché la moindre importance à l’infrastructure institutionnelle nécessaire au bon fonctionnement des marchés, et particulièrement à la compétitivité. Face à cette situation les PAS ont été abandonnés en catimini sans autre forme de procès remplacés par les DSRP qui tentent désespérément d’en conserver la substance. Conséquemment, les querelles doctrinales vont progressivement s’estomper cela d’autant plus que les couches intellectuelles protectrices désertent l’édifice ou ne le défendent plus avec l’acharnement d’antan. Certains courants de pensée économique parmi les plus conservateurs se mettent à réhabiliter l’Économie du développement. « La fille aux mauvaises fréquentations » devient estimable voire fréquentable. Le chemin de cette réhabilitation passe par la réconciliation entre la croissance économique et le développement social auquel le Programme des Nations Unies pour le Développement a donné ses lettres de noblesse en créant le concept du Développement Humain Durable (DHD). Plus qu’une simple notion, le développement humain durable (DHD) fait référence à un système complet de modèles : modèles de production, modèles de reproduction sociale, modèles de répartition, modèles de participation, modèles d’institutionnalisation, modèles de socialisation. C’est aussi le PNUD qui prend l’initiative de rouvrir le débat sur les questions essentielles du développement économique après les propositions du Rapport Willy Brandt, de la Commission Sud ou du Forum du Tiers-monde. Le projet fut confié au pakistanais MAHBUB UL HAQ qui a longtemps séjourné à la Banque mondiale. Pour la première fois un Rapport international se « référait aux auteurs classiques et fondait son argumentaire SUR KANT, QUESNAY, A. SMITH, RICARDO, MARX, J.S. MILL et reconnaissait que les individus ne sauraient être réduits à la seule dimension de « l’homo économicus ». Progressivement le PNUD marque sa rupture d’avec la vision de la Banque mondiale. Il va s’en suivre un bouillonnement et un regain d’intérêt pour les théories du développement. Le développement qui représente une transformation de la société, le passage de relations traditionnelles, de modes de pensée traditionnels, de façons traditionnelles de traiter la santé et l’éducation, de méthodes traditionnelles de production, vers des approches plus «modernes». Cette nouvelle Économie du développement regroupe l'ensemble des pratiques théoriques qui s'éloignent du modèle walrassien en reconnaissant les imperfections Dans ses deux ouvrages qui ont suivi sa sortie de la Banque mondiale en 2000 (La grande désillusion en 2002 et Un autre monde : contre le fanatisme du marché 2006), il a mis à la disposition de la communauté des économistes des analyses pénétrantes sur l’architecture de l’économie mondiale et la faillite de la gouvernance économique mondiale que devraient réaliser les institutions financières internationales. 7 7 du marché et l'incapacité des politiques de stabilisation et d'ajustement orthodoxes (inspirées de ce modèle de base) à opérer les transformations nécessaires à une reprise durable de la croissance dans les pays africains. Manifestement, il est devenu, aujourd’hui, plus intéressant de publier un ouvrage d’économie du développement notamment avec des références à l’Afrique dont tout le monde souhaite qu’elle « Retrouve sa place dans le 21ème siècle ». En effet, depuis la fin des années 90, le dédain vis-à-vis de l’Économie du Développement n’est plus de mise du fait que le développement se trouve « au cœur de vives controverses et plus encore des avancées conceptuelles marquantes au sein de la théorie économique.8 C’est cela qui explique, sans doute, le foisonnement des Manuels d’Économie du Développement : « les Dévelops » n’occupent plus une position inférieure dans l’échelle des valeurs de la tribu des Économistes (Prenab BARDHAN, 2001)9. Enfin, « mille écoles peuvent maintenant rivaliser ». Cetouvrage vient s’ajouter à toutes ces réflexions avec un triple questionnment: Qu’est ce que le sous-développement à travers les expériences africaines ? Comment les théories économiques appréhendent-elles cette réalité ? Quelles stratégies et politiques de sortie de cet état ? Ces trois questions sont au cœur de l’objet même de l’Économie du Développement qui est de fait la boîte à outils de la science économique qu’il faut solliciter pour trouver les réponses les plus idoines même si elle a été pour un temps « la belle au bois dormant ». Cet ouvrage se propose de mettre à la disposition des chercheurs et étudiants, des experts, des intellectuels et des décideurs le maximum de références et d’informations pour faire avancer la réflexion sur les complexes et difficiles problèmes du développement africain. R.BOYER : L’année de la Régulation : « Qu’on en juge : la théorie de l’information imparfaite et des contrats (principal/agence, STIGLITZ, 1987), alimente la réflexion sur des caractéristiques essentielles d’une économie rurale (BARDHAN, 1989). Les externalités associées aux problèmes de coordination suscitent des formalisations traitant aussi bien de la croissance endogène (LUCAS, 1993) que de la multiplicité des équilibres lorsque les préférences et les stratégies sont interdépendantes (HOLF et STIGLITZ, 2001) ». 9 Pendant longtemps, l’Économie du Développement revêtait une importance secondaire comme l’illustre ce propos de Axel LEIJONHUFVUD (1973) «La caste des prêtres, les Maths-Écons, appartient à une sphère supérieure à la fois aux Micro ou Macro, tandis que les Dévelops occupent clairement une position encore inférieure. Cela tient au fait qu’ils n’ont pas strictement respecté les tabous interdisant l’association avec les Polscis, Sociogs et autres tribus. Les autres Écons les regardent avec suspicion car ils mettent en danger la fibre morale de la tribu et ils soupçonnent même les Dévelops de renoncer à la modélisation. 8 8 Introduction générale La crise du développement est aussi une crise de la théorie du développement. La seule croissance économique, même rapide, n’apporte pas de solution aux problèmes sociaux, n’élimine pas la misère et le chômage. Pour amorcer un processus de développement de longue haleine, il faut beaucoup plus qu’une modernisation parcellaire de l’appareil de production et le mirage d’une urbanisation effrénée. Ignacy Sachs10 Le concept du développement a suivi depuis son apparition chez les économistes classiques, jusqu’à nos jours, une évolution désordonnée : accepté au siècle dernier comme l’objectif de toutes les nations, ses théories seront rejetées par la suite avec mépris par l’orthodoxie néo-classique dominante. Actuellement réhabilité, il intègre parfaitement le discours à la fois des économistes et des hommes politiques. Dans la maïeutique de la science économique, doit-on considérer l’économie du développement comme un savoir autonome au même titre que la macroéconomie, la microéconomie, l’économie internationale, les finances publiques ou alors est-elle simplement un chapitre des théories macroéconomiques ? Quel est exactement son statut dans la science économique ? I / Naissance de l'Économie du Développement Si le développement économique a dominé la science économique dès son origine au 18ème siècle avec les travaux d'Adam Smith (1776), le débat sur l'économie du développement comme problématique et questionnements spécifiques sur les pays sous-développés commence seulement au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale et en pleine guerre froide. Confirmation, le Président des États-Unis Harry TRUMAN, à l’occasion de son discours sur l'état de l'Union, le 20 janvier 1949, utilise pour la première fois le terme de développement pour justifier l'aide aux PSD dans le cadre de la lutte contre le communisme en pleine expansion. Il y déclara clairement que le devoir des pays du Nord capitalistes, qualifiés de pays développés, est de diffuser leurs technologies et de distribuer leur assistance aux pays qualifiés de « sousdéveloppés », afin qu'ils se rapprochent du modèle de société occidental. C'est dire que l'économie du développement a été forgée, en tant que discipline, il y a une cinquantaine d'années. Au même moment se mettaient en place le système de Bretton Woods et les principales institutions internationales comme la Banque mondiale et le FMI. Branche très importante de la science économique, on peut la définir comme l'analyse économique appliquée au processus de développement et à l'étude des pays en développement. Elle trace donc une frontière entre la science économique, la géographie et la sociologie ce qui soulève des problèmes fondamentaux sur sa définition et ses objectifs. Aujourd'hui, les études d'économie du développement sont essentielles au moins pour trois raisons : La première raison est que la science économique ne saurait se limiter à l'explication des problèmes du développement à partir des hypothèses exclusives de l'homo-economicus et de l'individualisme méthodologique, si tant est que la science économique doit être la servante des sociétés, de toutes les sociétés. En effet, l’homo10 Ignacy SACHS : Pour une économie politique du développement, Edition Flammarion, 1977 p.9 9 economicus est doté d’une rationalité de type individualiste et non holiste. La société a, dans un tel schéma, affaire à des individus « émancipés » conscients de leur existence et des rapports sociaux qu’ils alimentent. Or, dans la plupart des pays en développement, le groupe prime sur l’individu. La rationalité d’un individu ne dépend pas toujours et uniquement de sa satisfaction personnelle, son utilité (NDIAYE, 1999 ; SEN, 1983) ; La seconde raison provient du fait que les études du développement dans des aires par essence pré-capitaliste et non occidentales sont utiles et importantes et nécessitent la recherche d'instruments analytiques appropriés pour la pertinence des résultats. Comme l'observe A. HIRSCHMAN (1984), on ne saurait aborder l'étude des économies sous-développées sans modifier profondément, sous un certain nombre de rapports importants, les données de l'analyse économique traditionnelle, axée sur les pays industrialisés ; La troisième raison est que l'économie du développement conduit, par la diversité des champs disciplinaires concernés, à constater la difficulté à dissocier analyse scientifique et vision idéologique. II/ La difficulté de trouver un statut à l’économie du développement dans la science économique qui est devenue une entreprise gigantesque. La place de l’économie du développement dans le corpus théorique de la Science Économique est fortement controversée. Toutes les réflexions sur le développement soulèvent des controverses et des clivages théoriques relatifs à la caractérisation du sous-développement et aux stratégies à mettre en œuvre pour en sortir. Ces réflexions théoriques peuvent se ramener à deux courants qui correspondent à des visions différentes : le premier comprend les analyses qui tentent de replacer l’économie du développement dans le champ de l’économie néo-classique standard qui ignore notamment la dimension historique du sous-développement et le deuxième courant regroupe toutes les analyses alternatives qui postulent l’existence de spécificités communes à un ensemble de pays condamnés à réaliser des transformations qui les rendent aptes à déclencher un processus auto-entretenu de croissance. C’est l’ensemble de ces théories qui fondent l’économie du développement. 1°) Le premier courant considère l’économie du développement comme un simple prolongement de l’analyse macroéconomique. Pour ces auteurs, il n’existe qu’une science économique et les théories du développement doivent conforter ce mono-économisme et ne peuvent se constituer comme une branche spécifique Dans cette optique, la macroéconomie qui a connu un important développement ces dernières années s’est formalisée comme une théorie de l’équilibre global se fondant sur les grandeurs caractéristiques de l’activité (circuit économique, agrégats, fonction de production, de consommation et d’investissement, propension, multiplicateur, accélérateur) et des démarches qui articulent ces divers outils pour constituer des théories (théorie de l’équilibre macroéconomique, théorie des fluctuations et de la croissance, modélisation ou tentative de représentation abstraite de la totalité d’un système productif) qui peuvent rendre compte des questions de développement. Dès lors, certains auteurs se fondant sur ces acquis de l’analyse macroéconomique estiment que l’Économie du Développement ne doit pas être une 10 discipline autonome car sa problématique s’insère parfaitement dans celle de la Macroéconomie. En effet, les modèles normatifs agrégés comportant trois facteurs (travail, capital, technologie) rendent bien compte des préoccupations de développement, c’est-à-dire d’accroissement soutenu d’une grandeur de dimension nationale comme le produit national ou le revenu national. Ainsi, en considérant que le Produit Global (Y) est constitué de la Demande globale qui se compose de la Demande de Consommation (C) et de la Demande d’Investissement (I), on peut écrire que : (1) Y = C+I (2) C = Co + cY (3) I = Io - iY I = Investissement avec C = Consommation Co = Niveau incompressible de la consommation i = taux d’intérêt Y= Produit global En introduisant l’équation (1) et (2) dans la troisième, o+n obtient : 1 Y (C o I o ) 1 c i Certains auteurs ne sont pas loin de considérer que cet équilibre est applicable à toute économie quelle qu’elle soit. La seule précaution à prendre au plan analytique est une bonne estimation des variations que sont la consommation, l’investissement, le taux d’intérêt. La comptabilité nationale doit être en mesure d’offrir des évaluations exhaustives par le biais des prix et des marchés. Par ailleurs, pour passer de la statique à la dynamique, il suffit de procéder à une dérivation du système global, ce qui permet le déplacement du niveau d’équilibre de Y. 1 En écrivant que Y C o I o 1 c i On peut constater que les variations de Y peuvent être induites par une variation d’un des paramètres Co, Io, c, i. Ce qui nous donne : Y 1 C o 1 c i Y 1 I o 1 c i Y 1 (C o I o ) i (1 c i ) 2 En considérant les phénomènes monétaires, les analyses macroéconomiques retiennent certaines équations caractéristiques pour le marché de la Monnaie, à savoir : les équations de la demande de monnaie, du fait que la demande de monnaie découle de trois (03) motifs : de transaction, de spéculation et de précaution. Les deux premiers sont les plus déterminants. En effet, la monnaie est principalement un instrument de transaction. La demande d’encaisses de transactions découle de la non synchronisation des flux de recettes et de dépenses. Comme au niveau macroéconomique, les dépenses de certains agents sont les revenus pour d’autres, on dira que la Demande d’encaisses de transaction sera une fonction du revenu global, cela permet d’écrire que : 11 (1) M1 = M1(Y) ou encore M1 = k.P.Y. Pour la Demande pour des motifs de spéculation, elle est liée au fait que la monnaie peut permettre des plus values sur le Capital. Le spéculateur est celui qui achète des actifs financiers quand les taux d’intérêt sont faibles et qui les revend quand ceux-ci augmentent. Cela permet d’écrire que : (2) M2 = M2(i) La demande totale de monnaie sera : (3) Md = M1 + M2. Quant à l’offre, elle est une donnée exogène au système Mo = Mo. À l’équilibre, on a : Mo = Md ou en encore Mo = M1(Y) + M2(i). Là encore, des instruments de l’analyse monétaire sont universalisables car les motifs de la monnaie se présentent de la même manière dans tous les pays. Dès lors, les équations de comportement sont les mêmes partout. C’est seulement le niveau des grandeurs qui peut être différent d’un pays à l’autre. Au total, sur le marché du produit comme sur celui de la monnaie, l’analyse macroéconomique peut rendre compte des préoccupations de l’économie du développement. On peut aboutir au même résultat en prenant d’autres exemples comme la comptabilité nationale ou même la modélisation normative macroéconomique. Dans ce dernier cas, si on considère une fonction agrégée de production (k, l), une concurrence parfaite sur les marchés des produits et des facteurs, un prix des facteurs égal à la production marginale, il existe deux variantes de modèle normatif : celui à coefficient fixe de HARROD-DOMAR et celui à coefficient flexible de l’analyse néo-classique. On pourrait bien établir que les questions de développement et de croissance avec les concepts et outils qui ressortent des théories explicatives relèvent des deux types de modèle. Ainsi, la théorie du développement se pose deux questions : La première question est la suivante : étant donné certains taux d’accroissement des inputs travail et capital, comment s’effectue une expansion régulière et soutenue de la production ? Dans un modèle de type harrodien, il suffit d’écrire que (1) G.C = S avec G : taux de croissance, C : coefficient de capital, S : épargne. Ce modèle contient deux grandeurs macroéconomiques : l’Investissement et l’Épargne qui déterminent à la fois le processus de croissance et celui de l’équilibre. En effet, en posant : Y S I (2) G ; et C S Y Y Y (3) On peut remplacer dans (1) Y I S I S ou Y Y Y Y Y La politique de développement pourrait être comprise comme une perturbation (macrodynamique) de l’équilibre soit à partir de l’investissement (pour financer une politique agraire, industrielle, technologique, etc.) ou de l’épargne (compression de consommation, importation de ressources financières, endettement, etc.). 12 Quant à la seconde question, elle se formule comme suit : l’économie considérée n’est pas au départ engagée dans un processus d’expansion, va-t-elle s’en rapprocher ou s’en écarter ? Cela soulève la problématique de la stabilité de l’équilibre. En somme, pour beaucoup d’auteurs, ce processus de théorisation macroéconomique prend bel et bien en charge l’économie du développement. Donc celle-ci ne doit pas se constituer comme discipline autonome, elle n’est que le prolongement de la macroéconomie. L’économie du développement se démarque de cette dérive de la théorie économique standard en renouant avec les traditions de l’économie politique classique, en se servant des possibilités ouvertes par l’économie keynésienne sur le rôle actif de l’État afin de limiter le chômage et d’augmenter la croissance. 2°) La deuxième attitude théorique considère l’économie du développement comme un chapitre récent de la science économique. Le développement est en panne, sa théorie en crise et son idéologie fait l’objet de doute. Samir AMIN : La faillite du développement Cette position est soutenue par Samir AMIN. Le point de départ de l’auteur est qu’il faut abandonner toute prétention d’élaboration d’une théorie économique pure dont l’outillage conceptuel se situerait à un niveau d’abstraction opérationnelle pour l’analyse du fonctionnement des mécanismes d’une société. La seule science possible est celle de la société car le fait social est unique et comporte à la fois une dimension économique, sociale, politique. Il n’existe aucune raison pour privilégier l’aspect économique. Par ailleurs, l’art du développement veut précéder la science qui seule peut expliquer le développement et le sousdéveloppement comme des faits historiques. L’Économie du Développement serait alors pour Samir AMIN un chapitre très récent de la Science Économique puisque, jusqu’à la première Guerre Mondiale, la théorie économique ne nourrissait aucune préoccupation d’analyse des systèmes et des structures. Celle-ci était totalement hors du champ de la Science Économique. L’Économie du Développement s’est donc constituée sous la pression des faits et des besoins urgents. Elle s’est voulue dès l’origine au service des gouvernements engagés dans l’action pratique du développement économique et social. Samir AMIN conclut en observant «ainsi, comme la Science Économique générale, l’Économie du Développement comportera nécessairement deux (02) chapitres distincts : l’un d’analyse fondamentale qui, en partant de l’observation, s’assigne comme objectif l’élaboration d’une théorie du sous-développement et du développement et l’autre d’application orientée vers l’action et la transformation des structures, un art de gestion économique dérivé de la théorie du développement». Dans ce contexte, un problème méthodologique va se poser et consistera à soumettre toutes les catégories de la Science Économique à une sorte de test d’universalité pour mesurer leur domaine de pertinence : problématique de la vérification de l’utilité de la trousse à outils. C’est cela qui a obligé Samir AMIN à une remise en question généralisée de toutes les théories économiques. Cette démarche laisse ouverte certaines questions comme : quelles sont les frontières correctes de la recherche économique et quelle est la nature de la collaboration avec les autres Sciences Sociales ? Qu’entend-on par pertinence de tel ou tel jeu de concepts 13 théoriques ? Quelle relation unit en économie, la Science positive et la politique ? Peut-il exister une Science Économique valable pour l’ensemble du monde ? Les difficultés méthodologiques qui ressortent de ces interrogations expliquent la troisième thèse qui est celle des économistes qui récusent la théorie monoéconomiste dominante dans la pensée surtout universitaire. 3°) La troisième thèse considère que l’économie du développement doit se constituer en discipline autonome en s’assignant un double objectif : offrir une représentation théorique cohérente du sousdéveloppement et indiquer les voies et moyens pour en sortir. Cette autonomie est une volonté de donner à la théorie du développement, un statut scientifique par les questions qu’elle soulève et les méthodes qui permettent d’y répondre. De ce fait, on pourra débloquer l’analyse en brisant les moules étroits des concepts systématiques et en remettant les idées en mouvement. Les économistes ont, dans les pays développés, tendance à échafauder des théories compliquées et complètement détachées du réel. Il en va ainsi car la science économique dans ces pays fait partie du système de croyances conçu moins pour révéler la vérité que pour rassurer les citoyens sur l’organisation sociale. Ce luxe serait trop coûteux pour des pays sous-développés vers lesquels, observe Jean ROBINSON, «on exporte les doctrines afin de les empêcher de trouver une issue à leur situation». Pour aboutir à l’élaboration d’une économie du développement, il faut partir de la double incapacité de la théorie économique de donner une représentation totale ou expressive du sous-développement et indiquer des directions de transformation. En effet, si l’on considère la théorie économique comme une théorie de la coordination d’un système décentralisé, donc une théorie des rapports décentralisés, donc une théorie des rapports marchands comme l’autorise le texte de WALRAS, on s’aperçoit aisément que les catégories utilisées sont impertinentes dans les formations sociales sous-développées qui sont à dominante non capitaliste. La plupart des échanges y sont non marchandes, l’espace économique est hétérogénéisé par des cloisons et barrières rendant le marché totalement imparfait, la croissance ne peut être auto-entretenue par suite de l’existence de multiples déséquilibres et enfin les régimes autoritaires qui y prévalent ne connaissent pas de débat démocratique, donc un processus de génération des choix collectifs par interaction des choix individuels. Si, en revanche, on confère à la théorie économique une acception systématique pour en faire une théorie de l’équilibre stable d’un système complexe, les catégories économiques usuelles n’ont plus la même signification, ni la même portée analytique. À titre d’illustration, l’équilibre ne signifie plus que l’aptitude de l’organisation sociale ne peut pas être bloquée, l’optimum parétien signifie que toute organisation ne fonctionne qu’en tant que jeu à somme non nulle, la croissance équilibrée signifierait que toutes les variables d’état augmentent au même taux. L’économie du développement s’avère alors tout à fait indispensable pour interpréter et transformer le sous-développement. En fait, les conclusions théoriques dépendent avant tout, non pas des méthodes employées, mais des questions que la théorie pose. L’analyse macroéconomique qui transfère la réflexion théorique sur les mathématiques et la statistique (considérées comme des fins et non comme des moyens) est incapable de gérer les théories et problèmes du développement économique et social qui ne peuvent relever que de l’économie politique du développement. 14 III/ Que recouvre l’Économie du Développement ? La diversité des approches en économie du développement se traduit par l’existence de plusieurs définitions du phénomène du développement qui en est l’objet principal. 1°) A première approximation qu’est que le développement ? Selon KUZNETS, la notion de développement économique qui se distingue de la croissance économique (élévation du revenu par tête et du produit intérieur brut) combine trois éléments : une croissance économique auto-entretenue, des changements structurels de la production et le progrès technologique. Les historiens du développement, les théoriciens du développement de la nouvelle école institutionnelle et les économistes néoclassiques du développement ajoutent à ces éléments la modernisation institutionnelle qui permet aux marchés d’orienter rationnellement les décisions économiques des individus. Les théoriciens de la modernisation ajoutent le développement politique et social à la liste tandis que l’école de l’esprit d’entreprise insiste sur l’évolution socioculturelle. Enfin, les défaillances du processus de croissance qu’ont connu les pays en développement ont amené certains à ajouter l’augmentation du bien-être au bénéfice du plus grand nombre à la liste des caractéristiques du développement économique. Maurice BYE rappelle que toute science est avant tout une question de vocabulaire, c’est-à-dire un ensemble de concepts clairement définis et toute définition devra servir l’analyse qui en usera. Dans ce sens, la définition la plus consensuelle et la plus usitée est celle proposée par F. PERROUX pour qui « le développement est la combinaison des changements mentaux et sociaux d’une population qui la rendent apte à faire croître, cumulativement et durablement, son produit réel global ». Des auteurs comme P. Hugon apporteront des enrichissements en ajoutant que le développement est aussi « un processus de changements structurels accompagnant l’accroissement de la productivité du travail sur une longue période. Il est processus cumulatif caractérisé par la transformation des relations sociales et des modes d’organisation liés à l’affectation du surplus à des fins d’accumulation productive et conduisant à un accroissement de la productivité et sa diffusion dans un espace donné » Il en va de même pour A.O. HIRSCHMAN (1964) lorsqu’ il observe que « dans la typologie l’appellation économie du développement est réservée à l’un des courants théoriques qui analysent les problèmes de développement et de sous-développement. L’économie du développement se caractérise par le refus du mono-économisme (conception unique de l’économie) et l’affirmation d’une communauté d’intérêt entre pays riches et les pays pauvres ». Dans la même veine J. R. HICKS ajoute (en 1965) que « l’économie du sousdéveloppement est un sujet extrêmement important, mais ce n’est pas un sujet formel ou théorique. C’est un sujet pratique qui implique le recours à toute branche de la théorie qui le concerne… S’il y a une branche de la théorie économique, qui le concerne spécialement, c’est la théorie du commerce international ». Toutefois, « Si l’on veut plus de développement, il faut d’abord plus d’économie » (Stephen ENKE, 1963). 15 2°) Le développement peut aussi se définir à partir de facteurs plus quantitatifs que qualitatifs : le développement comme croissance du revenu par habitant, le développement comme changement structurel et le développement comme processus de dépendance. a) Le développement assimilé à la croissance du revenu. Plusieurs auteurs assimilent développement et croissance, notamment celle du revenu national. Sans entrer dans le débat, on observe qu’une variété de statistiques similaires exprime le revenu d’une nation : Produit Intérieur Brut (PIB), Produit Intérieur Net (PIN), Produit Domestique Brut (PDB), Produit Domestique Net (PDN), etc. même si les différences entre ces statistiques sont mineures : ces agrégats sont tous des mesures de la valeur monétaire globale de tous les biens (récoltes, tissus, etc.) et tous les services (transports, tailleurs, etc.) produits dans une année. Donc, la mesure du développement pourrait indifféremment être le RN per capita, le PIB par habitant, ou le PIN par habitant, etc. Cette définition est la plus couramment utilisée bien que comportant des limites qu’il importe de souligner avant d’aller plus loin. Celles-ci sont de quatre ordres : D’abord, le manque de précision dans les statistiques, surtout pour les pays sous-développés. À grands traits les raisons tiennent à divers facteurs : mauvaise quantification du nombre d’habitants, partie importante du PIB n’est pas commercialisée et prend la forme d’auto-consommation. Ensuite, le revenu moyen peut être loin du revenu reçu par un citoyen typique. Souvent, il est obtenu en divisant le PIB total par le nombre d’habitants. Toutefois, la meilleure mesure serait le revenu médian calculé en mettant en ordre tous les habitants, en allant du plus pauvre au plus riche. Pour faire ce calcul, il faut connaître le revenu de chaque individu, ce que les statistiques actuelles ne permettent pas. Le degré de surestimation dépend du degré d’inégalité dans la répartition des revenus. Selon les observations de l’économiste Simon KUZNETS, au cours du développement économique d’un pays, la répartition des revenus commence par devenir plus inégalitaire, mais ensuite devient moins inégalitaire au-delà d’un certain niveau du développement. L’implication est que l’écart entre le PIB par habitant (le revenu moyen) et le revenu d’un citoyen typique (le revenu médian) varie avec le niveau du développement du pays. En outre, les difficultés de comparaison du PIB/habitant entre différents pays. La comparaison internationale suppose que l’on rapporte les différentes devises nationales à une devise commune qui sert d’étalon de valeur (généralement, c’est le dollar). Seulement les fluctuations des taux de change rendent difficiles les comparaisons. Enfin, le revenu n’est ni le niveau de vie ni le bonheur national. Il est très compliqué de mesurer statistiquement le niveau de vie, à fortiori celui du bonheur dans un pays. Les comparaisons internationales sont tout aussi difficiles. En définitive, pour éviter tous ces problèmes découlant de la mesure du PIB, quelques économistes utilisent d’autres indices de développement comme la production d’électricité par habitant, l’espérance de vie, le nombre de lits d’hôpital par habitant, les kilomètres de voierie par kilomètre carré du territoire, etc. Mais comment peut-on ajouter des kilowatts d’électricité à des années d’espérance de vie ? L’Indice du Développement Humain (IDH) lancé par le PNUD est maintenant 16 souvent évoqué. C’est un indice composite calculé à partir d’une moyenne pondérée des indices. Le «poids» de chaque mesure entrant dans la moyenne pondérée est calculé en utilisant une technique statistique appelée l’analyse factorielle. b) Le développement comme changement structurel La mesure du développement par la croissance du revenu par habitant est une mesure purement économique et quantitative et elle écarte tout autre paramètre non économique. Mais le développement d’un pays entraîne toute une série de changements, sur le plan social, politique, psychologique, etc. autant que sur le plan économique. Beaucoup d’auteurs font une distinction entre «croissance» (qu’ils définissent comme un changement du niveau du revenu sans changement des aspects non économiques de la société) et «développement» (qu’ils définissent comme un changement simultané des aspects sociaux, politiques, économiques de la structure de la société). Le problème consiste à déterminer les changements spécifiques de la structure de la société qui constitueraient un «développement» c) Le développement comme processus de dépendance Les pays sous-développés sont définis par une double dépendance vis-à-vis de l’extérieur (exportations, importations, cours des matières premières, aides extérieures, flux financiers) et de facteurs internes (climat, conditions de production etc.). Tous ces facteurs ne sont pas sous contrôle et créent des instabilités et des risques sur le fonctionnement des économies. En prenant par exemple les exportations, on s’aperçoit qu’elles sont souvent dominées par un ou deux produits agricoles ou miniers, et les prix de ces produits subissent souvent des fluctuations violentes (pour des raisons que nous verrons plus tard). En l’espace d’un ou de deux ans, le prix peut être multiplié (ou divisé) par 3 ou même par 5 (ex. phosphates, sucre, cuivre, café, pétrole). Bien évidemment, il est très difficile de mesurer le niveau d’indépendance d’un pays ou de comparer le degré d’indépendance de différents pays. Les indicateurs utilisés comme le taux d’insertion à l’économie mondiale calculés à partir des éléments de la balance commerciale peuvent s’avérer insuffisants. La notion de développement a fait l’objet de diverses critiques. D’abord, elle fait de l’accumulation technico-économique le préalable à tout changement social, ce qui revient à nier le caractère indissociablement culturel des processus économiques et la dimension multidimensionnelle du changement social. Ensuite, elle traduirait la volonté des Occidentaux d’imposer leur modèle culturel. Pour les tenants de cette thèse, le développement est un paradigme occidental qui recouvre une expérience historique faussement exemplaire, celle de l’Europe de l’Ouest et un ensemble de croyances (croyance en un temps cumulatif et linéaire, croyance en l’attribution à l’homme de la mission de dominer totalement la nature, croyance en la raison calculatrice). Enfin, certains soulignent l’origine politique du concept. Ainsi, la notion de pays sous-développés date-t –elle du discours du Président américain H. TRUMAN de 1949. À l’époque, il s’agissait de convaincre le contribuable américain d’aider les pays sous-développés pour des raisons géopolitiques : il fallait limiter l’expansion du communisme. Pour les américains, le système colonial et surtout la misère contribuaient à l’essor des mouvements révolutionnaires. 17 Encadré 1 : Quelques Critiques de la notion de développement. Selon KUZNETS, la notion de développement économique qui se distingue de la croissance économique (élévation du revenu par tête et du produit intérieur brut) combine trois éléments : une croissance économique auto-entretenue, des changements structurels de la production et le progrès technologique. Les historiens du développement, les théoriciens du développement de la nouvelle école institutionnelle et les économistes néoclassiques du développement ajoutent à ces éléments la modernisation institutionnelle qui permet aux marchés d’orienter rationnellement les décisions économiques des individus. Les théoriciens de la modernisation ajoutent le développement politique et social à la liste, tandis que l’école de l’esprit d’entreprise insiste sur l’évolution socioculturelle. Enfin, les défaillances du processus de croissance qu’ont connu les pays en développement ont amené certains à ajouter l’augmentation du bien-être au bénéfice du plus grand nombre à la liste des caractéristiques du développement économique. La notion de développement a fait l’objet de diverses critiques. D’abord, elle fait de l’accumulation technico-économique le préalable à tout changement social ce qui revient à nier le caractère indissociablement culturel des processus économiques et la dimension multidimensionnelle du changement social. Ensuite, elle traduirait la volonté des Occidentaux d’imposer leur modèle culturel. Pour les tenants de cette thèse, le développement est un paradigme occidental qui recouvre une expérience historique faussement exemplaire, celle de l’Europe de l’Ouest et un ensemble de croyances (croyance en un temps cumulatif et linéaire, croyance en l’attribution à l’homme de la mission de dominer totalement la nature, croyance en la raison calculatrice). Enfin, certains soulignent l’origine politique du concept. Ainsi, la notion de pays sousdéveloppés date-t-elle du discours du Président américain H. TRUMAN de 1949. A l’époque, il s’agissait de convaincre le contribuable américain d’aider les pays sousdéveloppés non seulement pour des raisons géopolitiques (il fallait limiter l’expansion du communisme.) Pour les américains, le système colonial et surtout la misère contribuaient à l’essor des mouvements révolutionnaires. IV/ De la crise du développement à l’avènement du développement durable Aujourd’hui, beaucoup d’auteurs critiquent avec sévérité, le développement, l’Économie du développement ou les théories du développement. C’est le cas de Samir AMIN lorsqu’il observe que « Le développement est en panne, sa théorie en crise et son idéologie fait l’objet de doute ». Cette contestation intervient dans une période particulière de l’évolution caractérisée par des ruptures graves des équilibres naturels et environnementaux du fait des activités productives qui gaspillent ou détruisent les ressources naturelles (surtout celles qui sont non renouvelables), la biodiversité, la forêt, l’eau, les matières premières, la pollution atmosphérique. Cette situation a conduit beaucoup d’auteurs à se convertir au développement durable issu de la commission BRUNDLAND (1987) qui est défini comme « le développement qui est apte à satisfaire les besoins des générations actuelles sans pour autant porter atteinte à ceux des générations futures. Plus précisément, il s’agit, selon cette définition, d’une tentative planétaire de synthèse entre, d’une part, la nécessité de continuer le processus de développement avec la variante la plus importante et la plus prioritaire, la lutte contre la pauvreté et, d’autre part, la nécessité de sauvegarder l’environnement. 18 Le développement durable ainsi compris est multidimensionnel puisqu’il articule théoriquement trois dimensions économique, sociale et écologique mais également il est un facteur de croissance économique basée sur l'économie sociale et solidaire, l'éco-conception, le biodégradable, le bio, la dématérialisation, le réemploiréparation-recyclage, les énergies renouvelables, le commerce équitable, la relocalisation etc. Ce nouveau mode de développement qui veut assurer l'épanouissement de tout le genre humain, présent et à venir, partout et tout le temps soulève de nombreuses interrogations même s’il entraîne des adhésions massives. S’agit-il comme l’observe Jean MARC « d’une auberge espagnole, où chacun met très exactement ce qui l'arrange, un vœu pieux, ou un parfait exemple de schizophrénie, ou...un dialogue de sourds » ? V/ Les courants de pensée en économie du développement Dans le domaine du développement, les recherches, réflexions et pratiques sont extrêmement évolutives avec des différences fondamentales de nature idéologique, théorique et méthodologique, entre les écoles et courants de pensée. Il en résulte des controverses et des débats riches alimentés par l'éventail des théories économiques, leurs instruments et modèles. Donc, la discipline devrait tirer un grand profit de ces approches. Cependant, les théories du développement se sont affirmées comme un corpus distinct dans la science économique dès lors qu'elles postulent l'existence de spécificités communes à un ensemble de pays en même temps qu'elles adoptent l'idée que le développement ne se réduit pas à la croissance. Ainsi, depuis un demi-siècle, l'évolution de cette discipline reflète une tension entre, d'une part, le corset d'un appareil analytique (l'analyse économique «standard») qui a ses règles méthodologiques et son ambition universaliste, d'autre part, les particularités auxquelles il s'agit de l'adapter. Globalement, on peut distinguer, actuellement, quatre grands courants de pensée en économie du développement : Un premier courant qui réactive, à la lumière des travaux récents sur la croissance endogène (GUELLEC et RALLE, 1996 ; KRUGMAN, 1993 ; LUCAS, 1988 ; ROMER, 1986 ; etc.), les théories des précurseurs du concept de croissance : croissance déséquilibrée de HIRSCHMAN et le « Big push » de Rosenstein RODAN ; Un deuxième courant qui privilégie, dans ses approches du développement, les aspects liés à l'imperfection des marchés, la place et le rôle des institutions dans la coordination des activités des agents économiques. Ce courant, dénommé le courant de la régulation, remet en cause la capacité du commissaire-priseur à assurer la convergence des intérêts contradictoires des agents et accorde une grande importance aux différentes institutions jouant un rôle dans la régulation et le fonctionnement des économies ; Un troisième courant qui renouvelle les analyses structuralistes (Néoinstitutionnaliste) à partir d'une critique des approches orthodoxes de la stabilisation ; Un quatrième courant néo-marxiste qui remet en question la pensée dominante tendant à s’uniformiser et qui préconise le néolibéralisme et l'occidentalisation des sociétés en développement comme perspectives exclusives. C'est cela le fondement du « Consensus de Washington » qui consacre les politiques d'ajustements structurels. Or, pour ce courant, les pays en voie de développement ne peuvent espérer se développer à cause de l'impérialisme (rapports inégaux) c'est-à-dire leur intégration historique dans l'économie mondiale et le détournement du surplus vers des accumulations improductives par les classes dominantes (P. BARAN, 1957 ; S. AMIN, 1970 ; A. G. FRANCK, 1978). 19 VI/ P.HUGON a tenté d’établir une périodisation de l’évolution de la pensée du développement depuis les indépendances africaines (1960) à la crise des années 80 P. HUGON (1991) distingue trois moments, introduisant chacun un paradigme de l’économie du développement : 1°) Le premier moment est celui de la décolonisation et du début de construction des systèmes économiques nationaux : deux concepts prédominent « État et Développement » A cette période l’objectif majeur était de forger un corpus scientifique qui rompt avec la représentation coloniale, de sociétés sans histoire et de peuples aux mentalités archaïques, traditionnelles. Il fallait alors se tourner vers des problématiques alternatives fondatrices de l’économie du développement, dans lesquelles, l’Etat est un pilier du développement (MEIER & SEERS, 1987). Cette posture était justifiée par l’inexistence d’une bourgeoisie nationale ou d’un secteur privé national capable d’exploiter toutes les opportunités d’investissement pour élever les forces productives. Le schéma de cette école de développement est fortement influencé par le contexte international issu de la seconde guerre mondiale. Même Keynes a été minorisé lors des débats fondateurs des institutions de Bretton Woods, l’interventionnisme est dans l’air du temps. En effet, le Plan MARSHALL sert de modèle d’aide et de financement des investissements nationaux de base et de construction d’espaces régionaux. Ainsi, on comprend aisément que l’Etat soit au centre des interrogations de la quasi-totalité des sciences sociales. Les économistes le situent au cœur du processus de développement économique : les juristes et politologues en font le noyau de référence, comme les géographes, aménageurs du territoire, ou les historiens privilégiant le cadre national. Les anthropologues ou ethnologues, les géographes ruralistes soulignent, par contre, la spécificité des structures africaines et le jeu des pratiques sociales. Ils se situent davantage au niveau des petites échelles et des microsociétés. Cette première période dans l’histoire de l’économie du développement a été influencée dans le Tiers-Monde par les grandes thèses nationalistes et celles du mouvement des non-alignés cherchant, à travers un développement endogène à satisfaire les besoins sociaux de base des populations (éducation, santé, infrastructures sociales). Cette politique volontariste a cherché à s’adosser sur les potentialités internes. Les pays du Tiers-Monde cherchaient alors une troisième voie de développement. Selon le continent, les problèmes du développement se posent de manière différente. En Amérique Latine, on tente d’instaurer une économie de marché tout en favorisant un protectionnisme éducateur pouvant faire émerger une jeune industrie d’import substitution. Alors qu’en Asie, les débats sont controversés sur le choix des techniques et leur rôle au sein d’une économie de marché ou planifiée. D’autres questions non moins importantes sont également posées et portent sur les réformes agraires. En Afrique, au-delà de ces préoccupations, des questions spécifiques tournent autour de l’ouverture des pré-carrés coloniaux et de l’abolition des monopoles. 20 2°) Le deuxième moment est celui des années 70 : le moment de la radicalisation avec les succès politiques et économiques de la tricontinentale qui revendique un Nouvel Ordre Economique mondial. À la fin de la décennie soixante, la pensée dominante sur le développement se radicalise. Elle réclame la prise en compte des intérêts des pays du Tiers - Monde sur la scène internationale. Les tenants de ce courant sont qualifiés de tiers-mondistes et élaborent les nouvelles théories de l’impérialisme, de l’échange inégal, de l’exploitation des masses de la périphérie par les bourgeoisies du centre, des luttes sociales à l’échelle tricontinentale (Asie, Afrique et Amérique Latine). Cette période sera marquée par la constitution d’un vaste mouvement de solidarité des pays du Tiers-monde autour de leurs combats politiques et économiques, la formation du mouvement des Non-alignés, la constitution de puissants cartels (OPEP) et de groupes de pression (Groupe des 77, Groupe des 15, etc.) et l’avènement de la Tricontinentale. Les succès des guerres de libération nationale et la révolution chinoise vont jouer un rôle important dans les nouvelles perspectives du Tiers-Monde. Le contexte d’un monde bipolaire avec des affrontements idéologiques conduit à un éclatement des écoles : MAO TSE TOUNG dans la nouvelle Démocratie Populaire préconise que « mille écoles rivalisent et que mille fleurs fleurissent ». Durant cette période apparaissent les premières remises en question du Système Monétaire International (SMI)11 issu de Bretton Woods : abandon de la parité fixe du dollar par rapport à l’or et l’instauration des systèmes de changes flexibles (décision de NIXON 1971). Cette transition du SMI est renforcée par la première crise pétrolière (1973) qui est la première victoire des pays en développement membres de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole au devant de la scène internationale augurant la première inversion des flux de capitaux (pétrodollars) des pays développés vers les pays sous-développés exportateurs de pétrole. Cette victoire va permettre de poser le débat sur l’impératif d’un Nouvel Ordre Économique International (NOEI) et l’instauration de rapports économiques et financiers plus équilibrés. Également, c’est dans ce contexte que l’on tente de définir une troisième voie à équidistance entre les blocs capitaliste à économie de marché et socialiste à économie planifiée. Les projets de développement endogène font leur apparition. 3°) Le troisième moment est celui de la crise des années 80 et l’avènement de la libéralisation et de la gestion capitaliste. L’éclatement de la crise économique et financière mondiale des années 70, en déréglant le système économico-financier international, viendra extérioriser toutes les faiblesses structurelles des économies du Tiers-Monde : la non émergence d’une agriculture performante et diversifiée capable de satisfaire une demande alimentaire fortement croissante, la persistance d’une industrie monopolaire peu compétitive et extrêmement protégée, un sous-emploi des jeunes de plus en plus massif, la pauvreté de masse, le double déficit des finances publiques et de la balance des paiements. Pour juguler les nouveaux déséquilibres, il est envisagé l’instauration d’une politique longue et certainement pénible d’ajustement structurel. Les institutions de Bretton-Woods, Banque mondiale et FMI, vont exercer un leadership doctrinal. L’autonomisation de la sphère financière et la gestion de la dette Le SMI est un ensemble de pratiques qui régissent les mouvements de biens et des capitaux, les comportements de Banques centrales dans la gestion des réserves officielles, le rôle de chef d’orchestre dévolu au FMI. 11 21 conduisent à privilégier les équilibres macro-financiers et les ajustements de court terme (stabilisation). On constate l’échec – ou l’utopie – du NOEI. Enfin, les mouvements populaires et la montée des processus démocratiques, de même que l’atténuation de l’apartheid en Afrique du Sud, mettent en question des pouvoirs sans légitimité et mettent en œuvre de nouveaux modes de gestion politique pouvant favoriser la sécurité et l’émergence d’acteurs innovants. Pour P.HUGON, « les années quatre-vingt sont caractérisées par le dépérissement des théories globalisantes, le déplacement très net de la recherche du rural vers l’urbain, et le poids croissant donné aux acteurs et aux politiques. Au sein de l’économie domine une pensée standard ou orthodoxe. La question de la transition vers le socialisme fait place à celle de la transition vers le marché. Les concepts de modes de production, d’impérialisme, d’échange inégal, de développement des rapports capitalistes, de classes sociales sont considérés comme obsolètes, et ceux qui les emploient encore, comme des anciens combattants… Au niveau politique, la construction des États-nations et des partis uniques débouche aujourd’hui sur l’informalisation de l’État et les tentatives de pluripartisme. Sur le plan économique, la phase de l’Etat-développeur a fait place à des programmes d’équilibrages financiers et de transition à l’économie de marché. Ces nouvelles orientations sont une réponse à la crise africaine qui est à la fois économique, sociale et politique ». Encadré 2 : Petite histoire de la pensée du développement. Dans leur contribution, lors de la seconde conférence européenne sur le développement organisée par la Banque mondiale et le conseil d’analyse économique à Paris du 26 au 28 juin 2000 intitulée : « fifty years of development » Paul COLLIER, David DOLLAR et Nicolas STEN résument sommairement comme ils le soulignent les principaux changements dans l’histoire de la pensée du développement. Ces changements sont dus d’une part aux expériences dans les différents pays et d’autre part, aux évolutions de la science économique. Dans les années cinquante et soixante. De nombreuses économies considéraient que le fonctionnement ne pouvait pas répondre de manière satisfaisante aux problèmes particuliers des pays en développement. L’État devait jouer un rôle majeur dans l’allocation des ressources et, notamment, en matière d’investissement. La grande dépression des années trente et la réussite à l’époque des expériences de planification, que cela soit en URSS ou bien au Royaume-Uni au cours de la Seconde Guerre expliquent une telle position. Même s’il existait des différences sur la nature de la croissance équilibrée ou déséquilibrée, l’État était amené à jouer un rôle essentiel. Seuls des économistes comme Peter HAYEK, Gottfried HABERLER et Friedrich von HAYEK s’opposaient à ce consensus. Un deuxième paradigme de la pensée du développement à l’époque met en exergue son pessimisme vis à vis des stratégies de développement fondées sur les exportations et, au contraire, l’encouragement donné aux stratégies de substitution d’importation. Dans les années soixante et soixante-dix. Plusieurs études de nature microéconomiques mirent en évidence les distorsions de prix et les inefficacités qui résultaient des stratégies de substitution à l’importation. Parallèlement, la théorie économique a été amenée de plus en plus à s’intéresser aux problèmes d’information et d’incitation et à la manière dont les arrangements contractuels développés pouvaient soit résoudre, soit au contraire, aggraver ces problèmes. C’est au cours des années soixante et soixante dix que se sont également développées les études concernant la mesure de la pauvreté et des inégalités et les analyses de la relation entre concentration de revenus et la croissance, initiée par la courbe en « U » reversée de Kuznets. Les années quatre-vingt ont marqué un tournant. D’une part, la disponibilité des données ainsi que les progrès en matière de traitement informatique des données ont 22 permis une analyse empirique d’un certain nombre de mécanismes du développement. D’autre part, les maigres résultats obtenus par les stratégies de développement mises en avant dans les années cinquante ont conduit à la fois à une faible croissance et à des problèmes d’ajustement et de dette. Au cours des années quatre-vingt-dix. L’accent a été mis sur le rôle des institutions dans le développement et notamment l’importance des systèmes juridiques et financiers. Des travaux ont été menés dans les domaines de l’économie politique de la réforme et de la construction institutionnelle. Le capital social (degré de cohésion sociale, normes, associations, réseaux d’influence) est maintenant analysé comme un facteur important dans la mise en œuvre des politiques économiques des réformes, ainsi que le fonctionnement des institutions. Parallèlement, un ensemble de travaux a été consacré à l’efficacité du rôle de l’aide au développement. Ils ont mis en évidence le rôle des institutions et des politiques dans les résultats de cette aide. VII/ Quelle est la structure de cet ouvrage ? Cet ouvrage est une réflexion qui s’appuie sur l’Économie du Développement avec une référence essentielle à l’Afrique. Sa problématique est fort simple dans le contexte de mondialisation irréversible et à la lumière des enseignements de l’Économie du développement, quelles sont les grandes questions qui se posent aux PSD africains et quelles sont les réponses en termes de stratégie et de politiques de développement ? D’un point de vue méthodologique, nous avons divisé l’ouvrage en cinq parties logiquement articulées : le contexte de mondialisation, le concept du sousdéveloppement, le référentiel théorique, les options et les stratégies, les politiques sectorielles et l’intégration africaine, les partenariats et l’insertion dans la mondialisation. La partie introductive analyse le contexte de mondialisation qui conditionne tous les processus productifs, financiers, technologiques, sociaux et culturels qui permettent de mieux comprendre les enjeux actuels du sous-développement et du développement. Quelle compréhension avons nous de ce mot « fétiche » et polysémique ainsi que de ses configurations? Est-elle un handicap ou opportunité surtout quand elle est présentée comme une réalité incontournable qui condamne tous les pays à s’ajuster à cet ordre (ou désordre) mondial caractérisé par la formation et la complexification de puissants pôles de compétition qui entreprennent un travail gigantesque de disqualification à la fois des territoires et des États. La première partie traite des Théories Économiques face au développement et sous-développement. C’est une revue sommaire de la boîte des références sur laquelle s’appuient les économistes, les chercheurs et les techniciens pour comprendre, expliquer, justifier et agir ? La science économique est devenue aujourd’hui, une entreprise extrêmement impressionnante par la quantité des recherches, ouvrages et articles disponible pour l’analyse et l’action. Au-delà des diversités d’approches et des méthodes, des controverses et des désaccords multiples, cinq grandes familles de pensée économique se sont particulièrement passionnées à la problématique du développement : les classiques de A. SMITH à D. RICARDO, les Keynésiens de J. M. KEYNES à ses condisciples HARROD, DOMAR, J. ROBINSON, les marxistes de MARX à P. BARAN, de P. SWEEZY à l’École de la régulation, la Synthèse néoclassique contemporaine de JEVONS, MENGER, L. WALRAS à LUCAS et les structuralistes et institutionnalistes qui forment un ensemble disparate d’auteurs 23 allant des « hétérodoxes » aux divers institutionnalistes et socio-économistes. Cette catégorisation n’a qu’une valeur didactique au regard de l’entrecroisement des analyses et des idées : en fait il n’existe pas entre les grandes familles de pensée des barrières infranchissables tellement les méthodes, les références et parfois les formulations sont voisinent. C’est la conséquence, que les théories économiques ne sont pas toutes nées à la même époque et n’ont pas eu à affronter les mêmes problèmes.12 La deuxième partie présente une analyse des caractéristiques constitutives du sous-développement et une introduction générale aux objectifs, stratégies et instruments de gestion pour sortir du sous-développement. En effet, quand les économistes analysent ce phénomène, généralement, ils exhument un certain nombre de faits, une batterie d’indicateurs, de structures de tous ordres qui suscitent de vives controverses comme si ces éléments en eux-mêmes étaient suffisants pour définir et caractériser le phénomène de sous-développement. Ces diverses représentations du sous-développement selon le mot de G. D. DEBERNIS13 se présentent souvent comme une combinaison subtile de théories, de faits, d’intérêts, de pouvoirs, de mythes. La science commence toujours par une bonne observation des faits à partir de concepts et vocabulaires clairement définis. Dès lors quels sont les faits caractéristiques du sous-développement ? Peut-on les réduire aux traits de structure et de fonctionnement qui font apparaître la conséquence majeure des PSD à savoir leur incapacité à briser «le cercle vicieux de la pauvreté». 14 Quelles sont les stratégies et options de développement économique et social qui découlent de la morphologie du sous-développement ? La finalité des stratégies et politiques de développement étant l’élévation du niveau de bien-être des populations, sa réalisation passe par la définition d’options claires, d’institutions d’encadrement de la croissance, de l’organisation de l’économie, de l’utilisation de techniques de décision comme la planification, des analyses prospectives et enfin des acteurs. Deux problèmes déterminants sont traités à ce niveau : la stratégie de l’émergence à partir de la croissance économique et la planification comme instrument de cohérence et d’exploration de l’avenir. Lorsque l’on passe de l’économie du certain à celle de l’incertitude, l’outil de planification devient indispensable pour l’Etat dans l’exercice de ses fonctions d’impulsion et de régulation des économies. La Troisième partie est relative aux stratégies et politiques sectorielles. Le débat agriculture-industrie est maintenant très largement tranché. Le décollage et la croissance des PSD peuvent-ils encore se réaliser avec l’agriculture comme secteur moteur ? L’industrialisation est-elle encore possible ? Quelle articulation entre politique agricole et politique industrielle ? Cette partie apprécie les politiques à entreprendre au niveau : Premièrement de l’agriculture considérée comme un secteur prioritaire devant accomplir des fonctions motrices dans toute stratégie de développement avec une analyse qui s’articule autour : des limites de l’agriculture paysanne : pourquoi les résistances à la libéralisation du secteur ; des axes d’une autre politique agricole et de la fameuse question des subventions agricoles à l’échelle mondiale. Deuxièmement de l’industrialisation qui a joué dans l’histoire un rôle essentiel et contribué d’une part à l’accumulation productive et à la formation et à l’accroissement du capital physique par la production des biens d’équipement et . GALBRAITH : L’économie en perspective. Une histoire critique, Édit. du Seuil, 1989 Gérard Destanne DEBERNIS : Le sous-développement, analyses ou représentation, Revue TiersMonde, tome XV n° 57, Janvier 1974 14 Gunder FRANK préfère le terme de « développement du sous-développement » qui est l’intitulé de son ouvrage publié aux Édit. François Maspero 12 13 24 d’autre part, à l’augmentation de la productivité du travail. Dans cette optique, trois (03) questions sont à résoudre : les distorsions historiques en faveur des branches et techniques légères et l’industrialisation de substitution aux importations; le dilemme industrie lourde – industrie légère et l’articulation de l’industrie à l’agriculture qui permette une transformation rapide des systèmes agraires. Troisièmement de la problématique technologique et des innovations : nous partons de l’idée qu’il n’existe pas de détermination technologique. Le vaste processus d’intellectualisation croissante du travail social condamne les formations sous-développées à trouver des raccourcis. Dès lors que la science devient la base théorique non seulement de maîtrise des forces de la nature mais aussi de la direction méthodique orientée des processus sociaux de développement de la société, la technologie revêt une importance capitale. L’analyse s’organise autour de : l’évaluation du pool technologique disponible et que l’on peut mettre ensemble dans un processus de production ; l’appréciation des enjeux technologiques qui obligent le Tiers-monde à progresser rapidement dans la promotion de la révolution scientifique et technique et l’élaboration d’une nouvelle politique technologique. L’autre question traitée concerne la politique commerciale qui a joué, contrairement aux expériences de la plupart des pays africains, un rôle dynamique dans le processus de développement et d’amélioration de la compétitivité des économies. Or, la question qui se pose aujourd’hui est de savoir si les pays en développement peuvent continuer à jouir des mêmes libertés qu’ils ont pu avoir par le passé, pour mettre à contribution la politique commerciale dans la construction de leurs stratégies de développement. Cette question est d’autant plus importante que les réformes entreprises depuis l’Uruguay Round réduisent l’usage des outils de la politique commerciale et par conséquent laissent une marge limité aux PSD. Certains se demandent d’ailleurs si l’avènement de l’OMC ne signifie pas finalement la fin des politiques commerciales nationales. La quatrième partie traite du financement du développement. Les pays en développement ont des besoins financiers énormes pour faire face d’une part aux investissements productifs qui animent la croissance économique et d’autre part aux dépenses publiques qui dépassent trop largement les ressources. Pareille situation entraîne de lourds déficits financiers qui ne peuvent se résoudre que par trois sources essentielles : le recours à l’endettement, aux Investissements Directs Etrangers et à l’Aide Publique au Développement. Toutes ces sources sont externes et appellent en conséquence l’instauration de politiques adéquates de leur mobilisation en vue du financement du développement. La cinquième partie concerne les problèmes d’intégration. La mondialisation est entrain de déplacer systématiquement les frontières de la production et des échanges commerciaux, financiers et technologiques en créant de vastes blocs de compétition qui affaiblissent voire même gomment les Etats Nations. Face à cette configuration multipolaire de la globalisation, si les faibles Etats africains veulent survivre et prospérer, ils n’ont aucune autre alternative que l’intégration économique, régionale ou sous-régionale. Ce sera leur marchepied vers la mondialisation. Ils pourront alors disposer d’un plus grand pouvoir de négociation et mieux exploiter les différentes offres de partenariat émanant des différents blocs en compétition afin de les faire évoluer vers la formation d’un véritable contrat mondial de développement. Ainsi structuré, cet ouvrage, à proprement parler, n’est pas un manuel classique d’Économie et de théories du développement, son ambition est beaucoup plus modeste bien qu’il s’adresse à un public large et varié. Il s’organise autour de deux objectifs majeurs : 25 D’abord, il se veut une interpellation de toutes les élites intellectuelles toutes disciplines confondues, des techniciens du développement, des chercheurs et étudiants du Troisième Cycle pour une réappropriation des questions du développement à travers les expériences africaines. Ce faisant, notre objectif est d’amener toute l’intelligentsia, à une réflexion d’ensemble sur nos propres problèmes en vue de trouver nos propres solutions. Les thèmes abordés en offrent l’opportunité. En effet, de la pertinence du diagnostic établi à partir de l’examen minutieux des questions du sous-développement, dépendront la qualité et l’efficacité des stratégies du développement. De plus, la science économique a toujours progressé à partir de vives controverses, ce qui en fait une doctrine antidogmatique. Pourquoi cette référence à l’Afrique ? Simplement parce que le continent est traversé par une triple crise économique, politique et sociale et qu’il peine toujours à sortir par le haut de l’état de sous-développement. Cette référence est donc une invitation pour une plus grande implication dans la formulation des problématiques de développement et dans la recherche de solutions. Depuis le milieu des années 70, le continent est confronté à l’approfondissement de ses déficits macroéconomiques et macro financiers, à la stagnation voire au recul de sa production agricole comme industrielle, à l’élargissement de la pauvreté de masse et au creusement de son retard dans les technologies de l’information, de la communication et de l’innovation. Manifestement, il s’agit d’une crise profonde de développement qui peut se manifester à plusieurs niveaux : l’existence et la perpétuation d’une crise agro-alimentaire persistante faisant du continent une zone d’insécurité alimentaire endémique alors que d’autres régions connaissent des surproductions parfois détruites pour équilibrer les marchés; la double explosion démographique et urbaine qui accentue les déséquilibres macroéconomiques tout en délitant complètement tous les rapports sociaux et les relations villes/campagnes ; l’endettement asphyxiant qui n’a pourtant que très peu contribué à la mise en place d’un réseau fonctionnel d’infrastructures économiques et sociales, à l’amorce d’une industrialisation fondée sur la valorisation des immenses ressources naturelles, au financement de l’agriculture ainsi que des transferts techniques. S’agit-il d’une crise des modèles de développement, des institutions de régulation des systèmes économiques et sociaux ou alors plus gravement, ne s’agit-il pas d’une crise de la pensée du développement ? Toutes les études prévisionnelles ou prospectives sur l’évolution du monde au-delà de l’an 2025 sont formelles : l’Afrique restera à cette échéance au bas de l’échelon des nations, c’est-à-dire, dans la catégorie des nations sous-développées. À l’évidence, les prévisions sont loin d’être des prophéties, mais elles imposent des interrogations rigoureuses sur ce qu’il faut faire pour modifier ou conjurer les trajectoires négatives. Quels modèles de développement et quelles stratégies faut-il adopter pour sortir le Continent africain des scénarios tendanciels de marginalisation, d’exclusions ou plus sévèrement de clochardisation dans un monde globalisé avec un rétrécissement des espaces et des distances du fait de la révolution des technologies de l’information et des télécommunications. Le deuxième objectif est d’offrir surtout aux jeunes chercheurs et aux étudiants une première grande synthèse qui leur ouvre le maximum de références théoriques, d’instruments d’analyse et de matériaux statistiques afin qu’ils aillent bien au-delà des sentiers archi battus et des formulations de haute voltige du développement qui 26 n’ont que d’assez faibles liens avec les réalités africaines. La presse foisonne de questions comme : Pourquoi des économistes universitaires et à quoi servent leurs théories toujours divergentes? Expertise et ambiguïté de la science économique ? Rhétorique et idéologie marquée par un formalisme inapte à l’explication et à l’action suite à l’irréalisme des hypothèses ? La pensée économique dominante est-elle pertinente du fait que les économistes, selon le mot de Daniel COHEN, arrivent bien souvent après la bataille ? 27 28 L’Hôtel capitaliste est toujours complet, mais la liste des clients change constamment J. Schumpeter15 Considérée comme une chance pour les uns, une menace pour les autres, le phénomène de la mondialisation qui, pour beaucoup de monde, semble déterminer désormais l’avenir de la planète suscite des débats passionnés, des controverses savantes et des proclamations politiques aussi simplistes que péremptoires. Mais d’abord, de quoi s’agit-il lorsqu’on parle de mondialisation ? En réalité, elle recouvre quatre significations : l’extension de l’économie de marché à l’ensemble de la planète16 : c’est une définition classique qui met l’accent sur la synchronisation des marchés. l’ensemble du processus productif qui prendrait une dimension mondialisée dans ses sphères réelles, monétaires et d’échange. l’internationalisation par les Firmes multinationales qui imposent les règles du jeu international au détriment de toutes les autres institutions; l’économie globalisée, avec une régulation à l’échelle mondiale. Bien que les termes de « mondialisation », « globalisation », « internationalisation » soient à la fois flous et empreints d’ambiguïté, chacun pense que leurs conséquences (sans pouvoir les discerner avec précision) sont importantes. Pour certains économistes, l’entrée dans la mondialisation se mesure par un pourcentage significatif du PIB de la nation réalisé avec l'extérieur alors que pour d'autres, ce pourcentage est moins significatif que la «dépendance » ou «l’indépendance» de la nation vis-à-vis de décisions prises par des acteurs de l'étranger : firmes ou États compte tenu du caractère de "price taker" ou de "price maker" que détiennent ces acteurs sur le marché mondial. Pour d'autres enfin, la mondialisation s’exprime à travers l’ensemble des « mécanismes d’accumulation à l’échelle mondiale » qui enrichit les partenaires les plus riches et appauvrit les autres par l’échange inégal caractéristique des distorsions dans le processus de formation des marchés internationaux et de distribution des revenus. À l’origine, la mondialisation était essentiellement perçue par les auteurs comme un fait économique et financier qui indiquait la suppression progressive de barrières douanières et réglementaires pour les entreprises industrielles, commerciales et financières, ce qui permettait leur déploiement sans entrave et la délocalisation de leurs activités dans l’espace mondial. Les firmes multinationales se trouveraient ainsi au cœur d’un processus productif de dimension mondiale commandé par la recherche d’un profit maximal axé sur l’exploitation des dotations factorielles naturelles des pays. Le phénomène s’est par la suite élargi au point d’affecter aujourd’hui le politique, le social et le culturel. Cela soulève beaucoup de problèmes pour un concept aussi abusivement utilisé. Manifestement, le sujet est vaste, complexe, largement débattu, mais souvent sans analyses robustes avec des statistiques crédibles. Selon la remarque de R. BOYER, «quand des ouvriers d’un abattoir de poulets se mettent en grève pour contester un aménagement de leurs horaires de travail, on décrète qu’ils se battent contre la mondialisation qui impose sa rationalité aux entreprises de ce secteur étroitement dépendant de ses performances à l’exportation. Lorsqu’un gouvernement choisit de renoncer à exercer ses prérogatives pour s’aligner sur les positions des 15 16 J.SCHUMPETER : Socialisme, capitalisme et démocratie Alternatives Économiques, Hors Série n°44, Page 52 29 lobbies favorables au tout-déréglementation, il se justifie en se fondant sur les nouvelles exigences de la mondialisation17 ». Malgré sa forte présence dans plusieurs secteurs et dans plusieurs régions du globe, la mondialisation n’est pas encore universelle. Au contraire, une de ses particularités marquantes est qu’elle est paradoxalement non homogène et fortement asymétrique, dans la mesure où toutes les activités économiques, financières comme culturelles ne se mondialisent ni au même rythme ni de la même manière. Certaines, telles que la finance et les entreprises sont mondialisées depuis des siècles, alors que d’autres sont encore solidement chevillées dans des frontières géographiques nationales dont elles portent les marques. C’est bel et bien une mondialisation à plusieurs vitesses entraînant des chocs asymétriques. Considérée comme un phénomène multiforme, elle pose des questions déterminantes pour l’ordre national : Offre-t-elle les mêmes chances et les mêmes avantages à tous les partenaires ou participants? Quelles sont objectivement ses conséquences directes et indirectes sur les différents partenaires, singulièrement les plus faibles d’entre eux?18 Pourra-t-elle contribuer positivement à la croissance économique des pays d’Afrique sub-saharienne, au développement de l’emploi, à l’éradication de la pauvreté et à la réduction des inégalités ? Quel sort réserve-t-elle aux acteurs nationaux les plus fragiles et les plus déficients ? Va-t-elle harmoniser les structures institutionnelles et les normes et valeurs propres aux sociétés ? Est-elle inéluctable ou contournable ? Ces questions sont déterminantes pour les PSD, particulièrement ceux au Sud du Sahara qui sont engagés dans un travail de prospective pour l’horizon temporel 2015 qui correspond à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) du PNUD gravitant autour de la réduction de la pauvreté de masse qui menace tous les équilibres économiques et sociaux à l’échelle mondiale. R. BOYER et al : Mondialisation au-delà des mythes, Édit. La Découverte, 1997, 174p. Moustapha KASSÉ (2003) : De l’UEMOA au NEPAD : le nouveau régionalisme africain, Éditions Nouvelles du Sud, 256 p 17 18 30 31 CHAPITRE 1 LA MONDIALISATION ET SA CONFIGURATION MULTIPOLAIRE. La mondialisation présente un caractère de contrastes et de paradoxes. Les statistiques qui ressortent des Rapports mondiaux des Organisations Internationales (Banque mondiale, PNUD, CNUCED, CEA, BAD) montrent que depuis deux siècles le monde n’a jamais produit autant de richesses, disposé d’autant de techniques et pourtant, jamais il n’a été produit autant d’inégalités et de pauvreté révélant ainsi la marque d’une humanité socialement clivée. Le Produit mondial a connu au cours du siècle une croissance exceptionnelle : en dollars de 1975, il est passé de 580 milliards en 1900 à 25000 milliards au milieu des années 90 ce qui représente en moyenne 4500 dollars per capita. Seulement, ce tableau idyllique est altéré par la succession de crises graves qui sont autant de périls économiques, financiers et sociaux dont les dernières en date ont été la déroute de certains Nouveaux Pays Industrialisés d’Asie et d’Amérique Latine souvent proposés comme modèles de référence pour sortir du sous-développement en une génération. Ces crises répétées et de plus en plus profondes montrent l’ampleur des risques, des incertitudes et des dysfonctionnements que les Institutions Financières Internationales n’ont pas pu gérer, faute de disposer d’instruments adéquats de régulation et de ressources suffisantes. C’est ce qui est apparu dans le cas de la crise financière en Asie et auparavant au Mexique, au Brésil et en Uruguay. Tableau 1 : PIB nominal dans le monde. Produit Intérieur brut Économies 1990 2004 2005 Asie de l’Est et 665 783 2 650 867 3 039 976 Pacifique Europe et Asie 1 107 862 1 769 739 2 201 159 Centrale Amérique Latine et 1 101 298 2 021 995 2 460 991 Caraïbes Afrique de l’Est et __ 547 496 625 311 du Nord Asie du Sud 401 923 880 212 1 016 267 Afrique 298 442 523 310 621 879 Subsaharienne Sources: World Bank Indicators CD Rom 2006, World Bank Indicators 2007. À défaut d’un consensus sur la définition, les pratiques et les tendances de l’économie mondiale, dans sa double sphère réelle et monétaire, laissent apparaître une triple interdépendance que l’on pourrait qualifier de mondialisation. Éssayons de cerner de plus près ces interdépendances pour bien en mesurer toutes les conséquences à la fois sur les économies nationales et sur les différents acteurs: L’interdépendance par la production se caractérise par la décomposition internationale des processus productifs qui s’appuie sur un réseau de 32 filiales ou de sous-traitants et le nomadisme de segments entiers des appareils de production selon la logique des avantages comparatifs ; L’interdépendance par les marchés qui se traduit par la disparition des frontières géographiques, l’abaissement des barrières tarifaires et non tarifaires qui accélère alors les échanges commerciaux ; L’interdépendance financière qui procède d’une interconnexion des places financières mondiales fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre grâce à la conjugaison de trois éléments que sont la déréglementation, le décloisonnement des marchés et la désintermédiation ; L’interdépendance par les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) qui, avec les transports, intensifient la mobilité et la flexibilité des capitaux, des biens, des services et des personnes. Ce sont ces interdépendances qui déterminent les relations entre les différents acteurs du jeu économique, financier, politique et social à l’échelle mondiale. Les États doivent avoir une claire perception de cette configuration mondiale pour en évaluer les coûts et les opportunités par des politiques économiques et financières appropriées. Section 1 : L’interdépendance des systèmes productifs dominés par les firmes multinationales. Elle se caractérise par une division internationale du travail qui unifie les processus productifs nationaux et s’appuie, en conséquence, sur un réseau de filiales ou de sous-traitant qui opèrent la délocalisation de segments entiers des appareils de production selon la logique des avantages comparatifs. Cette structuration est le fait des firmes multinationales qui façonnent l’espace mondial en réseaux de production. Elles sont de plus en plus nombreuses, puissantes et originaires de diverses zones. Cette stratégie d’implantation leur permet de maximiser leurs profits à partir d’une optimisation de la localisation de leur production. Ce sont aujourd’hui, quelques 37 000 firmes multinationales de taille très inégale qui réalisent et contrôlent l’essentiel de la production mondiale de biens et services, les 500 d’entre elles les plus puissantes contrôlent presque 30 à 40 % du PIB mondial soit 25 000 milliards de dollars. Elles effectuent les 2/3 du commerce international sous forme d’échanges internes avec leurs 27 000 filiales soigneusement réparties dans l’espace mondial. Également, le négoce international des produits de base est largement sous le contrôle des firmes multinationales. Le processus de délocalisation des activités industrielles réalisé par les firmes multinationales sépare les lieux de production ou de transformation de certaines marchandises de leurs lieux de consommation. Il va s’amplifier sous l’influence de la Nouvelle Révolution des Technologies de l’Information et de la Communication, de la dématérialisation de capitaux et de l’extension des aires géographiques du libéralisme. Il a surtout fortement contribué au décollage industriel de la plupart des pays industrialisés d’Asie. En effet, les transferts d'activités industrielles et de services du Nord vers le Sud, appelés « délocalisations », sont l'une des causes les plus spectaculaires de l’industrialisation rapide des pays asiatiques même si par ailleurs, elle dévitalise les économies du Nord et y opère une destruction des emplois. S’agit-il alors d’un « partage des richesses ou d’un partage de la misère? Sans nul doute ; la mondialisation libérale complètement soumise aux lois du marché et du profit à court terme n'apportera pas de réponse à cette question. 33 Les Nouveaux Pays Industrialisés d’Asie et d’Amérique Latine ont tiré profit de cette délocalisation en attirant des segments de production industrielle, en valorisant leur dotation factorielle liée à l’espace géographique, à la qualité des ressources humaines ou à l’offre illimitée de main d’œuvre. Ils ont réussi à mettre en place un tissu industriel dans les domaines des hautes technologies. Certains États africains ont fait les mêmes tentatives avec la création des Zones franches industrielles considérées comme des moyens d’attirer les investissements étrangers, créer des emplois, développer l'industrie nationale et les infrastructures, favoriser les transferts de technologies et se procurer des devises. À l’exception de l’Île Maurice, les Zones Franches africaines ont produit des résultats médiocres. Ce modèle de réussite procède des capitaux asiatiques qui ont fait de Maurice leur base de pénétration du marché européen et d'accès aux pays du ProcheOrient. Créée en 1970, la zone franche couvre tout le pays, emploie 100 000 travailleurs et rapporte plus d’un millier de milliard de dollars. En vingt ans, le taux de chômage est tombé de 20 % à 3 %. Elle a permis à l’Ile en quasi-pénurie de maind'œuvre de privilégier désormais les investissements à forte valeur ajoutée avec des emplois qualifiés. Les principales transformations en cours concernent la multiplication des alliances et des fusions entre multinationales dans les secteurs stratégiques comme les industries aéronautiques et les télécommunications. La concentration transnationale augmente, de même que l’investissement international. Quelles que soient les modalités, la globalisation financière a favorisé l’internationalisation de la production. Les entreprises se sont largement financiarisées pour se couvrir contre les risques internationaux, en diversifiant leurs produits. Les investissements directs à l’étranger sont passés de moins de 40 milliards US $ en 1980 à 200 milliards en 1995. Ils conduisent souvent à une délocalisation, transfert à l’étranger d’une activité de production (segment ou ensemble de la fabrication) localisée antérieurement sur le territoire national. Il s’agit en fait d’une véritable décomposition internationale du processus productif (LASSUDRIE-DUCHENE). Chacun des segments est localisé dans des espaces différents, pour des raisons liées aux coûts de production, aux dimensions du marché, à des risques ou à des réglementations. Section2 : L’interdépendance des échanges. Le volume total des transactions quotidiennes sur les marchés des changes est passé d’environ 10 à 20 milliards de dollars dans les années soixante dix à 1500 milliards de dollars en 1998. De 1983 à 1993, les achats et les ventes transfrontaliers de bons du trésor américain sont passés de 30 à 500 milliards de dollars par an. Les prêts bancaires internationaux ont progressé de 265 à 4200 milliards de dollars entre 1975 et 1994. Le poids des échanges internationaux dans l'économie ne s'est pas accru de manière considérable, contrairement au discours fondamentaliste sur la mondialisation. Il est en fait à peine supérieur au niveau de 1914. Si l'on prend les chiffres du commerce international, il est (en fait) à peine supérieur au niveau de 1914 qui représente 20% du PIB mondial. Les services se sont enflés rapidement, particulièrement les services supérieurs directement liés aux activités productives : tourisme, fret et transit, communication et télécommunication. Le tourisme a plus que doublé entre 1980 et 1996 pour devenir une composante financière importante. La demande touristique accuse des taux de croissance élevés avec un nombre de voyageurs qui passe de 260 à 590 millions par 34 an. Malgré les restrictions sévères, les migrations internationales se poursuivent, de même que les envois de fonds des émigrants. Ces envois ont atteint 58 milliards de dollars en 1996. Le volume des appels téléphoniques internationaux s’est envolé entre 1990 et 1996, passant de 33 à 70 milliards de minutes. Les voyages internes et les médias stimulent la croissance exponentielle des échanges d’idées et d’informations. L’OMC entend désormais régenter toutes les règles de la concurrence, l'accès aux marchés publics et les lois sur les investissements. Elle impose aux Etats membres la prééminence des quatre principes du libre-échange à savoir : le principe de la non discrimination le principe de l’abaissement généralisé des droits de douane l’interdiction des restrictions quantitatives l’interdiction du dumping. Ceux-ci doivent prévaloir sur toute autre considération qu'elle soit culturelle, sociale ou écologique dans la régulation du commerce international. Cette intégration mondiale est tirée par des changements de politiques visant à promouvoir l’efficience économique via la libéralisation et la déréglementation des marchés nationaux et le désengagement de l’État de nombreuses activités économiques, ainsi que la restructuration de l’État providence. Mais ce sont surtout les innovations récentes dans la technologie de l’information et des communications qui favorisent l’intégration. Cependant celle-ci reste très partielle au niveau mondial. Ainsi, les mouvements de main d’œuvre sont encore restreints, les frontières étaient fermées aux individus sans qualification. Tableau 2: Montant des exportations par zone et en milliards de dollars Montant exporté (en milliards Croissance (%) de dollars) Par niveau de 1990 2001 1990-2001 développement. Pays à faible revenu 48 115 +139,6% Dont Inde 11 37 +236,4% Pays à revenu moyen 254 805 +216,9% Dont Chine 45 237 +426,7% Pays à revenu élevé 2212 3784 +71,1% Dont France 167 264 +58,1% Union européenne 996 1570 +57,6% États-Unis 291 599 +105,8% Total Par zone géographique Asie du Sud-est Amérique Latine Asie du Sud Afrique Subsaharienne 2549 4802 +88,4% 92 49 20 14 425 169 51 30 +362,0% +244,9% 155,0% 114,3% Source : Calculs réalisés par l’auteur à partir du Rapport de la CNUCED 35 Section 3 : Interdépendance et globalisation des marchés financiers. Cette troisième interdépendance est rendue possible par l’articulation de trois éléments qui permettent une internationalisation sans entrave des marchés financiers : la désintermédiation, elle permet aux entreprises, à l’État de recourir directement aux marchés financiers sans passer par les intermédiaires financiers et bancaires pour effectuer des opérations de placement et d’emprunt. Ils peuvent accéder directement aux marchés financiers pour satisfaire leur besoin de financement. le décloisonnement qui se traduit par la suppression de certains compartiments des marchés. la déréglementation : celle-ci indique l’abolition des réglementations des marchés des changes pour faciliter la circulation du capital. Au début du 20ème siècle, les mouvements internationaux de capitaux participent au processus de mondialisation de l’économie. Mais le développement de la finance mondiale atteste d’une déconnexion croissante entre les flux de capitaux et les besoins de financement de l’économie réelle. La globalisation financière se caractérise par l’interconnexion des marchés financiers, par un essor de nouveaux produits financiers et de nouveaux marchés émergents. On observe également une organisation mondiale de la production dans certains secteurs stratégiques. Les marchandises circulent de plus en plus librement avec des coûts de transport décroissants, du fait de la déréglementation et des progrès de télécommunication permettant des baisses de tarifs. L’instantanéité des informations abolit temps et espace. La circulation des informations peut remplacer celle des hommes (télé achat, télé travail). Les opérations financières génèrent à l’infini ou presque des produits dérivés. Les produits négociés, bien que de plus en plus sophistiqués, sont standardisés. Les transactions papier prennent, ainsi, une grande ampleur par rapport aux opérations physiques. On observe une déconnexion entre les opérations réelles (commerce et investissement) et la sphère finance-change. L’intégration financière résulte de la mobilité des capitaux et la substituabilité des actifs (BOURGUINAT). Le développement des eurodollars (les dollars circulant hors des États-Unis) à partir de 1957 a marqué le début de la circulation internationale des capitaux hors de tout contrôle étatique. Après le passage aux changes flottants, l’accélération du processus de libéralisation de la finance internationale date principalement de la fin des années 70. Les États à la recherche de sources de financement pour leurs déficits, ont aboli les principales règles qui contraignaient les mouvements de capitaux. Les mutations et innovations financières sont simplement démentielles et d’une rare ampleur avec le surdéveloppement de la titrisation et des bourses ainsi que l’opacité des marchés de gré à gré qui sont de nouveaux facteurs aggravants. Ces éléments installent l’instabilité au cœur même du système financier avec le triomphe des capitaux spéculatifs. La tourmente des marchés financiers mondiaux provoquée par les crises financières asiatiques et celle des subprimes des crédits immobiliers à risque aux Etats-Unis en apportent les preuves les plus récentes. Ainsi, les mutual funds aux États-Unis ont mobilisé quelques 2600 milliards de dollars en 1995 et les fonds de pension s’élèvent à 3600 milliards de dollars soit plus que l’encours des réserves de change de toutes les banques centrales de la planète. Les transactions opérées sur les marchés de change représentent environ 36 1500 milliards de dollars par jour, soit plus de 50 fois les flux réels de marchandise. La valeur des titres côtés en bourse dans 80 pays a été multipliée par 10 en 20 ans. Elle est passée de 1800 milliards en 1980 à 18 000 milliards en 1998. En clair, la sphère financière est complètement déconnectée de la sphère réelle car chaque jour 1500 milliards de dollars changent de mains sans contre partie en termes de biens et services. Ces chiffres montrent que les marchés financiers ont acquis des pouvoirs très étendus qui leur permettent de contrôler l’essentiel des circuits de financement à l’échelle mondiale et peuvent, en conséquence, déterminer les rythmes de croissance des économies. Le problème est comment mobiliser ces fonds d’investissements qui hésitent à prendre la direction de l’Afrique ? La globalisation des marchés financiers laisse apparaître d’abord un surdimensionnement des marchés qui rend les activités des établissements financiers complètement incontrôlables et permet aux acteurs financiers de promener librement leurs capitaux dans l'espace mondial à la recherche de meilleures rémunérations. Cette situation est largement expressive de la montée en puissance de la finance internationale avec la création d’un marché unique de l’argent au niveau planétaire. Cela va entrainer des dysfonctionnements quasi permanents du SMI et la multiplication des crises financières. Ensuite, on note une réelle incapacité de mesurer le niveau optimal des moyens de paiement pour l’économie mondiale. Enfin les finances illicites montent en puissance avec un produit mondial estimé à environ 1000 milliards de dollars. Désormais les actifs financiers peuvent se balader librement à la recherche de meilleures rémunérations. Ces capitaux alimentent les Investissements Directs étrangers (IDE) qui s’orientent vers les pays présentant de bonnes politiques dans un environnement institutionnel favorable et qui respectent les principes de bonne gouvernance économique. Dans les années 80, les investissements internationaux directs augmentent trois fois plus vite que le commerce mondial. À partir des années 90, après avoir surtout concerné les pays du Nord, ils se tournent de plus en plus vers les pays en développement. À la fin des années 1980, ces pays accueillaient environ 15 % seulement des flux d'investissements directs, aujourd’hui ils en ingèrent plus de 42 %. Les NPI d'Asie se taillent la part la plus importante puisqu'ils intègrent 25 % des investissements étrangers directs mondiaux, la Chine en accueillant à elle seule 15 %, soit 33 milliards de dollars sur 214,3 milliards, en 1994. Grâce à ces nouveaux flux financiers et des taux de croissance deux fois supérieurs à la moyenne mondiale sur une trentaine d'années, l'Asie apparaît de plus en plus comme l’une des locomotives d’une économie mondiale en proie au chômage et à la morosité, au niveau des grandes puissances industrielles. Quelles sont les principales conséquences qui méritent de retenir l’attention : La finance est de plus en plus déconnectée de la production: surdéveloppement de la titrisation et des bourses, L’opacité des marchés de gré à gré facteur aggravant, L’instabilité s’installe au cœur du système financier avec le triomphe des capitaux spéculatifs Le risque crédit devient de plus en plus un produit financier Section 4 : L’interdépendance par l’Information et de la Communication. 37 les Technologies de Ce qui change véritablement dans la mondialisation d’aujourd’hui, c'est l’ampleur et la profondeur de la Révolution des Technologies de l'Information qui modifie qualitativement et quantitativement les systèmes productifs avec la création de nouveaux produits, permet les échanges en temps réel du fait de la baisse drastique du coût des microprocesseurs et des télécommunications et ouvre de nouveaux canaux de communication et de distribution. La vraie révolution est dans l'innovation accélérée qui permet l’amélioration de la productivité, donc la compétitivité. Les technologies de l’information et de la communication sont en train de modifier les systèmes productifs et les perspectives de la croissance et de l’emploi. Elles déclenchent une explosion des activités économiques, recomposent les territoires industriels et interconnectent tous les marchés de la planète. Ce sont elles qui font précisément du monde un village planétaire. Des millions de kilomètres de fibres optiques se croisent en permanence et relient des continents dans le temps et l’espace. Des contrats, des transactions et des informations de tous ordres traversent les fuseaux horaires, les frontières et les cultures. Les nouvelles routes commerciales sont des éclats de laser et des rayons de satellites. Les marchandises transportées sont le savoir et la technologie. Les évolutions et les mutations technologiques accusent des rythmes à la fois rapides et bouleversants. Les innovations qui en résultent non seulement transforment structurellement les systèmes productifs, mais permettent d’accélérer la croissance. Cela entraîne selon P.CHAPIGNAC19 trois ruptures qui ont une tendance assez nette à structurer les activités économiques autour du traitement de l’information : La production de richesse déplace son centre de gravité de l’activité productrice (la dialectique entre la machine et l’homme) à la création (la conception et le pilotage intellectuel). Il va en résulter le déplacement de la source des richesses vers l’activité de conception. Les transactions de toutes natures ont tendance à s’imposer comme principaux générateurs de la valeur ajoutée, ce qui déjà se constate dans la structure des entreprises où les fonctions commerciales, marketing et autres prennent une importance grandissante Le renversement des hiérarchies des actifs avec un caractère dominant des actifs immatériels. Il se crée alors à l’échelle mondiale un immense réservoir technologique dont peuvent bénéficier tous les pays pour innover et exploiter leur potentiel compétitif dans les secteurs industriel, agricole et des services par acquisition de gains de productivité. Certains pays en ont largement profité sous des formes comme la « révolution verte » ou le développement d’industries lourdes ou légères. Ces éléments indiquent à souhait que la mondialisation est en train de concevoir un nouveau modèle de société que l’on appelle communément la société innovante dont les valeurs clés sont la productivité, la compétitivité, l’efficacité, la rentabilité, l’optimisation, la flexibilité, le contrôle, l’adaptabilité, la mesurabilité et la gestion. Cette société sous-tend un projet axé sur l’apologie du meilleur et de l’excellence. Elle privilégie les outils plutôt que les personnes, elle accorde la priorité aux phénomènes et se soucie très peu des finalités. Elle devrait entraîner de nouvelles réflexions car si on n’y prend garde, sous couvert de progrès techniques, elle peut déboucher sur une logique de compétition, de violence et d’exclusion. Par ailleurs, 19 P.CHAPIGNAC, Communication au Congrès IDT-Marchés et industries, Paris, 1995 38 elle ramène en surface le débat sur les technologies et la recomposition de l’emploi : la machine tue-t-elle l’emploi ou l’oblige-t-il à se déplacer et à se recomposer?20 Cependant, le Continent africain s’insère difficilement dans le concert des nations : en marge de l’expansion industrielle mondiale, il risque d’être exclu de la révolution mondiale des technologies de l’information et des télécommunications (Rapports de 1999 et 2001)21. L’accélération des innovations technologiques risque de produire plusieurs conséquences négatives sur le développement des pays, notamment le creusement de l’écart entre les capacités d’accès et d’utilisation des techniques au Nord et au Sud22, les économies de consommation des matières premières limitant les perspectives d’exportation des PVD et l’approfondissement des inégalités des revenus. Comme l’observait Carlo De Benedetti alors PDG d’Olivetti, « le développement technologique actuel rendra les riches encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres ». Section 5 : Mondialisation multipolaire : la formation de puissants pôles de compétition. Jusqu’à la fin des années 80 tout le système de la mondialisation était géré dans un cadre bipolaire. Mais avec l’effondrement du Bloc Soviétique et l’exacerbation de certaines crises, les contours d’une mondialisation encore plus multipolaire se dessinent. À l’observation, malgré cette forme multipolaire d’organisation et de gestion de la mondialisation, le monde reste fragile, instable et imprévisible. Jamais la précarité n’a été aussi grande sur la planète dans ses sphères économique, financière, politique et sociale et même culturelle. La rupture de la croissance fordienne à la fin des années 60, consolidée et aggravée par le désordre monétaire international a engendré des ruptures d’équilibre dans l’économie mondiale, et face auxquelles tous les moyens exceptionnels de régulation vont se révéler totalement inopérants. L’inflation croît en même temps que le chômage (stagflation). L’endettement s’enlise et fragilise les bases du système financier international marqué par l’ampleur des bulles spéculatives et les fluctuations anarchiques des devises. Le protectionnisme se réinstalle avec des techniques plus sophistiquées échappant souvent à la surveillance de l’OMC (la récente Conférence de Cancun vient d’en administrer la preuve). Face à cette situation et au darwinisme économique, la plupart des grandes nations industrielles organisent des espaces de commerce privilégié (multiplication des organisations régionales) et gèrent leurs complémentarités avec les nations voisines (prolifération des Accords de Libre Échange). C’est dans ce cadre que fonctionne le monde multipolaire qui consacre 4 pôles de puissance qui tournent autour de l’abolition des frontières par la libre circulation des marchandises, des capitaux, des services, l’ouverture des marchés publics et l’élaboration des politiques de coopération pour mieux affronter la concurrence : l’Union Européenne (UE), l’Accord de Libre Échange Nord-américain (ALENA), le J.B. Foucauld : Une nouvelle donne pour l’emploi, Revue Échanges et projets, janvier 1994 RMDH de 2000 et 2001 22 La possibilité pour les PVD de trouver des raccourcis techniques et de choisir le dernier et le meilleur équipement est assez restreinte. 20 21PNUD, 39 Groupe Économique d’Asie Orientale(GEAO) qui se compose des 6 pays de l’ASEAN plus le Japon, la Corée du Sud, Hong Kong et Taiwan, et le MERCOSUR. Ces blocs économiques régionaux sont les meilleurs instruments de compétitivité. En effet, la concurrence exige des pays et des entreprises un subtil dosage de protectionnisme et de libre-échange, d’étatisme et de libéralisme. Dans le monde des affaires, on se soucie bien peu des extrêmes : libre échange sans entrave ou protectionnisme dur ou atténué). Le modelage de l’espace mondial invite à des combinaisons complexes qui seules sont à même d’atteindre la plus grande efficacité. Jadis réservée aux pays en développement, la régionalisation devient la forme d’organisation de l’économie mondiale, si bien que les relations économiques et financières s’organisent en grande zone géographique. Dans ce contexte, les accords régionaux sont des accords préférentiels et accordent à certains pays des facilités d’accès aux marchés intérieurs qui ne sont pas concédées aux autres. La part du commerce mondial qui n’implique pas un des trois grands accords que sont l’UE, l’ALENA et le GEAO ne représente que 15,6%. Désormais, les relations commerciales sont fondées sur le principe fort de la clause de la nation la plus favorisée. Tout pays exportateur bénéficiaire de cette clause se voit automatiquement appliquer le tarif douanier le plus favorable. Cette règle est incluse dans les accords de l’OMC qui, cependant, tolère beaucoup d’exceptions et de dérogations. En conséquence, du point de vue strictement économique, la mondialisation favorise la tendance au renforcement de la régionalisation qui diminue l’efficacité des mesures nationales isolées à la concurrence internationale et encourage les réponses. D’autres éléments existent à coté de ces aspects purement économiques, financiers et technologiques, préfigurant de ce fait les changements spectaculaires comme par exemple le retour du politique et du culturel qui n’ont plus le statut de variables muettes d’une mondialisation qui repose sur l’exigence des « harmonies universelles ». Section 6 : Des mondialisation. conséquences non économiques de la En accentuant les échanges des biens, des capitaux, des technologies mais aussi des hommes, la mondialisation met en contact des systèmes sociaux différents. Elle les déstructure et impose ses modèles et ses valeurs propres selon les principes des « harmonies universelles » indispensables au fonctionnement des marchés : unification des valeurs culturelles, sociales et politiques et leur soumission à la logique marchande. Deux phénomènes importants en apportent la preuve. I/) Mondialisation et déstructuration des identités et valeurs culturelles par l’échange inégal des cultures. À la fin des années 60, H MARCUSE prédisait dans son célèbre ouvrage « l’homme unidimensionnel » la réduction de l’individu à une seule facette : un conformisme asservi par la technologie plutôt que par la terreur. Il déplorait la diffusion de la culture de masse qui réduit le citoyen au rang de simple consommateur. Une quinzaine d’années plus tard, Vance PACKARD dans « La persuasion clandestine » dénonçait la stratégie des industriels publicitaires visant à contrôler les mentalités des consommateurs et uniformiser leur comportement. Aujourd’hui avec la mondialisation, ces phénomènes prennent une dimension 40 insoupçonnée23 et remettent à l’ordre du jour les craintes de MARCUSE. Selon Théodore LEVITT il semble que « le temps des différences régionales et nationales dues à la culture, aux normes et aux structures sont des vestiges du passé »24. Des intellectuels anglo-saxons avancent l’idée que la culture de masse est vouée à s’étendre à partir du centre, en l’occurrence les États-Unis, vers la périphérie qui est en fait le reste du monde25. Cela fait craindre l’instauration de l’hégémonie d’une seule puissance du fait de « l’échange inégal entre les cultures ». On a beaucoup parlé du « Mc Monde » ou encore de la « Mc Donaldisation » à quoi les français tentent d’opposer « l’exception culturelle ». Ce débat est entré dans la conscience commune. Et pour beaucoup d’auteurs, la constitution d’un marché global entraîne la formation d’une culture globale qui gomme toutes les identités nationales. L’idée classique – et désormais banale – de l’unification humaine par la technique de production, de transport, de communication, d’information, revient en surface pour rendre compte de cette question de plus en plus prégnante qui concerne l’avenir de la culture à l’âge du « tout planétaire ». Que vont devenir les valeurs culturelles nationales ? Vont-elles se modifier pour épouser les logiques de compétition ou alors seront-elles étouffées ou gommées par la culture standardisée découlant de la mondialisation ? Ces questions sont au cœur de la crise qui secoue les sociétés africaines. En effet, la mondialisation, par les moyens de communication de masse, diffuse un modèle culturel global, bouscule toutes les valeurs et comportements autochtones et les pousse à des formes multiples et complexes de refus et de résistance. Cheikh Anta DIOP, dans un ouvrage consacré aux problèmes de la renaissance des cultures africaines met l’accent sur l’exemple révélateur de Thèbes sous la 18 ème dynastie. « Ekhanon fut un pharaon acquis à l’influence orientale. Par ses réformes, il faillit diluer l’Égypte de son époque et l’aliéner progressivement au profit des peuples d’Orient qui n’étaient ni techniquement ni scientifiquement plus avancés. Le clergé de Thèbes se dresse derrière Toutankhamon pour recouvrer sa liberté et l’autonomie de la nation égyptienne, en ramenant la pensée de l’époque des dieux, aux croyances et aux cultures de tradition purement thébaines. Les Prêtres savaient tout simplement que l’Orient de l’époque ne leur apportait rien de substantiel, même en matière religieuse. Ils savaient également qu’en renonçant à leurs dieux et à leur vision du monde sous-jacents à leurs institutions religieuses, ils s’abandonnaient dangereusement à une aliénation culturelle qui préparait progressivement l’extraversion de l’Égypte et la perte d’identité du peuple pharaonique, la conquête de leur pays par des modèles, des symboles et des instruments qu’ils n’avaient pas élaborés et dont ils ne pourraient décider l’évolution. Mais les Prêtres savaient aussi que l’impérialisme culturel est toujours contemporain de l’impérialisme politique et économique »26. Le drame évité à Thèbes est le drame vécu par le Continent africain qui doit se convaincre que « l’identité culturelle procède de l’expression volontaire d’une authenticité qui prend racine dans le génie de chaque peuple et dans les valeurs fondamentales qui la sous-tendent. Cette recherche de l’authenticité passe par un ressourcement qui ne traduit pas un simple retour aux sources, mais intègre les Cité par le Recteur Sélim ABOU lors du Colloque de Beyrouth sur la mondialisation, 28 avril 1998 Théodor LEVITT : The marketing Imagination, cité par le Recteur Sélim Abou 25 D.ROTHKOPF écrit dans ce sens que « Les américains ne devraient pas lier le fait que de toutes les nations du monde, la leur est la plus juste, la plus tolérante et constitue le meilleur modèle pour l’avenir, in Foreign Policy 26 C.A. DIOP : Nations nègres et culture, Édit. Présence Africaine, 1956 23 24 41 réalités et les impératifs du monde moderne. Elle implique une prise de conscience lucide qui permette l’actualisation et le renouvellement des valeurs, interdisant ainsi la création de ghettos culturels. Il s’agit de découvrir de nouvelles dimensions de la culture africaine. C’est dire que le monde africain doit élaborer une stratégie culturelle suffisamment efficace pour atténuer les impacts négatifs des modèles culturels étrangers. Cela suppose un système de communication fondé sur l’utilisation des langues nationales pour atteindre les masses africaines, une coopération culturelle internationale et la création d’instruments culturels destinés à favoriser les échanges, à financer les industries cultuelles, à encourager les activités intellectuelles. II/ Mondialisation libérale : système économique libéral doit rimer avec société démocratique. Au plan politique, la mondialisation se traduit par un regain d’intérêt pour les problèmes de démocratie, de paix, de sécurité et de bonne gouvernance. Il est indiscutable que ces éléments sont des préalables du développement économique et social. Le débat est clos assez vite par l’imposition d’un ajustement des PVD aux règles et normes démocratiques formelles et de bonne gestion de tous les centres de pouvoir. C’est le socle minimal de la nouvelle civilisation universelle de la démocratie et des droits de l’homme. Il repose sur l’idée implicite de l’existence de valeurs universelles dans lesquelles devaient se reconnaître l’ensemble des « citoyens du monde ». En effet, il apparaît clairement que « la démocratie portative » dont parlait PARETO doit essentiellement réglementer la circulation des élites. Elle repose sur les règles de la démocratie représentative que l’Occident a mis des siècles à édifier autour du concept de Parti politique27. A-t-on le bon modèle ? Et dispose-t-on des instruments et des moyens pour le réaliser ? Et enfin comment résoudre l’équation très délicate des sanctions à appliquer en cas de défaillance? Alors que certains auteurs soutiennent que la mondialisation annonce la fin des conflits ou « la fin de l’Histoire et le dernier homme »28(FUKUYAMA), d’autres martèlent les préceptes de la « pensée unique » qui font de la mondialisation la voie royale du bonheur : plus le monde sera ouvert, plus la croissance sera élevée, plus le bien-être se généralisera. Toutes les institutions et tous les acteurs ont l’occasion d’y assister, sinon d’y participer, en direct ou «en temps réel». Cette vision idyllique ne correspond-t-elle pas à la globalisation fortement asymétrique effectivement observée. Qu’apporte-elle globalement au continent et au Sénégal ? Section7 : La société civile mondiale en gestation et la revendication d’une mondialisation maîtrisée et équitable. La mondialisation qui s’accompagne d’une double dualité riches/pauvres et chômage/travail a entraîné beaucoup de critiques à l’encontre du système économique mondial incarné par les institutions internationales que sont, la BM, le M. ROCARD dans son ouvrage Pour une autre Afrique, Éd. Flammarion 2001, note que « les institutions africaines fondées sur des prises de décisions collégiales et consensuelles et en ce sens ne sont pas inférieures. La méthode en est l’arbre à palabre et l’instrument l’assemblée de village. Tout se passe comme si l’Occident a remplacé la démocratie consensuelle africaine par son produit la démocratie conflictuelle. » 28 F. FUKUYAMA : La fin de l’histoire, Édit. Flammarion, Paris 1992 27 42 FMI et l’OMC. Ces critiques émanent de plusieurs secteurs de l’opinion internationale et sont traduites sous diverses plateformes à travers des organisations autonomes qui, en conséquence, échappent plus ou moins au contrôle des politiques. La multiplication de manifestations à l’occasion des diverses rencontres des IFI et la convocation régulière du Forum Social Mondial sont des preuves de la formation lente d’une société civile internationale autour de l’exigence d’un monde plus juste et plus équitable et d’un retour à un meilleur équilibre dans les relations internationales. Pour toutes les organisations du Forum Mondial, si l’humanité n’a jamais produit autant de richesses, jamais les inégalités et la pauvreté n’ont été aussi fortes traduisant ainsi un environnement international fortement dual. Ce dualisme entre pays du Nord et du Sud peut s’identifier à travers la faillite du système éducatif, la montée de la pauvreté de masse, la dégradation de la situation sociale. La croissance et le développement sont bloqués, ce qui se manifeste à travers la détérioration des indicateurs du cadre macroéconomique suite à l’approfondissement du fardeau de la dette, l’effondrement des termes de l’échange et la diminution de l’aide publique. Face à cette situation dramatique, depuis plus d’une décennie, plusieurs conférences internationales ont été convoquées mais les résultats restent encore assez faibles: Initiative PPTE, Objectifs du millénaire pour le Développement, Résolution 2626 de l’Assemblée Générale des Nations Unies relative à l’enveloppe d’aide publique au développement (0,7% du PNB des pays riches). La succession de « décennies perdues du développement » et la marginalisation progressive des pays du Sud ont conféré aux ONG de plus en plus nombreuse des rôles accrus. Selon les statistiques du Comité d’Aide au Développement (CAD) de l’OCDE, les dons des organisations privées bénévoles s’élevaient à 6 milliards de dollars en 1995, auxquels il faut ajouter 1,2 milliards de l’Aide Publique au Développement (APD) qui transitent par ces organisations. En définitive, sur l’ensemble des ressources financières vers les PSD, la contribution des ONG représente 3,6%. Ces chiffres montrent l’ampleur des moyens dont disposent les ONG pour mener leurs actions directes au niveau des populations. Le foisonnement, la diversité des interventions, la multiplicité et la complexité de leurs relations, le poids économique, financier et social qu’elles représentent, mettent en relief la place et le rôle des ONG dans le processus d’aide au développement. Ces ONG représentent une fraction de la société civile et se donnent pour principale mission d’aider les populations défavorisées sans distinction de nations, d’États ou de cultures. Cette importance que prennent les ONG en Afrique et particulièrement au Sénégal appelle trois interrogations : Quel serait leur véritable rôle dans la réalisation des objectifs du développement ? Leur mode d’organisation et d’intervention leur permettent-ils de contribuer efficacement à la réalisation des objectifs de réduction de la pauvreté et de développement ? Leurs formes actuelles sont-elles en phase avec les transformations sociopolitiques dans leur sphère d’évolution? En d’autres termes, peuvent-elles passer d’une phase de contestation à celles d’acteurs à part entière dans le processus de mondialisation ? L'autorité morale exercée par ces organismes privés (qui vont des Organisations Non Gouvernementales (ONG) aux Mouvements Sociaux Internationaux) ont trois sources : aptitudes à proposer une liste des thèmes à 43 négocier dans les institutions internationales (pouvoir de fait plus que de droit), capacité de fournir des avis d'expert en vue d’un travail d'influence (lobbying) et positionnement dans les domaines sociaux, visant à l'émancipation des acteurs non étatiques (autorité morale). Les décideurs et tous les acteurs du jeu économique et social des Pays en Développement devraient exploiter positivement toutes ces opportunités qu’offrent les ONG et leurs mouvements sociaux. Au niveau interne, cela leur permettrait de disposer d’une information technique essentielle aux décideurs politiques pour légitimer certains choix et contribuer à la préparation de certaines décisions et au niveau mondial, de peser sur la recherche d’une égalité sociale dans le monde et de donner écho aux revendications d’annulation de la dette, d’instauration d’un commerce équitable etc. En effet, ces mouvements sociaux de la société civile internationale sont profondément réformistes et ont souvent pour objectif majeur d'aider la mondialisation à prendre en charge ses membres les plus faibles. Cette question est au cœur des débats de la Société Civile Internationale regroupée autour du Forum Social Mondial et des idéaux « altermondialistes ». Elle récuse le néo-libéralisme et ses conséquences, et cherche un modèle alternatif. Cette idéologie est rendue responsable des exclusions avec le démembrement des sociétés traditionnelles. En outre, elle est vivement critiquée pour son opposition à l’État providence, au Sud comme au Nord et pour l’exigence, au nom de l’impératif de concurrence, de l’abandon des protections et du soutien étatique à l’emploi, du démantèlement des services publics et de la suppression des filets de sécurité sociale. Section 8 : La question sécuritaire et la gestion des risques réels ou supposés. Depuis les attentats du 11 septembre 2001 les questions de la sécurité sont projetées au centre des préoccupations de tous les États, des peuples et des entreprises de tous les domaines. Les chercheurs en sciences économiques et politiques comme les stratèges accordent désormais une importance de premier ordre aux questions sécuritaires et de gestion des risques. Les attentats du 11 Septembre soulèvent beaucoup d’interrogations qui, sans aucun doute, concernent d’abord la gouvernance mondiale mais aussi les relations Nord-Sud : Comment la politique étrangère menée par les États-Unis depuis la guerre du Golfe a-t-elle créé un potentiel de haine expliquant les attentats du 11 septembre ? Quel est le pouvoir de conviction des intégristes partisans du Jihad ? Les terroristes ont-ils un projet ? Quels sont ses liens avec l'argent : celui des affaires, celui de la drogue et du crime, celui des hydrocarbures ? Quel contenu économique potentiel peut prendre la nouvelle configuration des alliances entre superpuissances après la fin du monde bipolaire? Derrière ces questions conjoncturelles se pose l’interrogation majeure à savoir si le triomphe du marché marque la fin de l'histoire comme le pense F. FUKUYAMA ou bien se dirige-t-on vers le choc des civilisations ? Les réponses à ces questions ont des répercussions directes sur l'économie, selon au moins trois axes : d’abord le mode de fonctionnement global de l'économie mondiale, ensuite la transformation de certains secteurs aujourd'hui clés et enfin la prise en compte des risques et des incertitudes. Depuis les années 90, avec la chute du mur de Berlin marquant la disparition d’une mondialisation bipolaire, l’humanité 44 semblait s’engager dans un processus inéluctable de globalisation marqué par la domination des marchés, le développement des échanges et le recul du pouvoir de régulation des États. Toutefois, cette tendance lourde est en train de s'inverser avec un retour frénétique du politique sur l’économique. En effet, les attentats ont ouvert la voie à une demande accrue d'État, de protection et de régulation. Tous les secteurs sont affectés directement ou indirectement, certains plus que d'autres : énergie, transports, tourisme, nouvelles technologies, banques, etc. Certains de ces secteurs sont particulièrement structurants pour toute l'activité économique. C’est le cas notamment du pétrole dont les prix sont déterminants pour la compétitivité, les échanges commerciaux et la circulation des personnes et des services. Le traitement du risque, des incertitudes et de la sécurité est devenu une question majeure, qui peut déboucher sur une demande de plus d'État et conduire les entreprises à redéfinir leurs orientations stratégiques. Face à ces problèmes aujourd'hui décisifs, des économistes ont tenté de clarifier l'évolution de l'économie mondiale après le 11 septembre 2001. Pour certains, beaucoup d’indicateurs caractéristiques montrent déjà de lourdes tendances récessives avec le freinage de la croissance au niveau des économies du centre, la baisse des activités productives, la détérioration des indicateurs monétaires et financiers etc. Alors que pour d’autres, il ne s’agit que de menaces passagères sur une économie mondialisée solide qui, après quelques turbulences dues au choc américain, devraient retrouver ses marques. Dans l’optique que voilà, les acteurs de l’économie perdent confiance, ce qui crée une morosité au niveau de certains secteurs d’activités : krach boursier passager, ralentissement de la consommation, renchérissement des prix du pétrole, perturbation des marchés du transport aérien et du tourisme. Le scénario catastrophe ne se dessine pas encore pour deux raisons majeures : la solidité de l’architecture bancaire centrale de l’ensemble des pays développés et leur solidarité par les rapides et indispensables régulations de la finance pour empêcher que la situation ne dégénère vers une crise financière qui provoquerait alors une chute de l’activité productive et de service. Cependant, quel que soit l’angle d’analyse, on observe déjà deux phénomènes : d’abord le retour de l’État comme facteur de régulation, et ensuite la réapparition de la question Nord-Sud c’est-à-dire la distance grandissante entre ces deux pôles avec l’élargissement de la dualité richespauvres, le développement des inégalités, la détérioration de la situation sociale et l’exclusion. Dès lors, toute stratégie de lutte contre la violence en général et la violence terroriste en particulier doit reposer sur un combat sans merci contre le cercle vicieux de la pauvreté et du désespoir. C’est la lutte pour le développement qui est largement détournée par la vision qui domine le monde depuis une vingtaine d’années et que l’on désigne par la mondialisation néolibérale. Comprendre et agir pour une paix juste rappelle que la sécurité viendra d’abord et avant tout par l’appui constant à un développement durable, l’instauration progressive d’une paix juste, le respect intégral des droits humains et une généreuse ouverture aux populations migrantes et réfugiées. 45 CHAPITRE 2 L’AFRIQUE PARIA DE LA MONDIALISATION ENTRE MARGINALISATION, PAUVRETÉ ET PRÉCARITÉ. La distribution des revenus à l’échelle mondiale laisse apparaître deux types d’inégalités : celles qui existent d’abord entre les pays et celles observées au sein même des pays, qu’ils soient du Nord ou du Sud. Aujourd’hui, on observe une très forte croissance des inégalités à ces deux niveaux dont les causes sont assez controversées. Généralement plusieurs facteurs sont évoqués pour expliquer ces inégalités dont deux semblent faire consensus : la concurrence accrue des pays à bas salaires particulièrement en Asie et qui justifie assez largement la délocalisation industrielle, le progrès technique « biaisé » au sens où ce dernier supprime de façon massive des postes de travail non qualifié tout en augmentant la demande de travail qualifié. C’est la raison pour laquelle HOANG NGOC LIEN estime que la mondialisation n’a pas encore atteint les hommes car « loin de s’être atténuées, les inégalités se sont creusées. Le fossé s’est agrandi entre les revenus des salaires et ceux du patrimoine, entre la part des salaires et celle du profit dans la valeur ajoutée. Pire, la reproduction sociale continue de jouer à plein : la mobilité intergénérationnelle entre les classes sociales ne s’est pas améliorée ».29 Section1 : Les inégalités et leur portée : la difficulté de réduire la fracture sociale. Sur le premier type, les statistiques montrent que le monde est en phase de polarisation, avec un fossé de plus en plus large entre les pays pauvres et les pays riches. Concrètement, l’écart du revenu par habitant entre les pays industrialisés et les pays en développement a ainsi triplé, passant de 5 700 dollars en 1960 à 15 400 dollars en 1993. De plus sur les 23.000 milliards de dollars que représentait le PIB mondial en 1993, 18.000 milliards provenaient des pays industrialisés, contre 29 HOANG Ngoc Lien : La fracture sociale : sommes-nous condamnés au Libéralisme Édt. Arlea, p192 46 seulement 5.000 milliards pour les pays en développement. Encore plus significativement, le cinquième le plus riche de la population mondiale dispose de plus de 80% des ressources et le cinquième le plus pauvre de 1%. Quelques 2,7 milliards d’individus (sur 6 milliards) vivent avec moins de 2 euros par jour et ils seront environ 4 milliards en 2015. Au cours des trente dernières années, la part des 20% de personnes les plus pauvres dans le revenu mondial est tombée de 2,3% à 1,4%. Dans le même temps, la part des 20% les plus riches passait de 70% à 85%. L’écart de revenu entre les 20% plus riches et les 20% les plus pauvres a ainsi doublé, passant de 30/1 à 6/1. La fortune des 358 milliardaires en dollars que compte la planète est supérieure au revenu annuel cumulé des 45% d’habitants les plus pauvres de la planète. Au cours des trois dernières décennies, la proportion d’individus habitant des pays ayant connu une croissance annuelle de leur revenu supérieure à 5% a plus que doublé (passant de 12 à 27%), mais la proportion de la population mondiale connaissant une croissance négative de ce revenu a plus que triplé, passant de 5% à 18%. Le second type d’inégalité est celle qui existe au sein même des pays. En prenant l’exemple de la France, le revenu mensuel moyen des ménages résidant dans ce pays était de 14 190 F en 1994. Mais 10% des ménages disposaient alors de moins de 4 530 F alors que 10% des ménages gagnaient plus de 25 890 F, soit un écart P9/P1 de 5,7 plus important que l’écart des seuls salaires qui s’établissait à 3,2. Dans les pays de l’OCDE, les inégalités salariales sont mesurées par le ratio P9/P1 qui s’élevait, en 1990, à 2 en Norvège, 2,5 en Allemagne, 3,4 au Royaume-Uni et 4,5 aux États-Unis. Ces inégalités font aujourd’hui l’objet d’intenses controverses au niveau de l’analyse du développement. En effet, certains économistes soutiennent avec force arguments que les inégalités sont favorables à la croissance économique. Ils prennent appui sur les prédictions de S. Kuznets et avancent que si la croissance accroît les inégalités dans un premier temps, elle les réduit ensuite. Encadré 3 : Inégale répartition du revenu Kuznet (prix Nobel 1971) montre que le rapport entre le PNB individuel et les inégalités dans la répartition des revenus prend la forme d’une courbe en « U » renversée. Lorsque les revenus individuels augmentent, les inégalités s’aggravent un maximum pour un niveau intermédiaire de revenus, puis déclinent pour des niveaux de revenus élevés. À y regarder de près, cette assertion peut-être économiquement fondée mais ne convient pas dans la perspective de lutte contre la pauvreté. Pour P. ENGELHARD30, il faut s’interroger pour savoir à partir de quel seuil d’inégalité la croissance de la richesse des uns ne compense plus la perte de richesse des autres ? Rawls fournit une piste intéressante dans le second principe de sa Théorie de la justice sociale31 : lorsqu’il y a des riches, les pauvres sont souvent moins pauvres que si tout le monde était pauvre. Mais alors sommes-nous encore dans un univers où l’accroissement de la richesse des riches garantit que la pauvreté des pauvres va P.ENGELHARD : L’Afrique miroir du monde ? Plaidoyer pour une nouvelle économie. Edit. Arléa, Paris, 1998, p.222 31 J. Rawls : La théorie de la justice sociale 30 47 diminuer ? Et P. ENGELHARD observe avec pertinence que deux ou trois cents personnes parmi les plus riches de la planète ont un revenu qui équivaut à celui de deux ou trois milliards de pauvres. Qu’une inégalité permette à ces pauvres de vivre un peu mieux qu’ils ne le feraient si la richesse était un peu moins mal répartie n’est pas très vraisemblable. Globalement, les inégalités se sont creusées entre les pays et au sein de la plupart d’entre eux. Ainsi, dans les pays opulents d’Europe occidentale, le nombre de pauvres n’a cessé d’augmenter depuis vingt ans. Toutefois, ces inégalités et ces pauvretés excessives deviennent inacceptables et dangereuses, car elles constituent le terreau sur lequel se recrutent les terroristes qui menacent toutes les démocraties du monde. Manifestement, les réseaux terroristes tirent leur origine de la désespérance et des souffrances de la pauvreté que vivent certains peuples souvent dans l’indifférence totale de la communauté internationale. Les attentats de Septembre sont intervenus dans une conjoncture de profonde détérioration des rapports NordSud : dégradation des termes de l’échange, approfondissement des déficits, massification de la pauvreté, endettement qui hypothèque le financement du développement, baisse de la croissance. Dans les diverses négociations internationales à Seattle (OMC), à KYOTO sur le réchauffement de la terre négocié par 160 nations, à Gènes (G8) et à Durban (ONU) dernièrement sur l’esclavage, les pays du Sud ont fait beaucoup de concessions mais n’ont presque rien obtenu en retour. Ces éléments entretiennent des sentiments d’exclusion, de frustrations, de désespoir, tout cela sur fond de pauvreté ambiante.32 Section2 : L’Afrique paria de la mondialisation. Entre pauvreté, précarité et exclusion, elle ne revendique pas encore sa place dans le 21ème siècle33. La participation de l’Afrique à l’économie mondiale a fortement diminué au cours des cinq dernières décennies aussi bien du point de vue de son PIB, de ses exportations que des IDE reçus. Selon l’OCDE, la part de l’Afrique dans le PIB mondial mesurée en parité de pouvoir d’achat entre 1950-2000 a baissé d’un tiers alors que sa part dans les exportations a été divisée par 3. Il en va de même pour les investissements directs étrangers, comme cela a été établi plus haut. D’un autre côté, l’économie mondiale a une assez faible incidence sur la croissance des économies africaines. Cela s’explique d’abord par la base de son système productif composée essentiellement de produits primaires et ensuite par son insertion faible dans des réseaux diversifiés de commercialisation On peut donc dire que les paramètres posés par la mondialisation ignorent l’Afrique. Les investissements croisés, les échanges internationaux sur la base de la croissance de la production mondiale, la globalisation financière aussi bien que les réseaux transnationaux et les firmes globales ne s’intéressent pas au continent. À ces facteurs s’ajoutent d’autres qui sont endogènes et contribuent à la marginalisation de l’Afrique. Au titre de ces facteurs on peut citer : l’absence d’infrastructures adéquates de communication ; l’étroitesse des marchés ; les incertitudes et risques nés des conflits ; la mauvaise qualité des administrations publiques. 32 33 Moustapha KASSE : Récession mondiale et terrorisme, Journal Info7 du 02 fév. 2002 Banque mondiale : L’Afrique peut-elle revendiquer sa place dans le 21ème siècle ?, 48 Les Programmes d’Ajustement Structurel ont tenté d’introduire des réformes qui avaient pour objectif l’assainissement des économies en vue de la restauration de leur compétitivité extérieure par la réduction des déficits budgétaires, une pression sur les salaires, la suppression des subventions, la privatisation et le dégraissage de la fonction publique. Une fois assainies, les économies devraient amorcer une croissance durable tirée par les IDE et les exportations. En définitive, on s’aperçoit qu’en fait l’assainissement ne finit jamais, les IDE se font attendre, la croissance n’est pas durable et la pauvreté est encore loin d’être éradiquée. Cela a nécessité l’élaboration par la Communauté internationale « des Objectifs du Millénaire pour le Développement, un pacte entre les pays pour vaincre la pauvreté »34 I/ Pauvreté de masse aggravée par la défaillance des systèmes traditionnels et modernes de protection sociale. Le Continent africain est la région du monde la plus pauvre, sa production moyenne par habitant à la fin des années 90 est inférieure à ce qu’elle était en 1960, sa part dans le commerce mondial a reculé. Au niveau social, la situation est simplement catastrophique avec 250 millions de personnes qui n’ont pas accès aux services de santé, 140 millions d’analphabètes et 2 millions d’enfants qui meurent chaque année avant leur premier anniversaire. Le bilan de 10 années de recherche et de lutte contre la pauvreté est fortement contrasté. Les actions de lutte contre la misère et la famine ont donné quelques résultats positifs indéniables avec l’augmentation de la production alimentaire du système périphérique et le recul de la faim. Toutefois, depuis les années 70, le nombre de pauvres augmente au même rythme que la population (KANKWENDA, 1999) sans que l’on soit en mesure de répondre aux questions fondamentales à savoir : i) Comment mesurer la pauvreté ? ii) Quels sont les groupes les plus vulnérables ? iii) Quelles sont les conditions de vie des pauvres et des très pauvres ? iv) Quelle politique efficace faut-il mettre en œuvre ? À l’analyse tous les pays africains sont handicapés par une crise sociale d’une très grande ampleur qui se manifeste dans l’accroissement du couple pauvreté et chômage. Cela entraîne une forte dégradation des conditions de vie : pénurie et insécurité alimentaires, diverses épidémies, non-accès aux services de base. Ce processus de paupérisation de masse s’accompagne paradoxalement d’un affaiblissement des formes modernes comme traditionnelles de protection sociale. Le Continent africain administrait la force d’une indiscutable « solidarité », découlant principalement d’un ensemble d’obligations et de droits complexes destinés à préserver la cohésion du groupe et à réduire l’incertitude économique. La logique du « don et du contre-don », sans doute latente dans ce tissu d’obligations réciproques, avait fini par instaurer un contrat-social implicite qui est en train de se déliter dangereusement. Dès lors, la protection sociale cesse de s’appuyer sur les réseaux de la famille élargie qui n’est plus en mesure de répondre aux sollicitations de ses membres les plus faibles et les plus démunis dans un contexte de crise économique. Au niveau des structures formelles, les choses ne vont pas mieux, suite à la crise profonde du système public de sécurité sociale, symbole de « l’Etatprovidence ». Il accuse une triple crise : une crise d’efficacité : effets pervers de prélèvements excessifs ; une crise de légitimité : côté recettes : une redistribution à rebours ; côté dépenses : la solidarité déviée avec des difficultés d’évaluation ; 34 PNUD : RMDH 2003 : Les OMD 49 et une crise d’adaptation. Pris en tenaille entre l’accroissement soutenu des dépenses et le tarissement des sources de financement, suite à l’assainissement économique et financier, le fonctionnement du système de redistribution et de protection sociale est de plus en plus bloqué. La crise économique et financière va finir par liquider tous les filets de protection et de redistribution. La conséquence est alors l’instauration de la pauvreté, de la précarité et de l’exclusion. Les analyses sur la pauvreté sont marquées par trois visions qui peuvent coexister ou alterner dans un même pays : une vision technocratique, une vision fondée sur l’assistance et une vision caritative. La vision technocratique est celle des organisations internationales. Elle est selon Bruno LAUTIER «exprimée sur le mode de la pathologie et emploie souvent un langage mi-médical, mi-guerrier : la pauvreté est une maladie à éradiquer et pour cela il faut mettre en place des stratégies pour les pauvres». Il s’agit d’une maladie du corps social et en conséquence, le réalisme imposant de limiter ses ambitions, il faut scinder la pauvreté en deux ou trois, pour éliminer «une pauvreté absolue» qu’il est nécessaire de supprimer en premier. Il est donc normal que cette vision mette l’accent sur les éléments de quantification en vue de déterminer la proportion de pauvreté absolue qu’une société peut supporter sans risque de faire imploser son ordre social. Cette vison implicite n’est pas appuyée par une bonne connaissance des mécanismes et des facteurs de la pauvreté : les causes macroéconomiques et structurelles (économie mondiale, politiques internes introduites par les PAS, l’endettement) et les causes sociales (double explosion démographique et urbaine, exclusion économique et sociale, absence de protection sociale et rupture des solidarités traditionnelles). Pour en sortir, il est recommandé aux pays africains de poursuivre et d’approfondir l’ajustement structurel qui est seul à même de relancer la croissance économique pour éradiquer la pauvreté. Ce schéma appuyé par les IFI postule que la croissance doit être tirée par les exportations. Ce principe appliqué à l’Afrique a quelque chose de surréaliste avec les exportations africaines qui ont régressé de 14%. Figure2 : Population vivant avec moins de deux dollars 50 II/ Etranglement et hypothèque du développement par l’endettement. A la fin de l’année 2000, les allègements promis s’élevaient à 34 milliards de dollars, ce qui ne représente que 1,6% de la dette totale du tiers monde, et 15% de la dette des pays pauvres très endettés (PPTE)35. On est très loin des pourcentages annoncés régulièrement à grand renfort médiatique. À cela s’ajoute le fait que les quelques allègements fort partiels qui sont décidés sont étalés sur plusieurs dizaines d’années et liés à certaines conditionnalités politiques et économiques difficilement accessibles. Si la Banque Mondiale et le FMI ont lancé cette initiative, c’est parce que la situation devenait trop dramatique et était intenable. Il fallait rendre la dette soutenable pour garantir la poursuite des remboursements. D’ailleurs, le Rapport Statistique de la dette extérieure de l’OCDE, paru en 2001, note que «la mise en œuvre intégrale de l’Initiative ne se traduira pas par une diminution de la valeur (…) de la dette, car les allègements prendront pour l’essentiel la forme de remises d’intérêts et de dons destinés à financier le service de la dette, et non de réductions directes de l’encours de cette dette». Moustapha KASSE : L’endettement de l’Afrique : quelles voies de sortie après PPTE, Marchés Tropicaux n°3000, 9 mai 03 35 51 Le problème demeure donc entier. L’initiative PPTE, c’est un coup de canif dans un baobab. Plus généralement, en 1980, le stock de la dette des Pays En Développement (PED) s’élevait à 586 milliards de dollars ; en 2000, il est passé à 2527 milliards de dollars, il a donc été multiplié par plus de quatre. Dans le même temps, les PED ont remboursé 4 096 milliards de dollars, soit sept fois leur dette de 1980. Tableau 3 : La dette extérieure africaine de 1982 à 2003 en millions de dollars 350000 300000 250000 Montant de la dette 200000 1982 1992 1998 2002 2003 150000 100000 50000 0 82 92 98 2 002 2003 Selon le rapport Global Développement Finance 2001 de la Banque Mondiale, les pays du Sud ont remboursé au Nord, en 1999, 137 milliards de dollars de plus que ce qu’ils ont reçu sous forme de nouveaux prêts. En 2000, c’est 101 milliards de dollars ! Le mécanisme de la dette représente un transfert de richesses des peuples du Sud aux détenteurs de capitaux du Nord. Alors que demander de plus ? Au Comité pour l’annulation de la dette du Tiers-Monde (CADTM), ainsi qu’à ATTAC, il faut dire que l’annulation totale de la dette extérieure publique du tiers monde est, sans conteste, le premier pas indispensable vers la construction d’un monde où le but n’est pas le remboursement de la dette, mais la satisfaction des besoins humains fondamentaux. La dette écrasante et la trop grande pauvreté rendent impossible le financement des investissements collectifs sans lesquels le développement ne peut commencer. 52 III/ Synoptique des défaillances et des risques de l’Afrique dans la mondialisation En résumant, les risques probables de la mondialisation et de la libéralisation sont à la fois économiques, politiques et sociales et se présentent comme suit : Au niveau économique faible capacité d’offre, insécurité alimentaire grandissante avec les deux boulets que sont l’expansion démographique et l’urbanisation accélérée et chaotique secteur privé pas suffisamment développé avec de faibles possibilités financières, techniques de production rudimentaires avec comme issue fatale la faible productivité qui va plomber la compétitivité des économies évoluant dans contexte mondial de haute concurrence et de compétitivité, concurrence dans les débouchés extérieurs et sur le marché domestique avec des conséquences dommageables aux entreprises nationales, suppression des préférences tarifaires et commerciales, orientations défavorables des IDE qui ne trouvent pas encore un environnement des affaires propice et sécurisé. Au niveau technologique faible capacité technique et technologique et tendance au creusement de la fracture technologique et numérique. Mise à l’écart de la société du savoir et des innovations ; insuffisance quantitative et qualitative du capital humain et des institutions de recherche–développement ; déficience des systèmes de formation et de renforcement des capacités du capital humain : éducation et santé transferts technologiques et innovations financièrement et culturellement coûteux. Au niveau social 53 processus contradictoire d’appauvrissement et d’affaiblissement des formes modernes comme traditionnelles de protection sociale ; l’offre de biens et services est calquée sur celle de l’Europe, dont le revenu par tête est quarante fois plus élevé (18000 dollars contre 450) ; absence de filet de protection pour atténuer la sévérité des conséquences sociales des premières générations de PAS. Au niveau politique échec des modèles démocratiques et de gouvernance mimétiques et imposés. La démocratie n’assure pas la circulation des élites et la bonne gouvernance n’assure pas la participation des peuples à la gestion des pouvoirs ; incapacité de l’État bienveillant de régulation des appareils économiques, politiques et sociaux et de contribuer à l’insertion des acteurs dans la mondialisation. Forte imbrication de certains intérêts et développement de la corruption qui gangrénent le fonctionnement de l’Etat ; confiance au marché comme régulateur de la vie économique alors qu’il est traversé par de multiples distorsions qui le rendent aveugle aux condtions des pauvres et des inorganisés. IV/ Face au déclin de l’Aide Publique au Développement (APD) à la fois insuffisante et mal orientée, la recherche de systèmes et de politiques monétaires flexibles. Plusieurs études réalisées sur le Système Monétaire International (SMI) et le Système Monétaire Européen (SME) montrent que l’une des tendances marquantes au sein de l’économie mondiale, depuis 1945, consiste en un mouvement d’intégration croissante entre les différentes économies nationales. Pour les pays africains, cette solution bien que peu retenue ne sera certainement pas évitable dans l’avenir. À long terme, la stabilité de la monnaie d’un pays dépend de la convergence de son économie et de la coordination de sa politique avec celles de ses partenaires. De ce point de vue, le Zone Franc comme accord de change peut découler de l’intégration croissante des marchés financiers dans le cadre de la mondialisation de l’économie avec la règle des 3 D (désintermédiation, déréglementation, décloisonnement). Aujourd’hui, les enjeux de la globalisation financière posent la question du gouvernement du monde par les marchés financiers. Ainsi, les citoyens de la planète ont commencé à suivre, en temps réel, la fiche de santé de l’économie mondiale au travers des indices financiers des grandes bourses (CAC 40, Indice Nikkei, Dow Jones,…). Dans ce contexte, les mécanismes de transmission de la politique monétaire confèrent un rôle plus accru à la politique de change et, l’absence de celleci sera un sérieux handicap pour tout pays ou groupe de pays. L’ouverture internationale d’un pays est pertinente lorsque ses produits sont compétitifs. Pour mesurer la compétitivité d’un pays et ses variations, on utilise généralement le Taux de Change Effectif Réel (TCER), qui apprécie la variation du taux de change effectif nominal par rapport au taux d’équilibre (PPA). Le TCER donne une bonne estimation des conséquences sur la balance extérieure des variations du TCEN, liée aux modifications de prix résultant des changements d’efficacité du système productif. Il procure une bonne appréciation de l’évaluation des coûts de production domestique des biens internationaux, ceux qui font l’objet 54 d’une demande mondiale et qui doivent guider la spécialisation. Pour que l’indice de compétitivité reste stable, il faudrait que les coûts nationaux de production des biens échangeables restent proches de ceux des autres pays concurrents, et donc que l’inflation interne reste voisine de celle des pays partenaires. Ce qui signifie, faut-il le rappeler sous une forme, que toute hausse des prix internes qui serait supérieure à la hausse des prix internationaux, pondérés par le taux nominal, entraînera une baisse du TCER, c’est-à-dire une surévaluation du taux réel, et donc une perte de compétitivité. Au contraire, pour améliorer la compétitivité nationale, il convient de : Diminuer le taux nominal, c’est-à-dire dévaluer la monnaie nationale ou diminuer le prix domestiques ou encore, augmenter les prix internationaux, par exemple grâce à la production aux frontières. On remarque que l’analyse ne conduit pas aux mêmes décisions de politique économique selon que le pays se trouve en régime de changes fixes ou variables. La stabilité d’une monnaie peut être défendue par sa Banque Centrale, mais pas indéfiniment. À long terme, la stabilité de la monnaie d’un pays dépend de la convergence de son économie et de la coordination de sa politique avec celles de ses partenaires. Dans les pays en voie de développement, la difficulté s’accroît avec la nécessité de donner à cette politique des objectifs à plus long terme. Il ne s’agit plus seulement de rétablir l’équilibre extérieur par la politique macroéconomique traditionnelle, mais d’assurer une croissance durable de l’économie et d’initier une véritable politique de développement. Sous ce rapport, l’intégration régionale devrait être favorisée par la mise en place d’un Système monétaire et de crédit en vue de faciliter les échanges entre pays de la Zone. Ceci exigerait la création d’une sorte de division régionale du travail (DRT) accompagnée de la création d’un Système Monétaire Régional (SMR) établissant des règles de parité, des règles de stabilité, des règles de gestion monétaire.36 Les soubresauts monétaires sont accompagnés par une baisse importante de l’Aide Publique au Développement qui subit une réduction depuis 1995, aussi bien en valeur absolue qu’en valeur relative. La désaffection relative de l’Afrique profitait essentiellement aux pays de l’Est européen. Dans les années 80, les pays donateurs s’étaient fixés un objectif : porter le montant de l’APD à 0,7% du PNB, le double des montants alloués à l’époque. Dans les faits, les budgets de l’APD ont plutôt diminué presque de moitié. Globalement, ils sont passés de 0,43% du PNB, en 1988, à 0,29%, en 2001. Parallèlement à cette diminution, l’APD a évolué comme instrument de mise en œuvre des Programmes d’Ajustements Structurels (PAS). « Les pays donateurs sont devenus des inconditionnels de la conditionnalité ». Les multiples défis que l’Afrique doit relever dans le cadre d’un développement durable qui réduise la pauvreté de masse, ne peuvent être levés par le simple recours aux marchés financiers. Les récentes crises financières de la mondialisation ont largement montré que les IDE ne peuvent être un substitut à l’Aide Publique au Développement qui doit en être le complément indispensable. Il faut alors améliorer quantitativement et qualitativement l’APD. Il y a alors un triple défi à relever augmenter substantiellement les budgets de coopération internationale en remettant concrètement à l’ordre du jour l’objectif de 0,7% du PNB; Moustapha KASSE : Le développement par l’intégration, chapitre4 intitulé : La création d’un ordre monétaire régional en Afrique de l’Ouest, Édit. NEAS, 1992 36 55 réorienter ces budgets vers les objectifs de lutte contre la pauvreté, de justice sociale et de développement humain. Rappel : 70% des 4, 5 milliards de personnes qui vivent avec moins de 2$ US par jour sont des femmes et des enfants; réserver des montants suffisants pour les initiatives non gouvernementales, en particulier pour les programmes de sensibilisation et d’éducation du public et pour la concertation organisée des organismes de coopération et de solidarité internationale. En définitive, cette analyse de la mondialisation montre que notre époque est celle des « démocraties concurrentielles » c’est-à-dire des démocraties qui promeuvent l’interaction permanente de la politique et de l’économie, la prééminence du marché mondial et l’obéissance des économies nationales. Dans ce nouveau contexte, la politique économique sera une politique internationale tournée vers le marché, où les méthodes d’intervention n’auront plus rien à voir avec les politiques nationales traditionnelles. Dès lors, une fois comprise et considérée comme une nouvelle configuration de l’économie mondiale, la mondialisation implique la question de l’insertion positive de l’économie sénégalaise à sa logique. À première vue, toutes les interdépendances analysées révèlent à la fois les potentialités mais aussi les risques de la globalisation pour l’Afrique. D’abord tous les paramètres qu’elle pose ignorent pour une bonne part le continent. Et lorsqu’elle les intègre, c’est pour l’introduire comme un support aux multinationales (européennes, américaines, asiatiques) en termes d’approvisionnement régulier et stable en matières premières et de débouchés solvables (ou solvabilisables). Autrement dit, ni les investissements croisés, ni les échanges internationaux sur la base de la croissance de la production mondiale, ni la globalisation financière, ni les réseaux transnationaux, ni les firmes globales, nulle part dans ce jargon de grands et de riches, on trouvera une place de premier plan pour l’Afrique. Les théories et les pratiques de la mondialisation ont une faible perception de l’État surtout, africain. Elle le confine au simple rôle de gestionnaire des collectivités sous l’œil vigilant de multiples observatoires que sont les institutions de gouvernance de l’économie mondiale dont l’efficacité est fortement contestée. Ces observations n’entament en rien le caractère inéluctable de la mondialisation. Section 3 : Les perspectives africaines d’insertion dans la mondialisation. Dans son rapport de 1996, le FMI montre qu’il serait illusoire de rejeter la mondialisation car elle doit permettre aux pays, quel que soit leur niveau de développement, de saisir des opportunités. Dans son sillage, certaines économistes considèrent que la globalisation n’est pas un jeu à somme nulle et que les pays en développement et les pays industrialisés en tirent des effets d’entraînement réciproques, conformément aux théories de l’échange international (RICARDO et H.O.S.). Celles-ci soulignent par ailleurs que le commerce sans entrave est favorable à tous les partenaires quelle que soit leur taille, pourvu simplement qu’ils se spécialisent dans les productions où ils ont les meilleures dotations factorielles naturelles. Il n’existe dès lors aucun obstacle insurmontable – si ce n’est l’État – au développement des échanges. C’est cette logique qui préside à la création de l’OMC. À l’appui, l’OMC montre que la valeur du commerce mondial de marchandises s’est 56 accrue en 1995 de 19%. Ainsi la valeur des exportations mondiales passe de 164 milliards de dollars en 1960 à 4900 milliards en 1990. Le commerce mondial a été multiplié par 39. Il n’en va pas de même pour l’Afrique dont la progression est inférieure à la moyenne mondiale (5,4%). I/ Exigence de construction d’économies compétitives. Quel que soit l’indicateur considéré, on s’aperçoit que l’Afrique est marginalisée tout aussi bien dans le processus de production, d’échanges que dans la distribution des investissements directs étrangers. À cela viennent s’ajouter des termes de l’échange complètement défavorables contribuant à la détérioration du pouvoir d’achat des africains. C’est dans ce contexte qu’il est demandé aux pays africains de redresser leurs économies (ajustement structurel) et de les ouvrir sans entrave avec la levée de toutes les restrictions tarifaires et non tarifaires et l’annulation de toutes les subventions et l’instauration de libres marchés. Beaucoup de chercheurs récusent cette vision optimiste plaçant l’Afrique parmi les grands bénéficiaires de la globalisation. L’argumentaire s’appuie sur deux éléments : l’un théorique, fondé sur la compréhension de la théorie des avantages comparatifs et l’autre plus pratique portant sur les subventions agricoles. Prenons cette dernière question. Les politiques agricoles restées jusqu’en 1986 à l’écart des négociations menées dans le cadre du GATT sont depuis l’objet d’une âpre bataille entre les deux puissances agricoles mondiales : les États-Unis et l’Europe de la PAC. Or les deux puissances n’ont en rien respecté l’accord de MARRAKECH qui postulait entre autres d’une part de faciliter les importations de produits agricoles en abaissant les droits de douane, et d’autre part d’améliorer les conditions de la concurrence entre pays exportateurs en réduisant les subventions et les aides publiques aux producteurs. Bien que la forme soit différente, l’agriculture américaine reçoit désormais une aide supérieure à son collègue européen. Ces subventions sont impérativement interdites aux africains. Figure 3 :L’Afrique se marginalise dans le commerce mondial. 57 II/ Exigence d’une régionalisation de gré ou de force. Quel que soit l’angle d’analyse, les mutations introduites par la mondialisation ne se présentent pas comme un mauvais moment à passer à tel enseigne que, tel le roseau de la fable, il faille plier l’échine et attendre que le beau temps revienne. Le monde est dans un nouveau système d’économie sociale de marché, de compétition économique et de démocratie concurrentielle dans lequel pour survivre, il faut avoir des stratégies clairvoyantes, pertinentes et complètes, une bonne maîtrise des savoirs et un très grand professionnalisme37. Les analyses réalisées montrent que l’Afrique est à la périphérie du système mondial, handicapée par d’innombrables difficultés économiques et sociales. Celles-ci sont subséquentes d’une part à la chute brutale des cours des matières premières provoquée par la crise financière et économique mondiale, et d’autre part par les conditions climatiques défavorables à l’agriculture et les problèmes engendrés par l’instabilité et les conflits qui ont affecté une bonne partie du continent. Malgré quelques embellies dans des pays limités (Tunisie, Maurice, Botswana, Burkina Faso, Ouganda, Afrique du Sud) et dans certains secteurs, le bilan du développement se lit en termes de contre-performances qui ont conduit progressivement le continent à la marge des affaires du monde. 37 Moustapha KASSE : Partenariat et nouveau régionalisme en Afrique, Édit Nouvelles Du Sud, 2003 58 Cette situation se manifeste par la détérioration généralisée des fondamentaux des économies nationales : faible taux de croissance économique, inflation souvent galopante, endettement massif, stagnation des économies, approfondissement du double déficit chronique de la balance des paiements et des finances publiques. Les économies africaines ont assez mal réagi aux chocs externes comme la morosité de l’économie mondiale, la baisse des cours des matières premières dont le pétrole, et la crise asiatique. Ces chocs externes ont entraîné des effets désastreux sur le déficit budgétaire, le taux d’inflation, la croissance du PIB, l’endettement et le taux de change. À la fin des années 90, l’Afrique représente 12% de la population mondiale mais fournit moins de 1% du PIB mondial. Les résultats du développement industriel et agricole sont aussi modestes. Il avait été mis en place une stratégie d’industrialisation par substitution aux importations qui avait de faibles relations en aval comme en amont avec le secteur agricole : les performances se sont révélées décevantes. Au niveau des relations avec l’extérieur, la part de l’Afrique dans les exportations est modeste. L’Afrique est complètement absente du commerce mondial dans les branches les plus dynamiques des produits manufacturés et des services. Au plan social, la dégradation du bien-être s’élargit avec la montée de la pauvreté dont le rythme de croissance est plus rapide que celui des revenus. Ainsi, la dimension d'un vaste marché regroupant un maximum d'entités économiques n'est-elle pas moins importante que les conditions stables appropriées permettant aux forces de ce marché de jouer pleinement dans le sens d'une relance des activités économiques et du développement? Cette question est d'autant plus fondée qu'aujourd'hui, nul ne doute que tout processus d'unification économique et monétaire nécessite un certain nombre d'étapes successives qu'il serait dangereux d'inverser, au risque de conduire l'intégration à l'inefficience ou à l'échec. Et cela, que l'on passe par des intégrations sous-régionales (Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique centrale, Afrique du Nord et Afrique Australe, par exemple) ou régionales. L’espace économique du continent est subdivisé en cinq régions qui développent chacune en son sein une ou plusieurs initiatives d’intégration : en Afrique Centrale avec la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC), la Communauté Économique des Pays des Grands Lacs (CEPGL), en Afrique de l’Est avec la Communauté Économique de l’Afrique de l’Est (CEA), en Afrique du Nord avec l’Union du Maghreb Arabe (UMA), en Afrique Australe avec l’Union Douanière de l’Afrique Australe (UDAA), la Communauté pour le Développement de l’Afrique Australe (SADC), la Zone d’Échanges Préférentiels (ZEP), le Marché Commun des États de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe (COMESA) et en Afrique de l’Ouest avec la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), l’Union du Fleuve Mano (UFM). Ces blocs fonctionnent de façon assez inégale et réalisent, par moments, des résultats appréciables dans les domaines respectifs du commerce intra régional, de la coordination des politiques économiques et monétaires, de la mobilité des facteurs comme la main d’œuvre et les capitaux. En définitive, il est attendu de tous ces schémas d’intégration qu’ils contribuent non seulement au développement de la taille des marchés, à la réduction des coûts de transaction mais aussi à l’amélioration de la concurrence entre producteurs. 59 CHAPITRE 3 LE PÉTROLE DANS LA GÉOSTRATÉGIE DE RÉGULATION DE LA MONDIALISATION. La situation énergétique mondiale est devenue une grande préoccupation à la fois des décideurs politiques, de tous les acteurs de la vie économuqe, de l’Agence Internationale de l’Énergie et des scientifiques. Aujourd’hui, les systèmes productifs, les activités industrielles et humaines reposent sur un modèle énergétique à base de ressources non renouvelables, qu'elles soient fossiles (pétrole, charbon et gaz) ou minérales (uranium). Plus précisément, le pétrole s’est imposé comme principale source énergétique, et ses sous-produits sont déterminants pour les économies modernes, ce qui entraîne une hausse constante de la demande mondiale alors même que l’offre semble avoir du mal à suivre cette demande. Section1 : Le pétrole, une variable clé dans la géostratégie et la compétitivité de l’économie mondiale avec des accroissements des prix sans fin. Dans ces conditions la flambée des prix du pétrole qui ont franchi la barre fatidique des 100 dollars a suscité de vives inquiétudes et des débats passionnés sur les véritables enjeux géostratégiques planétaires du pétrole. Au début des années 70, le prix du baril était de 2 dollars pour évoluer par la suite à 35 dollars en 1980, 80 en 2000 et maintenant 100 dollars et plus. Figure 4 : Fluctuation des prix du pétrole. 60 La configuration de la planète en fonction des dotations pétrolières laisse apparaître 4 groupes qui ont des perceptions différentes de l’enjeu du pétrole dans les relations internationales : les pays riches, riches en pétrole comme les États-Unis et la Russie. les pays riches et pauvres en pétrole comme l’Europe et le Japon. les pays riches en pétrole et non encore industrialisés comme les pays du Moyen-Orient et du Golfe, et de quelques producteurs africains. les pays pauvres et pauvres en pétrole comme la plupart des pays africains. Cette configuration établit que le pétrole est une variable stratégique en tant qu’instrument d’allocation des ressources financières à l’échelle mondiale (superprofits des majors du pétrole par exemple pour Exxon/Mobil 490 milliards de francs, BP/Amoco/ Arco plus de 167 milliards de francs), Total/Petrofina/Elf 80 milliards de francs et accroissement des réserves des pays producteurs comme l’indique le tableau qui suit et comme facteur de régulation de la compétition mondiale (par le biais des surcharges des coûts de production) dans les échanges internationaux. Pour les pays pauvres, le pétrole est l’un des facteurs des déséquilibres macroéconomiques graves qui ont conduit à l’endettement massif. Toutes ces raisons expliquent que cette matière première extrêmement sensible n'a jamais été laissée uniquement aux forces du marché. Au contraire, les États interviennent directement ou indirectement pour exiger ou imposer une gestion concertée des stocks restants. Voilà pourquoi beaucoup d’auteurs le considèrent comme un bien public international. En définitive le pétrole est à l’origine des trois crises qui secouent actuellement le système mondialisé: la première crise est le réchauffement climatique qui est à la base des perturbations comme la sécheresse, les inondations et d’autres catastrophes naturelles dues aux émissions des gaz à effet de serre, la deuxième crise est celle liée à la recomposition de l’espace du Moyen-Orient, source principale d’approvisionnement pétrolier des pays industrialisés et la troisième crise est celle de la dette des pays en développement victimes de l'augmentation des prix du pétrole. Ces pays sont condamnés à continuer d’emprunter au Fonds Monétaire International (FMI) et à la Banque Mondiale pour faire face à leurs déséquilibres externes. À cela s’ajoute les fortes inégalités dans l’accès aux ressources pétrolières qui se traduisent dans le fait que les ¾ de la production mondiale sont consommés par les ¼ de la population, soit o,8 Tonne Équivalent Pétrole par habitant pour les PVD et 4,7 TEP pour les pays industrialisés. Malgré ces faiblesses relatives des consommations énergétiques, les factures pétrolières deviennent insoutenables pour les PVD particulièrement les non producteurs. La situation énergétique mondiale est aujourd’hui préoccupante. La question se pose de savoir comment satisfaire des besoins fortement croissants sous la contrainte de ressources limitées et la nécessité du respect de l’environnement ? Pour y répondre, il importe d’opérer une analyse exacte de la carte de consommation mais aussi de la production. C’est dire qu’il faut dépasser les explications simplistes tendant à justifier les difficultés du jeu pétrolier mondial par les pays producteurs qui agiraient indûment sur l’offre pour accroître leur rente de situation ou par l’apparition de nouveaux demandeurs comme la Chine qui consommerait trop. Sans nul doute, la demande en pétrole a fortement augmenté sous l'effet conjugué de plusieurs facteurs comme l'accélération de la consommation aux ÉtatsUnis, en Europe et dans la plupart des pays d'Asie provenant du retour de la croissance dans les principaux pays industrialisés, du regain d'activité dans certains secteurs comme le bâtiment, les travaux publics et surtout les transports. Mais elle 61 s’explique aussi par des calculs géostratégiques plus complexes liés notamment à la gestion des risques par la recherche d’un approvisionnement stable et sécurisé, à la recherche d’économies de rente qui apparaît de plus en plus dans l’idée d’un réajustement équilibré pour garantir les transferts intergénérationnels, à la volonté de puissance et de domination. Au demeurant, pour rattraper leur retard d'industrialisation, les pays émergents d’Asie pèsent de plus en plus dans la consommation mondiale et continueront à exercer une forte pression sur la demande dans les années à venir. Figure 5: Réserves d’énergie par zone géographique Dans quel sens ces facteurs vont-ils évoluer ? Le dilemme est-il d’accroître l’offre ou de modifier le modèle de consommation énergétique ? Quels sont les choix énergétiques à moyen et long terme ? De quelles marges peuvent disposer les pays non producteurs particulièrement les plus pauvres d’entre eux? Section2 : Les choix énergétiques à moyen et long terme. L'énergie consommée dans le monde provient, pour environ 60%, des ressources en hydrocarbures qui sont par nature non renouvelables. Tous les Instituts de recherches dans le domaine établissent que le pétrole qui sort des puits mondiaux passera dans les prochaines années par un «pic» qui empêchera l’offre des pays producteurs de suivre la demande mondiale. En d’autres termes, les capacités mondiales de production vont atteindre leur maximum avant de décroître inéluctablement. Dans cette optique, l'AIE a construit un scénario de " référence " qui montre que le stock exploitable d’hydrocarbure liquide est de 45 ans, celui du gaz 62 naturel de 60 et celui du charbon de 250 ans, et qui en même temps évalue le « pic » : si les tendances actuelles se maintiennent, la consommation actuelle de 9 milliards de TPE devrait doubler aux environs de 2050 ; le « pic » interviendrait à l’horizon de 2030 et les prix du pétrole seront forcément liés à la proximité du pic de production. Le tableau qui suit synthétise parfaitement les consommations des différentes sources d'énergie, leurs réserves, leurs conséquences sur le climat et les tendances actuelles relatives à l'évolution des prix. Tableau 4 : Evolution des énergies dans le monde Source : Économie et Politique 620-621 Mars Avril 2000 Tout le défi énergétique du 21ème siècle se situe à ce niveau. En effet, le scénario de l'AIE indique clairement que les mécanismes de marché (tels qu'ils ont été modélisés par cette institution peu suspecte de défiance à leur égard) ne fourniront pas d'incitations suffisamment fortes pour éviter l’impasse énergétique planétaire. En effet, dans ce cas de figure, les prix pourraient atteindre, selon les prévisions, les 300 $ le baril. Manifestement, il faut définir des choix de politique énergétique, au plus vite, car 2030 est déjà là. Cette question interpelle les décideurs politiques malgré leur vision bornée par leur renouvellement à court terme, les scientifiques et les chercheurs de toutes les disciplines qui ensemble devront repenser l’intégralité du modèle énergétique depuis la production, la conversion et l'utilisation de l'énergie dans les modes de vie. Les réflexions en cours menées par les Instituts de Recherche et divers scientifiques gravitent autour de trois axes fondamentaux à partir desquels, il est souhaité que les pouvoirs publics élaborent des politiques volontaristes. Il s’agit 63 du retour de la filière nucléaire comme axe central des politiques énergétiques avec la fabrication de nouvelles générations de réacteurs à haut rendement mais suffisamment sûres pour être à l’abri du risque d'accidents grave, de type Tchernobyl. En effet, l'énergie nucléaire semble être la solution la plus robuste pour fournir de l'électricité aux populations urbaines, sans accroître les désordres climatiques. Il demeure que le développement du nucléaire relève davantage de la politique industrielle; du développement des énergies renouvelables qui ne couvrent actuellement que 10% des besoins mondiaux malgré les avancées technologiques assez significatives, particulièrement dans l’hydroélectricité ; de la promotion des biocarburants qui font des percées remarquables dans certains pays comme le Brésil. Il reste que, comme toutes les sources alternatives aux énergies fossiles, le nucléaire et les énergies renouvelables comportent des contraintes. Les Pays industrialisés notamment les États-Unis, l’Europe et le Japon ont engagé des investissements lourds dans des programmes de recherche pour maîtriser les nouvelles technologiques caractéristiques des énergies du futur. Certains pays émergents comme la Chine, l’Inde et le Brésil mènent des politiques similaires de recherche de sources substitutives. L’Afrique risque, une fois encore, d’être laissée en rade alors qu’elle pourrait selon le mot du Président Abdoulaye Wade « aspirer à être demain le fournisseur d’énergie propre du monde » Section 3 : Les Etats africains et le pétrole : handicap majeur au développement à la fois pour les producteurs et les déficitaires. Au regard de la flambée des prix du pétrole, il n’est guère superflu de s’interroger sur les perdants et les gagnants du marché. Les producteurs africains sont au nombre de 12 dont les plus importants sont : le Nigéria avec 3,5% de la production mondiale et des revenus annuels moyens de 52 milliards de dollars, la Lybie avec 2,1% et 34 milliards, l’Algérie avec 2,2% et 46 milliards, l’Angola avec 1,6% et 25 milliards, le Gabon et le Congo Brazza 0,3% et respectivement 4,70 milliards et 5,8. L’Afrique pétrolière ne perçoit pas moins de 200 milliards de dollars de recettes annuelles moyennes. Sans nul doute pour les pays déficitaires, il est connu qu’ils doivent faire face à un accroissement insoutenable de la facture pétrolière qui risque de compromettre leur processus de croissance et les pousse à rentrer dans un cycle infernal d'endettement international. Mais, parallèlement, les pays producteurs à leur tour connaissent bien souvent un certain nombre d'effets pervers connus sous l'expression de « syndrôme hollandais ». I/ Les pays africains pauvres et pauvres en pétrole : les étranglés par la flambée des prix pétroliers. En regardant la distribution de la consommation énergétique on observe des inégalités criantes d’accès à cette ressource devenue indispensable à la vie économique et sociale. En moyenne, un Africain consomme 13 fois moins d'énergie qu'un Américain. Toutefois, dans ce domaine comme dans bien d’autres, on observe un énorme paradoxe africain : la production de pétrole du continent excède une centaine de fois les besoins de consommation. La traduction financière de ce 64 paradoxe est d’un côté une accumulation importante de réserves financières pour les producteurs et de l’autre une asphyxie financière pour les non producteurs suite à un alourdissement de leur facture pétrolière. En l’absence des plus gros producteurs africains (la Libye, l’Algérie, le Nigéria, l’Angola, …) les producteurs moyens peuvent individuellement ou collectivement satisfaire largement la demande sans grand préjudice pour leurs recettes d’exportation. En conséquence, il importe d’œuvrer au plus vite, à la résorption de cette fracture énergétique pour reprendre un concept cher au Président Wade. Ce réajustement énergétique est d’autant plus urgent que sur le Continent, trois phénomènes conjugués (l’urbanisation accélérée, l’industrialisation et les réformes agraires) vont accroître de façon substantielle la demande énergétique. Ces facteurs vont peser lourdement sur l’aggravation de la facture pétrolière qui risque de compromettre sérieusement toutes les prévisions de développement et de croissance, particulièrement pour les Pays Africains Non Producteurs de Pétrole (PANPP) selon la dénomination du Président Abdoulaye Wade. L’envol des prix du baril de pétrole a complètement laminé leurs ressources financières qui devraient servir à financer le développement, et augmenter la taille de l’endettement. De fait, les annulations de la dette suite à la Conférence du G8 de Greeneagles n’auront plus que de faibles effets sur le développement social. Une nouvelle fois, les Objectifs du Millénaire pour le Développement seront encore compromis. Selon le Président A. WADE la facture pétrolière est absolument insoutenable pour les pays africains non producteurs38. À titre d’exemple souligne-t-il, «la facture pétrolière du Sénégal a plus que doublé entre 2002 et 2005 passant de 200 milliards de F CFA à 426 milliards de F CFA soit une surcharge cumulée de 320 milliards de FCFA. Dans le même temps, les subventions pétrolières qui se chiffraient à 23 milliards de FCFA en 2002 pourraient s’établir à 117 milliards de F CFA en 2006.» Cette situation est le lot de la quasi-totalité des pays non producteurs comme le Burkina Faso, le Bénin, le Niger, La Guinée, le Mali, le Maroc et Madagascar. II/ Le pétrole une malédiction pour les pays producteurs africains: le « syndrome hollandais »39 Les pays bénéficiaires d’une rente économique d’origine minière sont souvent victimes d’un phénomène connu sous le nom de « syndrome hollandais qui traduit les dysfonctionnements de l’économie qui la rendent incapables de bénéficier de cette rente. Les ressources financières provenant de la rente peuvent être à la base de cinq effets déséquilbrants sur l’ensemble de l’économie : un effet sectoriel, un effet sur le taux de change, un effet demande, un effet sur le budget, et effet social. Le premier effet de la rente est le développement hypertrophié du secteur exportateur qui exerce un effet de polarisation sur les facteurs de production à cause des opportunités de profit et de salaires, sur son espace de localisation qui va se développer au détriment des autres territoires. Le second effet est relatif à la surévaluation de la monnaie nationale soit par la hausse des prix intérieurs si le taux de change est fixe, soit par la progression du taux de change nominal si le taux de change est flexible Le troisième effet provient de l’accroissement des revenus Discours prononcé lors de l’ouverture de la Conférence ministérielle pour la création de l’Association des Pays Non Producteurs de Pétrole (Dakar, 27 juillet 2006). 39 Le « syndromel hollandais » encore appelé Dutch disease est apparu avec les découvertes de gaz naturel de la région de Groningue dans les années 1970, qui s'étaient traduites par des déséquillibres macroéconmiques et une surévaluation dommageable de la monnaie nationale le Florin. 38 65 distribués de manière licites ou illicites, dans les deux cas, ces revenus entraineront des pressions inflationnistes et une augmentation des importations dont l’incidence sera immédiate sur la balance commerciale. Tout va se passer comme si l’extérieur donne d’une main des revenus additionnels pour les récupérer de l’autre. Le quatrième effet concerne le gonflement des recettes budgétaires qui vont désormais dépendre des flctuations de la rente. Enfin le dernier effet est relatif au creusement des inégalités internes et surtout au développement de la corruption au niveau des acteurs liés directement ou indirectement à la valorisation de la rente. Ces effets conjugués créent des dysfonctionnements macroéconomiques qui font, en définitive, de la rente un handicap à la croissance et au développement : tensions inflationnistes, appréciation du taux de change, modifications de la structure des prix relatifs en faveur du secteur abrité, creusement des déficits et paradoxalement détérioration du pouvoir d’achat avec éventuellement une persistance de la pauvreté. Manifestemnt ce « syndrome hollandais est bel et bien observable à l’échelon des pays producteurs de pétrole. On y observe que la rente pétrolière quelque soit son niveau a désservi le développement économique en installant des mécanismes d’amplification des déficits des finances publiques et de corruption qui finissent par gangrener tous les équilibres macroéconomiques. En prenant le cas des Pays du Golf, ils sont devenus par l’ampleur des revenus pétroliers de grandes puissances financières qui restent encore structurellement sous-développés. En 2003, ces revenus ont atteint 82 milliards de dollars en Arabie Saoudite, 27 en Iran, 25 aux Emirats, 22 au Nigeria, 19 au Venezuela et au Koweït, 13 en Libye (pays de 2 millions d'habitants). Il convient d’y ajouter les ressources financières tirées des exportations de gaz. Pourtant, aucun de ces pays n’a réussi un quelconque décollage économique. Le Nigeria est la meilleure illustration du faible impact de la manne pétrolière estimée sur 25 ans à plus de 300 milliards de dollars versés aux gouvernements successifs. Ils représentent le 1/3 du PIB et les 2/3 des recettes publiques, alors que le revenu par tête moyen est de 1 dollar par jour (contre 3 dollars en 1980) et n’ont qu’une incidence bien limitée sur le développement et la croissance. La situation n’est pas différente pour un pays comme l'Arabie saoudite avec une rente qui atteint une moyenne annuelle d’environ 80 milliards de dollars soit 4 000 dollars per capita. En définitive, avec l'alternance rapide de phases de flambée des prix et de phases récessives, les « Etats pétroliers » sont parmi ceux qui ont connu le plus grand nombre de turbulences financières et de surendettement. Section4 : Résorption de la fracture énergétique et valorisation des potentialités par la coopération et l’intégration. Le monde est contraint de sortir de la période d’énergie abondante et bon marché ; dans ce contexte, la définition de politique énergétique vigoureuse devient une priorité particulièrement pour les PNPP qui doivent éviter que la facture pétrolière ne devienne insupportable au point de compromettre les faibles capacités de financement du développement ansi que les perspectves d’industrialisation. Ces pays ont des avantages relatifs pour les énergies propres à savoir les énergies renouvelables, l’énergie hydroélectrique et les biocarburants. D’abord, il est établi que les énergies renouvelables peuvent être d’un grand apport et doivent en conséquence être mises à forte contribution. Ce type d’énergie offre de bonnes performances à l’agriculture dans les pays où elle est fortement implantée (espace d’implantation (rural, centres urbains secondaires). Toutefois, 66 pour certains secteurs comme l’industrie ou les grandes mégalopoles, l’énergie solaire ne peut point répondre adéquatement à la demande du fait que sa production de masse appelle de grandes surfaces. La consommation de ce type d’énergie est encore marginale sauf pour l’Afrique du Sud et le Maroc qui tirent de cette source environ 4% de leur consommation. Les autres pays en sont à moins de 2%. Ensuite, le potentiel de développement hydroélectrique est simplement abyssal. Le barrage d’Inga peut développer une puissance permettant de couvrir la totalité des besoins énergétiques de l’ensemble du continent africain comme l’avait déjà clairement démontré Cheikh Anta DIOP40. A cela viendrait s’ajouter le potentiel inépuisable de la Guinée Conakry considérée comme le Château d’eau de l’Afrique de l’Ouest, les capacités sous-exploitées du Barrage de Cabora Bassa, de Manantali dans le cadre de l’OMVS et d’Akossombo au Ghana. D’ailleurs, l’Afrique n’exploite que moins de 8% de son potentiel hydroélectrique nonobstant les crises latentes de la fourniture d’électricité. La Banque mondiale porte d’énormes responsabilités dans la non réalisation de ces projets : elle s’est permanemment opposée aux projets de mise en valeur du potentiel hydroélectrique avec des arguments technicistes non seulement fallacieux mais qui manquaient de vision comme le désapprouvait déjà Kwamé NKRUMAH. Enfin, en matière de biocarburant les potentialités africaines sont énormes. En effet, la production de carburant à base de végétaux comme cela se fait par exemple au Brésil ou en Allemagne où de l’huile pure de colza et d’autres oléagineux est très envisageable. Ce biocarburant est aujourd’hui utilisé dans le transport qui est grand consommateur d’énergie (de nombreux véhicules, voitures, camions, tracteurs agricoles...). Techniquement, l’utilisation du biocarburant ne nécessite que de légères modifications des moteurs et présente l’avantage d’être plus écologique et bien moins onéreux. En définitive, la question énergétique doit être replacée au cœur des dispositifs de coopération et d’intégration. Ce cadre devrait permettre une exploitation efficiente de toutes les potentialités pour répondre aux besoins des Etats quelle que soit leur dotation factorielle. Les expériences en cours doivent être approfondies et élargies comme par exemple le Pool Energétique d’Afrique Australe (SAPP) même si elle traverse quelques difficultés et celle d’Afrique de l’Ouest (la West African Power Pool) de la CEDEAO. L’indépendance énergétique du Continent passera par de tels mécanismes de coproduction et de solidarité. Les pouvoirs publics doivent déterminer les objectifs, le calendrier, les moyens octroyés pour atteindre les résultats escomptés et agir dans trois directions : l’encouragement de la recherche et de la formation des scientifiques, des ingénieurs et des techniciens la promotion des productions par des investissements, par des incitations financières intéressantes (suppression des droits de douane pour le matériel importé, facilités pour les entreprises, les administrations) la motivation des particuliers candidats à la consommation des énergies renouvelables. Cette politique énergétique nécessite des moyens financiers énormes qui peuvent provenir d’un Fonds d’Investissement du Secteur de l’Énergie. Elles peuvent aussi résulter de plusieurs autres sources comme par exemple 41: C.Anta DIOP : Les fondements culturels d’un Etat Fédéral Africain Cette opinion est à la base du Wade formula qui propose un partage des excédents provenant des fluctuations des prix du pétrole. 40 41 67 le prélèvement sur la rente des PAPP au profit des pays non producteurs (PANPP) ; financement par la Communauté internationale à partir des ressources rendues disponibles par les annulations de dettes au titre des Initiatives en faveur des Pays Pauvres et Très Endettés (PPTE) et d’Allègement de la Dette Multilatérale (IADM). Section 5 : Quelle solution pour les questions énergétiques? Les débats intenses sur le pétrole qui agitent aujourd’hui les milieux des décideurs politiques, les spécialistes du jeu pétrolier, les scientifiques, les chercheurs, les journalistes et les simples citoyens indiquent l’ampleur et la gravité des problèmes que suscite la flambée actuelle des prix du pétrole. Tout le monde semble prendre conscience que les besoins énergétiques vont croître dans des proportions exponentielles, suite à l'expansion démographique, l’urbanisation accélérée et l’accès au développement des pays du sud, alors même que l’offre est déclinante. Il faut s'orienter dès maintenant sur une triple voie. Il faut tout d'abord engager une dynamique très forte d'économies d'énergie afin d'obtenir une meilleure efficacité énergétique des hydrocarbures. Ensuite, à très court terme, il faut développer l'emploi du gaz naturel pour suppléer le pétrole - mais pendant à peine vingt ans - et, surtout, s'engager dans la voie de subventions massives pour la recherche et le développement dans le domaine des énergies renouvelables et pour la construction des infrastructures nécessaires à un régime énergétique fondé sur l'hydrogène. Il ne faut surtout pas attendre la fin des énergies fossiles parce que la création de ces infrastructures prendra entre vingt cinq et cinquante ans. Nous pouvons espérer dans les prochaines décennies, une augmentation de la demande énergétique mondiale induite par la marche vers le développement des pays les moins avancés. Il serait inacceptable qu’une pénurie d’énergie freine l’indispensable mouvement de résorption des inégalités de niveau de vie entre les peuples. Une alternative souvent proposée serait la réorientation profonde des Institutions Monétaires et Financières Internationales avec la création d’un Fonds Monétaire Mondial pour le développement de l’accès à une énergie respectueuse de l’atmosphère. Ce Fonds viserait une création monétaire, sous la forme par exemple de droits de tirage spéciaux (DTS), en vue de la distribution de crédits à taux faibles, avec des critères d’allocation soutenant un développement prenant en compte les défis environnementaux. Les projets ne seraient plus jugés à l’aune de leur rentabilité financière mais en fonction de leur efficacité sociale et environnementale. Les Gouvernements africains ont souvent manqué de vision à court, moyen et long termes, le renchérissement du cours du pétrole était prévisible en raison de la demande de plus en plus forte, de l’instabilité régnant dans certaines régions productrices et de catastrophes naturelles de plus en plus dévastatrices. Pour éviter le risque de voir leur économie ébranlée par l’ascension inexorable des prix du pétrole, ils devraient sérieusement songer à réduire les importations et la dépendance quasi-totale vis-à-vis de cette source d’énergie en cherchant et en développant les énergies substitutives. 68 69 « Ce qu’on peut dire, c’est que la théorie est nécesssaire mais qu’en soi elle n’est pas suffisante. C’est comme une bonne voiture, elle peut vous conduire trés rapidement au but que vous désirez si vous savez vous en servir, mais elle peut vous conduire au fossé si vous l’utilisez mal ». Maurice ALLAIS L’objet de cette partie est principalement d’étudier ce que nous enseigne la Pensée Économique en vue d’en tirer toutes les leçons en direction de l’élaboration d’une analyse rigoureuse du sous-développement et de la maîtrise des politiques et autres outils qui permettent de sortir de cet état. Que disent nos théories et que font les professionnels de l’économie face au développement et au sous-développement ? Les connaissances économiques nous rendent–elles plus aptes à la compréhension et à l’action dont la complémentarité est une nécessité absolue ? Au moment où l’Économie a complètement soumis les sociétés humaines, on décèle de graves impuissances pour les nations et les pays condamnés aux manques, à la pauvreté et à l’exclusion. Dans ce contexte, il semble normal, d’interroger les différents courants de la Pensée Économique pour cerner les différentes propositions de théories économiques pouvant contribuer à l’explication et à l’action. La multiplicité des théories et les différentes controverses peuvent-elles permettre de mieux appréhender les différentes facettes du sous-développement et les moyens d’en sortir : accumulation productive, équilibre, options sectorielles, fonctions de la monnaie, place des relations économiques internationales ? En abordant ces questions, les chercheurs et les analystes du champ doivent prendre beaucoup de précautions, car dans les pays industrialisés d’Europe, le développement a précédé la Science Économique. En conséquence, celle-ci ne s’était guère préoccupée de problèmes comme ceux qui, aujourd’hui se posent aux pays sous-développés. Mais elle s’est plutôt intéressée par exemple aux questions d’équilibre, c’est-à-dire à la recherche d’une utilisation cohérente et optimale des ressources. Cette constatation explique le flottement sémantique que l’on retrouve dans la littérature économique de l’époque ; des mots comme « Expansion », « Croissance », « Développement », « Progrès » (en anglais Expansion, Growth, Développement, Progress) ont des significations diverses. Le concept le plus universel est celui de la croissance qui est devenue une exigence, toujours réitérée, des professionnels, des politiques et des populations. Maintenant la croissance est accouplée au mot «développement» et ils deviennent des exigences. Comment la pensée économique a-t-elle abordé ces questions dans les diverses formulations des auteurs ? Quelles leçons peut-on tirer des très anciens débats des économistes ? Quels choix d’action découlent des controverses doctrinales, des grandes polémiques des différentes Écoles de pensée passées et contemporaines ? Cette partie comprendra six chapitres dont les cinq sont relatifs chacun à un courant de pensée pour en rappeler les acquis analytiques : l’analyse classique, l’analyse marxiste, les formulations keynésiennes et post – keynésiennes, l’approche néo-classique et les analyses contemporaines, comme les théories des institutions et de la régulation qui marquent une délimitation entre les économistes institutionnalistes et les gardiens de l’orthodoxie néo-classique. Le sixième chapitre traite des »heurs et lueurs de la croissance économique. Au début des années 80, on divisait les économistes en quatre grandes familles : les classiques, les keynésiens, les marxistes et les néoclassiques : 70 les classiques du XIXème siècle sont les tenants du libre-échange et voient dans le marché à la fois le meilleur moyen de répartir les produits. Ces idées forces font toute l’actualité de cette École ; Marx et les néo-marxistes ont introduit une critique beaucoup plus radicale du capitalisme et montré que les crises, les inégalités, la paupérisation, le chômage caractérisent ce système et révèlent sa nature profonde. Pour J.M.Keynes et les siens, le marché n’est pas ce modèle d’équilibre spontané et harmonieux que décrivent les classiques. Les keynésiens pensent en termes macroéconomiques et admettent que le marché livré à lui-même peut générer des situations de chômage chronique ou des crises. Enfin, ils pensent que l’État doit intervenir dans la régulation du circuit économique. Cependant, face aux failles théoriques mises à jour et à l’épuisement des politiques keynésiennes, ils ont dû se renouveler. Les néokeynésiens ont intégré de nombreux aspects de l’analyse néo-classique (importance de l’offre, des anticipations rationnelles). Ils accordent à l’État un rôle nouveau : sa fonction n’est plus d’intervenir pour stimuler l’activité mais plutôt pour créer un environnement favorable à la croissance (par la création d’infrastructures, d’aides à la formation, à l’innovation). Les néo-classiques vont inventer une nouvelle façon d’approcher l’économie à partir du modèle d’équilibre général du marché de L. WALRAS. Les soubassements théoriques ne changent point : les agents économiques sont rationnels, ils cherchent à optimiser leurs gains. En revanche, le cadre d’application de la théorie s’est beaucoup étendu. Les néoclassiques ne raisonnent plus vraiment à partir du seul cadre du marché « pur et parfait » supposé équilibré. Ils ont construit une infinité de modèles possibles : situations de monopole, concurrence imparfaite, coûts de transaction. Ils reconnaissent également que les divers agents économiques (consommateurs ou producteurs) ne sont pas toujours bien informés (économie de l’information) qu’ils agissent dans un environnement incertain (théorie des jeux), que différents comportements de la firme dépendent de son organisation À ces courants traditionnels vient s’ajouter l’École « structuraliste et institutionnaliste » parfois appelée École « développementaliste » à partir de l’affirmation de la spécificité du sous-développement caractérisé par la dépendance, la dégradation des termes de l’échange et le dualisme. Aujourd’hui, la pensée économique s’est enrichie et élargie, de nouveaux courants sont apparus. L’abondante littérature permet de répertorier cinq grandes écoles de pensée : la théorie standard étendue, les détracteurs de la pensée unique (avec ses multiples subdivisions), les nouveaux théoriciens de l’économie solidaire, les héritiers de KEYNES et les diverses variantes du libéralisme. D’autres classifications plus simplistes distinguent les orthodoxes et les hétérodoxes. Les théories économiques du développement se rattachent à une ou plusieurs de ces familles qui fournissent l’essentiel des idées fondamentales qui servent à interpréter et à reconstruire les complexes réalités du sous-développement. Egalement, ces Écoles offrent les éléments d’explication et produisent les différents instruments d’action et de gestion des politiques économiques des États et des grandes officines internationales du développement. 71 Encadré 4 : L’Objet de l’Économie La pensée économique a toujours distingué deux questions : la création de richesse – son origine, sa nature, les causes de son accroissement – et la répartition de cette richesse entre les hommes. Chaque école de pensée les a traitées et articulées différemment. Adam SMITH ne traite vraiment que de la première, dans son Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations, le texte fondateur de l'économie politique. David RICARDO présente ainsi son programme de recherche dans une lettre de 1820 à MALTHUS : « L'économie politique est selon vous une enquête sur la nature et les causes de la richesse. J'estime au contraire qu'elle doit être définie comme une enquête au sujet de la répartition du produit de l'industrie (1), entre les classes qui concourent à sa formation. On ne peut rapporter à aucune loi la quantité de richesses produites mais on peut en imaginer une assez satisfaisante à leur répartition. De jour en jour, je suis plus convaincu que la première étude est vaine et décevante et que la seconde constitue l'objet propre de la science ». Karl MARX Fait dériver à la fois la croissance de la richesse et sa répartition de « lois tendancielles » du mode de production capitaliste. Quant aux NEOCLASSIQUES, ils considèrent que la seule question scientifique est celle de l'efficacité de l'allocation de ressources rares, donc de la croissance. Dans leurs modèles de base, la question de la répartition est en partie subordonnée aux lois de l'efficacité et, pour le reste, exogène. La rémunération de chaque facteur de production, travail, capital, terre, est rigoureusement déterminée par les lois de l'efficacité, mais les droits de propriété sur ces facteurs, qui déterminent la part qui revient finalement à chacun, sont des données exogènes à l'analyse. Pierre-Noël GIRAUD : Pourquoi privilégier la question de l'inégalité, Problèmes politiques et sociaux n° 834, 11 février 2000 pp. 9-12 72 CHAPITRE 4 L’ECOLE CLASSIQUE : LES PRÉCURSEURS DU MODÈLE LIBÉRAL THEORICIENS DE LA RICHESSE DES NATIONS, DES MARCHÉS LIBRES ET DE LA SPÉCIALISATION INTERNATIONALE. Il est impossible, avertit Jacques FREYSSINET, de collecter tout ce qui, dans la littérature classique a trait aux pays sous-développés ; il serait peu honnête d’attribuer à leurs auteurs des idées trop précises à partir de textes qui ne sont souvent que des incidentes dans leurs développements généraux. Pour comprendre l’apport des classiques à la formation de la Science Économique, il faut se situer au double point de vue des faits économiques et de la pensée sociale en général. Pour les faits économiques, l’époque des auteurs classiques se caractérise par le développement du capitalisme industriel avec des fortes incidences sur l’agriculture. Selon Mouhamed DOWIDAR, «au cours de cette phase, l’expansion industrielle atteint un point qualitatif qui se reflète dans la révolution industrielle grâce à laquelle s’industrialise l’économie nationale. La base industrielle qui se présente dans les industries des biens de production s’édifie comme base non seulement pour l’activité agricole mais pour l’ensemble de l’économie nationale». Au point de vue de la pensée sociale, les traits caractéristiques se situent d’abord, dans le triomphe de la vision scientifique des choses qui remplace, sous l’influence des changements économiques, la vision théologique, ensuite dans la formation des sciences sociales et surtout de la théorie politique et économique et enfin, dans la destruction de la base intellectuelle et morale de l’image de la société ancienne. Dans ce contexte, les auteurs classiques vont mettre de l’ordre surtout dans la science économique. L’objet de cette science se rapporte aux phénomènes de la production, de l’échange, de la répartition du produit social. Au niveau de la production, il faut chercher la richesse des nations pour mettre en place les conditions de son expansion ; d’où l’étude du rôle du travail, de la division du travail et de son effet sur la productivité, du rôle du capital et de la propriété foncière. De la valeur, on étudie les phénomènes de prix et la répartition du produit social. Dans la ligne de l’étude viennent les phénomènes monétaires et les échanges avec l’extérieur. Telle est la vision qu’ont les classiques des phénomènes économiques quant à leur nature et leur délimitation. Le cadre analytique retenu pour l’étude des questions économiques se fonde sur une société composée de trois classes sociales définies selon leur place dans le procès de production (la classe capitaliste, les propriétaires fonciers et la classe ouvrière) où l’activité économique est orientée vers le marché et effectuée par des individus du type «homo economicus» et où domine la concurrence interne entre agents économiques. Les classiques étaient donc au plan des faits économiques comme à celui méthodologique, mal placés et mal préparés pour élaborer une analyse spécifique du sous-développement. C’est dans quelques évaluations ponctuelles que certains auteurs envisagent des situations de sous-développement, c’est-à-dire des situations qui échappent à l’ordre naturel. Dans la Richesses des Nations, A. SMITH indique que certaines régions sont placées en dehors du mouvement historique, du progrès économique. Il explique cela par le fait que ces régions sont éloignées des mers. L’étroitesse de leur 73 marché ne leur permet pas de bénéficier des avantages de la division interne et externe du travail. Après SMITH, Stuart MILL a analysé les différences des situations économiques des nations. Il note dans ce sens que «la situation économique de la plupart des pays d’Asie reste ce qu’elle a été depuis les origines de l’histoire connue, et reste telle toutes les fois qu’elle n’est pas perturbée par des influences étrangères». Cependant, l’auteur ne tente pas une explication économique de cette stagnation séculaire. Pour lui, cela s’explique par des raisons socio-politiques comme l’absence d’une structure administrative. N’ayant pas une approche claire du sous-développement, les classiques peuvent-ils présenter des théories cohérentes de développement ? Section 1 : Les analyses du développement et de la croissance chez les classiques Les classiques conçoivent le développement comme un phénomène naturel et spontané dans une économie libre. En effet, les théories élaborées par A. SMITH, RICARDO, S. MILL se réfèrent à un ordre naturel d’où est censé partir le progrès économique. Cet ordre naturel est à la fois immanent, spontané et bienfaisant. Sa réalisation nécessite trois conditions : la liberté politique (pour assurer la sécurité de la propriété), la liberté économique (non intervention systématique de l’État) et la concurrence. Il faut alors analyser les axes de la théorie du développement et l’état stationnaire conçu comme l’étape ultime du progrès économique. I/ Problématique théorique l’accumulation productive. du développement se ramenant à La formulation de départ est celle de SMITH pour qui la spécialisation et la division du travail sont les éléments essentiels de la Richesse des Nations. Ils opèrent dans un cadre institutionnel où domine la propriété privée des instruments de production. Dans ce cadre, le développement économique et social doit aboutir à une augmentation quantitative et qualitative des facteurs de production, à une offre adéquate de main la d’œuvre, des ressources nationales disponibles et à un volume appréciable de capital. C’est ce dernier élément qui est décisif, car comme l’affirme S. MILL, «c’est lui qui peut limiter le développement industriel et agricole d’un pays». Or, son expansion obéit à la loi de l’accumulation. Tous les classiques s’accordent sur la problématique centrale selon laquelle le volume du capital est fonction des perspectives de profit et du comportement de l’intérêt qui module à la fois la demande d’investissement et l’offre d’épargne qui est une renonciation à une dépense de consommation improductive. La croissance sera une fonction de l’accroissement du capital, lui-même est fonction de l’accroissement de l’épargne. David RICARDO est encore plus systématique que SMITH dans l’analyse du processus de développement à long terme. Il a voulu comprendre la nature de la richesse des nations et les lois qui gouvernent la distribution des marchandises. Il établit que la détermination d’une théorie cohérente de la répartition est un préalable majeur à la compréhension de tout mécanisme de développement d’un système économique. C’est à partir des lois qui gouvernent les parts distribuées qu’il construit son modèle macroéconomique de développement. Le moteur de la croissance est le profit. Cependant, observe-t-il, la masse et le taux du profit dépendent eux-mêmes de la confrontation avec la masse et le taux de salaire avec lesquels ils entrent en concurrence pour le partage du revenu national. 74 Le mouvement du salaire nominal est commandé pour l’essentiel par les prix des aliments, lesquels dépendent de la rente foncière. La hausse du salaire nominal (par la loi de la population) bloquera la croissance du profit donc celle de l’investissement et de l’économie toute entière. On retiendra que chez D. RICARDO, le postulat des rendements décroissants dans l’agriculture est à la base de la théorie de la baisse du taux de profit et de la relation particulière salaire-profit. Le caractère fixe de l’offre de terre et par conséquent les difficultés rencontrées pour satisfaire la demande de subsistance des travailleurs additionnels dont le capital accru exige l’utilisation. Cette thèse sera présente dans beaucoup de formulations actuelles d’économie et de politique de développement. Autrement dit, les surplus qui se forment sont utilisés à l’achat de produits vivriers par suite de l’inefficience des politiques agraires. Au total, D. RICARDO établit, contrairement à S. MILL, que si l’accumulation du capital s’accompagne d’un degré d’intensité capitalistique croissante, le salaire réel stagne autour du niveau de subsistance, et le sentier de croissance de l’économie sera perturbé par des déviations occasionnelles dues au plein-emploi. En définitive, l’accumulation est la base du développement économique. Il importe, dans une politique, de chercher à élever le fonds d’accumulation au détriment de la consommation improductive. Cette conclusion est très actuelle et se retrouve dans les théories contemporaines du développement. C’est la fameuse option «affamer pour développer». Cependant pour les classiques, l’expansion n’est pas éternelle, sa limite est l’état stationnaire. II/ La question de l’état stationnaire. L’État stationnaire a occupé une place importante dans la conception des auteurs classiques. Il procède d’une élévation du salaire nominal et de la rente résultant d’une augmentation de la production. Cette élévation bloque la croissance du profit donc de l’investissement et de l’économie toute entière. On parvient ainsi à l’État stationnaire à l’issue duquel aucun progrès important ne sera plus possible. Cette hantise de l’État stationnaire a dominé la théorie économique pendant une bonne partie du XIXe siècle. Il faut dire que cette phase ne correspond pas à une anticipation correcte de l’évolution du capitalisme. Même si ces dernières années il y a eu de nouvelles théories de l’État stationnaire. Celui-ci est intégré dans un modèle théorique d’absence de croissance (Alvin HANSEN, Club de ROME). Ces deux aspects établissent toute l’actualité de l’analyse du développement chez les classiques qui, bien que n’ayant pas eu une présentation du sousdéveloppement, ont fourni des éléments (accumulation du capital, profit et salaire, évolution démographique) qui peuvent constituer un point de départ pour les théories du développement. Section 2 : A. SMITH fondateur de l’Économie politique et père spirituel du libéralisme contemporain. Le modèle d’Adam SMITH remonte à 1776 et porte sur la richesse des Nations. Pourquoi commencer si tôt ? Les anciennes idées, les premiers modèles, sont plus simples, plus faciles à comprendre, que ceux qui les ont suivis 75 I/ Sur quoi repose la richesse d’une nation ? Un facteur causal : le degré de la division du travail Un facteur permissif : le sol, le climat, les ressources naturelles Un autre facteur : les lois, les coutumes et traditions les attitudes et habitudes 1°) les Avantages de la division du travail La division d’un travail en un grand nombre de tâches plus simples, et l’affectation d’une tâche simple, au lieu du travail complet, à un ouvrier, augmente la productivité. Ceci est bien illustré par le fameux passage d’Adam Smith concernant une fabrique d’épingles. On se fera plus aisément une idée des effets de la division du travail sur l’industrie générale de la société, si l’on observe comment ces effets opèrent dans quelques manufactures particulières. Prenons un exemple dans une manufacture de la plus petite importance, mais où la division du travail s’est fait souvent remarquer : une manufacture d’épingles. 2°) Le processus d’auto-renforcement de la croissance économique Dans l’analyse d’A. Smith, la croissance de la Nation peut être renforcée par quatre facteurs agissant seuls ou ensemble. Ce sont : Une spécialisation approfondie rendue possible par un élargissement du marché provenant D’un accroissement de la densité de la population, qui s’agglomère en des villes. Smith cite le cas d’un menuisier de campagne, qui est obligé, pour gagner sa vie, de faire tout ce qui se rapporte de loin ou de près au travail de bois, et qui perd par ailleurs une grande partie de son temps à des déplacements entre les domiciles de ses clients. Un menuisier de la ville peut au contraire se spécialiser, il ne fabriquera que des meubles (par exemple), puisqu’il a suffisamment de clients. D’une réduction des coûts de transport à l’intérieure du pays, provenant par exemple de la construction de canaux de navigation ou (après la mort de Smith) de la construction de chemins de fer. Cela rend possible les ventes à un plus grand nombre de clients sans payer de frais de transports prohibitifs. D’un accroissement du commerce international. Cet accroissement peut être due à : de nouvelles découvertes géographiques, la signature d’un traité de paix entre deux nations qui étaient en guerre et à La réduction de coûts des moyens de transports (notamment l’invention du bateau à vapeur après la mort de Smith). L’accroissement de la division du travail qui suit l’élargissement du marché augmente la productivité des travailleurs et partant, diminue les coûts de production. La réduction de coûts de production implique une augmentation des profits, qui sont réinvestis dans de plus grandes fabriques avec plus de machines spécialisées, permettant une division encore accrue, etc. À long terme, l’accroissement de l’emploi dans ces fabriques agrandies augmente la masse des salaires, qui permet une augmentation de la population, qui cause un accroissement de la densité de la population, qui élargit le marché, etc. 76 Encadré 5 : De la nature et des causes de la richesse des nations (1776) «Ainsi, en écartant entièrement tous ces systèmes ou de préférence ou d'entraves, le système simple et facile de la liberté naturelle vient se présenter de lui-même et se trouve tout établi. Tout homme, tant qu'il n'enfreint pas les lois de la justice, demeure en pleine liberté de suivre la route que lui montre son intérêt, et de porter où il lui plaît son industrie et son capital, concurremment avec ceux de tout autre homme ou de toute autre classe d'hommes. Le souverain se trouve entièrement débarrassé d'une charge qu'il ne pourrait essayer de remplir sans s'exposer infailliblement à se voir sans cesse trompé de mille manières, et pour l'accomplissement convenable de laquelle il n'y a aucune sagesse humaine ni connaissances qui puissent suffire, la charge d'être le surintendant de l'industrie des particuliers et de la diriger vers les emplois les mieux assortis à l'intérêt général de la société. Dans le système de la liberté naturelle, le souverain n'a que trois devoirs à remplir; trois devoirs, à la vérité, d'une haute importance, mais clairs, simples et à la portée d'une intelligence ordinaire. Le premier, c'est le devoir de défendre la société de tout acte de violence ou d'invasion de la part des autres sociétés indépendantes. Le second, c'est le devoir de protéger, autant qu'il est possible, chaque membre de la société contre l'injustice ou l'oppression de tout autre membre, ou bien le devoir d'établir une administration exacte de la justice. Et le troisième, c'est le devoir d'ériger et d'entretenir certains ouvrages publics et certaines institutions que l'intérêt privé d'un particulier ou de quelques particuliers ne pourrait jamais les porter à ériger ou à entretenir, parce que jamais le profit n'en rembourserait la dépense à un particulier ou à quelques particuliers, quoiqu'a l'égard d'une grande société ce profit fasse beaucoup plus que rembourser les dépenses.» Adam SMITH : Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, livre IV, éd. 1843, traduction de 1843 du comte Garnier, reprise par Osnabruck, Zeller, 1966 II/ Le rôle primordial du marché libre Il y a un libre mouvement des produits, des travailleurs, du capital, de la propriété des terres. Spécifiquement, les prix des produits ne sont pas contrôlés par le gouvernement, les gens peuvent changer de métier sans restrictions, on peut investir des fonds dans n’importe quel secteur économique sans avoir besoin d’obtenir des permissions spéciales ou des licences (en contraste, par exemple, au système médiéval de corporations), le terrain peut s’acheter et se vendre. 1°) Un premier avantage du marché libre : à court terme, l’offre d’un produit par ses fournisseurs est mise en égalité avec la demande pour le produit par les clients, à cause du jeu des prix. Soit une plage avec un marché de poissons. Supposons que les pêcheurs reviennent un jour avec une maigre récolte. Le prix du poisson augmentera, diminuant la quantité de poisson que veulent acheter les ménagères. À un certain prix, il y aura juste suffisamment de clients pour faire écouler les poissons. Supposons que le lendemain, les pêcheurs débarquent avec une grande quantité de poissons. Ils sont obligés de vendre le poisson avant qu’il ne pourrisse. Ils feront 77 diminuer le prix ; les ménagères achèteront plus de ce poisson si bon marché. À un certain prix, il y aura suffisamment d’achats pour vendre tous les poissons. Ce phénomène, répété dans tous les secteurs de l’économie, assure que toute la production commercialisée est vendu, et que le peuple est fourni de tout ce qu’il veut, dans la limite de ses moyens financiers. Cet avantage du marché libre dépend de l’absence de restrictions sur les prix, autrement dit la liberté des prix. 2°) Un deuxième avantage du marché libre : à long terme, le prix est égal au coût de production. Comme on vient de le voir, au court terme, de jour en jour, le prix du poisson subit des fluctuations. Mais supposons qu’à long terme, en moyenne, les pêcheurs gagnent beaucoup. De plus en plus de jeunes gens deviendront des pêcheurs. L’augmentation du nombre de pêcheurs augmentera le produit total de la pêche, ce qui entraînera plus de concurrence et une diminution des prix. Par contre, supposons qu’en moyenne, après soustraction de ses frais pour l’essence, etc., un pêcheur gagne moins qu’il ne pourrait avoir dans un autre métier. Dans ces conditions, les pêcheurs abandonneraient leurs bateaux pour d’autres métiers, réduisant le produit total de la pêche et augmentant les prix. Le nombre de pêcheurs se stabilisera quand le prix moyen de poisson leur permettra de retirer un revenu (après dépenses) égal au revenu qu’ils auraient gagné en suivant un autre métier. Ce revenu minimal pour que les pêcheurs n’abandonnent pas leur métier peut être considéré comme un «pseudosalaire» que le maître pêcheur se paye lui-même. En conclusion, en faisant abstraction des fluctuations éphémères, le prix moyen à long terme sera égal au coût de production, si on considère le «pseudosalaire» comme une partie des coûts. Ce deuxième avantage du marché libre dépend de la liberté de l’emploi. 3°) Le cas spécial de l’offre du travail. L’offre du travail dépend finalement du nombre d’ouvriers. Mais quel est le «coût de production» d’un ouvrier ? Supposons que le salaire est à peine suffisant pour nourrir l’ouvrier et sa famille. De temps en temps, il y a des famines et des épidémies. La population ne s’accroît pas sous ces conditions. Par contre, supposons qu’à cause d’une insuffisance d’ouvriers, les employeurs rivalisent pour obtenir la main-d’œuvre ; pour attirer du personnel, ils payent un salaire supérieur au minimum de subsistance. Alors, les enfants des ouvriers, bien nourris, survivent en plus grand nombre, provoquant une augmentation de la population ouvrière. 4°) Les limites du marché libre Les avantages du marché libre (que, à court terme, le peuple est fourni en toute chose tout ce qu’il veut et peut payer, et que, à long terme, le prix moyen n’est pas audessus du coût de production) impliquent que la meilleure politique est une politique de «laisser-faire». En effet, la Richesse des nations est une polémique contre le dirigisme de l’État. Cela dit, Smith reconnaît certaines limitations au marché libre, au «laisser-faire» 78 L’État doit lutter contre le monopole Il est tout naturel, dit Smith, que les marchands d’une place essayent de se mettre d’accord pour augmenter les prix, quitte à réduire la quantité vendue. Le gouvernement doit prendre des mesures contre de telles actions. L’État doit réaliser les dépenses sociales : voierie, défense, éducation, qui sont génératrices d’externalités positives Une autre limitation du marché libre, que Smith ne mentionne qu’en passant, mais qui est vraiment d’une importance cruciale : l’action du marché libre peut laisser inchangé, ou même aggraver l’inégalité de la répartition des revenus. En effet, ceux qui ne peuvent pas payer ne déterminent pas ce qui sera produit. Par exemple, si des gens sans argent veulent du pain, et des gens riches veulent des carrosses, c’est le carrosse qui sera produit. 5°) Les perspectives à long terme Pendant une très longue période qui pourrait s’étaler sur des siècles, le taux de croissance de la productivité peut excéder le taux de croissance de la population, impliquant un accroissement à long terme du revenu par habitant. Finalement, une très forte densité de la population (SMITH cite le cas de la Chine) peut mettre fin à la croissance, en raison de la pénurie de terre cultivable par tête. Section 3 : D.RICARDO : « la grosse tête pensante » de l’École Classique, la référence de la théorie de la rente et du commerce international. MARX dira de D. RICARDO qu’il est le plus rigoureux et le plus complet de l’École Classique anglaise. Sommité de l’Economie politique, il publie en 1817 la première édition des principes de l’économie politique et des impôts. RICARDO écrivait en un temps où la Grande Bretagne avait subi une augmentation vertigineuse du prix des grains, provoquée par de mauvaises conditions météorologiques et par une série de guerres (1790-1815). La situation était aggravée par des taxes très fortes sur les céréales importées (les infâmes «Corn Laws», dont l’un des articles stipulait que les taxes douanières devaient être d’autant plus lourdes que le prix des céréales importées était peu élevé). Ces lois avaient été votées par un Parlement élu selon un système de franchise médiéval, où les grands propriétaires fonciers disposaient de la majorité des voix. Ceux-ci, évidemment, tiraient des gros bénéfices du gonflement des prix de leurs récoltes. Deux des formulations théoriques peuvent être retenues car elles constituent encore des références : la théorie de la rente et celle de la spécialisation dans le cadre des relations économiques internationales. I/ La Théorie de la rente Selon Ricardo, la rente est le revenu dû au fait que les coûts de production sont divers pour le même produit. Chaque producteur reçoit une différence entre le prix de vente qui est le même pour tous et son coût de production qui n’est pas identique aux autres. Dans son analyse de la rente différentielle, D. Ricardo distingue plusieurs catégories de terre : 79 la première : bonne, où les coûts de production sont faibles pour une certaine quantité ; la deuxième : moins bonne, avec des coûts de production plus élevés pour une certaine quantité ; la troisième : encore moins bonne, avec des coûts de production encore plus élevés. Rente du 1er prop Rente du 2è prop. Avec beaucoup de catégories de terre (p.ex. 2000), la ligne brisée du coût de production devient une courbe régulière. Si le propriétaire ne gagne pas un certain minimum, il abandonnera ses champs pour travailler comme « main-d’œuvre » sur le terrain des autres. Ce minimum pour que le propriétaire n’abandonne pas la culture de sa terre est inclus dans les coûts de production (il s’agit d’un «pseudo-salaire» comme celui des pêcheurs discuté plus haut). Supposons que le prix soit fixé à 42 Fcfa/kg par une demande de 35 kg sur le marché libre (premier graphique), ou par un décret du gouvernement. Le troisième producteur reçoit juste assez de revenu pour ne pas abandonner ses terres. Mais le premier producteur a des coûts de 12 FCFA/kg, y compris le minimum de revenu pour qu’il continue à cultiver, reçoit également 42 FCFA/kg. Le surplus de (42-12) = 30 Fcfa/kg est appelé rente. La rente se calcule individuellement. Dans notre exemple, la rente du premier propriétaire est égale à (42-12) Fcfa/kg x 10 kg = 300 Fcfa : la rente du deuxième propriétaire est égale à (42-24) Fcfa/kg x 15 kg = 270 Fcfa ; la rente du troisième propriétaire est égale à 0. Noter que le concept de la rente utilisé par un économiste est indépendant de l’acte de louer la terre, et n’a rien à voir avec la «rente viagère». Le même raisonnement peut s’appliquer en dehors du secteur agricole. Par exemple, si l’industrie sidérurgique d’un pays comprend plusieurs entreprises produisant l’acier avec divers coûts de production, les entreprises les plus efficaces reçoivent une rente. 80 II/ Les perspectives à long terme. Le niveau du salaire réel perçu par ouvrier reste constant à cause du mécanisme démographique décrit ci-dessus. L’ouvrier est payé à peine plus qu’il faut pour survivre et reproduire sa famille. Le «salaire réel» est le pouvoir d’achat du salaire nominal (le salaire en argent). Quand le prix de la nourriture augmente, les entrepreneurs sont obligés d’augmenter le salaire nominal pour que leurs ouvriers ne meurent pas de faim. Le pouvoir d’achat du salaire demeure constant. Les profits gagnés par les entrepreneurs commencent par s’accroître mais ensuite sont graduellement réduits à zéro. Les entrepreneurs réinvestissent leurs profits dans des fabriques plus importantes. La multiplication du nombre de fabriques, et l’accroissement de la productivité dans chaque fabrique qui fait suite à une division du travail plus poussée, augmentent dans un premier temps la masse totale de profits qui reviennent aux entrepreneurs. Mais l’accroissement de la population rendu possible par l’accroissement de l’emploi dans les nouvelles fabriques implique une demande accrue pour les produits alimentaires. Puisque le nombre d’entrepreneurs plus le nombre de propriétaires fonciers est négligeable par rapport au nombre d’ouvriers, la population et son taux d’accroissement, sont essentiellement égaux au nombre d’ouvriers et leur taux d’accroissement. La production d’une plus grande masse d’aliments ne se fait qu’à un prix de vente plus élevé. Les entrepreneurs sont forcés de payer un salaire nominal plus grand à leurs ouvriers pour que ceux-ci puissent continuer à acheter leurs moyens de subsistance, réduisant ainsi ce qui reste aux entrepreneurs comme profit. Finalement, la hausse du prix des salaires étrangle les profits, mettant fin à l’investissement, l’accroissement de l’industrie, l’accroissement du nombre de positions salariées, l’accroissement de la population, l’accroissement du prix des produits alimentaires, l’accroissement des rentes. Encadré 6 : Théorie de la recherche de rente. Les systèmes administratifs de nombreux pays en développement se caractérisent par diverses formes de clientélisme, de népotisme ou de corruption. L’intervention de l’État offre, de par les emplois et les législations, des possibilités de rente. Les individus et les groupes de pression seront incités à investir des ressources pour rechercher des rentes et obtenir des privilèges au lieu de rechercher à accroître la production. Les responsables politiques offriront des rentes en échange de rémunérations monétaires et/ou de soutien politique. Cette recherche de rente entraîne un gaspillage de ressources et un facteur de violence politique pour s’approprier des rentes. II/ RICARDO découvre le commerce international et formule la loi de l’avantage comparatif. Avec la «loi de l’avantage comparatif», RICARDO veut prouver que deux pays peuvent chacun tirer avantage du commerce entre eux, même si un des pays peut fabriquer avec plus d’effectivité tous les produits qui sont traités entre les deux. Cette loi est à la fois très importante et fondée sur une analyse subtile. De ce fait, la théorie ricardienne mérite et exige une longue explication. Pour faciliter la démarche (quitte à la prolonger), nous allons commencer par l’analyse d’un cas plus évident que celui envisagé par Ricardo : les conditions «d’avantage absolu». 81 1°) Le commerce sous des conditions d’avantage absolu On va analyser les bénéfices du commerce international dans un cas aussi simple et aussi évident que possible : un premier pays peut fabriquer un produit A plus efficacement qu’il ne peut être fabriqué dans un deuxième pays, tandis que le deuxième pays peut fabriquer un produit B plus efficacement que le premier pays. Dans ces conditions et en supposant que le transport est gratuit, les citoyens des deux pays tirent profit si le premier pays exporte le produit A vers le deuxième pays, en échange des importations du produit B provenant du deuxième pays. L’analyse sera faite à partir d’un exemple concret. Soit deux pays, que l’on peut appeler «Sénégal» et «France» ; dans chaque pays il n’y a que deux produits, que l’on peut appeler «lait» et «arachides». Supposons qu’au Sénégal, chaque personne, si elle consacre l’intégralité de son temps à l’élevage, puisse produire 1 litre de lait (par jour, en moyenne pendant l’année). Et supposons que chaque personne, si elle passe l’intégralité de son temps à cultiver son champ d’arachide, puisse produire 3 kg d’arachides (par jour, en moyenne pendant l’année). Si les gens passent la moitié de leur temps avec les vaches et la moitié de leur temps aux champs (ou, ce qui revient au même, si la moitié de la population est composée d’éleveurs à plein temps et si l’autre moitié est constituée d’agriculteurs à plein temps), alors la production moyenne par personne par jour sera 0,5 litre de lait plus 1,5 kg d’arachides. Sur le graphique 1, la quantité de lait est mesurée sur l’axe vertical et la quantité d’arachides est mesurée sur l’axe horizontal. Le point r (a) représente la production moyenne si tout le monde ne produit que du lait ; le point (c) représente la production moyenne si tout le temps est affecté à la production d’arachides, et le point (b), avec les coordonnées (0,5 lait, 1,5 arachides) représente la production moyenne si le temps de travail de la population est réparti également entre l’élevage et l’agriculture. Toutes les combinaisons de production possible par habitant pour la population sénégalaise tombent sur la ligne «Possibilité de production» du graphique (2). En l’absence du commerce international, les possibilités de consommation ouvertes aux sénégalais sont égales aux possibilités de production puisque tout ce qui est consommé au pays doit avoir été produit au pays. Toujours en l’absence du commerce international, on peut prouver qu’au Sénégal, le prix d’un litre de lait sera égal au prix de trois kilogrammes d’arachides. Supposons que le prix d’un litre de lait soit égal aux prix de deux kg d’arachides. Toute personne qui désirerait consommer du lait, 82 au lieu de passer toute la journée à produire un seul litre de lait, produirait 3 kg d’arachides, qu’elle porterait au marché pour les échanger contre 1,5 litre de lait. Mais dans ces circonstances, personne ne produirait du lait, et l’absence de ce produit augmenterait son prix. Par contre, si 1 litre de lait s’échangeait contre 4 kg d’arachides, personne ne produirait des arachides, car il serait plus rentable de produire du lait pour l’échanger contre des arachides, que de produire des arachides soi-même. En conclusion, le seul prix stable est 1 lait = 3 arachides (au Sénégal, en l’absence du commerce international). Supposons maintenant qu’en France, où les conditions climatiques sont différentes au Sénégal, chaque personne puisse produire 2 litres de lait ou 1 kg d’arachides. Les possibilités de production de la France sont montrées dans le graphique (3). (Exercice : démontrer qu’en l’absence du commerce international, le prix en France de 2 litres de lait est égal au prix d’un kg d’arachides). On remarque que le premier fermier français peut produire plus de lait par jour que son confrère sénégalais (2 litres au lieu de 1) et que le fermier sénégalais peut produire plus d’arachides que son confrère français (3 vs 1). On dit que la France bénéficie d’un avantage absolu dans la production de lait et que le Sénégal bénéficie d’un avantage absolu dans la production d’arachides. Dans ces conditions, les bénéfices du commerce international sont clairs. Pour les rendre aussi clairs que possible, on suppose que le coût du transport est négligeable comparé aux coûts des produits. Les Français refuseront d’exporter du lait au Sénégal si 1 litre de lait s’échange contre moins que 0,5 kg d’arachides, car dans ces conditions, il leur sera plus rentable de produire des arachides eux-mêmes que de produire du lait pour l’échanger contre des arachides sénégalaises. Les Sénégalais refuseront d’exporter des arachides si 1 litre de lait s’échange contre plus de 3 kg d’arachides (Exercice : pourquoi ?) Sans parler du mécanisme qui détermine le niveau exact des prix des biens qui entrent dans le commerce international, il est évident que ce prix doit se situer entre : 1 lait = 0,5 arachide et 1 lait = 3 arachides. Supposons que le commerce international se fait au prix de : 1 litre de lait = 2 kilogrammes d’arachides Les Français sont satisfaits car d’une part ils peuvent obtenir autant de lait qu’avant, en le produisant eux-mêmes et d’autre part ils peuvent obtenir plus d’arachides qu’avant l’ouverture du commerce international, en produisant du lait pour l’échanger contre des arachides sénégalaises. Également, les Sénégalais peuvent trouver satisfaction en ce que d’un côté, ils peuvent obtenir plus de lait qu’avant l’ouverture du commerce international, en produisant des arachides pour les échanger contre du lait français et de l’autre ils peuvent obtenir autant d’arachides qu’avant, en le produisant eux-mêmes. C’est dire en définitive que les deux pays tirent des bénéfices du commerce international entre eux. Ricardo veut prouver que les deux pays tireront des bénéfices du commerce international, même si un des pays peut fabriquer plus efficacement chacun des produits échangés. Changeons maintenant les hypothèses comparées au paragraphe précédent et supposons maintenant que : 83 Chaque citoyen Français Sénégalais peut produire par jour 2 litres de lait ou 4 kg d’arachides 1 litre de lait ou 3 kg d’arachides Noter que sous les nouvelles hypothèses, les Français peuvent produire plus de lait et plus d’arachides que les Sénégalais. Les Sénégalais ne bénéficient d’avantage absolu dans la fabrication d’aucun produit. Le graphique ci-dessous montre les possibilités de production dans les deux pays suivant ces hypothèses. Possibilités (choix) de consommation = production avant le commerce international Possibilités (choix) de consommation production avant le commerce international, avec 1 lait s’échangeant contre 2,5 arachides. En l’absence du commerce international, les possibilités de consommation sont égales aux possibilités de production. Au Sénégal, 1 litre de lait s’échange contre 3 kg d’arachides. En France, 2 litres de lait s’échangent contre 4 kg d’arachides, soit 1 litre de lait contre 2 kg d’arachides. Peut-il y avoir du commerce international dans ces conditions ? (on suppose, comme avant, que le coût du transport est négligeable). La France serait prête à exporter du lait contre des arachides importées du Sénégal, pourvu que 1 litre de lait s’échange contre plus de 2 kg d’arachides. Le Sénégal voudrait bien exporter des arachides contre du lait importé de la France, pourvu que 1 litre de lait s’échange contre au moins 3 kg d’arachides. Donc il y aura commerce international pour un prix d’échange entre : 1 lait = 2 arachides et 1 lait = 3 arachides Supposons que le prix d’échange international soit : 1 lait = 2,5 arachides Considérons la situation au Sénégal. Il est plus rentable de produire des arachides et de les exporter contre du lait, que de produire du lait soi-même. Donc tout le monde au Sénégal produira des arachides, soit pour les manger, soit pour les échanger contre du lait français. Si les Sénégalais échangent toutes leurs arachides contre du lait, ils pourront consommer : 1,0lait 3 arachides x = 1,2 lait 2,5arachides Par personne par jour, et zéro arachides (puisque toutes les arachides sont exportées). Si les Sénégalais mangent toute leur récolte, ils auront une quantité nulle de lait et 3 arachides. Si les Sénégalais exportent la moitié de leurs arachides, ils 84 consomment 0,6 litres de lait et 1,5 kg d’arachides. Une ligne brisée sur le graphique montre toutes les possibilités de consommation offertes aux Sénégalais après l’établissement du commerce internationale à un taux de 1 lait = 2,5 arachides. Les Français ne produiront que du lait. S’ils consomment toute leur production, ils auront une quantité de lait égale à 2 et une quantité d’arachides égale à zéro : s’ils exportent toute leur production, leur consommation de lait sera nulle et leur consommation d’arachides sera égale à 5. Une ligne brisée sur le graphique montre toutes les possibilités de consommation offertes aux Français après l’établissement du commerce international. Comme pour les conditions du paragraphe précédent, les conclusions sont quasi identiques car les Français sont satisfaits car ils peuvent obtenir autant de lait qu’avant, en le produisant eux-mêmes et ensuite obtenir plus d’arachides qu’avant l’ouverture du commerce international, en produisant du lait pour l’échanger contre des arachides sénégalaises. Dans le même sens les Sénégalais sont satisfaits car ils peuvent obtenir plus de lait qu’avant l’ouverture du commerce international, en produisant des arachides pour les échanger contre du lait français et également ils peuvent obtenir autant d’arachides qu’avant, en le produisant eux-mêmes. La France retient un avantage absolu et dans la production du lait et dans la production d’arachides. Mais au Sénégal, la productivité d’arachides est 3 fois celle du lait et en France, la productivité d’arachides est 2 fois celle du lait. On dit que le Sénégal a un avantage comparatif dans la production d’arachides, c’est-à-dire qu’il y a une plus grande productivité d’arachides (comparée à sa productivité de lait) au Sénégal que la productivité d’arachides comparée à sa productivité de lait en France. De manière similaire, au Sénégal, la productivité de lait est 0,33 fois celle d’arachides et en France, la productivité de lait est 0,50 fois celle d’arachides et la France a un avantage comparatif dans la production de lait. La France retient un avantage absolu et dans la production du lait et dans la production d’arachides. Mais au Sénégal, la productivité d’arachides est 3 fois celle du lait et en France, la productivité d’arachides est 2 fois celle du lait. On dit que le Sénégal a un avantage comparatif dans la production d’arachides, c’est-à-dire qu’il a une plus grande (productivité d’arachides comparée à sa productivité de lait) au Sénégal que la productivité d’arachides comparée à sa productivité de lait en France. De manière similaire, au Sénégal, la productivité de lait est 0,33 fois celle d’arachides et en France, la productivité de lait est 0,50 fois celle d’arachides et la France a un avantage comparatif dans la production de lait. 2°) Définition de la loi de l’avantage comparatif Si dans deux pays les productivités relatives de deux produits sont différents, c’est-à-dire si le rapport : Productivité dans la fabrication du premier produit Productivité dans la fabrication du deuxième produit n’est pas le même dans ces deux pays, alors le commerce international leur permettra de consommer d’avantage qu’ils n’auraient pu le faire en l’absence de commerce international, et ils auront intérêt à pratiquer celui-ci. Chaque pays exportera le produit pour lequel il bénéficie d’un avantage comparatif. Cette loi est valable même si l’un des pays bénéficie d’un avantage absolu dans la fabrication des deux produits. 85 On n’a pas encore discuté la détermination du niveau exact du prix d’échange international. Supposons que le Sénégal soit énorme et que la France soit petite. Les Sénégalais voudront importer beaucoup de lait de la France, peut-être plus que la production totale de la France, tandis que les quelques Français ne voudront qu’une quantité relativement petite de la récolte sénégalaise. Dans ces conditions, les Sénégalais payeront cher pour obtenir le lait, et les termes de l’échange seront près de la limite de 1 litre de lait = 3 kg d’arachides, peut-être à 1 lait = 2,9998 arachides. Les Sénégalais ne retireront qu’un très petit bénéfice du commerce international ; les Français gagneront près de l’avantage maximal possible. Maintenant, supposons que la France soit grande et le Sénégal soit petit. Les millions de Français voudront beaucoup d’arachides, les quelques sénégalais voudront peu de lait ; et le prix d’échange s’établira près de la limite : 1 lait = 2 arachides, peut-être à 1 lait = 2,0001 arachides. Les Français ne retireront qu’un très petit bénéfice du commerce ; les Sénégalais en retireront presque l’avantage maximal. C’est une situation où il est avantageux d’être un petit pays. En conclusion, le prix d’échange est déterminé par la grandeur relative de la demande de chaque pays pour le produit de l’autre. Le pays voulant acheter plus payera plus cher, mais en tout cas, le prix d’échange ne dépassera pas les limites établies par les prix qui auraient prévalu dans chaque pays en l’absence du commerce international. Finalement, on peut considérer les frais de transport (qui jusqu’ici ont été supposés négligeables). La conclusion à retenir est que le commerce international sera bénéficiaire aux deux pays, pourvu que les prix de transport ne soient pas trop élevés. Par exemple, supposons que les coûts pour transporter 2,75 kg d’arachide du Sénégal en France et 1,0 litre de lait de la France au Sénégal soient égaux à 0,5 arachides. Il peut y avoir du commerce entre les deux pays : les Sénégalais exportent 2,75 kg d’arachides, le transporteur soustrait 0,5 kg comme commission et livre 2,25 kg aux Français en échange d’un litre de lait, qu’il retourne aux Sénégalais. Du point de vue du Sénégal, 1 lait s’échange contre 2,75 arachides. Du point de vue de la France, 1 lait s’échange contre 2,25 arachides Les autres 0,50 kg d’arachides servent à payer le transport (si le transporteur veut boire, il est libre d’échanger ses arachides contre du lait). 3°) Les hypothèses sous-jacentes à la loi de l’avantage comparatif La loi de l’avantage comparatif implique que chaque pays devrait s’ouvrir au commerce international, en se spécialisant dans la production des biens pour lesquels il retient un avantage comparatif, et qui seront exportés en échange des importations. Néanmoins, presque aucun pays ne suit entièrement une politique de libre échange. Puisque la logique du modèle de Ricardo est correcte, la plupart des justifications des politiques limitant la spécialisation et le commerce international commencent par nier une des hypothèses sous-jacentes à la loi. Les étudiants qui feront une étude approfondie de la théorie économique du commerce international verront qu’une large partie de cette théorie est fondée sur une distinction entre ce qui bouge et ce qui reste sur place, et que les différences entre les auteurs peuvent généralement être rapportées à des hypothèses différentes à cet égard. L’analyse de D.RICARDO suppose que : les produits s’échangent entre nations, mais pas la main d’œuvre, ni le capital ; à l’intérieur de chaque pays, il y a un 86 libre mouvement des facteurs de production (travailleurs, capital, terres) entre les différents secteurs de l’économie. Une prétendue absence de libre mouvement des travailleurs est souvent avancée comme justification pour une politique de protectionnisme contre les importations des produits concurrents des vieilles industries nationales. Par exemple, on dit aux États-Unis : «Les pays en voie de développement ont un avantage comparatif pour les textiles, les EU pour les produits agricoles et pour la construction des avions. Selon RICARDO, nous devrons importer les textiles, et exporter plus de blé et d’avions. Mais nous savons que si nous admettons des importations illimitées de textiles, nos fabriques en ce domaine feraient faillite et leurs ouvriers, au lieu d’aller en campagne comme agriculteurs ou en Californie pour construire des avions, resteraient pour la plupart en chômage.» Ricardo suppose que l’ouverture du pays au commerce international ne causera pas de problèmes de répartition du revenu, ou que les problèmes éventuels de répartition du revenu sont sans intérêt, ou que ces problèmes peuvent être résolus sans difficultés. Mais on peut démontrer (la preuve est compliquée et dépasse le cadre de cet ouvrage) que les importations par les pays riches des produits de pays pauvres tendent à égaliser le niveau du salaire entre pays riche et pays pauvre ; ce qui est un problème plein d’intérêt, et une raison citée par les syndicats des pays riches pour limiter les importations en provenance des pays pauvres. Parallèlement à la réduction des salaires, il y aura des ouvriers mis en chômage dans les entreprises qui font faillite à cause de la compétitivité des importations. L’analyse est «statique», pour un temps La loi de l’avantage comparatif peut impliquer, par exemple, qu’à un moment donné, le Sénégal devrait se spécialiser dans la production d’arachides pour l’exportation. Mais la loi ne prétend pas que le Sénégal devrait éternellement exporter des arachides : les conditions économiques changent et peuvent être modifiées par la politique économique. Mais un pays habitué à une économie spécialisée dans les exportations d’un ou deux produits risque de se spécialiser encore plus dans ces secteurs avec des dépenses publiques pour des routes et des chemins de fer pour évacuer les produits d’exportation, des instituts agronomes spécialisés dans les cultures dominantes, etc. ; quand le pays aurait peut-être mieux fait à long terme en investissant dans la diversification vers d’autres cultures ou dans l’établissement de nouvelles industries, pour changer sa spécialisation. C’est dans ce cadre qu’intervient l’argument de «l’industrie naissante». Selon cet argument, pour établir une nouvelle branche d’industrie dans un pays, il faut limiter les importations (par exemple, en imposant de forts droits de douane) pendant un premier temps, durant lequel les entrepreneurs du pays apprennent à bien mener leur industrie. Dans un deuxième temps, après que les entrepreneurs nationaux auront appris leur métier, le pays pourra exporter le produit qu’il importait auparavant. Ceci est un argument qui dépend du passage du temps (pour un argument «dynamique») ; tandis que la loi de RICARDO s’applique pour un moment donné (c’est une analyse «statique»). 87 CHAPITRE 5 ANALYSE MARXISTE : ACCUMULATION PRODUCTIVE, BAISSE TENDANCIELLE DU TAUX DE PROFIT ET SURVIE DU CAPITALISME. Quel est l’intérêt d’étudier l’analyse marxiste du développement au moment où le système du socialisme réel s’est effondré, perdant sa compétition avec le capitalisme qui, aujourd’hui, s’impose comme système mondial ? Faut-il dire « Adieu » à MARX ou alors « À bientôt KARL » comme l’écrit avec force de conviction J. ZIGLER ? Le marxisme est-il encore pertinent aujourd'hui ? Ces questions sont assez récurrentes, toutefois, elles n’ont pas grande signification dans la mesure où le marxisme est et demeure avant tout une théorie économique, politique et sociale qui permet d’approcher la réalité fût-elle celle du sous-développement. Dans ce sens, il a établi que «le pays industriellement le plus développé montre au pays moins développé l'image de son propre développement à venir». Quant au caractère pertinent ou dépassé du marxisme, un seul exemple, les classiques continuent d’inspirer des visions et des approches économiques depuis le 19ème siècle et pourtant, leurs analyses font partie du référentiel de la pensée du développement : richesse des nations, division du travail, théories des marchés libres, avantages comparatifs etc. Globalement et depuis l’École marginaliste (1870), jusqu’à la synthèse néoclassique, les économistes de la pensée dominante ont apporté peu d’intérêt à Marx et se refusent à l’admettre dans les rangs des « grands théoriciens » de la pensée économique. Ils se sont toujours invariablement refusé à dialoguer avec les marxistes en arguant leur faiblesse d’idéologisation excessive de leur analyse et non réalisation des prédictions sur le capitalisme. Certes le capitalisme évolue et se transforme radicalement pour surmonter ses contradictions. Il est totalement naïf de croire que cette évolution pose des problèmes théoriques dont toutes les réponses se trouvent dans « Le Capital ». Scientifiquement, elles ne peuvent s’y trouver. La validité actuelle de certaines thèses fondamentales du marxisme compréhension et confrontation des analyses avec la réalité. D’abord, Marx présente une approche de la révolution industrielle dans une optique tout à fait différente de celle des classiques pour qui le développement économique s’interprète en termes de variations de la production, du capital, du salaire, des profits et la de rente. MARX prend le contre-pied de toutes ces conceptions et développe une analyse implacable du capitalisme et de ses contradictions. Ensuite, les disciples de Marx continuent d’apporter de nombreuses contributions pour une meilleure compréhension des trajectoires du capitalisme contemporain, ses diverses contradictions et ses issues. Enfin, le marxisme, de ce fait, se présente comme la critique la plus imparable et la plus complète du capitalisme contemporain et de son orientation néolibérale. Sous ce rapport, il continue, malgré sa baisse d’influence politique, d’être un courant de pensée, une référence dont se réclament des chercheurs et des politiques à la recherche d’une alternative à l’unilatéralisme capitaliste mondial. Toutes ces raisons font qu’il est capital de réaliser une analyse exhaustive du marxisme pour mieux cerner ses divers apports à la pensée sociale. 88 Section 1 : Bref rappel des principales thèses de l’analyse approfondie du stade capitaliste42 La préoccupation n’est pas de présenter une analyse exhaustive de la Théorie marxiste du mode de production capitaliste mais de procéder à quelques rappels de l’étape capitaliste en Angleterre qui présente un triple intérêt pour l’économie du développement. En premier lieu, l’Angleterre préfigure l’avenir du capitalisme mondial. Dès l’Introduction à la première édition allemande du Capital, Marx observe qu’«Il …. s’agit … ici ….[des ] lois naturelles de la production capitaliste, …. des tendances qui se manifestent et se réalisent avec une nécessité de fer. Le pays le plus développé industriellement ne fait que montrer à ceux qui le suivent sur l’échelle industrielle l’image de leur propre avenir ». En second lieu, certains aspects de la théorie marxiste concernant les pays capitalistes sont le point de départ des théories sur l’impérialisme, sur le colonialisme même si les formalisations sont surtout dues aux disciples (notamment LENINE, MAO). MARX et ENGELS ont écrit peu sur l’impérialisme (par exemple, le chapitre du Capital intitulé «La théorie moderne de la colonisation» n’a absolument rien à voir avec les conditions d’un pays comme le Sénégal. I/ Les quatre conditions de base pour atteindre l’étape capitaliste : l’ «aliénation » des moyens de production. En résumé, MARX dégage quatre conditions qui sous-tendent la formation d’un mode de production capitaliste à savoir : 1) Les moyens de production sont « aliénés » dans le sens qu’ils n’appartiennent plus aux ouvriers qui les emploient. 2) Les produits sont des «marchandises», c’est-à-dire qu’ils sont fabriqués pour être vendus, et non pour satisfaire les besoins directs de leurs producteurs. 3) Le travail est une marchandise, qui peut être vendue et achetée comme n’importe quelle autre marchandise. 4) Le capital est mobile entre les secteurs économiques Sur la première condition, les moyens de production sont « aliénés » dans le sens qu’ils n’appartiennent plus aux ouvriers qui les emploient. Dans le secteur agricole, les paysans sont expropriés de leurs terres. La plupart des champs sont convertis en pâturage ou même en réserves de chasse ; le reste est organisé en grandes fermes cultivées avec la main-d’œuvre embauchée. Les grands propriétaires remplacent les petits paysans cultivant leurs propres champs. Les paysans expropriés deviennent les premiers prolétaires (ouvriers n’ayant aucune autre ressource que leur force de travail). Pour cette raison, l’expropriation des paysans marque le commencement du stade capitaliste. Dans le secteur industriel, les machines deviennent trop chères pour les ouvriers individuels. Même quand les usines n’étaient pas motorisées et lorsque les machines étaient simples, l’organisation d’une entreprise comme la fabrique d’épingles décrites par Adam Smith dépassait le budget des ouvriers. Et par la suite, ce type de fabrique a été remplacé par des usines avec Cette section est basée sur Le Capital de Karl Marx. L’ouvrage est en trois livres : la traduction française disponible à l’Université (éditions sociales) répartit ces trois livres entre huit tomes/ Sauf avis contraire, les références ici sont à cette édition. Dans le premier livre, cette édition réunit en quatre chapitres 4,5 et de la dernière (quatrième) édition allemande du capital : donc il y a un décalage dans la numérotation des chapitres entre les versions originales et sa traduction française. 42 89 des machines beaucoup plus productives et plus chères. (MARX remarque qu’au temps de SMITH, dix hommes travaillant ensemble pouvaient fabriquer 48 000 épingles par jour, et une seule femme pouvait surveiller quatre de ces machines). Donc l’artisan possédant ses propres outils est remplacé par un ouvrier travaillant avec les machines d’un patron capitaliste. La seconde condition postule que dans un Mode de production capitaliste, les produits sont des «marchandises», c’est-à-dire qu’ils sont faits pour être vendus, et non pour remplir les besoins directs de leur producteur. Par exemple, le patron de l’usine Bata ne fabrique pas des milliers de souliers par jour avec l’intention de les porter lui-même, par contre, une récolte faite par un paysan surtout pour nourrir sa famille n’est pas une marchandise. La troisième conditio est que le travail est une marchandise, qui peut être vendue et achetée. Un ouvrier vend sa force travail à celui qui paye son salaire. Dans l’époque féodale, à cause des restrictions des compagnies et des lois attachant un serf à son seigneur, une personne n’avait pas cette possibilité de vendre sa force de travail où il voulait. La quatrième condition est relative au fait que le capital est mobile entre les secteurs économiques : on est libre d’investir son argent comme on veut. Les conditions (2), (3) et (4) forment ensemble l’hypothèse du marché libre ; mais il faut noter la nuance entre la définition du même concept chez SMITH et chez MARX. II/ La théorie de la valeur : Pourquoi cette théorie et quel est son contenu ? Une théorie de la valeur répond à la question, «quelle est la valeur d’un produit (ou d’un service) ?». La valeur de quelque chose n’est pas nécessairement égale à son prix –après tout, on peut dire que quelque chose se vend pour « plus que cela vaut » ou pour « moins que cela vaut ». De nos jours, la question de la théorie de la valeur est peu étudiée par les économistes non-marxistes, qui d’ailleurs donnent une réponse différente de celle de MARX. Mais le concept de la valeur était un problème important pour les économistes dit «classiques» (notamment SMITH et RICARDO). Et la théorie de la valeur est au centre de l’analyse faite par MARX dans le Capital : on ne peut pas comprendre le reste de cet ouvrage si on n’a pas compris sa théorie de la valeur. 1°) La «théorie de la valeur travail» de MARX. MARX commence par se poser la question, comment des biens et des services, des marchandises – de nature tout à fait différente – l’or, le fer, les services d’un tailleur, etc. peuvent-ils s’échanger à travers les mécanismes d’achat et de vente ? On peut échanger quelques grammes d’or (qui coûtent mille francs) contre beaucoup de kilogrammes de fer (qui coûtent mille francs) et on peut échanger les deux contre une certaine quantité, qui ne peut pas être pesé, des services d’un tailleur (qui coûtent également mille francs). Ces trois marchandises (or, fer, couture) doivent avoir quelque chose en commun qui permet l’échange au même prix. La «chose en commun» ne peut pas être la valeur subjective (que Marx appelle «valeur d’usage») attachée à la marchandise par le client ; car l’appréciation d’un produit varie avec la personne. Par exemple, un individu trouve la glace au café délicieuse, mais la glace à la pistache dégoûtante ; son frère adore la glace à la pistache mais pense que la glace 90 au café est nauséabonde ; néanmoins, une glace à café se vend au même prix qu’une glace à la pistache. L’air, qui a une grande valeur pour tous ceux qui désirent respirer, est gratuit. Donc la «chose en commun» ne peut pas être l’appréciation subjective, la valeur d’usage. Pour MARX, la «chose en commun» aux marchandises qui permet l’échange de diverses marchandises et qui détermine quelle quantité de l’une s’échangera contre celle de l’autre, est que toutes sont produites avec le travail humain. Dans ce sens, on définira la «valeur d’échange» d’un produit ou d’un service comme la quantité de travail nécessaire pour fabriquer ce produit ou ce service. Il faut apporter quelques nuances à cette définition. En effet, le même produit peut être fabriqué avec des différentes quantités de travail dans des pays différents ou à des époques différentes, dépendant du progrès technique, etc. Dans le même pays au même temps, le même produit peut être fabriqué avec des quantités de travail diverses : par exemple, un forgeron peut être plus ou moins habile que la moyenne des forgerons. Dans la définition ci-dessus, par «travail nécessaire», il faut comprendre la moyenne du travail nécessaire à une époque déterminée dans un pays déterminé ; Marx appelle ce concept le «travail socialement nécessaire». Ensuite, il y a des travailleurs non-qualifiés et des travailleurs qualifiés (ingénieurs, docteurs, mécaniciens, etc.). Les travailleurs qualifiés sont plus productifs que les travailleurs sans qualification ; par conséquent ils sont mieux payés. Puisque la qualification d’un travailleur est elle-même le produit du travail (le travail des professeurs, le travail incorporé dans les bâtiments de l’école, etc.), Marx appelle le travail qualifié par un entraînement le «travail complexe» ; et il appelle le travail non-qualifié le «travail simple». Si un ingénieur est trois fois plus productif qu’un ouvrier non-qualifié, on peut convertir ses heures de travail complexe en leur équivalent d’heures de travail simple en multipliant par trois. Dans la définition cidessus, par « quantité de travail, il faut comprendre le nombre total d’heures de travail simple, après que les heures de travail complexe aient été convertis en leur équivalent d’heures de travail simple (non-qualifié). Enfin, si le produit est fabriqué non seulement avec du travail direct, mais aussi avec des matières premières, la valeur du produit final comprend le travail incorporé dans la production des matières premières. Par exemple, la valeur d’un fer à cheval comprend non seulement le travail du forgeron, mais aussi le travail qui a produit le fer brut. Le travail incorporé dans les outils et les machines est traité d’une façon similaire (expliqué en détail au § 1.3.2.4). Dans la définition ci-dessus, par «travail», il faut comprendre le travail indirect (des ouvriers) plus le travail indirect (incorporé dans les matières premières et dans les outils et les machines). Finalement, la définition de la valeur d’échange d’une marchandise est le nombre d’heures de travail simple (ou leur équivalent) direct et indirect, socialement nécessaire, en moyenne, pour fabriquer la marchandise. En bref, la valeur d’échange d’une marchandise est le nombre d’heures de travail de sa fabrication. Quand Marx utilise le terme «valeur» sans autre spécification, il se réfère à la valeur d’échange et non à la valeur d’usage. L’essentielle de la définition est très simple et facile à comprendre, mais il faut l’appliquer de façon rigoureuse. La valeur n’est pas la même chose que la quantité produite. Par exemple, si à cause d’un développement de la productivité au cours de trente ans, le PIB d’un pays double sans augmentation du nombre d’heures de travail de sa population, la valeur du PIB n’a pas augmenté. Si la quantité des produits et services fabriqués dans un pays double avec une réduction du nombre d’heures de travail, la valeur du PIB a diminué, en dépit de l’augmentation de sa masse. 91 2°) La détermination des prix (première version) Marx donne deux explications différentes de la détermination des prix. Celle-ci est utilisée dans tout le premier livre du Capital dans tout le deuxième livre et dans la première section du troisième livre, soit les premières 1.600 pages. (La deuxième explication des prix est discutée dans ces notes à partir du §.1.3.2.12). Les marchandises s’échangent en proportion de leurs prix. Si un gramme d’or coûte 1000 francs et un kilogramme de fer coûte 50 francs, alors un gramme d’or s’échangera contre 20 kg de fer. Les proportions des prix déterminent les proportions des marchandises qui s’échangent. Théorème sur la détermination des prix (première version) : les marchandises s’échangent en proportion de leur valeur, c’est-à-dire que le prix est proportionnel au nombre d’heures de travail incorporées dans la marchandise. Si un kg d’un produit A incorpore deux fois autant de travail qu’un kg d’un produit B, le prix de A (par kg) sera deux fois le prix de B (par kg). Il faut noter qu’il existe une différence entre une définition et un théorème. Une définition ne dépend que de son auteur. Un théorème est une déclaration que l’on peut vérifier ou rejeter. Par exemple, je peux définir la «salinité» d’une subsistance comme le pourcentage du nombre de ses molécules qui ont la formule chimique NaCl. Un autre peut définir la «salinité» d’une substance comme le pourcentage de son poids composé de molécules NaCl. L’autre a le droit à sa définition et moi j’ai le droit à la mienne. Mais si je prétends que les prix des substances sont proportionnels à la salinité, j’avance un théorème que l’on peut vérifier ou rejeter en observant les faits. Marx donne une définition de la valeur et avance le théorème qui affirme que les prix sont proportionnels aux valeurs ainsi définies On a vu que le prix est (ou serait) proportionnel à la quantité de travail nécessaire pour fabriquer la marchandise. Cela implique qu’un produit incorporant deux fois autant de travail qu’un autre aurait un prix deux fois plus grand ; mais cela ne dit pas ce que sera ce prix en termes de la devise nationale (livres sterling par exemple). Au temps où écrivait Marx, les devises étaient basées sur l’étalon d’or : on pouvait librement échanger des devises pour de l’or. Supposons qu’une livre sterling s’échangeait pour 30 grammes d’or. L’or est une marchandise, dont la production exige du travail pour l’extraire du sol et la transporter en Angleterre. Supposons qu’une heure de travail produit en moyenne 10 g d’or. Alors une livre sterling serait l’équivalent de 3 heures de travail ; un produit incorporant deux heures de travail s’échangerait contre 20 g d’or = 2/3 livre sterling, etc. De nos jours, les devises nationales ne sont plus basées sur l’or. L’État imprime des morceaux de papier qui s’échangent contre … d’autres morceaux de papier. Pour simplifier un processus macroéconomique réellement compliqué, on peut dire que les prix sont déterminés par la quantité de monnaie en circulation. Si dans une économie il y a en circulation des morceaux de papier ayant un total de 800 millions de «pesos» imprimés sur eux, s’échangeant contre le produit de 2 millions d’heures de travail, alors chaque heure de travail serait l’équivalent de 400 pesos. 92 L’origine des profits et la décomposition de la valeur d’un produit Pourquoi y a-t-il une augmentation du PIB/habitant dans un pays ? A cause d’une augmentation de machines, de bâtiments d’usine, de matières premières, … en bref, une augmentation des moyens de production. L’accumulation des moyens de production implique qu’il y ait un investissement pour les acheter. D’où proviennent les fonds pour cet investissement ? Des profits, répond Marx. D’où proviennent les profits ? Le profit au niveau global de la société ne peut être généré que par l’achat à bon marché et la revente à prix cher, dit Marx, parce que pour chaque veinard qui achète une marchandise à bas prix, il y a un malchanceux qui lui a vendu la marchandise à bas prix, et pour chaque personne bienheureuse qui réussit à vendre chère, il y a un client malheureux qui a dû acheter cher, de sorte que les gains des uns sont compensés par les pertes des autres. En moyenne, les marchandises doivent se vendre à leur valeur. Pour découvrir l’origine des profits, il faut analyser plus profondément la détermination de la valeur d’un produit. L’industrie-type (selon les termes de Marx) était une filature de coton ; prenons donc une filature comme exemple concret. La valeur de son produit (fil de coton) est égale aux heures de travail incorporées dans la production du fil : valeur du produit = travail total. La valeur attribuée aux machines dépend de leur usure. Supposons qu’une machine à filer produit 100 kilomètres de fil avant d’être complètement usée, et que la fabrication de la machine prend 200 heures. Dans ces conditions, on attribue 0,002 heures de travail (= 200 heures/ 100.000 mètres) par mètre de fil, au compte d’usure de la machine à filer. Les matières pour le fil comprennent non seulement le coton, mais aussi le charbon pour alimenter le moteur à vapeur qui fait tourner la machine à filer, etc. Puisque par hypothèse le prix de toute marchandise est égal à sa valeur, le coût du capital investi en machines et matières premières est égal à la valeur incorporé dans ces choses : cette valeur est transmise intégralement au produit fabriqué. Puisque le capital investi en travail indirect ne crée pas de nouvelle valeur, mais seulement une transformation de la forme d’une quantité constante de valeur, Marx appelle en conséquence «capital constant» l’argent que le patron d’une fabrique investit en machines et en matières premières. La valeur ajoutée provient du travail direct. Donc on a : Valeur du produit = valeur du capital constant + travail direct. Quelle est la valeur du travail des ouvriers de la fabrique, le «travail direct» ? Posée de cette manière, dit Marx, la question est absurde : par définition, la valeur d’une heure de travail est une heure de travail (c’est comme demander le prix d’un franc : par définition le prix d’un franc est un franc). Mais on peut demander : quelle est la valeur du salaire payé aux ouvriers ? Les ouvriers dépensent leur salaire pour acheter de la nourriture, des vêtements, etc. et la valeur de la nourriture, du vêtement, etc. peut être mesurée par le nombre d’heures de travail nécessaire pour produire ces biens. Suivant un raisonnement que nous verrons plus tard, la théorie marxiste aboutit à la conclusion que le salaire plane au niveau minimal de subsistance pour l’ouvrier et sa famille. Dans la mesure où le salaire est juste suffisant pour payer la «production» démographique des salariés, l’ouvrier est payé à sa valeur. 93 Supposons que la valeur des produits que l’on peut acheter avec le salaire journalier est égale à cinq heures ; rien ne dit que les ouvriers travaillent 5 heures par jour pour recevoir ce salaire. La journée de travail à l’usine peut durer, par exemple 11 heures. Les ouvriers n’ont pas le choix : ne possédant eux-mêmes pas de moyen de production, ils doivent travailler aux conditions imposées par les capitalistes pour ne pas mourir de faim. Donc (suivant notre exemple), un capitaliste qui investit l’équivalent monétaire de cinq heures de travail pour payer des salaires, reçoit 11 heures de travail d’un ouvrier. Le capital investi en salaires, en travail direct, produit plus de valeur qu’il ne coûte. Pour cette raison, Marx appelle «capital variable» le capital investi en salaires. La différence entre la valeur du salaire et le nombre d’heures de travail acheté avec ce salaire est appelée «plus-value». Dans notre exemple, la plus-value est égale à (11 heures- 5 heures) = 6 heures de travail. Donc on a finalement : valeur du produit = capital constant + capital variable + plus-value. Marx distingue entre la «valeur du travail», qui est une tautologie (une heure de travail vaut une heure de travail) et la «valeur de la force de travail», qui est ce que nous avons appelé la valeur de salaire. On notera que dans le schéma aléatoire ici présenté, toutes les marchandises, y compris la force de travail des ouvriers, se vendent à leur valeur ; néanmoins la plus-value génère un profit. Nous sommes en mesure de donner quelques définitions. Il y a une «exploitation» de la classe ouvrière parce qu’une partie de son produit (la plus-value) est reçue par les membres d’une autre classe, la bourgeoisie, qui, elle, ne travaille pas. Le «taux d’exploitation», aussi appelé «le taux de plus-value», est le suivant, dans notre exemple : 6 heures/5 heures = 120%). Les heures correspondant au salaire, au capital variable, peuvent aussi être appelées le «travail payé» ; et les heures correspondant au reste de la journée de travail, à la plus-value, peuvent être appelées «le travail non-payé». Un capitaliste voulant faire un profit doit nécessairement garder ses ouvriers dans la fabrique au moins aussi longtemps que la valeur de leur salaire ; au-delà de ces heures, il gagne un surplus : donc «heure de travail nécessaire» est un synonyme pour «travail payé» et «heures de surtravail»est un synonyme pur «travail non-payé». Ne pas confondre «travail nécessaire» (V) avec «travail socialement nécessaire (C + V + P1 en moyenne pour toute l’industrie). En bref : taux d’exploitation = taux de plus-value= P1 = plus-value = V travail non-payé = capital variable surtravail = travail payé travail nécessaire Notez que le taux de plus-value n’est pas le même que le taux de profit. Le taux de profit sera défini rigoureusement au § 1.3.2.9.1.2. Les économistes classiques, y compris Smith et Ricardo, avaient élaboré la théorie de la valeur travail avant Marx. Eux aussi pensaient que la valeur d’un produit est, en dernière instance, le travail humain direct et indirect qui l’a créé. La 94 contribution originale de Marx, là où il approfondit l’analyse de ses prédécesseurs, est le concept de la plus-value. 3°) La répartition de la plus-value Au moment où un produit est fabriqué, le capitaliste industriel a la mainmise sur un produit ayant une certaine valeur (20 heures, par exemple), qui lui coûté une certaine somme pour usure des machines, matières premières et salaires (16 heures, par exemple). Si le capitaliste industriel vend son produit directement au grand public pour sa valeur, et s’il ne paie pas d’impôts, il garde tous les profits (qui seront l’équivalent d’une plus-value de 4 heures selon notre exemple). Mais normalement, un capitaliste industriel n’a pas l’organisation pour faire écouler toute sa production au public. Donc il vend le produit pour moins que l’équivalent monétaire de 20 heures à un grossiste. La perte de l’industriel dans ce cas peut être comparée à la situation où il vend directement au public pour l’équivalent de 20 heures. Cette perte est exactement compensée par le gain du grossiste qui achète pour moins que 20 heures. Le commerçant en gros vend (pour moins que 20) au commerçant de détail, qui vend au public pour 20. Ainsi, les quatre heures de plus-value ont été partagées entre le capitaliste industriel, le commerçant en gros, et le commerçant en détail. Si l’État prélève des impôts, il prend aussi une partie des 4 heures de plus-value. En bref, une fois le produit fabriqué, sa valeur ne change pas par suite de changements de possesseurs : les vendeurs, les revendeurs et les re-revendeurs ne font que partager entre eux la plus-value provenant de la fabrication. Chaque capitaliste réinvestit une partie de son revenu net après paiement des impôts et il dépense le reste pour la consommation de services et des biens de luxe. Analyse des effets d’un accroissement de la productivité du travail. Supposons que dans l’industrie de dentelle, on fabrique 30 mètres de dentelle en utilisant une journée de travail de 10 heures (payée avec un salaire qui s’échange contre des biens de consommation ayant une valeur de 5 heures), plus des matières premières valant 10 heures, plus des machines dont l’usure par jour est l’équivalent de 10 heures de travail ; en conséquence la valeur de la dentelle sera (10 + 10 + 10) = 30 heures, soit 1 heure par mètre. Si 90 francs sont l’équivalent monétaire de chaque heure de travail incorporée dans la production d’une marchandise, alors les 30 mètres de dentelle se vendront pour (30 mètres) x (1heure/mètre) x (90 francs/heure) = 2700 F. Les coûts de production seront 10 x 90 F (pour l’usure des machines) plus 10 x 90 F (pour les matières premières) plus 5 x 90 F (pour les salaires), soit 900 + 900 + 450 = 2250 F. les profits seront : 2700 (ventes) moins 2250 (dépenses), soit 2700 – 2250 = 450 F. Les 450 F des profits sont l’équivalent de 450/90 = 5 heures de plus-value. Ces résultats sont résumés dans la ligne 1 du tableau suivant. Maintenant nous supposons qu’un entrepreneur découvre une nouvelle méthode de fabrication. Avec le même nombre d’ouvriers qu’avant, il augmente la production de 20% (elle passe de 30 à 36 mètres). Il faut augmenter la quantité de matières premières de 20% (la valeur de matières premières passe de 10 à 12 heures), mais la nouvelle machine ne coûte pas plus que l’ancienne. Dans un premier temps, quand toutes les autres usines utilisent encore l’ancienne méthode, l’entrepreneur peut vendre sa dentelle à l’ancien prix de 90 F le mètre. En effet, puisque la valeur d’un produit est le nombre d’heures de travail en moyenne socialement nécessaires 95 pour sa production, et puisque l’industrie de dentelle continue pour le moment d’utiliser l’ancienne méthode de production en moyenne, 1 mètre de dentelle vaut encore 1 heure de travail (et 36 mètres valent 36 heures). Ne voyant pas pourquoi il devrait faire des cadeaux aux clients, l’entrepreneur qui innove vend ses 36 mètres pour 36 x 90 F = 3240 F. Ses dépenses sont (10 + 12 + 5 hures) x 90 F/heure = 27 x 90 F = 2450 F. il retire donc un profit de 3240 – 2430 = 810 F. il faut noter que puisque le salaire vaut toujours 5 heures (comme dans toute autre usine) et la longueur de la journée de travail reste fixée à 10 heures (comme dans toute autre usine), en conséquence le montant de la plus-value reste inchangée à 10- 5 = 5 heures. La situation est résumée dans la ligne 2A du tableau suivant. Mais cette situation ne peut pas continuer. Tous les autres patrons de l’industrie de dentelle, voyant que leur collègue innovateur gagne 810 F où ils gagnent 450 F, vont se procurer la nouvelle machine. Ils vont essayer d’écouler autant de dentelle que possible, en vue de gros profits ; la concurrence entre eux va mener à une réduction du prix. Le prix ne cessera de diminuer que quand la dentelle se vendra à sa nouvelle valeur. Quelle est cette valeur ? Sous les nouvelles conditions de production, 36 mètres de produit valent 32 heures de travail, donc chaque mètre vaut 32/36 d’heures. Le prix équivalent est (32/36) x 90 F = 80 F ; les coûts sont (27 heures) x (90F/heures) = 2 430 F ; les profits retombent à 2880 – 2430 = 450 F. En conclusion, une augmentation de la productivité donne des surprofits temporaires aux premières firmes qui adoptent la nouvelle méthode. Mais après que toutes les firmes dans l’industrie auront adopté la nouvelle méthode, la concurrence parmi elle réduira le prix du produit jusqu’à l’équivalent monétaire de la nouvelle valeur du produit. (La valeur par unité du produit est réduite parce que l’augmentation de la productivité a réduit le montant de travail incorporé dans chaque unité de produit). Une fois que la marchandise se vend à sa valeur, la valeur des profits est exactement égale à la valeur de la plus-value ; et en supposant que la valeur du salaire et la longueur de la journée de travail restent inchangées, la quantité de la plus-value est constante. Donc une augmentation de la productivité, ceteris paribus, n’augmente pas le montant des profits (abstraction faite des surprofits temporaires) Section 2 : Le marxisme comme première l’économie politique de l’Ecole Classique. critique de La deuxième moitié du 19ème siècle était un âge d’or de la science, avec des découvertes fondamentales dans la physique, dans les sciences naturelles, etc. C’est sans doute ce qui explique que Marx se proposait d’écrire une théorie scientifique de l’évolution des sociétés humaines avec des analogies assez évidentes avec les travaux de Charles Darwin sur l’évolution des espèces animales et de l’espèce humaine (publiés en 1859). En effet à cette époque trois hypothèses caractérisaient la philosophie de la science : d’abord l’existence de lois logiques qui peuvent être découvertes, ensuite, ces lois s’appliquent en tout temps et en tout lieu et enfin leur application permet la prévision des événements futurs. Toutes ces caractéristiques se retrouvent dans l’œuvre de Marx. Le point de départ de Marx est l’évaluation critique de la pensée économique de l’École Classique anglaise. A.SMITH et D.RICARDO ont élaboré la théorie de la valeur travail selon laquelle la valeur des marchandises vient du travail humain socialement mis pour leur fabrication. C’est cette théorie que reprend et précise MARX et de laquelle il tracte notamment la théorie de la plus-value qui fut la 96 première explication scientifique de l’exploitation des travailleurs. Pour A. Smith et D. Ricardo comme pour Marx, la théorie de la valeur (couplée avec la théorie de la plus-value) constitue l’approche à partir de laquelle il était possible de comprendre à la fois la répartition du revenu national et la croissance du capitalisme. MARX commence par observer que RICARDO a découvert l’une des lois essentielles du développement de la société capitaliste : la loi tendancielle de la baisse du taux de profit, mais il l’explique par l’augmentation de la valeur des produits agricoles découlant de la prétendue loi de la population de MALTHUS : les produits tendent naturellement à baisser parce que, dans le procès de production, le surcroît de subsistances nécessaires exige un travail toujours croissant. MARX observe à ce propos «les économistes, qui, comme RICARDO, considèrent la production capitaliste comme une forme définitive, constatent qu’elle se crée elle-même ses limites et attribuent cette conséquence, non pas à la production mais à la nature, dans la théorie de la rente». Il démontre alors que la baisse tendancielle du taux de profit ne découle pas de circonstances accidentelles étrangères au régime capitaliste mais au contraire, elle est l’essence même de ce régime qui implique l’accroissement du capital constant et la diminution relative du capital variable. C’est cette découverte qui établit clairement que le capitalisme contient en lui-même la loi qui l’achemine vers sa destruction. Dans cette direction, MARX écrit que «ce qui inquiète RICARDO, c’est que le taux du profit, stimulant de la production et de l’accumulation capitaliste, soit menacé par le développement même de la production». Dès lors, le capitalisme apparaît comme une forme, non pas absolue et définitive, mais relative et transitoire. Enfin, la dernière erreur de RICARDO est selon MARX qu’il n’a pas pu rendre compte du phénomène des crises capitalistes. Celles-ci ont pourtant jalonné la marche du système à cette époque. Ces crises ont eu lieu, en Grande Bretagne pendant les années 1815, 1825, 1840 (profonde), 1863, 1873 (crise de très longue durée), 1890, 1913, 1920 et 1933 (extrêmement ample et profonde). Chaque crise a duré plusieurs années. Elles revêtent, de plus en plus, une sévérité croissante. Elles ne procèdent plus, désormais, des mauvaises conditions climatiques mais proviennent exclusivement des actions humaines qui créent une situation où il y à la fois le chômage des hommes et des machines (inutilisées) ainsi que la mévente de la production (crise de surproduction dont J .B. SAY disait qu’elle était impossible). En somme, pour Marx l’erreur de RICARDO est de n’avoir jamais pu rendre compte du phénomène des crises capitalistes. En effet, RICARDO admet à la fois que le profit apparaît ‘simultanément comme condition et comme impulsion pour l’accumulation et que la production capitaliste vise à satisfaire les besoins. Dès lors, se pose la question de savoir si la production capitaliste a pour moteur le profit ou les besoins ? RICARDO utilise les deux explications pour défendre le développement illimité de la production capitaliste. Les contradictions profondes du régime vont complètement lui échapper. En conséquence, l’économie politique classique va s’avérer impuissante à rendre compte des crises inhérentes au système capitaliste. Ces limites de l’analyse ricardienne, vont amener MARX à procéder à un renversement qui permettra de mieux comprendre le fonctionnement du mode de production capitaliste et de saisir toutes ses contradictions internes. Ce renversement comporte trois moments théoriques essentiels : d’abord, l’application du matérialisme historique à la solution des problèmes de l’Économie politique qui va permettre de découvrir le caractère transitoire et relatif de MPC ; ensuite, l’analyse de l’aliénation du travail et du fétichisme de la marchandise, ce qui permet de découvrir, au-delà de l’apparence de la circulation des choses, la réalité des rapports sociaux de production et enfin, la découverte du caractère contradictoire de ces rapports. 97 Le modèle de développement marxiste devient transparent à travers l’analyse du processus de réalisation des présupposés du capital. Prenons l’exemple du salaire réel de la main-d’œuvre industrielle, notamment leur ravalement au niveau de subsistance. Sur la question, on observe un glissement entre les idées de Smith, Ricardo et Marx. A. Smith, optimiste, estimait que le taux d’accroissement de la productivité pouvait être maintenu au-delà du taux d’accroissement de la population pendant une longue période (peut-être des siècles), en fournissant un niveau de vie croissant aux ouvriers. Alors que Ricardo, en pessimiste, pensait que dans quelques décennies, l’accroissement de la population plus rapide que l’accroissement de la production alimentaire mettrait fin à toute croissance du salaire réel. Marx aboutit à la même conclusion que le salaire réel n’augmenterait pas, mais pour une raison différente : le chômage chronique causé par la mécanisation du travail, plutôt que le manque d’aliments, empêcherait la hausse des salaires réels. Section 3 : Les modèles marxistes de développement. Le concept de départ pour une analyse des modèles de développement est l’accumulation primitive que MARX étudie pour dégager les conditions de l’apparition du capitalisme comme rapport de production. I/ Le concept d’accumulation primitive : transition vers le capitalisme Dans la huitième section du livre du capital, MARX présente simultanément le concept « d’accumulation primitive » qui recouvre tout processus historique de réalisation des présupposés du capital et une forme historique déterminée de réalisation de ces présupposés du capital. 1°) L’identification des présupposés du capital Le capital est un rapport de production, et comme tel, il est le produit d’un procès de production capitaliste. Donc, les présupposés du capital sont les présupposés du procès de production qui suppose : l’achat de la force de travail, la prise de possession des moyens de production, une circulation étendue des marchandises pour que le travailleur vende sa force de travail ; il faut qu’il puisse en disposer à son gré, il doit être un travailleur libre. Mais il doit aussi être obligé de vendre sa force de travail pour subsister. Au total, il doit être séparé de ses moyens de production. Il doit être libre de tout rapport social lui permettant de subsister. Pour que naisse le rapport de production capitaliste, il faut aussi que le travailleur trouve un marché, un acheteur pour sa marchandise. Le capital ne peut exploiter le travailleur s’il ne dispose pas des moyens de production à mettre à sa disposition. Enfin, le dernier présupposé du capital postule l’unité du procès de production et de circulation. Pour que le travailleur puisse utiliser son salaire à acheter les marchandises nécessaires à sa subsistance, il faut que la circulation se soit emparée d’une certaine quantité de produits. 98 2°) L’accumulation primitive comme concept d’une transition vers le capitalisme. La question se pose de savoir comment on doit analyser un processus d’accumulation primitive, c’est-à-dire réaliser des présupposés du capital. Nous posons que l’accumulation primitive est le concept d’une transition vers le capitalisme. Elle est le concept des processus historiques et sociaux qui assurent le passage d’une forme non capitaliste vers le capitalisme. Schématiquement, ces processus peuvent être représentatifs d’un développement capitaliste qui s’effectue comme suit : Forme non capitaliste (Sous-développement) Forme capitaliste Dissolution Combinaison Pour la dissolution, on peut observer que comprendre la genèse du capital, c’est comprendre le processus de dissolution des formes antérieures. Cette compréhension nécessite l’analyse des contradictions de ces formes. Ce sont les contradictions d’une forme économique qui déterminent sa dissolution et la possibilité d’émergence du capital. Pour ce qui est de la combinaison, c’est un processus de mise en relation des éléments issus de la dissolution et il constitue le commencement de fonctionnement du mode capitaliste de production. La phase de destruction des formes économiques antérieures débute depuis le XVIIe siècle. En Europe, et seulement pour les pays non européens intégrés au système mondial, l’extension des échanges internationaux s’est traduite par une décomposition de leurs formes économiques sans que cette décomposition soit suivie d’une extension importante du capitalisme. Ce phénomène historique constitue le facteur initial de la formation de structures sous-développées. Par ce biais, on explique la formation du sous-développement. Ainsi, le dualisme rural constitue un effet de surface d’une accumulation primitive avortée. Les politiques d’instauration des présupposés du capital émanent de l’avènement d’un capitalisme réel, c’est-à-dire un mode de production où le capital investit le procès de production et le procès de travail. II/ L’alternative socialiste ou la voie non capitaliste du développement La richesse de l’analyse marxiste réside dans le fait qu’elle autorise l’approche d’un modèle alternatif au capitalisme. Á ce niveau de l’analyse, la démarche est de réunir les éléments épars en vue de dégager les lignes directives d’une théorie de la transition vers le socialisme dans des formations caractérisées par un faible niveau des forces productives et une situation de domination extérieure. Observons que MARX et ENGELS n’étaient nullement les tenants d’un dogme figé et sans vie, ni de schémas rigides et définitifs qui auraient le pouvoir magique d’expliquer toute la réalité objective dans toute sa complexité. C’est une méprise que d’avoir une telle opinion de leurs travaux. Hommes de sciences, ils étaient plus soucieux de pénétrer le réel pour en extraire les éléments qui peuvent fonder une 99 praxis sociale43. Dans la problématique de la transition, la doctrine ne pouvait être achevée car cela signifierait que MARX et ENGELS pourraient devancer «le rythme historique réel des masses»44. EN conséquence, ils n’ont fait que ce qui était possible de faire ; poser* les pierres angulaires et le cadre méthodologique pour appréhender assez correctement le projet socialiste et les diverses voies qui pourraient y mener. De fait, les directions analytiques sont ainsi nettement spécifiées. Il s’agit en premier lieu de s’interroger sur la signification exacte du socialisme. Cette interrogation en évitant de piétiner sur les mots doit avancer dans les idées vers la découverte des principes fondamentaux totalement dépouillés des mythes et de l’obscurantisme introduits par la propagande et le dogmatisme. Ce n’est que par cette approche que l’on peut mettre en lumière les lois universelles du socialisme les plus diverses. Il s’agit en second lieu, de formuler les voies de passage entendues comme les préalables à réunir pour créer tel ou tel état socialiste. Ces préalables relèvent aussi bien de la conjoncture interne que de la situation externe. Postulée en cas termes non occultes, la transition ne laisse transparaître aucune voie royale vers le socialisme. a) Les fondements du socialisme Les idées socialistes remontent très loin dans l’histoire de l’humanité, depuis la République de Platon jusqu’aux ébauches de sociétés communistes de Thomas MORE et Giovanni CAMPANELA. En effet, à partir d’une critique de l’ordre social, ces auteurs vont s’attacher à imaginer de nouvelles formes d’organisation sociale plus justes et plus harmonieuses pour une suppression radicale de toutes les formes d’inégalités. MORE et CAMPANELA font un effort de développement systématique de ces nouvelles cités humaines. Le premier imagine une île qui porte l’idéal communiste où le travail de chacun contribue à l’épanouissement de l’ensemble de la collectivité. Le gouvernement, dans cet ordre social, aura à assurer une double tâche : diriger la production économique et organiser une répartition égalitaire du produit social. Dans le même ordre d’idées, Giovanni CAMPANELA développe la nécessité de construire une société fondée sur l’amour et qui devra vaincre toutes les formes de division et d’opposition pour arriver à une harmonie universelle excluant toute inégalité sociale45. Ces idées de socialisation de la vie ont pour finalité la création de rapports sociaux plus harmonieux lesquels excluent toute propriété privée. Elles joueront, comme le note Henri DENIS, un rôle décisif à partir du XVIIIe siècle dans la formation des grandes doctrines socialistes. C’est surtout au XIXe siècle, avec la généralisation et l’approfondissement des rapports de production capitalistes que les systèmes socialistes des « grands utopistes » apparaissent. La France et l’Angleterre seront les pays d’élaboration de MARX rappelle dans «L’idéologie allemande» (Édit. Sociales, 1965) qu’à l’encontre de la philosophie allemande qui descend du ciel sur la terre, c’est de la terre au ciel que l’on monte ici ou par des hommes dans leur activité réelle, et c’est à partir de leur processus de vie réel que l’on représente aussi le développement des reflets et des échos idéologiques de processus vital. 44 Perry ANDERSON : Sur le marxisme occidental, Petite Collect. F. MASPÉRO, p. 13, LENINE (œuvres complètes, t. IV) affirme plus nettement encore que nous ne tenons nullement la doctrine de MARX pour quelque chose d’achevé … nous sommes persuadés qu’elle a seulement posé les pierres angulaires de la science que les socialistes doivent faire progresser dans toutes les directions s’ils ne veulent pas retarder sur la vie. 45 H. DENIS : Histoire de la pensée économique. Collection «Théruis», pp. 79-120. 43 100 ces systèmes de pensée. L’Angleterre était un champ de réflexion car dans le pays se forme la première grande industrie qui selon F. ENGELS «développe d’une part les conflits qui font d’un bouleversement du mode de production une nécessite inéluctable et d’autre part, elle seule développe dans ces gigantesques forces productives elles-mêmes, les moyens de résoudre aussi ces conflits»46. La France présentera d’autres traits permettant l’apparition d’idées socialistes. Dès la fin du XVIIIe siècle jusqu’au milieu du XIXe siècle, elle connaît, selon Georges GOGNIOT, une vie orageuse, saturée de mouvements politiques et sociaux, d’évènements et d’idées47. Elle propagera, comme l’observe LENINE, par toute l’Europe les idées du socialisme. Ce courant du socialisme prémarxiste de Saint-Simon (1770-1825) à R. OWEN (1771-1858) en passant par C. FOURIER (1772-1837) remet en question toutes les formes d’exploitation et propose un nouvel ordre économique et social ayant pour but d’affranchir les travailleurs de la tutelle du capital. Ces changements radicaux seront le fait des savants et des techniciens. Dans cette ligne de pensée, Saint-Simon pense qu’il revient aux philosophes et aux techniciens de concevoir un système d’organisation sociale meilleur et d’inciter les gouvernements à le mettre en application. Cette organisation sociale doit être absolument débarrassée de tous les maux comme l’ignorance, le parasitisme et la misère. En plus, la direction des hommes doit y faire place à l’administration des choses ; ce qui annonce le dépérissement de l’État que MARX reprendra. Quant à l’industrie, elle doit s’organiser en dehors des interventions maladroites des pouvoirs publics. Sur ce point, Saint-Simon sera vivement critiqué par MARX qui défendra plutôt la socialisation des moyens de production. Cette idée est fortement présente dans les analyses de FOURNIER pour qui l’harmonie universelle ne peut être atteinte que si la société arrive à exclure l’appropriation privée, à supprimer toute exploitation de l’homme par l’homme, donc à réaliser profondément une totale socialisation de la vie économique et sociale. Au total, ce courant prémarxiste avait perçu, parfois avec beaucoup de clairvoyance, les tares du système socioéconomique et l’opportunité d’opérer la création de nouvelles sociétés qui corrigent toutes les inégalités et les injustices. Selon tous ces auteurs, les transformations décisives des édifices sociaux doivent être conçues par les intellectuels et les techniciens et réalisées par les masses populaires. Ces analyses ont été sévèrement critiquées par MARX et ENGELS. Ces critiques se situent à trois (03) niveaux : - en premier lieu, il est reproché aux socialistes prémarxistes de n’avoir pas saisi le rôle politique de prolétariat dans la lutte pour la liquidation du capital. Pourtant, ces auteurs ne pouvaient pas sérieusement appréhender ce rôle fondamental du prolétariat car les conflits issus de l’ordre capitaliste n’étaient qu’en devenir. Dans ces conditions, comme le reconnaît F. ENGELS, le prolétariat était absolument incapable d’avoir une action politique indépendante. - en second lieu, le nouveau système social proposé est sorti de la raison pensante et non des contradictions caractéristiques du mode production capitaliste. Or écrit ENGELS «ce n’est pas dans la tête des hommes, dans leur compréhension croissante de la vérité et de la justice éternelle, mais dans les modifications du mode de production et d’échanges qu’il faut chercher les causes dernières de toutes les F. ENGELS : Socialisme utopique et socialisme scientifique, p. 126. in K. MARX et F. ENGELS, Œuvres choisies. Édit. du Progrès. 47 G. COGNIOT : le socialisme utopique de Saint-Simon et FOURIER, le socialisme petit bourgeois de Proudhon, les cahiers du CERM, n° 3, 1963. 46 101 modifications sociales et de tous les bouleversements politiques : il faut les chercher non dans la philosophie mais dans l’économie de l’époque considérée»48. - en troisième lieu, la vision du monde, si généreuse qu’elle soit, reste utopique. C’est le propos d’un décalage entre une vision abstraite de l’esprit et l’architecture complexe de la réalité objective. D’ailleurs, ces projets une fois élaborés, sont octroyés de l’extérieur ; ce qui traduit une absence d’investigation sur les moyens effectifs de leur matérialisation. Comme pour excuser ces lacunes, ENGELS s’efforce de montrer pourquoi ces courants socialistes ne pouvaient aboutir à l’élaboration de théories correctes du socialisme. Dans cette optique, il note qu’«à l’immaturité de la production capitaliste, à l’immaturité des classes, répondit l’immaturité des théories. La solution des problèmes sociaux qui restait cachée dans les rapports économiques embryonnaires, devait être tirée du cerveau» 49. De fait, les théories ainsi élaborées par les élites en dehors des structures productives et sociales effectives ne sont pas en mesure d’indiquer les causes profondes qui légitiment l’arrivée d’une nouvelle formation économique et sociale, et de désigner les moyens précis qu’il importe de mettre en œuvre pour accéder à cette formation sociale socialiste. MARX et ENGELS se porteront comme les successeurs légitimes des conceptions les plus avancées des socialistes utopiques. C’est cela qui explique la boutade d’ENGELS qui rattache le socialisme au fond des idées existantes. Pour ramener ces conceptions sur le plan scientifique, il fallait les placer sur le terrain du réel. Dès lors, il ne s’agit plus simplement d’inventer par la pensée de nouveaux modèles de société et des moyens d’éliminer les anomalies de la société capitaliste. Ces modèles et ces moyens sont à découvrir dans les faits matériels de la production. Donc le socialisme scientifique découlera des contradictions du mode de production capitaliste. Ces contradictions soulignées, trouvent leur solution sur le plan économique et politique. Quels sont alors les fondements du socialisme ? Selon P. JALEE50, le socialisme scientifique de MARX repose sur deux (02) piliers : la socialisation de l’économie et l’avènement d’un pouvoir politique d’essence populaire et démocratique capable d’assumer une gestion adéquate des instruments de production socialisés. La socialisation de l’économie passe par un impératif qui est l’abolition de la propriété privée des moyens de production, d’échange, de crédit et de transport. Selon ENGELS, cette prise de possession des moyens de production par la société, élimine la production marchande et par suite, la domination du produit sur le producteur. L’anarchie à l’intérieur de la production sociale est remplacée par l’organisation planifiée consciente51. Cette socialisation n’est profondément qu’un moyen au service d’une fin ultime : la socialisation de la vie de l’homme52. En effet, F. ENGELS observe que la propriété d’État sur les forces productives n’est pas la solution du conflit, mais elle renferme en elle le moyen formel, la façon d’approcher la solution53. On peut donc déjà remarquer que la socialisation intervient dans une société capitaliste où «les forces productives sont devenues trop grandes pour toute autre direction que la sienne». F. ENGELS, op. cit., p. 143. F. ENGELS, op. city. p. 143. 50 Pierre JALEE: Le projet socialiste : approche marxiste. Petite Collection, F. MASPÉRO, Paris, 1976. 51 F. ENGELS, op. city. p. 161. 52 Qui de ce fait pourra faire lui-même sa propre histoire en pleine conscience. En somme, ce sera le fond du régime de la nécessité à celui de la liberté. 53 F. ENGELS, op. city. p. 156. 48 49 102 Pour ce qui concerne le pouvoir public, il revêt une nature et des formes différentes et doit également avoir des fonctions exorbitantes par rapport à l’ancien appareil d’État. Celui-ci était considéré comme un instrument au service du capital ayant de puissantes fonctions répressives. Désormais, il doit subit de profondes transformations pour pouvoir accomplir pleinement la socialisation de la vie économique, politique et sociale. Il doit également assurer une démocratie réelle et non formelle, c’est-à-dire une démocratie qui garantisse une participation effective des travailleurs à la gestion aussi bien de l’économie que de l’État. Une telle démocratie exclut toute fonction répressive. En plus, une fois toutes tâches accomplies, l’appareil d’État doit dépérir. On retrouve là une idée des socialistes prémarxistes que MARX et ENGELS reformulent. En effet, lorsque l’État représente réellement la société globale, il devient superflu ; alors le gouvernement des personnes fera place à l’administration des choses et à la direction des opérations de production. ENGELS précise que l’État en réalité n’est pas aboli, mais il s’éteint54. À ces deux (02) piliers, on pourrait en ajouter un troisième qui aurait trait à l’idéologie et à la culture. Selon R. GARAUDY, il se traduirait par «une révolution socialiste dans l’idéologie et la culture présentant le double caractère de détruire les aliénations engendrées dans l’esprit des hommes55 … et de créer les conditions permettant l’accès de tous aux acquisitions millénaires de la science et de la culture»56. Cette rapide analyse des éléments de base du socialisme scientifique de MARX et ENGELS appelle deux (02) observations essentielles pour nos développements futurs. La première est que le socialisme ainsi envisagé prend la suite d’une formation sociale capitaliste très développée, donc arrivée à la pleine utilisation de ses capacités de production. La contradiction entre la socialisation excessive de la production et la forme privée d’appropriation des résultats en est la preuve la plus évidente. En conséquence, dans des formations qui ne connaissent pas le même niveau de développement des forces productives, les problèmes peuvent se poser tout autrement. Cela introduit précisément une nouvelle conceptualisation du projet socialiste57. Cette première observation en appelle une seconde qui lui est directement liée. Une vision globale des analyses de MARX et d’ENGELS permet d’établir une étroite dépendance du socialisme à l’égard de la structure économique et sociale. À y F. ENGELS, op. city. p. 159. De ce point de vue, le Pr. Henri BARTOLI souligne les effets aliénants de l’argent. Il observe que « la monnaie devenue pouvoir et fin … corrompt les rapports du travail, la vie politique, la justice, la presse, le sport, la vie privée, l’art, la charité même. Le temps où les choses mêmes qui jusqu’alors étaient communiquées, jamais échangées ; données, jamais vendues, requises jamais achetées –vertu, amour, opinion, science, conscience, etc. tout enfin passe dans le commerce atteint de capitalisme de ce temps tout autant que le capitalisme du siècle passé » – in H. BARTOLI : Hypothèses marxistes (travail et condition humaine, Édit. FAYARD, Paris, 1963, p.72). 56 Roger GARAUDY: Pour un modèle français du socialisme. Collection idées actuelles, NRF, GALLIMARD, Paris, 1970. 57 On peut dire que toute imitation mécanique où tentative de construire un modèle socialiste sur ces bases dans les formations sous-développées mépriseraient carrément les réalités objectives. En conséquence, le décalage entre la théorie et le réel ouvre une voie sûre à l’échec. LENINE administre de ce point de vue une magistrale leçon de recherche non dogmatique d’une transition vers le socialisme, assise sur le niveau effectif de développement des forces productives. Tous les problèmes théoriques ouverts à la discussion des intellectuels du parti ont été brutalement résolus dans le sang par STALINE qui a physiquement liquidé tous les protagonistes. Le combat cessa faute de combattants. 54 55 103 réfléchir, cette liaison postule l’existence d’une pluralité de modèles socialistes. En effet, le projet socialiste sera différent selon que la transition s’amorce à partir d’une base capitaliste avancée ou de structures socio-économiques de faible niveau. Or, comme nous l’avons établi, la transition a toujours un caractère organique propre qui détermine les formes que prend le socialisme. Deux (02) faits viennent appuyer cette thèse. Le premier de nature théorique nous est fourni par LENINE qui observe que ni la régularité, ni la proportionnalité, ni l’harmonie n’ont jamais existé dans le monde capitaliste et en conséquence, les pays qui construisent le socialisme peuvent présenter un régime politique et une structure d’État différents. De ce fait, il était convaincu que chaque nouvelle révolution devait dépasser les modèles socialistes existants et offrir de nouvelles formes. Le deuxième fait découle de l’expérience historique des pays socialistes d’Europe de l’Est, d’Asie et d’Afrique. Cette expérience laisse apparaître des variétés structurelles traduisant des projets socialistes différents. On est alors tout fondé à établir, comme le fait G. AIMARD, une véritable typologie politico-économique du socialisme58 pour saisir la pluralité des modèles et les implications profondes notamment pour des formations sous-développées caractérisées par une immaturité des structures sociales et des rapports de production. Cette pluralité est encore plus nette lorsque l’on envisage les voies d’accès. b) Les voies d’accès au socialisme Cette réflexion est propre aux disciples dont le plus prestigieux est sous ce rapport V. LENINE. Les voies d’accès au socialisme ont fait l’objet de deux (02) conceptions diamétralement opposées concernant les moyens à mettre en œuvre. Pour la première, la transition n’intervient qu’après une rupture révolutionnaire violente. Les classes au pouvoir ne sont pas de nature à capituler et abandonner pacifiquement le pouvoir politique. Cet abandon ne peut provenir que de l’issue d’une lutte violente que la classe ouvrière assume par ses organisations l’avant-garde. La thèse pose le problème de la violence dans l’histoire59. La seconde thèse défend le passage pacifique au socialisme comme une voie possible. Dans le fond, il importe cependant d’observer que l’histoire offre une pluralité de voies de passage au socialisme. Il en est précisément ainsi parce que l’accès au socialisme dépend aussi bien de facteurs internes que de la conjoncture extérieure. Dans ce sens, Roger GARAUDY rappelle avec beaucoup d’à-propos, que la révolution ne se définit aucunement par une stricte violence mais par un changement profond dans les rapports de production. Il observe que «les deux (02) possibilités, violente et pacifique, sont toujours ouvertes et leur actualisation dépend de la conjoncture» 60. En clair, la question ne peut se résoudre dans l’absolu et les expériences concrètes montrent des processus d’accès multiformes dont aucun n’est pur61. Donc il n’y a là G. AIMARD : Typologie politico-économique du socialisme. Revue algérienne des Sciences Juridiques, vol. VII, n°1, mars 1970. 59 Ce problème des conditions de la révolution a fait l’objet de vives polémiques dans les mouvements de libération. F. FANON figure en bonne place (les damnés de la terre, Édit. F. MASPERO) parmi les défenseurs de la lutte violente mais à côté de CHE GUEVARA (la guerre de guérilla). 60 Roger GARAUDY, op. cit. p. 305. 61 F. ENGELS, sur la question est très pragmatique. Il écrit «pour moi, en tant que révolutionnaire, tout moyen conduisant au but est valable, le plus violent comme celui qui semble le plus pacifique». De même, MARX observe que «nous agirons contre les gouvernements bourgeois pacifiquement là où cela est possible, par les armes quand cela est nécessaire». LENINE ne dit pas autre chose dans la polémique avec les gauchistes qui ignorent l’opportunité du compromis. 58 104 aucune mécanique, les voies de passage dépendent à la fois des traditions de lutte, de l’état des classes sociales et de leur degré d’organisation et des rapports des forces sociales à l’échelle mondiale. L’intérêt de cette idée de pluralité des voies de passage est d’introduire par une autre fenêtre la pluralité des modèles car les structures que des forces radicales conséquemment préparées mettent en place peuvent être qualitativement différentes et celles qu’installent d’autres forces négociant prudemment le passage. En définitive, on peut retenir de l’examen de la théorie du socialisme scientifique que celui-ci se définit par des critères précis qui sont en réalité des objectifs. Les critères sont, d’abord l’avènement d’un pouvoir prolétarien capable de diriger la vie économique, politique et sociale et d’améliorer de façon soutenue les conditions matérielles62 d’existence des masses laborieuses et ensuite, l’extension de la propriété sociale qui apporte une mutation radicale dans les rapports sociaux de production de manière à garantir une réelle participation des producteurs à la direction et à la gestion des unités de production. Ces principes sont altérés par les structures économiques et sociales au départ de la transition de sorte qu’à l’arrivée, la formation socialiste révèlera des particularités qui la différencient du schéma idéal. À la lumière de ces analyses, il devient possible de formuler avec plus de précision les éléments de base d’une théorie de la transition entendue comme une phase organiquement complexe, structurée et préparatoire au socialisme. Dans ce cas, la formation sociale en transition se caractérise par un ensemble de composantes structurales dont une est dominante. Chaque composante est un mode de production que les stratégies mises en place sur le plan politique, économique et social bousculent ou renforcent. Ainsi, dans la transition, le problème de l’État – qui est un appareil et non l’expression de la société – doit être réglé. Par son contenu social et son organisation, il doit être à mesure de diriger et de conduire les changements fondamentaux. Il est en permanence menacé par le phénomène bureaucratique qui peut le transformer en un gigantesque appareil hautement répressif et inefficace. C’est dans ce sens que LENINE recommandait d’utiliser les «orientations ouvrières pour défendre les ouvriers contre leur État» 63. Sur le plan économique également, les tâches de transition sont complexes. Le problème central est de savoir comment arriver au renforcement du secteur socialiste pour qu’il soit suffisamment large et efficace pour introduire les changements dans les rapports de production et améliorer les conditions sociales d’existence. En fait, la socialisation des instruments de production est un moyen au service d’une élévation continue du niveau des forces productives sans laquelle la transition ne produit autre chose qu’une socialisation de la misère et de la pauvreté. Il faut alors que le nouvel appareil de l’État soit capable d’assumer ses fonctions de gestionnaire. À l’évidence, l’exercice de fonctions économiques exorbitantes aboutit à une inefficacité, donc au gaspillage des ressources et à la stagnation. Denis CLERC dans article marxisme et nouveaux problèmes» (Économie et humanisme, mai-juin, 1977) souligne cet aspect productiviste du marxisme car dans la doctrine, la mission du prolétariat est de se servir de sa suprématie politique pour accroître au plus vite la masse des forces productives. L’auteur, à tort me semble-t-il, condamne cette problématique productiviste sans laquelle toute amélioration des conditions d’existence serait illusoire. Personne ne peut raisonnablement soutenir un socialisme de la pauvreté ou une socialisation de la misère. 63 N. BOUKHARINE était parfaitement conscient de la gravité du phénomène bureaucratique ; ce qui l’amenait à observer que «dans les pores de notre gigantesque appareil sont nichés des éléments de dégénérescence bureaucratique absolument indifférents aux intérêts des masses, à leur vie, à leurs intérêts matériels et culturel». 62 105 Tout compte fait, une juste solution de ces problèmes de la transition nécessite une correcte appréciation de la structure centrale de la formation en transition et des rapports sociaux impliqués. C’est à partir de leur connaissance qu’il est possible d’établir une périodisation du processus de transition qui, selon P. JACQUEMOT, «désigne les changements effectivement opérés dans l’état des rapports sociaux fondamentaux et principalement quant au rôle des producteurs immédiats dans l’articulation des procès de production et de répartition du produit social» 64. En somme, cette périodisation permettra de saisir les divers facteurs perturbateurs et les obstacles qui retardent les progrès du socialisme et d’envisager les moyens à mettre en œuvre pour les lever. Tous ces éléments indiquent que pour les formations sous-développées qui partent avec de sérieux handicaps économiques et sociaux, il est impérieux de définir avec clarté le projet socialiste de société qui ne soit ni une copie mécanique, ni une utopie, ni une aventure. Ces travers ne peuvent être évités que si le projet est rivé aux réalités objectives, donc au réel. Section 4 : Deux limites du marxisme originel : la baisse tendancielle et la chute inéluctable du capitalisme. Ricardo avait lui aussi prédit la fin du système capitaliste, en se basant sur une analyse de classes économiques. Comme on l’a fait pour Ricardo, il s’agit maintenant de mette en exergue les aspects du modèle de Marx qui sont toujours applicables et ceux qui ne le sont pas aux conditions d’aujourd’hui ; et pour les parties inapplicables, d’analyser si c’est à cause d’un changement au niveau des conditions de la société sur lesquelles le modèle était fondé, ou à cause de problèmes dans la logique en lui-même. I/ Les implications de la deuxième version de la détermination des prix sur la loi de la baisse tendancielle du taux de profit. L’assertion de MARX Selon laquelle le taux de profit moyen est égal à PL/ (C’+V) est fondée sur l’argument que le montant global des profits est égal au montant global de la plus-value, PL. Mais rien ne prouve que les prix s’ajusteront de telle façon que le montant global de profits soit égal au montant global de plus-value. Marx essaye de le prouver, mais si on examine ses arguments attentivement (par exemple, le passage au chapitre 10 du troisième livre du Capital apparaissant sur les pages 176-177 des Éditions sociales, tome VI), on s’aperçoit qu’il avance des arguments circulaires, c’est-à-dire qu’il proclame que les profits sont égaux à la plus-value parce que les profits sont égaux à la plus-value. En fait, un entrepreneur n’a aucune raison d’augmenter la composition organique de sa fabrique si cela réduit son taux de profit. Comme exemple concret, on peut reprendre l’usine de dentelle analysée plus haut. Pour simplifier considérablement, on utilise la formule «sans nuance» pour calculer le taux de profit. On vous rappelle que dans un premier temps (voir ligne 1 du tableau suivant), on fabriquait 30 mètres de dentelle en utilisant un capital constant ayant une valeur de 20 heures mis en œuvre par des ouvriers qui recevaient un salaire d’une valeur de 5 heures pour une journée qui durait 10 heures. Suivant la première version de la 64 Pierre JACQUEMOT, op. Cit. p. 598. 106 détermination des prix, la dentelle se vendait pour sa valeur, soit 90 f le mètre. Les revenus provenant des ventes seraient (30 mètres) x (90 f/mètre) = 2700 F ; les dépenses seraient (20 heures + 5 heures) x (90f/heure) = 2250 F ; les profits seraient 2700 – 2250 = 450 F et le taux de profit serait 450/2250 = 0,2 = 20%. Si en plus, on suppose que le capital constant et le capital variable se vendent à leur valeur (ce sera le cas si l’industrie qui produit le capital a une composition organique égale à la composition organique moyenne de toutes les industries du pays, et si on suppose par ailleurs que le taux de profit moyen du pays est de 20%, alors la deuxième version de la détermination des prix implique aussi un prix de 90 F par mètre de dentelle, puisque ce prix donne un rendement de 20% à l’industrie dentelle. Maintenant, nous supposons que dans un deuxième temps (ligne 2A du tableau), un patron d’une usine découvre une nouvelle méthode fabriquer la dentelle. Avec méthode, du capital constant valant 22 heures plus 10 heures de travail produisent 36 mètres de dentelle. Pour le moment, puisque toutes les autres fabriques produisent la dentelle avec l’ancienne méthode pour la vendre à 90 f/mètre, lui aussi peut vendre au prix des autres. Cela lui permet de récupérer un profit de 810 francs sur la vente de 36 mètres pour un taux de profit de 33,3%. Mais les autres chefs d’usine, en voyant les surprofits gagnés par celui qui innove, adopteront bientôt la nouvelle méthode. Selon la première version de la détermination des prix, à cause de compétition entre fabricants, le prix de la dentelle sera baissé jusqu’à sa nouvelle valeur (compte tenu de la nouvelle méthode de production), c’est-à-dire 8/9 d’heure de travail, direct et indirect, par mètre de dentelle, soit 80 f/mètre. Comme l’indique la ligne 2B du tableau, ceci impliquerait un taux de profit de 450/2430 = 18,5%. Selon la deuxième version de la détermination des prix, la concurrence entre fabricants cessera de réduire le prix une fois que le taux de profit dans l’industrie de dentelle est égal au taux de profit moyen pour l’ensemble du pays, c’est-à-dire 20% (si le taux de profit était vraiment réduit à 18,5%, des capitalistes abandonneraient l’industrie de dentelle pour d’autres secteurs ayant un taux de 20% réduisant ainsi la production et créant une pénurie de dentelle qui augmenterait son prix). Avec la nouvelle méthode de production, les dépenses pour capital constant (22 x 90 F) et pour capital variable (5 x 90 F) sont au total, 2430. Un taux de profit de 20% sur 2430 F de dépenses donne des profits au montant de (0,2 x 2430) = 480 F. Ajoutant ces profits aux dépenses, on sait que le revenu provenant de ventes est 2430 + 486 = 2916 F. Si 36 mètres de dentelle se vendent pour 2916 F, alors un mètre de dentelle se vend pour 2916/36 = 81 francs (voir la ligne 2 C du tableau). La quantité de plus-value n’a rien à voir avec la nature ou la quantité du produit fabriqué : la plus-value est définie simplement comme la longueur de la journée de travail moins la valeur du salaire. Comme on peut le constater, en comparant la ligne 1 avec la ligne 2 C, les profits ne restent pas en proportion constante avec la plus-value (en ligne 1, la proportion est de 90 francs de profits par heure de plus-value, en ligne 2 C, la proportion est de 97,2 francs par heure de plusvalue). Rien n’empêche que toutes les industries du pays subissent les mêmes changements que l’industrie de dentelle : un accroissement de la composition organique et de la productivité, accompagné d’une réduction du prix, sans réduction du taux de profit, ni augmentation du taux de la plus-value. En conclusion, la «loi de la baisse tendancielle du taux de profit» est erronée parce qu’elle repose sur un faux raisonnement que le profit global dans un pays serait égal à la plus-value globale. 107 On peut avancer toutes sortes d’arguments qui auraient comme implication une baisse tendancielle du taux de profit (voir par exemple, le modèle de Ricardo). Il se passe que le raisonnement avancé par Marx est un sophisme. II/ Pourquoi les sociétés capitalistes ne se sont elles pas effondrées ? Pourquoi « le capitalisme moribond se porte-t-il toujours bien ? » À cause des profits de l’impérialisme (discuté sous «LENINE ») et de l’échange inégal avec le tiers-monde. À cause de l’augmentation du niveau de salaires dans pays capitalistes avancées et de changements politiques. Une multiplication du niveau de salaires, depuis le temps de Marx dans les pays capitalistes industrialisés a enlevé la misère de la classe ouvrière et dans même temps a fourni un débouché pour la production élargie de ces pays. En effet, la proportion du PIB attribuée aux salaires en divers pays riches a été si stable que certains considèrent la stabilité de la production (salaire)/(PIB total) comme une «loi» économique (la soi-disant « loi de Bowley»). Aux Etats-Unis, par exemple, la proportion de salaires dans le PIB a à peine varié de 67% au cours des dernières cinquante années (l’autre tiers du PIB prend la forme de profits et de rentes). En conclusion, l’évidence empirique démentit ce que Marx appelle la «loi absolue, générale, de l’accumulation capitaliste» au cadre des pays capitalistes avancés. L’amélioration des conditions de la classe ouvrière était due non seulement à des causes économiques (l’augmentation de la productivité), mais aussi à des causes politiques. Il est instructif à cet égard de réviser brièvement l’histoire du parlement anglais. Des réformes électorales augmentant le pourcentage d’adulte mâles qui avaient le droit de voter ont eu lieu en 1832, 1867, 1885 et 1918 (les femmes âgées d’au moins 30 ans ont acquis le droit de vote en 1918 ; les femmes âgées de 21 à 30 ans, en 1928). Avant la réforme de 1832, le parlement était élu, surtout par la grande et la petite noblesse, en suivant un mélange chaotique de lois médiévales. Après la réforme de 1832, les représentants des industrialistes avaient une légère majorité sur les représentants de la noblesse. Sous ce régime, les infâmes «Corn Laws» furent annulées en 1846, permettant l’importation du blé sans paiement de tarif douanier ; et une série de lois de réforme des conditions de travail furent passées, commençant en 1833. Après la majorité des électeurs étaient la petite noblesse et la classe moyenne en campagne, la classe moyenne et les cadres en ville. Les parlementaires ainsi élus ont renforcé les lois portant sur les conditions de travail et ont légalisé l’action syndicale. Après la réforme électorale de 1885, la majorité de la population pouvait voter, y compris la majorité des ouvriers industriels et agricoles. S’il était raisonnable de penser, en 1848 que «le gouvernement moderne n’était qu’un comité qui gère les affaires commune de la classe bourgeoise toute entière» (Marx et Engels, Manifeste communiste), cette thèse devient très difficile à défendre une fois que toute la population choisit les membres du parlement. Dans des pays autres que l’Angleterre, notamment l’Allemagne, des lois socialistes furent passées même avant que la majorité de la population ait eu le droit au vote, justement avec l’objectif d’éviter une situation qui engendrerait une révolution prolétarienne. 108 1°) À cause de l’adoption des mesures keynésiennes Les crises économiques, causées largement par des imbalances entre l’offre de fonds pour l’investissement (l’épargne) et la demande pour les investissements au niveau global de l’économie, sont devenues de plus en plus graves jusqu’à la crise qui débuta en 1929 et toucha son fond en 1933. Depuis lors, l’adoption de mesures keynésiennes a évité des crises majeures («dépressions») dans les pays capitalistes avancés toutefois, la mise au point exacte de l’économie n’a pas été perfectionnée, de manière qu’il se passe encore des crises mineures («récessions»). Essentiellement, le gouvernement compense l’épargne excessive avec des dépenses au-delà des recettes budgétaires. Ainsi pour rétablir la balance entre l’offre et la demande au niveau global, l’État peut imprimer de l’argent pour acheter la production de l’économie que le secteur privé ne veut acheter soi-même. 2°) La monopolisation reste comme un fondamentalement irrésolu dans les pays capitalistes. problème Dans les pays capitalistes avancés, de plus en plus d’industries deviennent concentrées dans les mains de quelques firmes géantes, et les firmes géantes deviennent toujours plus gigantesques. Plusieurs facteurs contrecarrent, sans éliminer, ce problème de monopolisation : la compétition internationale (par exemple, le géant Fiat contre le géant Volkswagen), l’émergence de nouvelles industries qui ne sont pas encore concentrées dans les mains de quelques producteurs (par exemple, la fabrication de transistors), la compétition entre diverses industries (par exemple, on peut remplacer le cuivre par l’aluminium si le cuivre devient trop cher), la législation contre le monopole, un esprit de «vivre et laisser vivre» dans les industries dominées par quelques compagnies (par exemple, la compagnie Renault n’a pas comme objectif la destruction des compagnies Peugeot et Citroën), et finalement, l’absence de profondes crises économiques qui élimineraient périodiquement un grand nombre de firmes faibles. 3°) Que reste-t-il de la théorie de la valeur travail ? Nous avons vu que dans le système capitaliste, les prix de marchandises ne sont pas proportionnels aux valeurs des marchandises, et que le montant global des profits n’est pas égal au montant global de la plus-value. Quoique superficiellement attrayante, la théorie de la valeur travail élaborée par Marx ne permet pas le calcul des prix, et elle ne permet pas le calcul du taux de croissance de l’économie à travers l’accumulation de moyens de production, puisqu’elle ne permet pas le calcul du montant de profits qui financerait cette accumulation. Ayant fait cette critique de la théorie de la valeur marxiste, il faut ajouter qu’aucune autre théorie de la valeur n’est entièrement satisfaisante, non plus. Un objectif central de la théorie de la valeur marxiste est d’éviter l’attribution de la création d’une valeur à des entités abstraites telles que «le capital » et «la terre» (selon Marx, seul le travail crée la valeur). Il est vrai que le capital, conçu comme un 109 fonds d’argent, ne crée aucun produit en soi-même. Mais quand on considère le capital conçu comme un stock de machines et d’autres moyens de production, on voit que les machines créent des produits, et on voit que la valeur de la production d’une machine peut être plus grande que le montant du travail nécessaire pour construire la machine elle-même. Prenons un exemple concret. Nous supposons que les 10 hommes travaillant un an peuvent fabriquer 100 tonnes de briques (la matière première, l’argile est gratuite) ; ou bien que 5 hommes puissent passer un an à construire une machine, et la machine, qui dure une année, peut être utilisée par 5 ouvriers pour fabriquer 108 tonnes de briques. Puisque le travail total est le même dans les deux cas, dix hommes-années de travail, où peut on attribuer les 8 tonnes de plus fabriquées, sinon au capital investi en la machine ? Pour affecter efficacement des fonds d’investissement limités, même un État communiste devrait agir comme s’il essayait de maximiser les profits sur ses investissements. (En effet, le gouvernement soviétique exige le paiement d’un taux d’intérêt sur les investissements faits dans ses industries, mais pour ne pas insulter la mémoire de Marx, on appelle cela : «la facturation d’un loyer pour le capital» au lieu que «l’extraction d’un taux de profit»). Section 5 : La contribution positive du marxisme à la pensée du développement. « Le marxisme demeure d’actualité et il reste un instrument indispensable bien que sur beaucoup de détails ses analyses se soient révélées critiquables ». R. HEILBRONER65 Après la chute du socialisme en Europe de l’Est et la défaite des Partis Communistes dans les pays du socialisme réel, la question se pose de savoir ce qui reste de Marx ? En d’autres termes, le marxisme inspire–t-il encore la pensée économique et sociale ? Ces reflexions sont menées partout dans le monde mais avec des contributions de réactualisation plus massives et plus remarquables particulièrement dans les Universités américaines avec entre autres P. BARAN, P. SWEEZY, Samuel BOWLES (Univesité du Massachusets), R.HEILBRONER (School for Social Research), A. MELTZER. I/ Le premier aspect positif de la théorie marxiste est la concentration sur le «surplus» économique : les analyses de P. BARAN et P. SWEEZY P. BARAN et P. SWEEZY observent à partir de l’analyse marxiste que toute les sociétés fussent-elle d’une extrême pauvreté produisent plus que le minimum absolument nécessaire pour la subsistance de leur population, laissant un surplus. Ainsi, en prenant le Sénégal où le revenu par habitant est très faible, il est commun de constater, même dans l’agriculture, la formation d’un surplus qui peut être assez substantiel. On peut analyser la nature d’une société, dit MARX, à partir de l’étude des modalités de la formation et de la dépense de ce surplus économique. Les utilisations possibles du surplus selon les classes sociales : construction de grandes mosquées, d’édifices communautaires, les dépenses de consommation de luxe, l’investissement, le loisir. 65 Robert HEILBRONER : Marxisme pour ou contre 110 Cette question revêt aujourd’hui une importance capitale car les PSD sont caractérisés par des déficits importants d’épargne ce qui fait qu’ils comptent sur les transferts de capitaux pour financer les investissements productifs. Pourtant une épargne existe même si elle est assez faible. Il importe de la mobiliser comme le font maintenant les systèmes financiers décentralisés et les tontines en vue de leur utilisation à des fins productives. Dans la société socialiste, le surplus serait réparti entre l’investissement, d’une part et l’accroissement du loisir (réduction des heures de travail) et de la consommation de la population entière de l’autre. II/ Un deuxième aspect positif de l’approche marxiste concentration sur les liens entre politique et économique est sa Sous plusieurs angles, l’analyse marxiste est une méthode globale expliquant la très forte imbrication dialectique des variables économiques et non économiques, de l’infrastructure matérielle et de la superstructure. Toutefois, la sphère économique est la plus déterminante en dernière instance. Toutefois, même si par moments, les événements politiques ne sont pas sans influence sur l’économie, surtout à court terme, les facteurs économiques seraient fondamentaux, dès que l’on raisonne à long terme. Sur un autre plan, Marx établit que les méthodes de production, les «moyens de production» déterminent les «relations de production», c’est-à-dire les relations entre les hommes et les choses (matières premières, outils, produits) et les relations entre les hommes et les hommes. Engels ajoutera dans « Socialisme utopique et socialisme scientifique » que « nos idées juridiques, philosophiques et religieuses sont les produits plus ou moins directs de conditions économiques régnant dans une société donnée ». Toutefois, on peut critiquer cette approche marxiste qui présume une causalité unilatérale de l’économie vers la politique cela doit être nuancé car il n’existe pas de corrélation intangible entre les facteurs économiques qui causent les événements politiques et les facteurs politiques ou sociaux. En considérant la question de la répartition du revenu national, elle constitue le talon d’Achille des économistes non marxistes qui ignorent le problème et soutiennent que la croissance du PIB est un bon objectif mais ils ne cherchent pas à savoir qui sont les bénéficiaires de la croissance. Il est vrai que les marginalistes à partir de la théorie de la valeur utilité, ont tenté de reconstruire toute la théorie de la répartition du revenu national. Pour eux, sur un marché de concurrence pure et parfaite, les facteurs de production sont rémunérés en fonction de leur utilité marginale. La productivité du dernier travailleur employé détermine le salaire de l’ensemble des travailleurs. La rente foncière et l’intérêt du capital se déterminent de la même façon .Quant au profit, le marginalisme fait éclater le concept : il se décompose en intérêt du capital d’une part, en rémunération du travail de direction d’autre part. Le profit pur n’existe qu’en tant que rente de monopole qui disparaît en régime de concurrence pure et parfaite. III/ Un troisième aspect positif de la théorie marxiste est la constatation que les «lois» économiques changent avec la société. En effet, le comportement économique des hommes en période capitaliste est différent de ce qu’il était à l’époque féodale. Notez le contraste entre ce point de vue et celui de Smith. Marx dira clairement que chaque société crée non seulement les conditions pour la reproduction de la même société pour la prochaine génération de ses habitants, mais crée aussi, graduellement, les conditions qui mèneront à la 111 destruction de l’organisation présente du pays, et le passage à un nouveau niveau de société plus évoluée. La nature de la société change à travers l’histoire, dans ses aspects sociaux, économiques, politiques, religieux, psychologiques, etc. Par exemple, les lois du jeu économique d’une société féodale sont tout à fait différentes des lois du jeu économique d’une société capitaliste. Les «règles internes» de la société changent mais les lois scientifiques qui déterminent les règles internes d’une société ne changent pas. On peut faire le rapprochement avec une société privée qui peut modifier ses règles internes d’une année à l’autre, mais toujours sous le contrôle des lois du pays. IV/ La théorie économique marxiste répond à différentes questions que les théories économiques non marxistes n’envisagent pas. Ce phénomène cause fréquemment des malentendus. On peut illustrer ce point avec le chapitre du Capital intitulé «la différence dans les taux de salaires nationaux» (le chapitre 22 du premier livre). La première chose à remarquer est la brièveté du chapitre (seulement 5 pages dans un ouvrage de 2300 pages). En effet, Marx s’intéresse beaucoup plus à l’évolution du niveau de salaire dans un pays et à la répartition des revenus à l’intérieur d’un pays, qu’aux comparaisons internationales. Pour Marx les différences dans les facteurs suivants sont en dernière analyse les causes de différence entre salaires nationaux. Il s’agit notamment de : la répartition de l’effectif de la main d’œuvre entre hommes, femmes et enfants ; la longueur de la journée de travail ; le prix des produits alimentaires (le même salaire réel coûte plus dans un pays où la nourriture est plus chère) ; la longueur de la journée de travail ; le prix des produits alimentaires (le même salaire réel coûte plus dans un pays où la nourriture est plus chère) ; le niveau moyen de qualification et d’entraînement des ouvriers ; le standard de vie (ce qui est considéré comme le minimum de subsistance varie d’un pays à un autre) ; l’intensité du travail ; et la productivité du travail. Marx observa que souvent le salaire par jour était plus élevé en Angleterre que dans les pays les moins développés du continent européen, tandis que le salaire par unité de produit était plus bas en Angleterre. Ceci serait le cas, par exemple, si le salaire anglais par jour était 1,5 fois le salaire français, tandis que chaque ouvrier anglais fabriquait 2 fois autant de produit par jour qu’un ouvrier français. Mais après avoir fait cette observation, Marx rejette l’idée que le niveau moyen du salaire dans un pays est proportionnel au niveau moyen de productivité dans le pays : dans ce sens, il note que « Monsieur H. Carey cherche à démontrer que les différents salaires nationaux sont entre eux comme les degrés de productivité de travail national. La conclusion qu’il veut tirer de ce rapport international, c’est qu’en général la rétribution du travailleur suit la même proportion que la productivité de son travail. Notre analyse de la plus-value prouverait la fausseté de cette conclusion » (Marx, Capital, Livre premier, chapitre 22). Dans la plupart de ses réflexions, Marx considère comme donné le niveau réel du salaire et procède à une analyse de la répartition des revenus dans un pays 112 capitaliste, en relation avec la lutte des classes. Par exemple, il observe que « La valeur de la force de travail (c’est-à-dire le niveau des salaires) est déterminée par la valeur des nécessités de vie habituellement requises par un travailleur moyen. Tandis que la forme de ces nécessités peut varier à travers l’histoire, leur quantité est connue pour une société déterminée, et peut ainsi être traitée comme une magnitude constante. (Marx, Capital, quatrième édition allemande, livre premier, chapitre 15). Ainsi, quand on regarde les facteurs que Marx mentionne en passant comme déterminant le niveau national du salaire, un niveau qu’il traite comme une quantité déterminée pour son analyse, on voit que ce qu’il prend comme «une magnitude constante» est le sujet de la théorie non marxiste de l’économie du développement. En effet, cette dernière essaie d’expliquer des changements dans le niveau de vie (les «nécessités de vie habituellement requises par le travailleur moyen») en termes de changements de productivité du travail et de différences internationales dans la propension à travailler («la productivité et l’intensité du travail») ; les différences de productivité sont en partie expliquées par la théorie du capital humain («le niveau moyen d’entraînement des ouvriers», etc.). De la même manière, les économistes non marxistes considèrent comme des données, les conditions que l’analyse marxiste essaie d’expliquer sur le comportement économique des hommes (par exemple l’effort de maximiser leurs revenus), les lois de base de la société (par exemple la propriété privée), la répartition des revenus, la répartition du pouvoir politique, etc. En conclusion, une difficulté pour la comparaison entre la théorie économique marxiste et la théorie économique non marxiste est que ces deux théories répondent à des questions différentes. 113 CHAPITRE 6 LA RÉVOLUTION KEYNÉSIENNE ET NÉOKEYNESIENNE DE LA CROISSANCE ET DU DÉVELOPPEMENT. L’importance de l’analyse keynésienne dans le domaine du développement économique et de la croissance tient moins à l’élaboration par KEYNES d’un modèle complet du développement que par son approche des problèmes et les instruments utilisés. J.M. KEYNES n’est pas à proprement parler un théoricien du développement et de la croissance seulement ; toutefois, il a joué en la matière un rôle fondamental. D’abord, ses théories ont inspiré sur une trentaine d’années les politiques économiques de sortie de crise et de relance de la croissance. En effet, aucune crise économique sérieuse n’a secoué le système capitaliste mondial depuis 1940 jusqu’au début des années 70. Keynes a indiqué avec simplicité les politiques économiques de reprise et de régulation de la croissance que les gouvernements ont mise en place avec succès, ce qui s’est traduit par l’avènement des « Trente Glorieuses années de croissance (1945-75) » dans le monde capitaliste. Ces résultats ont fait dire à des analystes que si le « capitalisme moribond » décrit par Marx, se porte bien, c’est grâce à la thérapie keynésienne. Ensuite, les principaux théoriciens de la croissance sont des disciples, ou alors très fortement influencés par Keynes. Ce sont notamment HICKS, HANSEN, HARROD, DOMAR et SCHUMPETER, qui ont continué ou approfondi toute l’analyse économique du maître sur la question centrale de la croissance. Enfin, les premiers outils analytiques et conceptuels des théories de la croissance et du développement sont keynésiens. Ce sont la consommation, le revenu, l’épargne, l’investissement. C’est le multiplicateur que KEYNES a emprunté à KAHN et qui permet de passer d’un investissement donné à l’accroissement du revenu : En écrivant Y C (Y ) I , en dérivant, on obtient : dY c'dY dI dY (1 c' ) dI 1 dY dI 1 c' Le multiplicateur est accouplé à l’accélérateur que KEYNES a emprunté à AFTALION et qui traduit quel est l’effet inverse d’un accroissement du revenu sur le montant de l’investissement. C’est surtout HARROD qui introduit l’accélérateur dans la théorie de la croissance et cherche à la combiner avec le multiplicateur pour prendre une vue d’ensemble de la dialectique des liens entre le revenu et l’investissement. Que reste-t-il de l’analyse keynésienne, après les multiples remises en cause de sa pensée ? Les recettes de politique économique peuvent-elles encore servir ? Section 1 : L’analyse keynésienne Examinons le système des idées de l’orthodoxie keynésienne dans leur suite logique et leur enchaînement. Le point de départ de J.M. KEYNES est qu’il faut chercher la solution des problèmes économiques de la société non pas du côté de l’offre de ressources (leur rareté, leur valeur, leur combinaison optimale, la rémunération des facteurs de production) mais du côté de la demande qui garantit la réalisation de ces ressources. Cette conception amène Keynes à la critique puis au 114 rejet brutal, bien après MARX, de la loi de J.B SAY selon laquelle la surproduction est impossible car l’offre engendre automatiquement sa demande. Elle est possible, dit KEYNES et de façon durable. Keynes avance le problème de la demande effective et de ses deux composantes : la consommation et l’épargne. À l’analyse, chaque homme a deux utilisations possibles de son revenu : le consommer ou l’épargner. La fameuse loi psychologique humaine veut que plus le revenu s’élève plus la fraction épargnée s’élève aussi. Si bien que dans les sociétés en expansion, de même que dans les sociétés riches, la propension à consommer diminue, la propension à épargner augmente. Tout va bien tant que l’épargne accumulée est toute entière investie. Mais l’égalité entre l’épargne et l’investissement est un hasard parce que l’un et l’autre ne sont pas commandés par les mêmes forces. L’épargne dépend de la propension à épargner pour un revenu donné, alors que l’investissement dépend d’une autre force psychologique, l’incitation à investir elle-même commandée par la différence entre le taux d’intérêt et l’efficacité marginale du capital. Le système keynésien s’enchaîne comme suit : Fonction Demande de monnaie Offre Revenu Efficacité marginale du capital Taux d’intérêt Fonction de consommation Multiplicateur Fonction d’investissement Épargne Demande d’investissement + demande de consommation Consommation Demande effective Production Cette analyse permet d’établir l’articulation entre les différentes variables du circuit économique et de comprendre l’enchaînement des variables des politiques économiques préconisées par KEYNES. Celles-ci sont de trois ordres : La politique monétaire qui stimule l’investissement productif privé et public ; La politique de finances publiques par une fiscalité redistributive. La politique d’investissement. 115 Ces trois politiques doivent être expliquées par suite de l’intérêt que leur portent encore beaucoup de techniciens du développement. Toutefois, la préoccupation n’est pas une analyse de théorie économique mais une représentation du schéma keynésien et les analyses les plus pénétrantes pour le développement. I/ La politique d’investissement Alain BARRERE observe que «KEYNES était trop attaché au système économique dominant pour préconiser son abandon immédiat et pour le rejeter sans en avoir tiré ce qu’il était susceptible de donner. C’est la raison pour laquelle il recommande la stimulation de l’investissement privé comme meilleur moyen de développer le volume de l’emploi. De plus, il cherche ce développement par une politique bancaire compatible avec le jeu normal du système». L’idée centrale de l’analyse keynésienne est la demande effective, somme des dépenses de consommation et des investissements supposés. En définitive c’est elle qui détermine le niveau de l’emploi et celui du revenu. P. Samuelson dira à ce propos que »Les grandes lignes fondamentales sont acceptées par tous les économistes de toutes les Écoles, par beaucoup d’auteurs y compris ceux qui ne partagent pas les mesures spécifiques de politique économique ». La dynamique du développement réside dans le jeu des variables que sont la consommation et l’investissement. Réglons la question de la consommation qui est une fonction du revenu. La dépendance fonctionnelle amène Keynes à conclure que lorsque les revenus augmentent la consommation augmente, mais pas dans les mêmes proportions. Cela est relié à la loi psychologique fondamentale caractéristique des sociétés riches. Dès lors, pour maintenir une croissance constante du revenu national, il faut augmenter les investissements appelés à absorber l’excédent d’épargne. Le rôle de l’investissement dans le dispositif keynésien est central. Il note dans ce sens que « Pour une valeur donnée de ce que nous appelons la propension de la communauté à consommer, c’est le montant de l’investissement courant qui détermine le niveau d’équilibre de l’emploi, le niveau où rien n’incite plus les entrepreneurs pris dans leur ensemble à développer ni à contracter l’emploi » (Théorie générale pp52-52) . Dans la « Théorie générale», le montant de l’investissement dépend de deux facteurs : l’efficacité marginale du capital qui augure des avantages attendus à long terme des investissements actuels, et le taux d’intérêt. L’efficacité marginale du capital dépend avant tout de l’évaluation des profits futurs, des perspectives favorables de l’économie, des révolutions techniques, des risques encourus, des incertitudes, etc. Le taux d’intérêt est l’autre composante de l’investissement. Mais il est un paramètre monétaire II/ La politique monétaire de stimulation de l’investissement La politique monétaire de KEYNES est fort simple : puisque l’investissement se développe tant que l’efficacité marginale du capital est supérieure au taux de l’intérêt, il faut s’efforcer d’élever la première et d’abaisser le second. Seulement, il est difficile d’obtenir une élévation de l’efficacité marginale dès lors que la politique monétaire se résout à une politique de maniement du taux de l’intérêt. C’est sur cette base que l’on écrit la fonction d’investissement de la manière suivante : 116 I I o ji où (j) est un paramètre monétaire et (i) le taux d’intérêt. On établit ainsi que le volume de l’investissement varie pour un certain niveau donne (Io) en sens inverse par rapport au taux de l’intérêt. Pour accroître l’investissement, il faut baisser le taux d’intérêt à long terme. Or, dans sa théorie de l’intérêt, son niveau est déterminé par l’action combinée de l’offre et de la demande sur les encaisses monétaires. C’est dire que l’intérêt est un phénomène purement monétaire exprimant les automatismes du marché de la monnaie : la demande et l’offre. La première que Keynes appelle aussi la préférence pour la liquidité dépend de trois motifs : le motif de transaction découlant des besoins engendrés par la circulation de la monnaie et des marchandises ; le motif de précaution étroitement lié au premier et le motif de spéculation, cause directe des variations imprévues de la préférence pour la liquidité, qui influe sur la dynamique du taux de l’intérêt L’action régulatrice de la monnaie et du crédit, la modification du volume de l’offre de monnaie s’opèrent à partir de deux actions qui portent respectivement sur une expansion de la masse monétaire et sur les créances à long terme. Le premier point part de l’idée que plus la monnaie est abondante, plus il est bon marché, donc il faut accroître la masse monétaire. Bien entendu, il pourrait en résulter une élévation des prix donc un approfondissement de l’inflation mais celle-ci ne serait pas ruineuse si elle arrive à provoquer une hausse de l’efficacité marginale du capital. Il y a là une politique de financement de l’investissement que nous préconisons dans les développements ultérieurs. Car l’inflation peut jouer un rôle dans le processus d’accumulation si elle est utilisée à bon escient. Pour ce qui est du second moyen, il consiste en une action indirecte sur le marché des capitaux par l’intermédiaire des créances à long terme, c’est-à-dire que pour obtenir une baisse des taux d’intérêts, les Autorités monétaires achètent des titres et font ainsi monter les cours des valeurs ce qui fait apparaître un taux d’intérêt plus bas. On voit alors que les actions sur les déterminants monétaires et de crédit n’exercent une influence sur le développement qu’en agissant sur le processus d’investissement. Toutefois, si l’augmentation de l’offre de monnaie n’entraîne pas une diminution du taux de l’intérêt (trappe de la liquidité), la régulation monétaire et du crédit apparaît comme impuissante. Au total, toutes les politiques tournent autour de la stimulation de l’investissement. Sous ce rapport, KEYNES observe que le Secteur Privé est à lui seul incapable d’assurer le niveau optimum d’investissement nécessaire pour une expansion soutenue de l’économie. L’État devra alors intervenir non pas seulement pour fixer un cadre général, mais pour participer, en permanence et de l’intérieur, à la direction de l’Économie. Quelles formes, quelle ampleur doit revêtir cette intervention de l’État ? J.M. KEYNES est peu explicite sur ces points ; il s’intéresse à la théorie de l’intervention non pas à sa pratique. Seulement l’État n’est autorisé à intervenir que là, et quand il ne gène pas le secteur privé et peut, au contraire, lui apporter une aide. Il s’agit de compléter l’investissement privé, non de le concurrencer. Au total, le contrôle de l’investissement global apparaît à KEYNES, comme la meilleure manière d’assurer le développement, le plein emploi. La baisse du taux de l’intérêt ne peut être poursuivie indéfiniment, et l’élévation de l’efficacité du capital n’est pas facile à réaliser. L’État devra intervenir pour maintenir l’investissement à un niveau capable d’assurer la poursuite de l’expansion. Donc l’État doit combler la 117 marge que laisse apparaître la défaillance de l’investissement privé. Il peut le faire à travers sa politique budgétaire II/ La politique budgétaire de stimulation de l’investissement C’est le troisième volet des politiques keynésiennes. La politique de développement et de réalisation de plein emploi peut utiliser le canal des Finances Publiques. Selon A. BARRERE, les principes se ramènent à deux points essentiels : l’autorité publique doit combattre par la fiscalité l’insuffisance de la propension à consommer ; les dépenses publiques doivent exercer une action compensatrice susceptible de maintenir la dépense globale au niveau requis par l’expansion ou le plein emploi. Sur le premier point, l’objectif visé est principalement, par une autre redistribution des revenus, à accroître les capacités de consommation sans lesquelles la menace de surproduction ne sera pas levée. Il s’agit donc d’une fiscalité redistributive qui consiste à prélever sur les revenus élevés des classes épargnantes au profit des classes où les besoins non satisfaits sont importants. Les revenus moyens ou faibles alimentent alors une plus grande dépense. Le second point concerne l’action compensatrice des finances publiques. KEYNES note que c’est du côté de la dépense d’investissement que doit porter l’effort à cause des effets multiplicatifs. Ceci conduit alors à deux (02) conclusions : d’abord, l’Autorité Publique doit effectuer des décaissements tels que le volume de la dépense globale soit maintenu à un niveau suffisant pour absorber la totalité de la production : Capacités de consommation = capacités de production ; ensuite le financement de ces décaissements peut s’opérer soit par emprunt, soit par création de monnaie. Ces différentes actions peuvent et doivent être agencées dans le cadre d’une politique financière cohérente, connue sous le vocable de déficit systématique. Il s’agit théoriquement d’opposer au déséquilibre économique (désiré, voulu) un déséquilibre financier de sens contraire. C’est dire que le déficit autrefois condamné est systématiquement recherché pour provoquer un effet compensateur. En conclusion, toutes les politiques de développement actuellement revendiquées pour les Pays sous-développés, se réclament de ce corps de théories keynésiennes. En clair, J.M. KEYNES inspire les politiques monétaires de financement des investissements productifs et les politiques de déficits budgétaires pour soutenir le niveau des activités. Des réflexions intéressantes sur ce deuxième point sont réalisées par Paul BARAN qui voit dans le déficit budgétaire des pays capitalistes un facteur essentiel de régulation et de lutte contre la crise de surproduction. Section 2 : L’approche post-keynésienne du développement et de la croissance À la fin des années 30, beaucoup de disciples de Keynes vont tenter d’adapter le modèle du maître à l’analyse du développement et de la croissance à long terme. Cette analyse post-keynésienne concerne principalement trois (03) auteurs qui présentent de ce point de vue un intérêt incontestable. Ce sont : HARROD et DOMAR qui ont découvert le premier modèle formalisé de croissance. 118 KALECKI qui a plutôt exposé une variante du keynésianisme classique en matière de développement. Joan ROBINSON et Nicolas KALDOR qui ont soutenu une analyse de l’accumulation du Capital en vue du développement. En 1939, R.F HARROD, étudie dans un article célèbre « les principes fondamentaux de l’économie dynamique. Au même moment HANSEN développe sa théorie de la stagnation. Ce sera surtout dans l’après-guerre qu’une pléiade d’économistes se réclamant de J.M. Keynes écrivent plusieurs ouvrages sur la théorie keynésienne de la croissance. Ce mouvement se poursuivra jusqu’à N.KALDOR et SOLOW Ces auteurs posent trois groupes de problèmes : d’abord les déterminants de la croissance potentielle du revenu national, conditions assurant une croissance économique dite auto-entretenue (self sustained growth) ; l’équilibre dynamique, y compris les facteurs qui le détruisent et ceux qui le restaurent. En ce qui concerne les facteurs de la croissance à long terme, les recherches sont principalement empiriques alors que la croissance auto-entretenue et de l’équilibre dynamique ont permis l’élaboration de modèles théoriques dont certains restent encore très consistants. Cela amènera SOLOW à affirmer que « La théorie moderne de la croissance économique est consacrée essentiellement à analyser les conditions de l’état d’équilibre et à déterminer si une économie qui, initialement n’est pas en état d’équilibre, pourra le devenir en respectant certaines règles du jeu dans son développement ». C’est surtout N. KALDOR qui va formuler, dès 1958, un groupe de faits « faits stylisés » (stylised facts) caractérisant la croissance auto-entretenue ; il s’agit de : La stabilité du taux de croissance de la productivité du travail et du revenu national (avec une croissance démographique constante) ; La stabilité du taux de croissance du capital ainsi que du rapport travail/ capital, c’est-à-dire de la masse du capital par unité de travail ; La tendance à la constance du rapport capital-produit, c’est-à-dire de la masse de capital par unité de production ; La stabilité du taux de profit ainsi que de la part du profit dans le revenu national. La théorie doit alors établir comment se réunissent les conditions de la croissance auto-entretenue et de déterminer si l’économie est capable de compenser automatiquement les écarts par rapport à cette ligne de développement. La théorie keynésienne de la croissance tente de résoudre ces problèmes à partir des équations du modèle de HARROD-DOMAR. I/ Le modèle HARROD-DOMAR On peut dire que l’approche post-keynésienne a pour point de départ les tentatives de dynamisation du système keynésien originel. En 1948, HARROD publiait son ouvrage «Vers une théorie de la dynamique économique». Dans la même période, E. DOMAR publie à son tour, quelques articles présentant les mêmes orientations et les mêmes préoccupations que R. HARROD. Tous ces travaux tournent autour des conditions de la reproduction, de la croissance et dans une optique keynésienne. Dans cette direction d’ailleurs, HARROD observe que « la seule remarque critique que je me hasarderais à faire, c’est que le système de KEYNES est encore statique. D’ailleurs poursuit-il, la théorie macroéconomique statique est un fondement indispensable à l’élaboration de toute théorie dynamique ». 119 Le problème théorique que soulève la dynamisation du système keynésien, réside dans le fait que KEYNES a toujours traité l’investissement comme un simple instrument de création du revenu (effet multiplicateur) en ignorant les effets sur les capacités productives. Or, il n’existe pas d’investissements courants sans accumulation de capital, c’est-à-dire un accroissement de la capacité productive. Il s’agit de considérer le double aspect de l’investissement d’abord en tant que facteur générateur de revenu et ensuite en tant que facteur créateur de capacité productive. L’équilibre dynamique qui s’établit sera caractérisé par l’accroissement simultané des revenus et des capacités de production. Les post-keynésiens s’attèleront à l’étude des conditions d’avènement d’un équilibre dynamique. Ces travaux vont permettre l’élaboration d’instruments conceptuels nécessaires pour l’analyse du processus du développement économique et social. Étudions de plus près le modèle de croissance de HARROD. 1°) La relation du modèle La croissance est définie en termes de revenu ou de produit. Le taux Y d’accroissement s’écrit : G Y La production d’un niveau accru de produit requiert un investissement nouveau net (1). Or, l’investissement dans l’équipement en capital nécessaire à I l’accroissement du produit d’une unité s’écrit : C Y Où C est le capital output ratio ou encore le coefficient du capital. Étant donné la propension moyenne de la communauté à épargner, un S niveau donné de produit sera associé à un volume donné d’épargne : s Y Il est alors possible de définir la relation : G C s que HARROD qualifie de S fondamentale et qui reflète G , le mariage du principe de l’accélérateur et du C multiplicateur. 2°) Les variables du modèle Le Capital recouvre non seulement les biens capitaux mais aussi les biens de toute sorte produits par le système. Pour le taux de croissance (G) ne différencie pas les différents secteurs de production. Enfin, l’épargne est la fraction non consommée du revenu. Dans son analyse, HARROD distingue trois (03) taux de croissance : Ga = le taux réel observé de croissance réalisé par l’économie, Gn = le taux naturel de croissance qui constitue le taux le plus élevé d’accroissement soutenu du produit. Il est limité par l’accroissement de l’offre de main-d’œuvre et le progrès technique, Gw = le taux garanti de croissance. C’est le taux d’accroissement qui satisfait les opérateurs économiques. Des différences fondamentales existent entre ces trois (03) taux et c’est à partir de ces différences que HARROD appréhende les mouvements possibles d’un système dynamique. Ainsi, 120 Ga dépend du comportement réel de l’investissement et du produit, Gn est le taux d’équilibre compatible avec l’offre de main-d’œuvre et le progrès technique, Gw est le taux compatible avec l’épargne de la communauté. Ainsi, on peut réécrire l’équation fondamentale comme suit : S Ga C S Gw C Gw Ga s Cependant, ces trois (03) formes de l’équation fondamentale n’ont pas à s’égaliser à un moment donné, si deux (02) d’entre elles peuvent être égales, elles ne le seront pas à la troisième. 3°) Le fonctionnement du modèle De son modèle, HARROD déduit qu’il existe deux (02) sources potentielles de déséquilibre ou d’incompatibilité : l’inégalité entre les taux réels et garanti de croissance ; l’inégalité entre les taux naturels et garanti de croissance. Ainsi, lorsque le taux garanti assurant la satisfaction des entrepreneurs est plus petit que le taux naturel Gw Gn assurant la satisfaction de tous les producteurs, l’économie traverse une phase d’essor et celui-ci est d’autant plus accentué que l’écart est plus grand. À l’inverse, l’économie traversera une dépression. Au total, dans le modèle, l’épargne joue apparemment un rôle primordial. Ce qui explique que des évaluations rapides mais fausses ont voulu rattacher HARROD aux néo-classiques. En effet, on constate que pour HARROD, une valeur élevée de (s) joue le rôle exactement contraire à celui qu’elle joue dans le modèle néo-classique. Pour lui, loin de permettre un taux élevé de croissance, elle constitue un obstacle à cette dernière. Par ailleurs, HARROD a toujours refusé de lier le taux d’intérêt au capital output ratio, comme le voulaient les néo-classiques. Pour lui, le taux d’intérêt n’est qu’un phénomène monétaire et nulle part, il n’essaie d’introduire le concept de fonction de production, où même d’égaliser taux d’intérêt et taux de profit. Tel est l’essentiel de l’articulation de l’analyse d’HARROD qui cherche à donner une base objective à une politique de croissance correspondant aux forces réelles d’une économie. II/ Les autres modèles de croissance des autres néo-keynésiens La problématique de la croissance et du développement se retrouve chez d’autres néo-keynésiens comme KALECKI, HICKS, Mrs Joan RONINSON et Nicolas KALDOR. Ces deux derniers auteurs ont marqué les théories actuelles et méritent que l’on s’y arrête. 1°) Les analyses de Joan ROBINSON Le défi dynamique de HARROD devant être relevé par J ROBINSON, préoccupé par la croissance à long terme et dont le point de départ est constitué par 121 une rigoureuse analyse critique de la pensée néo-classique. Le système de J. ROBINSON présente une analyse de l’accumulation de longue période. Les aspects essentiels du système peuvent être ramenés : aux flux des revenus, à la détermination du taux de profit, aux conditions d’une croissance régulière, au rôle du progrès technique, à l’effet de la consommation des réntiers sur l’accumulation, au produit marginal du capital et au produit marginal de l’investissement. Sur cette base, l’auteur étudie quelle est la relation entre le taux de croissance de la production et la croissance du stock du capital dans le temps ? Dans tout système économique en expansion, le taux d’accumulation maximum possible est limité par le taux d’accroissement de la force du travail et le taux auquel le progrès technique accroît la productivité par homme. Pour J. ROBINSON, une économie qui se développe à ce taux maximum possible avec un taux de profit constant est à l’âge d’or. J. ROBINSON rejette l’optique néo-classique car cette dernière n’a jamais pu définir un taux de profit en dehors du produit marginal du capital. Pour elle, la quantité de capital n’a aucun sens si le taux de profit n’est pas préalablement déterminé, d’où le rejet de toute théorie qui tenterait de déduire le taux de profit de la quantité de capital. Au total, dans l’analyse de J. ROBINSON, le caractère "dual" de la relation entre le taux de profit et le taux de croissance est particulièrement mis en évidence. Cependant, elle montre qu’il existe une relation double entre le taux de profit et le taux d’investissement, de sorte que ce dernier est le déterminant majeur du premier mais le taux de profit affecte aussi l’investissement à travers les anticipations. 2°) Les approches de Nicolas KALDOR N. KALDOR se propose d’élaborer une théorie dynamique de la production (1959) avec une méthode keynésienne et dans la lignée de RICARDO et MARX. Il débute son analyse avec un modèle de type HARROD exprimé en termes 1 d’accroissement du capital physique : G K (S = épargne ; V = ratio du stock de V capital). Seulement, KALDOR diverge avec HARROD car il suppose que toutes les épargnes sont égales aux profits globaux. Ce qui suppose que les salariés n’épargnent pas et que les titulaires de profits ne consomment pas. KALDOR obtient les résultats suivants : P S Y P I GK Y Y P K GK Y Y P P Y K Y K P GK K 122 La dernière équation indique que le taux explicite de profit du capital, P K est égal au taux de croissance du capital. L’objectif de KALDOR est d’élaborer un modèle permettant de promouvoir un équilibre de croissance régulier qui peut être défini comme un modèle où "le taux d’accroissement du produit par tête est égal au taux d’accroissement de la productivité de l’équipement, les deux étant en outre égaux au taux d’accroissement de l’investissement (fixe) par travailleur et au taux de croissance des salaires". Comme le note l’auteur, le modèle est keynésien dans son mode de fonctionnement, c’est-à-dire que les décisions de dépense des entrepreneurs sont l’élément premier, les revenus sont secondaires. Il n’est absolument pas néo-classique car les facteurs technologiques (productivités marginales ou ratio marginal de substitution) ne jouent aucun rôle dans la détermination des salaires et des profits. Une fonction de production au sens d’une relation de valeur entre le capital et le travail n’existe pas. En conclusion, si nous avons insisté sur les analyses keynésiennes et néokeynésiennes, c’est parce qu’elles inspirent les politiques de développement, de même que les politiques de croissance. Elles ont particulièrement tenté d’abord, de donner une traduction simple mais totale de la dynamique de croissance et ensuite, de dégager les bases d’une politique effective de croissance optimale. Elles ont insisté sur l’investissement autonome considéré comme variable stratégique de la croissance. Elles ont initié une série de recherches sur le coefficient du capital, forme transformé du multiplicateur. Enfin, l’ensemble des concepts keynésiens converge vers la confection de modèles dont certains, sous une forme mathématique très élaborée. Ces modèles finissent par devenir des sortes de représentation schématiques des principales variables qui président au dynamisme de la croissance. III/ Mise à mort et réhabilitation du keynésianisme Le keynésianisme a été mis en berne durant toute la période ascendante des approches libérales néo-classiques. Critiqué et presque marginalisé par la pensée orthodoxe, il a été pendant une période fortement remis en cause. La synthèse néoclassique, comme nous l’analyserons, était construite autour de convictions fortes : les marchés des biens et du travail sont concurrentiels, il n’éxiste pas d’externalités, l’information est parfaite, l’Etat doit s’abstenir d’intervenir dans le circuit économique. Parallèlement, les politiques économques construites à partir de la vulgate keynésienne simple sont vigoureusement rejetées dans les années 70 car jugées incapables de résoudre la nouvelle crise économique et financière : inflation, chômage, déficits internes et externes, faible croissance économique Aujourd’hui, on observe un retour du keynésianisme avec une nouvelle génération de théoriciens qui reconstruisent d’une architecture inspirée du Maître: G. MANKIV, G.AKERLOFF, J.STIGLITZ, S. FISHER D.ROMER, E. PHELPS… Ces auteurs ont souvent été appelés « les poissons de mer »66 par opposition « aux poissons d’eau douce » Ils conservent les principes de base du keynésianisme comme l’imperfection des marchés et l’intervention de l’Etat. Les cycles économiques réels observe G.MANKIV, représentent des imperfections de marché. Comme par ailleurs, l’Etat est le pilote de La dénomination fait référence à la localisation géographique de leurs Universités d’attache, Boston et Colombia situées en bordure de mer alors que l’autre courant tenant de l’orthodoxie sont dans des Universités des Grands Lacs comme Chicago. 66 123 la machine économique et doit intervenir pour réamorcer la pompe de la consommation ou de la production. » (G.MANKIV).itué la ligne de démarcation et de rupture. 124 CHAPITRE 7 : L’ANALYSE NÉO-CLASSIQUE : LES NOUVEAUX FONDAMENTAUX DU LIBÉRALISME ET DU LIBRE ÉCHANGE. L’analyse néo-classique est celle sur laquelle on commet les plus graves erreurs d’interprétation, de délimitation, de caractérisation et de composition67. Globalement cette Ecole de pensée regroupe les économistes, inspirés à la fois par l’École Classique et l’analyse keynésienne, conçoivent la société comme un ensemble d’individus libres et égaux, raisonnent au niveau micro-économique à partir d’hypothèses sur le comportement des agents à la fois rationnels et calculateurs cherchant à maximiser leur utilité (consommateur) ou leur profit (producteur) sous la contrainte de leurs ressources. Ces agents comme producteurs ou consommateurs évoluent sur des marchés de concurrence pure et parfaite. Beaucoup d’analystes s’autorisent à parler de l’École néo-classique souvent assimilée au libéralisme, sans jamais prendre la précaution de préciser les contenus des idées et les figures de proue qui forment ce courant de pensée présenté comme dominant dans la science économique68. Elle est diversement appelée théorie standard, orthodoxie ou maître-pilier du libéralisme. Toutefois, des défauts de précision sont à la base soit d’une trop grande réduction qui ne se référent qu’aux pionniers A. MARSHALL, PIGOU, CARL MENGER, STANLEY JEVONS, WALRAS ou d’une trop grande extension en incluant tous les auteurs qui ont constitué la synthèse contemporaine, de MILTON FRIEDMAN, HAYEK, jusqu’aux théoriciens de la croissance endogène LUCAS et ROMER en passant par Solow et la figure de proue du « néolibéralisme » Milton Friedman qui poursuivra les travaux de l'École néoclassique, en inversant les objectifs de l'interventionnisme monétaire. Le credo fondateur du courant d’analyse néoclassique est parti de trois auteurs STANLEY JEVONS, Carl MENGER ET LEON WALRAS successivement bâtisseurs de l’École de Cambridge, de Vienne et de Lausanne. Ils avaient déclenché entre 1871 et 1874 sans jamais s’être rencontrés, ni échangé aucun élément de leurs recherches respectives la révolution marginaliste d’où émergera l'économie néoclassique qui s'impose aujourd’hui comme théorie économique dominante. Ce trio se proposait surtout de faire table rase du passé afin de reconstruire la science économique sur des bases nouvelles. Toutefois, l'histoire révèle que dans leurs analyses, les éléments de continuité l’emportent sur ceux de la rupture. C'est pourquoi d'ailleurs, Veblen fondateur de l'institutionnalisme, a forgé l'expression néoclassique pour dire que la rupture avec les classiques n’est pas aussi nette qu’on le laisse croire. Pourquoi cette pensée a-t-elle eu un tel rayonnement et joue-elle, aujourd’hui un rôle aussi déterminant ? Est-ce par la robustesse de ses analyses ou la pertinence de ses propositions de politique économique ? Ou alors cela procède-t-il de sa force de persuasion, de légitimation des politiques économiques libérales? En fait, leur principal ajout à l’analyse classique procède d’une part de leur approche plus formalisée (avec l’utilisation des techniques quantitatives) et systématique en termes de marché et d'équilibre et d’autre part de la généralisation du raisonnement marginaliste. À l’origine, les auteurs néo-classiques avaient repris les principales B. Guerrien : L’économie néo-classique, Col. Repères, La Découverte, 1991, Du même auteur : La théorie néo-classique. Bilan et perspective du modèle d’équilibre général. Économica, 1989 68 Cette École est qualifiée de gardienne de l’orthodoxie en sciences économiques, de constructeur du modèle standard de l’analyse économique et d’inspiratrice de la pensée unique 67 125 idées de l’École Classique notamment leur approche formalisée et systématique en termes d’économie de marché, d'équilibre global, d’intervention minimale de l'État, de neutralité de la monnaie et de libre concurrence. « Ainsi, on trouve dans la théorie néo-classique la conviction du caractère universel des lois économiques. Jevons, Menger ainsi que leurs successeurs actuels affirment plus nettement la similitude entre l'économie et les sciences naturelles, ce qui se traduit par l'utilisation de plus en plus intensive - et parfois exclusive - du langage mathématique. Walras estime même que l'économie politique pure doit devenir une branche des mathématiques. Cette conviction n'est toutefois pas partagée par Menger qui, en dépit de son libéralisme radical, se positionne comme hétérodoxe sur l'échiquier de la pensée économique moderne »69. Ce positionnement théorique les avaient amené à rejeter en bloc les théories marxistes et à opérer un examen critique de l’analyse keynésienne dont ils proposent une modernisation de l’appareillage théorique dans le but de lui permettre de mieux cerner les nouveaux problèmes macroéconomiques et surtout de corriger les insuffisances qui sont à l’origine des mauvais résultats des politiques économiques. La pensée néo-classique est loin d’être homogène. Ces tenants de la nouvelle orthodoxie constituent une galaxie d’auteurs et de courants qui se présente comme suit : 1) Les précurseurs : Étienne de Condillac(17151780) Antoine Augustin Cournot (1801-1877) Hermann Heinrich Gossen (1811Arsène Dupuit (1804-1866) 1858) 2) Les fondateurs : la révolution marginaliste : L'école de Lausanne L'école anglaise (Équilibre général) (Cambridge) Léon Walras (1834 1910) S. Jevons (1835-1882) Vilfredo Pareto (1848- A.Marshall (1842-1924) 1923) A. C.Pigou (1877-1959) L'école autrichienne (Vienne) Carl Menger (1840-1921) F.V. Wieser (1851-1926) E. Böhm Bawerk (18501914) 3) Les courants néo-classiques contemporains : Le courant de l'équilibre La synthèse keynéso- La nouvelle général classique classique Robert Lucas John Hicks (1904-1989) Paul Samuelson (né 1915) 1937) Kenneth Arrow (né 1921) Robert.M.Solow (né 1924) Gérard Debreu (né 1921) Maurice Allais (né 1911) école (né en Cette diversité des auteurs et des analyses rend l’exposé plus difficile du fait de l’absence de points de vue consensuels sur les grandes questions de théorie économique. L’objectif de ce chapitre est de présenter sommairement, au moins, les 69 Gilles DOSTALER : « Orthodoxie et hétérodoxie : une vieille histoire », Alternatives Économiques, Hors-série 57, 2003 126 principaux points d’accord : les principales hypothèses du modèle d’analyse et les approches proposées pour le développement et la croissance, deux cibles majeures pour les pays sous-développés. Section 1 : Les fondements théoriques de l’analyse néoclassique. Les néoclassiques sont les héritiers critiques des classiques. Ils se focalisent surtout sur l’analyse marginaliste et cherchent à fonder l’analyse économique sur de nouvelles hypothèses : la rationalité économique, l’individualisme méthodologique et la supériorité du modèle du marché qu'il soit pur et parfait, ou imparfait et dont les mécanismes jouent un rôle régulateur conduisant à un équilibre optimal de l’ensemble du système économique. Le soubassement théorique, à la différence des classiques et de Marx, se fonde sur une analyse des comportements individuels à partir des présupposés de l’individualisme méthodologique. L’individu est identifié par une fonction dont les paramètres sont ses préférences, ses dotations en compétences et en capital et moyennant quoi, il maximise sa satisfaction. Avec de nouveaux instruments mathématiques, les théoriciens néoclassiques formalisent le processus d'interaction sur les marchés des agents économiques qui cherchent toujours à optimiser leurs gains, qu’ils soient producteurs ou consommateurs. Dans une optique marginaliste, la théorie de la productivité marginale devient l’un des principaux fondements théoriques de la pensée néo-classique70. Cette démarche explique que dans une situation donnée la rémunération des facteurs de production s’effectue à partir du principe unique de leur productivité marginale. Cependant, la fonction de production est elle-même l’élément le plus simple mais aussi le plus essentiel de la théorie de productivité marginale. Pour un état donné des techniques de production, la fonction de production peut être comprise comme dérivant des diverses combinaisons productives. En effet, en supposant qu’il existe une certaine relation quantitative entre le volume du revenu national (ou du produit) et le volume des ressources en travail et en capital utilisées, il est possible d’estimer, sous certaines conditions raisonnables, cette relation sous la forme d’une fonction de production et de recourir à un appareil mathématique approprié d’analyse fonctionnelle pour quantifier certaines interrelations de la production. Ainsi, on peut écrire que : f ( K , L, N ) (où Y = produit, K = le capital, L = le travail, N = terre). On suppose que chacun des facteurs de production (K, L, N) est capable de se diviser infiniment. En différenciant, on obtient : Y Y Y dY dK dL dN K L N où dY = accroissement de la production dK = accroissement du capital dL = accroissement du travail Y = produit marginal du capital K Y = produit marginal du travail L OY = produit marginal de la terre L 70 Carlo BENETTI : Valeur et Répartition, François Maspero 127 Ainsi, la valeur de la production est déterminée comme la somme des produits de la grandeur de chacun des facteurs de production et de son produit marginal. Quant à la part de chacun des facteurs, elle est déterminée fonctionnellement une fois l’équilibre réalisé et qui coïncide avec le plein emploi. On peut faire alors les déductions suivantes : si l’offre globale de capital s’accroît plus rapidement que l’offre de la main-d’œuvre, le prix d’offre du capital tendra à baisser, la densité du capital augmentera ; ce qui correspond à une baisse de la productivité marginale du capital. Un raisonnement inverse peut être établi pour le travail, donc quelle que soit la situation de l’offre de main d’œuvre, toutes les personnes désirant travailler peuvent trouver un emploi, pour peu qu’elles acceptent le salaire prévalent sur le marché. Ces analyses extrêmement éloignées de celles de KEYNES et des néo-Keynes et des néokeynésiens. Par ailleurs, la densité du capital dépendant des prix relatifs du travail et du capital, le prix du capital résulte de l’équilibre qui s’établit entre l’offre d’épargne et la demande de capital. Cela correspond en fait au taux d’intérêt. Seulement, hormis l’intérêt, représentant la rémunération du capital, il n’existe pas dans une économie d’équilibre au sens de WALRAS, de profit. Ce dernier dans la pensée néoclassique se trouve exclu du système d’équilibre général et ramène à la théorie du taux de l’intérêt. On peut le montrer en prenant : (1) Y f ( K , L) et considérant Py, Pk, Pl, les prix du produit et des facteurs, nous pouvons écrire l’équation comptable suivante : Prix de vente = Coût de production, c’est-à-dire (2) Py Y Pk K Pl L Le minimum du coût de production est obtenu par différenciation de ces deux équations, soit : Y Pk Y PL (3) et K Py L Py En remplaçant les prix dans l’équation (2), on obtient : Y Y K L (4) Y K L Au bout du compte, l’utilisation des fonctions de production a stimulé tout un ensemble de recherches consacrées à l’estimation quantitative du rôle exercé par les divers facteurs de production pour garantir le niveau potentiellement possible du revenu national, ou du produit, ainsi que de leur taux de croissance. C’est pourquoi, lorsque l’on évalue les fondements théoriques de la fonction de production néoclassique, il faut en même temps comprendre les interrelations techno-économiques réelles et les processus de la croissance qui peuvent être analysés à l’aide des fonctions de productions dites d’ingénierie. Dans les années 50 et 60 on va observer un processus qui a pris le nom de « renaissance néo-classique » et au cours duquel les théoriciens de l’école ont proposé une modernisation notable de leur appareil théorique et analytique dans le but d’étudier de nouveaux problèmes macro-économiques, en particulier là où le keynésianisme avait commis de notables erreurs théoriques qui sont à l’origine de mauvais résultats de politique économique. Dans leur synthèse, les auteurs de la renaissance néo-classique montrent que, malgré leurs divergences de points de vue, ils vont tenter d’élaborer une théorie économique pure dans la tradition walrasienne, c’est-à-dire un "corpus"" théorique constitué de concepts explicatifs des aspects les plus caractéristiques du fonctionnement de l'économie capitaliste. 128 Sous ce rapport, la pensée dite néo-classique est tout à la fois une idéologie, une vision du monde, un ensemble de politiques et une collection de théories qui ne sont pas nécessairement cohérentes les unes avec les autres” (DOSTALER, 2001, p. 107) mais qui sont unies autour de l’économique définie par un champ sémantique où s’articulent la rareté, le besoin, les fins, les moyens. Dans ce contexte, la Science Économique aurait pour objet principal la détermination des lois de l’allocation optimale des moyens rares à usage alternatif. L’équilibre du producteur comme celui du consommateur se constitue sur le postulat de base d’une psychologie hédonistique à partir duquel on passe à une théorie générale des prix de marché qui englobe finalement l’investissement (allocation optimale des capitaux) et le salaire (allocation optimale du facteur travail). Qu’est ce qui fonde la prééminence de la pensée néo-classique dans la science économique contemporaine ? Est-ce sa cohérence théorique, la robustesse de ses formulations, sa capacité d’illustrer et de défendre l’économie de marché, de justifier l’économie libérale? Toutes ces questions renvoient à la confrontation entre les tenants de l’orthodoxie et ceux de l’hétérodoxie, aux forces et faiblesses des deux courants qui dominent la pensée économique contemporaine bien qu’aucun de ces deux courants ne présente véritablement une parfaite homogénéité des formulations théoriques, doctrinale et méthodologiques. Quelle analyse du développement soutiennent et défendent les auteurs de la pensée néo-classique ? Section 2 : L’analyse néo-classique et le développement : comment faire une croissance durable ? La plupart des discours se réclamant de la théorie néo-classique mettent au centre de leur préoccupation en matière de développement la question de la croissance économique. Autant les classiques se demandaient comment faire pour amorcer la croissance, la problématique des néo-classique est de savoir « comment faire pour que la croissance dure ? ». Cette problématique ressemble fort à celle que pose J.M. KEYNES. Au-delà de l’interprétation de la théorie keynésienne comme une « théorie de l’équilibre de sous-emploi », comme un cas particulier de l’équilibre général du système économique, les problèmes soulevés par la théorie néo-classique de la croissance, sont identiques à ceux que KEYNES a tenté des résoudre à savoir la croissance potentielle du revenu national à long terme, les conditions de l’équilibre dynamique et la question de l’adaptation de l’économie. Les néo-classiques, vont finalement inclure le keynésianisme en le modifiant, en l’élargissant et en le modernisant. Cette identité des problèmes montre à souhait que l’apparition de la théorie néo-classique de la croissance a été dans une certaine mesure fortement influencée par le keynésianisme, plus précisément encore, elle s’est développée à partir de la critique, en particulier des aspects technico-économiques du processus de la croissance conçu par J.M.KEYNES. Le point de départ des auteurs néo-classiques, est formé par la trame des idées développées par les auteurs classiques : supériorité de l'économie de marché, bienfaits de la libre concurrence (sous certaines conditions), non intervention de l'État, libre circulation des marchandises (pas de protectionnisme), concurrence pure et parfaite. Cette double filiation (entre Classiques et Keynes) fait que les auteurs néoclassiques retiennent (de leurs devanciers), en matière de développement 129 économique, trois volets essentiels à partir desquels, ils échafaudent leurs modèles d’analyse et d’action: l’accumulation du capital fondement des modèles de croissance économique les plus réputés de l’École (celui de SOLOW, de SWAN, et MEADE.) Le modèle des échanges internationaux basé sur la théorie ricardienne des coûts comparatifs prolongée et approfondie par J.VINER, HABERLER, HECKSHER-OHLIN La promotion de l’économie du marché et la non intervention de l’État. La politique monétaire Le premier volet de la théorie néo-classique du développement se formule en termes de croissance économique qui est fonction de l’articulation des deux facteurs déterminants que sont le travail et le capital. Or, l’accroissement de la productivité du travail qui se traduit par une hausse du salaire réel résulte du processus d’accumulation du capital dont le rythme dépend à son tour du prix du capital ou prix d’offre de l’épargne. L’accumulation du capital, en induisant une élévation des salaires réels renforce la participation des salariés au produit, et partant, réduit le taux moyen de rentabilité du capital. Donc les idées du profit d’accumulation, de développement sont étrangères au modèle néo-classique. Elles n’apparaissent dans le modèle que lorsque l’on s’écarte de l’équilibre. En ce point, la rémunération du capital doit être égale dans toutes ses applications ; ce qui correspond au taux d’intérêt. Si des profits apparaissent, c’est que la rémunération du capital dans le secteur est supérieure à la rémunération moyenne d’équilibre. Le modèle apparaît ainsi à la fois comme une théorie de la production et de la répartition de la valeur ce qui le différencie de la théorie marxiste de l’exploitation car, ici, chacun des facteurs de production est un participant autonome à la création de la valeur et, de ce fait un partenaire égal dans son partage. Les principales conclusions de cette analyse sont que la croissance s’explique faiblement par la croissance des facteurs. Le facteur explicatif essentiel serait le progrès technique mais ce n’est là qu’un mot que l’on s’est efforcé de préciser en le décomposant en progrès technique autonome (les innovations), en progrès technique incorporé dans le facteur capital (perfectionnement des nouvelles machines), en progrès technique incorporé dans le facteur travail (capital humain et accroissement de la formation et de l’éducation : learning by doing). Il serait intéressant de voir cette analyse néo-classique à travers trois (03) modèles : de SOLOW, DE T.W.SWAN et J. MEADE ; Il est vrai qu’il existe bien d’autres modèles mais ceux-ci sont les plus caractéristiques et inspirent plus les politiques de croissance. Pour ce qui concerne R. SOLOW71 et W. SWAN, leur modèle se fonde sur les hypothèses de base de la fonction production néo-classique en tant que modèle de croissance économique. Les thèses fondamentales en sont les suivantes : Il est retenu deux facteurs de production-le travail et le capital- de même caractère fabriquant un produit de même nature. En somme, le bien composite unique est produit par du travail et du capital De plus, le travail augmente à des rythmes constants. Avec la libre concurrence, la rémunération des facteurs de production correspond à leurs produits marginaux, c’est-à-dire que le salaire est égal 71 Théorie du capital et taux de rendement. 130 au produit marginal du travail, le profit (intérêt) est égal au produit marginal du capital. C’est pourquoi, la répartition du revenu exprime en même temps l’apport productif de chacun des facteurs dans le coût de production. La libre concurrence, la libre substituabilité du travail et du capital, ainsi que la libre variation de la rémunération des facteurs de production conformément à la dynamique du travail et du capital, garantissent le plein –emploi de toutes les ressources. Toute la partie non consommée du produit, c’est-à-dire l’épargne est investie c’est-à-dire que le problème de la demande n’existe pas L’élargissement de la production n’influe pas sur l’augmentation de l’efficacité ; la productivité des facteurs décroît, les conditions de production restant les mêmes Le progrès technique a un caractère neutre, autonome, il s’élève dans une égale mesure l’efficacité de tous les facteurs de production. Le modèle est une parfaite illustration du thème commun à A. SMITH, S. MILL et A. LEWIS, à savoir la connexion entre l’accumulation du capital et la croissance de la force de travail productive. Concernant le modèle de J. MEADE, il porte sur la recherche de l’équilibre dynamique et, l’aspect néo-classique de son modèle réside dans le fait qu’il utilise les hypothèses de concurrence pure et parfaite dans une analyse de productivité marginale d’équilibre général, afin de déterminer les prix relatifs des facteurs de production. Dans cette optique les conditions de stabilité du taux de croissance sont les suivantes : l’élasticité de substitution doit être égale à 1 ; le progrès technique est neutre par rapport à tous les facteurs ; la part des épargnes prélevée sur le revenu des trois facteurs est une grandeur constante. Dans ces conditions en supposant constant les taux de croissance démographique et de progrès technique, le taux de croissance de la production globale tendra toujours vers un niveau constant donné représentant la croissance économique équilibrée. Ces modèles expliquent le niveau éventuel de la production mais ils ne disent rien sur les conditions de sa réalisation. C’est pourquoi ils sont sévèrement critiqués particulièrement par les marxistes, les néo-ricardiens et les tenants de l’analyse hétérodoxe72. En définitive, la conception de la régulation de l’économie s’est forgée dans le creuset de la discussion relative aux facteurs qui déterminent en dernière analyse les rythmes du développement économique dans une situation concrète donnée : les conditions de la réalisation, c’est-à-dire la demande, ou bien les conditions de la production, donc l’offre de ressources économiques. La discussion qui a été soulevée à ce sujet opposait keynésiens et néo-classiques. Les premiers voient les causes de la rupture de l’équilibre dynamique, tant à court terme qu’à long terme, du côté de la demande, dans son excès ou son insuffisance alors que les seconds accordent une importance primordiale aux facteurs qui se rattachaient à la production et à l’offre de ressources, au rapport coût-prix, à la combinaison optimale des ressources, à l’efficacité de la production, c'est-à-dire à tout ce qui détermine le potentiel économique Voir sur ce point, l’excellente réflexion de R. E. ROWTHORN : Neo-Classical Economics and its critics a marxisview et de Carlo BENETTI : Valeur et Répartition .Presses Universitaires de Grenoble 1974 72 131 Le deuxième volet de l’analyse néo-classique concerne le modèle des échanges internationaux selon lequel le libre-échange est la clef pour une organisation efficace de la production mondiale. L’analyse ricardienne avait établi, depuis 1817, que l’existence des écarts de coûts relatifs de production entre pays, doit pousser à la spécialisation et à l’ouverture l’échange international. En effet, chaque pays dispose d’un avantage relatif (ou comparatif) même les plus pauvres qui ont de faibles productivités globales de leurs facteurs de production. Ils ont intérêt à se spécialiser dans les secteurs où ils sont relativement moins désavantagés) et à s’ouvrir au commerce international. Le fondement de cette analyse du modèle néo-classique de l’échange international est l’approche élaborée par HECKSCHER-OHLINSAMUELSON selon laquelle chaque pays doit se spécialiser dans la production des biens pour lesquels il dispose de meilleures dotations factorielles. (facteurs abondants et donc peu coûteux). Enfin le troisième volet est relatif au mode de régulation du système économique. Globalement les néo-classiques accordent une confiance absolue aux mécanismes du marché qui ont une force régulatrice supérieure à condition de garantir la libre concurrence. L’État, compte tenu de ses dépenses grandissantes, est un facteur de déstabilisation. Toutes leurs constructions théoriques néo-classiques visent à démontrer que la stabilité de la croissance peut être garantie non pas, comme l’estimait Keynes et ses successeurs, par une activité compensatoire de l’État avec ses dépenses inflationnistes, mais par la politique monétaire et de crédit de la Banque centrale. En effet, en opposition aux formulations keynésiennes, le courant monétariste conduit particulièrement par M.FRIEDMAN73 dans les années 50. se base sur les capacités autorégulatrices des marchés. La manipulation de la demande effective par l’État ne peut qu’entraîner l’inflation. Dès lors, la politique économique doit limiter les dépenses publiques et contrôler l’expansion de la masse monétaire génératrice d’une inflation toujours ruineuse pour l’activité économique. La théorie néoclassique ne permet pas encore l’élaboration d’une politique économique cohérente et complète qui ne suscite de vives controverses entre les divers courants qui la composent. En ne prenant en compte que les relations techniques, elle a totalement oublié des aspects déterminants de la politique économique qui est en définitive une interaction de nombreux facteurs. 73 Friedman : “A theorical framework for monetary analysis”, Journal of Political Economy n°2, 1970 132 CHAPITRE 8 LES THÉORIES STRUCTURALISTES ET INSTITUTIONNALISTES DU DÉVELOPPEMENT ET DU SOUS-DÉVELOPPEMENT : APPROCHES TIERS-MONDISTES ET ANALYSES NÉO- MARXISTES. Le progrès que représente pour l’analyse du sousdéveloppement la démarche historique par rapport à la présentation fonctionnelle est évident. Si le développement est un scandale historique, un phénomène exceptionnel étroitement limité, le sousdéveloppement doit lui aussi, être analysé dans l’histoire. L’erreur serait de ne pas pousser plus loin la réflexion et de faire du sousdéveloppement l’état commun de toutes les économies qui n’ont pas connu la mutation révolutionnaire que constituent le décollage ou l’industrialisation. J. FREYSSINET74 Dans un article introductif aux Cahiers de l’ISEA consacrés spécialement au sous-développement, F. PERROUX propose trois outils d’analyse du sousdéveloppement: la domination, la désarticulation et la non-couverture des coûts de l’homme. Ces outils prennent racine dans une approche selon laquelle le sousdéveloppement n’est ni une étape naturelle ou une manifestation originale et spécifique, ni un phénomène conjoncturel, ni un retard de développement encore moins une étape dans une ligne d’évolution historique. Il est le produit de l’histoire de pays insérés dans la division internationale capitaliste du travail qui a façonné toutes leurs structures économiques, politiques, institutionnelles et sociales. L’un des premiers apports de cette approche est alors une perception plus lucide du rôle de l’histoire économique dans la compréhension et surtout de l’importance des facteurs « non-économiques » dans le fonctionnement et la transformation des systèmes économiques, comme celle du degré d’information des agents responsables des décisions économiques. Une meilleure connaissance des structures permet d’établir toute l’importance du non-économique dans les chaînes de décision qui entraînent la transformation des ensembles économiques complexes comme le sous-développement. Ce dernier se caractérisant alors par la particularité des structures de pays dominés dont la croissance pour cette raison est vouée au blocage. Il devient dès lors l’alternative radicale à la théorie de la croissance transmise et soulève des questions relativement à son origine et son essence profonde. Dans les années 50, la plupart des économistes notamment ceux d’Amérique Latine regroupés au sien du CEPAL ont tenté de répondre à ces questions dans le cadre de leur recherche d’un projet national de développement. Des auteurs comme R. PREBISCH, H.SINGER, SUNKEL, C. FURTADO et André GUNDER FRANK, Ruy Mauro MARINI, Fernando H. CARDOSO, Vania BAMBIRRA, Osvaldo SUNKEL, et T.DOS SANTOS, les plus éminents chercheurs de cette époque avaient émis le point de vue que le sous-développement était un processus historique spécifique, demandant un effort de théorisation autonome. Ces réflexions sur ce cadre historique seront à la base de la « théorie du sous-développement ». En effet, selon FURTADO « le sous-développement n'est pas une étape par laquelle sont nécessairement passées les économies les plus avancées. C'est une situation 74 J. FREYSSINET : Le concept de sous-développement p173 133 particulière, conséquence de l'expansion de ces économies les plus riches, qui cherchent à utiliser les ressources naturelles et la main-d'œuvre des zones d'économie pré-capitaliste ».75 Ainsi, C. FURTADO met en évidence que la théorisation de la croissance doit tenir compte des facteurs psychologiques ou sociaux qui influent sur le développement d’une communauté. La simple quantification des variables s’avère insuffisante pour expliquer la praxis des agents productifs car la "prévision économique doit se contenter par obligation d’établir un champ de possibilités" et le profit que l’homme peut tirer d’un horizon d’action plus ample, seule l’histoire sociale peut l’expliquer. Lorsque C. FURTADO s’attache à délimiter l’objet théorique du structuralisme, il cite expressément F. PERROUX pour souligner ce que l’on doit comprendre par « structure » : «proportions et relations qui caractérisent un ensemble économique localisé dans le temps et l’espace». En effet, F. PERROUX avance « Les trois outils d’analyse du sous-développement » qui sont, en fait, des réponses articulées à ces questions : le sous-développement est le produit de la domination (influence asymétrique et irréversible) exercée par des puissances extérieures sur les pays périphériques. Cette domination qui fut une agression économique véritable a entrainé la destruction de l’équilibre ancien des économies et s’est traduite par une déstructuration, une désarticulation des structures qui se manifeste concrètement non pas dans les termes ambigus d’un chiffre unique, fut-il le PNB par tête, mais dans un phénomène à la fois beaucoup plus profond et beaucoup plus complexe : la « noncouverture des coûts de l’homme ». Ces trois concepts foyers (la domination, la désarticulation et la non-couverture des coûts de l’homme se retrouvent dans toutes les réflexions des auteurs qui se réclament du structuralisme avec par moment des formulations, des méthodes d’approche, des référentiels théoriques différents. Toutefois, C. FURTADO va plus loin que PERROUX dans ses analyses théoriques. D’abord, il démonte avec rigueur les modèles économiques comme “ahistoriques”, “statiques” et “abstraits”. Certains auteurs ont tenté de construire des modèles pour leur insuffler une “dynamique” ou d’introduire, d’une manière ou d’une autre, le temps (axe diachronique) dans leurs postulats théoriques mais sans grands résultats. Ensuite, C. FURTADO se démarque clairement en observant que le « structuralisme économique » latino-américain n’a rien à voir avec “l’école structuraliste française”. Car ce que l’on entend par pensée « structuraliste » en économie n’a pas de lien direct avec l’école structuraliste française dont l’idée générale a été de souligner l’importance de l’axe des synchronies dans l’analyse sociale et d’établir une syntaxe des disparités entre les organisations sociales. Le structuralisme économique, École de pensée qui surgit dans la première moitié des années 60 parmi les économistes latino-américains, a pour objet principal de mettre en valeur l’importance des paramètres non-économiques des modèles macro-économiques. Comme le “comportement des variables économiques dépend en grande mesure de ces paramètres”, ceux-ci doivent faire l’objet d’une étude méticuleuse. Cette observation est particulièrement pertinente en ce qui concerne les systèmes économiques hétérogènes, socialement et techniquement, comme c’est le cas des économies sous-développées. Celso FURTADO : Le nouveau Brésil : Publié dans la Revue Carta Capital de décembre 2002. Traduction : Sandrine Lartoux pour Autres Brésils 75 134 Malgré tout, les structuralistes de tous bords partagent trois lignes de pensée qui sont: l’analyse historique, les incidences des modes d’insertion à l’économie mondiale des pays sous-développés et les politiques et stratégies de développement. Ces thèmes constituent souvent le point de départ des réflexions et recherches des structuralistes. Bien que plurielles, les auteurs convergent vers le rejet des analyses à prétention technicistes centrées essentiellement sur des variables strictement économiques. Le sous-développement dans ces conceptions ne peut se comprendre sans prendre en considération le processus historique de la formation des structures économiques et sociales et leurs interactions dans le processus de développement ou de sous-développement. Ces idées fondatrices du structuralisme révèlent deux interprétations, deux lignes d’approche différentes : l’approche libérale qui considère l’état de sousdéveloppement comme un retard dans le développement, elle prend sa source dans l’analyse de l’École Classique et la deuxième qui considère le sous-développement comme le produit du développement du capitalisme mondial, cette analyse se réfère souvent au marxisme. On trouve aussi des auteurs qui échappent à cette classification et qui développent des réflexions synthétiques indépendantes. C’est pourquoi, la variété des auteurs et la diversité de leurs méthodologies dépassent de loin cette présentation certainement trop réductrice de la richesse et de la profondeur des recherches des structuralistes. Tableau 5 : Résumé des deux méthodologies d’approche Champ Méthode Systémique (holisme) Analytique (individualisme méthodologique) Théorie hypothéticodéductive 76[11] (universalisme) Approche globale du développement (systémisme, néomarxisme, dépendantisme, structuralisme) Modélisation du développement (néoclassique, anthropologie formaliste, école standard élargie) Terrain induction (particularisme) Anthropologie économique du développement Historicisme Institutionnalisme Théorico-empirique ex : travaux économétriques sectoriels. Tests empiriques et d’efficience Action (normatif) Développement intégral et intégré. Nouvel ordre économique. Réforme des structures Choix de projets micro-réalisations systèmes incitatifs prix et marché Source: Ph. HUGON, art, cit. p. 174. Section 1 : La première École de pensée économique latinoaméricaine : la formation de l’approche structurale au niveau de la CEPAL. La création de la Commission Économique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes (CEPAL) en 1945 marque la naissance du structuralisme. En effet l’élaboration de la thèse structuraliste est essentiellement associée aux écrits de cette 135 Agence des Nations Unies et, plus particulièrement, aux travaux de son premier Directeur, R.PREBISCH, considéré comme le père du structuralisme. Les économistes latino-américains, dans leur effort pour expliquer pourquoi la croissance économique n’avançait pas plus rapidement en Amérique Latine dans les années 1950, en vinrent à penser que certains aspects des structures économiques de leurs pays en étaient la cause. Pour cela, pour être bref nous nous intéresserons aux analyses faites par ces économistes à partir des années 50 basées particulièrement sur la détérioration des termes de l’échange et sur la théorie de la substitution aux importations avant d’étudier un renouvellement de la théorie structuraliste du développement. Les idées développées par les anciens structuralistes (J.NOYOLA-VASQUEZ, A.PINTO, L.PRETRSCH, H. SINGER, O.SUNKEL, M.TAVARES) en vogue dans les années 50 et 60 ont été fortement influencées par les théories keynésienne et postkeynésiennes qui existaient sur le rôle positif et nécessaire de l’État face à l’inefficacité des mécanismes de marche, sur la nécessite de créer et d’étudier la « demande effective » interne afin de stimuler l’activité économique et proposer une explication du phénomène inflationniste a partir des facteurs sociaux ou réels et par le courant néo-structuraliste qui traite des liens entre répartition du revenu et formation des prix et du taux de profit. Également les structuralistes remettent en cause l’analyse ricardienne et la théorie néoclassique (version HOS) du commerce international selon laquelle les différences de dotations relatives en facteurs de production entraînent la spécialisation internationale et une tendance à l’égalisation (relative ou absolue) de la rémunération des facteurs de production entre les coéchangistes. Cette tendance devrait permettre de rapprocher les niveaux de développement : le commerce se porterait alors comme un instrument de réduction des inégalités entre les nations. La liberté du commerce conduirait à réduire l’écart de revenu entre les pays riches et les pays pauvres. Contrairement à cette analyse, les structuralistes découvrent dans l’ouverture extérieure l’explication de la condition permanente du sousdéveloppement en Amérique Latine car les forces du marché ne poussent pas vers l’égalité de la rémunération des facteurs de production et des revenus. La principale conclusion à tirer de la théorie d’HECKSCHER-OHLIN, que l’on retrouve dans une multitude d’ouvrages et d’articles d’auteurs consacrés aux rapports économiques internationaux est que chaque pays a tendance à se spécialiser dans la fabrication et l’exportation de marchandises exigeant de nombreux facteurs de production qui y sont relativement abondants et, de ce fait, relativement bon marché. Ohlin souligne que la division internationale du travail est également influencée par les conditions de la demande à l’intérieur de chaque pays, mais selon la plupart des auteurs néo-classiques contemporains, ce facteur ne revêt habituellement pas une importance décisive et ne porte pas atteinte au principe susmentionné. De ce fait, affirment-ils, le commerce international est avantageux pour tous ceux qui y participent, car les ressources productives de tous les pays sont utilisées de la manière la plus efficace et, grâce à la division du travail et du commerce, chaque pays reçoit avec un minimum de frais plus de marchandises qu’il n’en aurait pu fabriquer lui-même. Selon cette théorie, le marché capitaliste mondial serait une sphère d’échanges « réciproquement avantageux » et les intérêts de tous les pays sont réglés par l’harmonie naturelle. Les traits distinctifs suivants caractérisent, selon PREBISCH, les États industriels (« centre ») et les pays producteurs de denrées agricoles et de matières premières (« périphérie ») : 136 détérioration des termes de l’échange pour la périphérie et leur amélioration pour les principaux centres de l’économie mondiale ; économie intégrée au centre ; à la périphérie, économie productrice de denrées alimentaires et de matières premières, de préférence monoculture, reposant sur des méthodes de production précapitalistes ; impulsions de la conjoncture au centre ; intenses transpositions de ces impulsions des centres à la périphérie ; accumulation rapide du capital et intense progrès technique avec accroissement de la productivité et des revenus au centre ; faible accumulation du capital, progrès technique insignifiant, faible productivité et faibles revenus réels à la périphérie ; à la périphérie, part considérable du commerce extérieur dans le revenu national exerçant une influence décisive sur la conjoncture ; faible part au centre où les investissements intérieurs et non le commerce extérieur exercent une influence décisive sur la conjoncture ; tendance chronique à la dépression au centre ; à l’inflation chronique à la périphérie ; chômage au centre ; sous-emploi et faibles productivités du travail à la périphérie. Ainsi, pour les structuralistes, l’unique voie pour rompre cette insertion régressive qui contraint la périphérie à rester sous développée et conduit donc à une « spécialisation appauvrissant » réside dans l’impulsion d’un développement industriel. La mise en œuvre du processus d’industrialisation doit permettre d’améliorer a la fois la répartition internationale des fruits du progrès technique (l’industrialisation considérée comme véhicule premier du progrès technologique devait contribuer à réduire l’écart technologique qui est à la base de l’accentuation des différences structurelles entre le centre et la périphérie) et la répartition interne du revenu national (via l’absorption d’un montant croissent de main d’œuvre) L’accent mis par la CEPAL sur les vertus magiques de l’industrialisation doit permettre d’élever le niveau de vie des masses populaires sans même mettre en place une politique de “redistribution des revenus”, ou même une réforme agraire. Somme toute, ces politiques structuralistes de développement ont été suivies avec succès par certains pays comme le Brésil, l’Argentine et le Mexique, notamment en matière de décollage de l’industrialisation, même si ces résultats ont tendance à être oubliés à un moment à cause des nombreux soubresauts politiques puis de la crise de la dette des années 80 qu’a connu la région latino-américaine. Si bien que le structuralisme fondateur a pu sembler définitivement dépassé, pour certains, ou bien à renouveler et c’est ce projet théorique de renouvellement (de régénération) que constitue le néo-structuralisme. Section 2 : La variante libérale du sous-développement comme retard du développement de C. CLARK à W.W. ROSTOW. Renouant avec la tradition historique du siècle dernier, la période contemporaine a vu certaines analyses visant à déterminer les étapes du développement et de la croissance. Pour ces auteurs, il existerait un sentier sinon optimal, du moins obligé, de la croissance ; un certain nombre d’étapes par lesquelles il est nécessaire que les différents pays passent. Cette analyse se retrouve souvent dans la littérature économique libérale. Elle est particulièrement soulignée par HIGGINS lorsqu’il observe que « Ce qui s’est produit dans les pays européens au 137 XVIII et XIXème siècles, c’est ce que nous désirons voir se produire maintenant en Asie, en Afrique et en Amérique Latine » Donc l’idée est bien claire, : les mutations qui se sont passées à une époque historique , dans certains pays qui sont maintenant industrialisés et les PSD sont en retard par rapport à cette évolution, l’application des mêmes techniques et des mêmes modèles de développement leur permettront de sortir de l’état de sous-développement. Une série d’auteurs ont défendu ces idées parmi eux Colin CLARK mais surtout ROSTOW dont les approches continuent encore d’inspirer les approches libérales du sous-développement. La première approche est de Colin CLARK. Il considère qu’il existe une corrélation entre la répartition de la population et le niveau du revenu par tête. La proportion de la population occupée dans les activités primaires c’est-à-dire l’agriculture, la pêche, l’élevage est fonction inverse du revenu par tête. Au contraire, l’emploi de la main-d’œuvre dans le secteur secondaire augmente avec le niveau du produit par tête. Le secteur tertiaire va lui aussi croître lorsqu’on aura atteint la phase supérieure du développement. De sorte qu’il y a un développement successif des secteurs les uns après les autres. Le secteur primaire va se dégonfler au profit du secondaire, puis les deux premiers au profit du secteur tertiaire. Les PSD sont des pays qui ont encore une forte proportion de leur population dans le primaire. Cette analyse qui a eu ses heures de gloire, est largement démentie par l’évolution des faits. En effet, on observe aujourd’hui dans la quasi totalité des PSD une hypertrophie des activités tertiaires qui sont plus signe de sous-développement que de développement. D’ailleurs, S. AMIN fait de cette distorsion en faveur des activités tertiaires une caractéristique du sous-développement. La deuxième approche est celle de Rostow La « philosophie » de l’histoire de ROSTOW se résume dans le fait que, selon lui, toute société lancée sur la voie de l’industrialisation indépendamment de sa force sociale, parcourt cinq stades : la société traditionnelle, les conditions préalables de ce démarrage, les progrès vers la maturité, l’ère de la consommation de masse. Le déterminisme très primaire de ce découpage a provoqué de multiples contestations. Si ce livre a fait tant de bruit c’est essentiellement pour deux raisons ( hormis l’heureuse image du « take- off ») : c’est d’une part parce que avec la doctrine des conditions préalables l’économie politique dominante a cru un moment tenir le modèle capable à la fois d’être offert aux pays sous-développés comme l’image de leur futur développement, et exporter ces mêmes pays sous-développés à la patience. Rostow s’attache en effet à démontrer l’identité de ces conditions préalables avec les conditions historiques de naissance du capitalisme, et l’inévitable longueur du mûrissement de ces préalables. 138 Tableau 6 : Analyse libérale du sous-développement. L’analyse libérale : le sous-développement un retard de développement. La théorie du développement linéaire de ROSTOW (1960) Les étapes Les caractéristiques des étapes de la croissance Situation contemporaine La société traditionnelle Société agricole, stationnaire, la terre est la seule source de richesse. Perspectives de changement faibles. Société hiérarchisée Les P.M.A. Les conditions préalables au décollage Apparition du profit, développement de l’agriculture, idées nouvelles, Apparition d’un Etat centralisé, l’épargne et l’investissement augmentent Pays en développement intermédiaires Le décollage ou « take off » Emergence de branches motrices, La croissance devient habituelle et crée un processus cumulatif, inégalités sociales Les N.P.I. La marche vers la maturité Apparition d’industries nouvelles, augmentation de la productivité agricole (exode rural), idée de progrès Corée du Sud ? P.E.C.O. ? L’ère de la consommation de masse Besoins essentiels satisfaits, organisation efficace mais contraignante, développement de la protection sociale, développement du secteur tertiaire Pays occidentaux développés De même que SCHUMPETER a fait rentrer le socialisme dans la théorie de même ROSTOW y a-t-il fait pénétrer les pays sous développés, D’autre part, avec sa cinquième étape, l’ère de la consommation de masse, ROSTOW pose sous la forme moderne, le problème de maturité .Cette ère de la consommation de masse se définit, Selon Rostow, par le fait que le moteur de la croissance , dans les sociétés mures , se situe dans le secteur des biens de consommation , le secteur de biens d’ équipement abandonnant le rôle entraînant qu’il avait jusque là . ROSTOW développe une idée qu’on a vu exister en germe chez KEYNES et chez d’autres. Ou, pour s’exprimer plus justement, Rostow insiste sur cette idée mais ne la développe pas. Il n’existe en effet chez lui, ni analyses des raisons pour lesquelles, à un moment déterminé les besoins d’investissement devraient abandonner leur rôle moteur au régime capitaliste, ni analyse des raisons pour lesquelles les besoins de la consommation devraient tôt ou tard approcher de la saturation, ni esquisse d’une solution possible à cette situation préoccupante. En effet la seule consolation réelle qu’offre ROSTOW au régime c’est qu’a l’en croire, toutes les sociétés futures (socialistes) auront un jour à affronter les mêmes problèmes. Section 3: Les néo-marxistes et les essais d’une approche du développement à la lumière de l’œuvre de Marx. Dans la théorie marxiste l’évolution de la société obéit à des lois scientifiques, qui devraient impliquer que toute société devrait suivre les mêmes étapes d’évolution. Dés lors, l'histoire est une succession des modes de production qui, à partir du communisme primitif, sont passés par des stades plus ou moins enchevêtrés, qui peuvent se classer pour simplifier, au moins en Europe: en société esclavagiste, société féodale, en société capitaliste et en société socialiste. Cette succession des modes de production est la base matérielle de l'histoire humaine. Elle s'accompagne d'un accroissement de la productivité sociale du travail, ou si l'on veut, des valeurs 139 d'usage produites par unité de temps et par producteur. Avec le capitalisme, la productivité augmente de façon exponentielle, ne trouvant d'autre limite que dans les rapports de production capitalistes eux-mêmes (limites qui s'expriment dans les crises, les guerres... ou dans les révolutions prolétariennes). C’est dire, en définitive, que l’évolution de la société obéit à des lois scientifiques, qui devraient impliquer que toute société devrait suivre les mêmes étapes d’évolution.77. Toutefois comme l’observe R. GARAUDY, «le matérialisme historique de MARX n’est donc ni une méthode de déduction, ni une méthode de réduction : l’on ne peut ni déduire les superstructures de la base, ni réduire les superstructures à la base. L’on peut dire seulement que la superstructure et la base sont des moments d’une même totalité organique dans laquelle les rapports de la société (considérée comme un système ou une totalité vivante), avec le milieu naturel qui l’entoure, jouent un rôle majeur » Cette supposition semblerait confirmée par une position de Marx montrant que «Le pays le plus développé industriellement ne fait que montrer à ceux qui suivent sur l’échelle industriel l’image de leur propre avenir»78. Pourtant, dans sa fameuse lettre écrite en 1881 à une Russe nommée Vera Zassoulitch, Marx observe clairement que les développements analysés dans son livre Le Capital ne seraient inévitables que pour les pays qui s’étaient déjà engagés sur la voie capitaliste, notamment, avec l’expropriation de petits paysans de leurs terres. Une société (dans ce cas, la Russie) qui garderait la propriété communale de terres pourrait passer directement du féodalisme au socialisme, en sautant l’étape capitaliste. Ce débat fut repris dans le cadre du Mode de Production Asiatique qui introduisait les découvertes de formes particulières de transition vers une Formation Sociale socialiste79 qui fasse l’économie de la phase proprement capitaliste. Et les expériences concrètes des pays comme la Chine, la Mongolie et le Viêt-Nam semblaient montrer qu’un pays peut devenir socialiste sans passer préalablement par une étape capitaliste, quelle que soit l’idée que se faisait K. Marx sur ce sujet. Au temps où il écrivait « Le Capital », Marx était convaincu que la première révolution prolétarienne aurait lieu dans le pays capitaliste le plus développé, l’Angleterre. Vers la fin de sa vie, il pensa que la première révolution pourrait bien se dérouler en un pays sous-développé (la Russie), mais à condition qu’une révolution russe soit l’étincelle d’une révolution dans le reste de l’Europe, sinon les pays capitalistes écraseraient le nouveau régime de Russie : «Il s’agit, dès lors, de savoir si la communauté paysanne russe, cette forme déjà composée de l’antique propriété commune du sol, passera directement à la forme communiste supérieure de la propriété foncière ou bien si elle doit survivre d’abord au même processus de dissolution qu’elle a subi au cours du développement historique de l’Occident. La seule réponse qu’on puisse faire aujourd’hui à cette question est la suivante : si la révolution russe donne le signal d’une révolution ouvrière en Occident, et que toutes Certains interprètent MARX et ENGELS en disant qu’il faut nécessairement passer par toutes les étapes, et d’autres interprètent Marx et Engels en disant qu’un pays peut sauter des étapes. Le lecteur intéressé au «problème du socialisme en un seul pays» peut se référer a deux passages écrits en 1845 et 1847 (mais publiés MARX et ENGELS, l’Idéologie allemande (éditions sociales, pages 63-64), et Engels, Principes du communiste, question XIX (éditions sociales, annexe au manifeste communiste, page 87). 78 K. MARX : Préface à la première édition allemande. Certains interprètent Marx et Engels en disant qu’il faut nécessairement passer par toutes les étapes, et d’autres interprètent Marx et Engels en disant qu’un pays peut sauter des étapes. 79 Moustapha KASSE : Du sous-développement au Socialisme : réflexion sur la transition, Édit Silex 77 140 deux se complètent, la propriété commune actuelle de la Russie pourra servir de point de départ à une évolution communiste.»80 Il faut rappeler que dans nos développements antérieurs, nous avions montré que le capitalisme porte en lui une contradiction fatale, la baisse tendancielle du taux de profit. Or, les recherches des structuralistes marxistes comme S. AMIN, EMMANUEL, G. FRANK, G.DHOQUOIS, C. PALLOIX entre autres, vont établir, après une analyse du fonctionnement du capitalisme au Centre et à la Périphérie, que le système central est sauvé d’une chute inéluctable. I/ Le capitalisme à la périphérie ou la définition du sous-développement comme une structure plutôt que comme un niveau du revenu par habitant. C’est au chapitre II que se développe la partie centrale de l’ouvrage de Samir AMIN, non plus cette fois ci en termes de modèle de fonctionnement, mais en termes de modes de production et de formations sociales. Cette partie qui est la plus importante renouvelle de façon magistrale l’analyse du « sous-développement » concept qui, comme le dit S. AMIN, en occulte la réalité, celle d’une formation sociale capitaliste dominée, exploitée et façonnée par l’impérialisme. La problématique amorcée constitue l’élément dominant de l’analyse. Le moment premier est de partir de ce qui est la base, les fondements internes des dites Formations sociales à savoir des modes de production antérieurs à la pénétration capitaliste, soit la connaissance des modes de production précapitalistes, tel que le mode de production asiatique pour lequel il se propose l’expression de mode de production tributaire pour sa variante africaine. Il s’oppose à deux variantes antagoniques de l’analyse du sous-développement, l’une qui est celle de l’idéologie bourgeoise-consistant à faire du sous-développement un retard ou un blocage correspondant au maintien des sociétés traditionnelles (thèse du dualisme), l’autre (marxiste) qui tend à vouloir expliquer le sous-développement uniquement à travers des causes externes (l’impérialisme). La transition au capitalisme périphérique81 à savoir la construction d’une formation sociale capitaliste spécifique à la périphérie à partir de la colonisation et de l’exportation de capital sur la base des modes de production précapitalistes. La théorie de la transition au capitalisme périphérique livre deux séries de résultats : d’une part, en ce qui concerne les conditions nécessaires pour que s’établisse le mode de production capitaliste à la périphérie « celles-ci sont au nombre de deux essentiellement : la prolétarisation et l’accumulation du capital argent (p165) ce qui insiste sur la dissolution des anciens rapports pour libérer la force de travail nécessaire à l’établissement de rapports de production capitalistes, libération obtenue le plus souvent par la violence ; Et d’autre part en ce qui concerne la dynamique de l’accumulation : « Le mode de production, capitaliste tend à devenir exclusif c’est-àdire à détruire les autres modes de production. Sur ce point Samir AMIN développe la spécificité du mode de production capitaliste dans les formations sociales capitalistes de la périphérie qui me parait résider dans la carence des rapports de production à dominer le développement des forces productives, ce qui conduit d’un côté à la non industrialisation, et de l’autre à la consolidation des rapports Le développement du capitalisme périphérique ou le développement du sousdéveloppement (pp197-338) qui selon S.AMIN se manifeste par trois distorsions 80 81 MARX et ENGELS : Introduction à l’édition russe (1882) du Manifeste S.AMIN : pp 163-193, 141 une distorsion décisive en faveur des activités exportatrices qui absorberont la fraction motrice des capitaux en provenance du centre ; une distorsion en faveur des activités tertiaires qui traduit les contradictions particulières au capitalisme périphérique et les structures originales des formations périphériques une distorsion dans les choix des branches de l’industrie en faveur des branches et techniques légères, accessoirement en faveur des techniques légères (p198) Les formations sociales capitalistes périphériques82 avec plus spécialement une caractérisation des formations sociales africaines de la péripétie partagent trois caractéristiques communes : la prédominance du capitalisme agraire et commercial dans le secteur national, la constitution d’une bourgeoisie locale dans le sillage du capital étranger dominant, la tendance qu développement bureaucratique original, propre à la périphérie contemporaine (p360). Cette troisième caractéristique engagerait les formations sociales vers un « capitalisme d’État » parfaitement compatible avec les exigences du centre et la reproduction des rapports capitalistes internes aux Pays sous-développés83. La question des relations (spécialisation et échange inégal) entre Centre et Périphérie. Ces deux points sont étroitement imbriqués : spécialisation internationale inégale Tout cela établit avec clarté que les pays pauvres d'aujourd'hui n'ont pas la même structure que les pays riches du siècle passé. Donc ils n'auront pas la même histoire qu'ont eue les pays riches. Nous retrouvons les caractéristiques structurelles distinctives des pays pauvres (ou « périphériques ») et que soulignent presque tous les auteurs structuralistes de F. PERROUX aux autres : Dualisme. Il y a des très fortes différences de productivité entre un secteur moderne (mines, industries, plantations commerciales, …) et les autres secteurs de l'économie (agriculture traditionnelle, .etc.). Ce thème a fait l’objet d’une abondante littérature depuis son introduction comme préoccupation de recherche par BOEKE (1953). C’est surtout C. FURTADO qui construira autour de cette situation structurelle toute sa construction du sous-développement. « Le cas le plus simple est celui de la coexistence d’entreprises étrangères productrices d’une marchandise d’exportation, avec un large secteur d’économie de subsistance, coexistence qui peut durer pendant de longues périodes. Le cas le plus complexe est celui où une économie présente trois secteurs : le premier essentiellement de subsistance, le second tourné surtout vers l’exportation, le troisième étant un noyau industriel lié au marché interne, suffisamment diversifié pour produire une partie des biens de capital dont l’économie a besoin pour se développer »84. Dans un cas comme dans l’autre FURTADO85 montre que l’économie sera bloquée, analyse partagée par S. AMIN Ibid : pp 339-376 Ibid :p.372 84 Celso FURTADO dans ses deux ouvrages publiés aux Presses Universitaires de France : Développement et sous-développement (1966, p.149) et Théorie du développement économique (1970) 85 Les caractéristiques du structuralisme qui apparaissent dans Théorie du développement économique, dans son « Annexe méthodologique » ou dans ses chapitres 14, 16, 18 et 20, évoquent une interprétation du “structuralisme” proche de celles d’auteurs comme A. HIRSCHMAN, W. LEWIS, R. 82 83 142 Désarticulation. Il y a peu d'échange intersectoriel ou entre industries. Dans un pays développé, les produits finis d'une industrie sont souvent les matières premières d'une autre industrie du pays (par exemple, l'acier provenant d'une sidérurgie est une matière première pour une fabrique de camions, et les camions sont des pièces d'équipement utilisées par la sidérurgie) ; dans un pays sous-développé, les matières premières du secteur industriel sont importées, et les produits finis sont exportés ou consommés par les ménagères - ils sont rarement utilisés par les autres industries du pays. Domination extérieure. Le pays pauvre a peu d’autonomie ; une large partie de son économie est sous le contrôle effectif des étrangers. II/ L’accumulation à l’échelle mondiale86 permet d’éviter la chute du capitalisme au Centre. Il est théoriquement possible pour le système capitaliste de continuer indéfiniment en fait de régler théoriquement et pratiquement la contradiction de la baisse du taux de profit. Il serait alors assez naïf de baser sa politique sur une disparition imminente du capitalisme au niveau des pays riches. En effet Samir AMIN opère une certaine réduction instantanément au plan du concept d’économie mondiale qu’il identifie l’économie mondiale capitaliste et l’accumulation mondiale du capital d’où le titre de l’ouvrage. En clair, au lieu de se tenir sur le terrain des rapports de production et du développement des forces productives, il se situe à un niveau écran qui est celui de l’accumulation du capital. Cela apparaît très nettement lorsqu’il écrit que «L’accumulation, la reproduction élargie, est une loi interne essentielle du mode de production capitaliste, et sans doute du mode de production socialiste ; mais elle n’est pas une loi interne du fonctionnement des modes de production précapitalistes ». Dès lors, qu’il admet ce qui est juste qu’ « aucune formation socio- économique concrète contemporaine ne peut être saisie en dehors de ce système », le système mondial se définit par l’accumulation à l’échelle mondiale et les mécanismes de cette accumulation, ce qui le conduit à traiter de l’accumulation au niveau de l’économie mondiale comme un transfert de plus- value de la périphérie vers le centre. NURKSE et ROSENSTEIN RODAN et de ce que l’on entend alors par le terme « dépendance ». Il s’agit d’un ouvrage qui déchiffre les phénomènes économiques à partir d’une « matrice structurale » caractérisée par la manière dont les variables exogènes et endogènes entrent en relation et se déterminent réciproquement C. Furtado souligne dès le départ que les modèles économiques contiennent un « nombre indéterminé de structures » 86 Samir AMIN/ L’accumulation à l’échelle mondiale 143 Analyse structuraliste: Accumulation et enrichissement au Centre Désarticulation et Appauvrissement à la Périphérie Accumulation et Développement au Centre Accumulation échelle mondiale Domination/ Sous-dévelop. à la Périphérie Prebisch, Furtado, Singer, Emmanuel, Amin Sunkel, G. Frank et Maurini Non couverture coûts de l’Homme appauvrissement Désarticulation Distorsions structurelles et faible productivité, C’est le thème fondamental de l’échange inégal d’Arghiri EMMANUEL qui observe que « les relations entre les formations du monde développé (le centre) et celles du monde « sous développé » (la périphérie) se soldent par des flux de transferts de valeur, qui constitue l’essence du problème de l’accumulation à l’échelle mondiale. Chaque fois que le mode de production capitaliste entre en rapports avec des modes de production qu’il se soumet, apparaissent des transferts de valeurs des derniers vers le premier qui révèlent des mécanismes de l’accumulation primitive. Ces mécanismes ne se situent pas seulement dans la préhistoire du capitalisme : ils sont aussi contemporains. Ce sont des formes renouvelées, mais persistantes de l’accumulation primitive au bénéfice du centre qui constituent le domaine de la théorie de l’accumulation à l’échelle mondiale ». Cette analyse qui nous situe au plan de l’économie mondiale marque un progrès certain. En effet, ce qui est au centre du capital de Karl Marx, c’est l’action des rapports de productions capitalistes – interne en mode de production essentiellement national –sur le développement des forces productives, à travers les mécanismes de l’économie du capital, qu’ils soient du type de la reproduction élargie du capital social ou de l’accumulation primitive du capital, pour reproduire les rapports de production. Le passage du cadre national au cadre mondial exige que nous nous placions sur la base des rapports de production définissant le rôle de l’accumulation du capital à l’échelle mondial vis-à-vis de la production de ces mêmes rapports. Le mérite de l’analyse, et cela est d’une première importance, est de nous engager sur cette voie. « La théorie des relations économiques internationales pose mal son problème, plus exactement elle pose un faux problème. Elle procède en effet de l’hypothèse que les partenaires dans les relations internationales sont des économistes capitalistes « pures ». Le cadre de raisonnement n’est pas différent pour l’analyse de l’échange international ainsi appréhendé de celui conçu pour l’analyse de l’accumulation interne : on se place dans le cadre dune production capitaliste. Cette hypothèse conserve un sens pour l’analyse de l’échange international entre « pays 144 développés », toutefois, elle n’a pas de sens pour ce qui concerne l’échange entre « pays développés » et « pays sous développés ». À ce niveau, on doit se placer dans le cadre d’un raisonnement complètement différent : celui des relations d’échange entre les formations socio économiques différentes. Quelles sont ces formations en présence ? Là est le vrai problème ». En effet, le capitalisme au Centre diffère de celui de la périphérie. 1°) Le fonctionnement du capitalisme au Centre En ce qui concerne l’analyse des formations socio économiques capitalistes dominantes, un des apports essentiel de Samir AMIN tient au refus de connecter « le modèle de fonctionnement » du capitalisme au Centre de son insertion dans l’économie mondiale, à le séparer de l’espace impérialiste mondial dans lequel il fonctionne concrètement. En ce qui concerne le modèle de fonctionnement, si Samir AMIN ne se croit pas tenu de développer largement son analyse – on aurait espérer un renouvellement – c’est qu’il se réfère très étroitement d’une part à une vision marxiste classique quant aux stades de développement historique du capitalisme et d’autre part à la formulation du modèle de fonctionnement du capitalisme américain de notre temps, tels que développé par BARAN ET SWEEZY.87 Vis-à-vis des stades de développement du capitalisme au centre, Samir AMIN distingue trois étapes très classiques : la période de constitution du capitalisme …que l’on peut définir par le caractère mercantile dominant du capitalisme ; la période d’épanouissement du mode de production capitaliste au centre, caractérisé par la révolution industrielle, la dominance essentielle du capital industriel nouveau et la forme concurrentielle du marché capitaliste…. ; la période impérialiste des monopoles – au sens leniniste de l’expression – qui débute à la fin du XIXème siècle. Tout modèle de fonctionnement capitaliste au centre est réductible au modèle Américain. De plus le modèle DE BARAN ET SWEEZY s’applique semble- t’-il à la totalité la phase retenue, si bien que l’auteur ne dit pas un mot sur la thèse du capitaliste monopoliste d’État. Par ailleurs Samir Amin n’explore pas les transformations du capitalisme monopoliste contemporain qui évolue manifestement vers une phase de « concurrence internationale des monopoles » (G.DE BERNIS). En bref, il recouvre d’une même identité des périodes évolutives au sein de la phase du capitalisme monopoliste : capitalisme monopoliste industriel et financier, capitalisme monopoliste d’État, capitalisme de concurrence internationale des monopoles. L’auteur se place sur le terrain du modèle de fonctionnement uniquement, et cela en des termes très voisins à ceux de BARAN ET SWEEZY, que ce soit le capitalisme concurrentiel ou pour le capitalisme monopoliste , c'est-à-dire à travers le mode de création et d’absorption du surplus – en liaison avec le problème de la baisse tendancielle du taux de profit – d’où se dégage la fonction des relations extérieures du centre avec la périphérie : « Les relations internationales (commerce et exportations de capitaux) conservent les mêmes fonctions pour le capital central, c'est-à-dire combattre la baisse tendancielle du taux de profit : en élargissant les marchés et en exploitant des zones nouvelles ou le taux de la plus value est plus élevé qu’au centre et en réduisant le coût de la force de travail et du capital constant .Que l’on en déduise pas que capitalisme concurrentiel et capitalisme monopoliste sont 87 Du groupe rattaché à la «MONTHLY REWIEW» 145 réductibles l’un à l’autre sur le plan de la fonction des relations extérieures, car le capitaliste monopoliste se caractérise par une exportation de capital qui induit une nouvelle division internationale du travail entre le centre et la périphérie. Quoi qu’il en soit, sur le point de l’analyse du capitalisme monopoliste Samir AMIN tente une synthèse des thèses de Baran et Sweezy d’un coté et du collectif R RICHTA de l’autre sur la révolution scientifique et technique, comme aggravation des contradictions au centre, accentuant l’exportation du capital du centre vers la périphérie. Au fond des choses, Samir Amin ne débouche pas vraiment sur une analyse de la formation sociale capitaliste au centre, se cantonnant en réalité sur un modèle de fonctionnement capitaliste « ouvert » sur la périphérie. 2°) La périphérie au cœur des mécanismes de sauvetage du système capitaliste au Centre. Les contre tendances à la baisse du taux de profit au centre tiennent à une série de raisons qui justifient le maintien et même le renforcement du système capitaliste. Elles sont pour Samir AMIN au nombre de 4 dont la dernière mérite une évaluation particulière au regard du rôle que joue la périphérie dans le sauvetage global du système capitaliste au niveau central. Première raison : Une augmentation des salaires. Parmi les conséquences de l'augmentation des salaires qui vise un double objectif d’une part la réduction des tensions sociales et d’autre part la provision d'un marché pour les manufactures, que les ouvriers ont les moyens d'acheter. Deuxième raison : L’adoption de mesures « Keynésiennes » pour balancer le niveau global de l'offre et de la demande dans l'économie en jouant avec le surplus ou le déficit budgétaire, et avec la quantité de monnaie mise en circulation. C’est le double effet de la conjugaison des politiques budgétaires et monétaires qui stimule la demande globale et déclenche le cercle vertueux de hausse par l’effet combiné du multiplicateur (KAHN) et de l’accélérateur (AFTALION). La conception de l'indemnité de chômage comme une politique économique est souhaitable : elle n’est pas un pis-aller chez Keynes. Troisième raison : L’absorption d’un «surplus économique» par le gouvernement en forme de grandes dépenses publiques pour l'armement, la « race de l'espace », etc. Le rôle de ce genre de dépense dans le maintien du système capitaliste a été souligné par les économistes BARAN et SWEEZY. Quatrième raison : L'exploitation des colonies et par la suite des pays indépendants du Tiers-Monde. Le mécanisme passe par les relations économiques internationales qui contribuent à la ruine de la périphérie par les divers transferts visibles et invisibles à travers les termes de l’échange et l’échange inégal. La détérioration des termes de l'échange des pays pauvres permet, du point de vue des pays riches, d'importer à prix bas et d'exporter à prix élevé. L'investissement direct aux colonies et ensuite au Tiers-monde est caractérisé par un taux de profit élevé (exemple: pétrole, cuivre, banane,...) 146 III/ La question des relations (spécialisation et échange inégal) entre le centre et la périphérie88 Ces deux points (spécialisation et échange inégal) sont étroitement imbriqués à la spécialisation internationale inégale. Ils ont été développés par tous les structuralistes d’inspiration marxiste : R. PREBISCH, C. FURTADO, A. EMMANUEL, S. AMIN, G. FRANK, C. PALLOIX, T. SVENTES, M. MAURINI, Vis-à-vis de la spécialisation, ou de la division internationale du travail entre le centre et la périphérie, Samir AMIN souligne l’apparition d’une nouvelle division du travail, issue de la nécessité pour le centre de surmonter ses contradictions dans deux voies la première étant celle de « l’intégration de l’Europe de l’Est dans les échanges internes du centre » la seconde étant énoncée comme suit : « La seconde direction possible c’est la spécialisation du Tiers-monde, dans la production industrielle classique (y compris celle de biens d’équipement), le centre se réservant les activités ultra modernes (automation, électronique, conquête de l’(espace, atome). Notre époque est en effet celle de la révolution scientifique et technique extraordinaire. Celle ci rend caduques les modes classiques de l’accumulation, marqués par l’évolution de la composition organique du capital…Les pays sous-développés se spétialiseraient alors dans des productions classiques qui n’exigent que du travail simple, y compris les productions industrielles lourdes classiques (sidérurgie, chimie, etc.) » Tout d’abords il n’est pas certain que cette nouvelle spécialisation dans les productions classiques, à forte composition organique du capital et à faible composition organique du travail (travail simple), se généralise car elle est en contradiction avec la dépendance technologique et politique de la périphérie. En effet, ces pôles industriels classiques engendrent l’apparition d’un prolétariat urbain qui induit forcément une activation de la lutte des classes ; aussi certains pays sousdéveloppés (Maroc par exemple) refusent ostensiblement les bases de l’industrialisation (sidérurgie, chimie). Par ailleurs, pour des raisons de sécurité du capital, le centre préfère importer de la main d’œuvre dans son espace que réallouer ses activités de productions chaque fois que cela est possible. D’autre part, l’implantation de bases industrielles classiques peut être le support – à condition que les formations sociales de la périphérie le veuillent – d’un procès autonome d’engineering, conduisant à briser la dépendance technologique. Il faut saisir les contradictions dans leur dynamique et agir sur elles. Section 4 : Structuralisme et Institutionnalisme : les nouvelles recherches des économistes. À l’origine, les fondateurs de l’économie du développement, en l’occurrence les structuralistes et les marxistes, manifestaient déjà le plus grand scepticisme quant à l’aptitude du marché à promouvoir une accumulation régulière du capital dans les économies développées, et plus encore leur rattrapage par les autres pays (MEIR [1995].) Ils soutiennent ainsi que l’État devrait remplacer le marché, responsable des crises et disfonctionnements répétées des économies. Cette réflexion est aujourd’hui prolongée par celle des institutionnalistes comme D. NORTH. A.EMMANUEL : L’Échange inégal Samir AMIN : Le Développement inégal mais aussi et surtout L’Afrique de l’Ouest bloquée, Paris Édit. de Minuit, 1971 88 147 Après une longue période de vive contestation de la part des néo-classiques (pour qui la pauvreté des paysans des pays du « Tiers-Monde »89 était loin d’être un obstacle au développement d’une rationalité d’homo-economicus et donc d’une réponse aux signaux des prix que véhiculent le marché [SHULTZ]), les économistes du développement contemporains semblent aller vers une certaine convergence : le renouveau du structuralisme et la prise en compte des institutions. L’échec des politiques antérieures prônant uniquement le marché ou l’État semble être le moteur de cette nouvelle configuration. I/ Vers un renouveau de l’approche structuraliste et institutionnaliste du développement. Pour favoriser le développement, faut-il plus ou moins d’État ? (SEN, 1988). D’un coté le consensus de Washington, qui donnait 10 prescriptions libérales aux pays en difficulté, semble aujourd’hui être remis en cause, depuis les années 1990. Si à l’observation, il était admis que l’omniprésence du pouvoir public, comme en Union Soviétique, suggère que le « tout État » est voué à l’échec, aujourd’hui d’autres faits dévoilent les imperfections des marchés qui inclinent au retour de l’Etat dans le système économique et social : D’abord la crise asiatique. En effet ce consensus formulait des principes généraux valables pour tous les pays : discipline budgétaire, réformes fiscales clarifiant les incitations économiques, élimination des barrières à l’échange internationale et à la concurrence etc. John WILLIAMSON, auteur de ce consensus, reconnait même que ces mesures auraient dues être accompagnées par « la construction d’institutions clés telles qu’une Banque centrale indépendante, une administration budgétaire forte, des juges indépendants et incorruptibles et des agences en vu de développer les missions de productivité. » Ensuite, les nombreuses recherches (nouvelle microéconomie, nouvelle macroéconomie) montrent les limites du marché, mis en exergue le rôle des coordinations hors marché dans l’apparition de sentiers de croissance ou d’équilibres plus favorables que ceux qui résulteraient du marché uniquement. Cela fait dire à HOFF ET STIGLITZ que « maintenant, la théorie formalisée s’étend à de nombreux domaines de l’information imparfaite et des contrats incomplets » et que « dans de nombreuses configurations, des interactions hors marché donnent lieu à des complémentarités qui peuvent être associées à des équilibres multiples. » Enfin les recherches économiques actuelles de certains auteurs notamment les travaux de D. NORTH découvrent le rôle primordial des institutions dans le développement et la croissance. Elles établissent empiriquement que les écarts constatés au niveau des revenus et des productivités ainsi que les différences dans les performances proviennent principalement de la qualité des institutions. 89 Terme anciennement utilisé pour désigner les pays en voie de développement. 148 Figure 6 : Vers une approche systémique et institutionnaliste du développement : le tournant des années 1990. Le domaine des théories L’achèvement du programme de recherche de la TEG montre la généralité des failles du marché Les recherches contemporaines formalisent certaines intuitions à l’origine des analyses du développement (externalités, coordination, rendement croissant, croissance endogène. La conception du développement en 2001 : L’application du consensus de Washington n’empêche pas des crises majeures Le domaine des stratégies 1. Etat et marché sont plus complémentaires que substituts 2. Trappes à la pauvreté, multiplicité des facteurs qui font obstacle au développement 3. l’ensemble des institutions, normes, modes de gouvernement conditionnent le développement Réconcilier théorie/ observation/ pratique La diversité des expériences nationales et l’expérience de la transition des économies soviétiques appellent un renouvellement théorique Source : R.Boyer : L’Année de la régulation 2001, Économie, Institutions, Pouvoirs Presse de Sciences-Po. Dans son Rapport Mondial sur le Développement 2007, la Banque Mondiale, qui était pourtant l’un des principaux défenseurs du « consensus de Washington », reconnait la responsabilité de l’État dans les économies en développement, notamment par l’investissement dans la jeunesse et son rôle de l’assister de l’entrée à l’école à l’insertion économique et sociale. De plus, l’exploitation des ressources naturelles engendre des externalités. Le marché à elle seule ne peut réguler ces externalités car les agents en produisent excessivement s’ils sont négatives et peu s’ils sont positives. Il appartient à l’État de canaliser les premières et d’inciter les secondes 149 (éducation, santé…). C’est aussi à lui de gérer les questions comme la préservation de ces ressource naturelles et donc de l’environnement. Depuis les années 70, les pays en développement prennent de plus en plus conscience du rôle de celui-ci car leurs économies en dépendent considérablement. En outre, par les politiques de redistribution (de revenus et d’actifs), l’État peut veiller à atténuer les distorsions sociales et réduire la pauvreté. Ainsi, il ne s’agit plus de choisir entre l’État et le marché, mais plutôt d’une juste association de ces deux institutions. Le rôle de chacune d’entre elles n’est plus à contester, tout comme leur insuffisance à nier. Il s’agit maintenant pour les pays en développement de pouvoir pallier aux dérives du marché par des interventions efficientes du pouvoir public. II/ Le rôle des institutions dans le développement. Beaucoup de recherches théoriques et empiriques établissent aujourd’hui, toute l’importance que jouent les institutions dans le développement et la croissance. En effet, l’évolution institutionnelle d’une économie est déterminée par l’interaction entre les institutions et les organisations : les premières représentant les règles du jeu et les secondes les joueurs constitués de groupes d’individus mus par des objectifs communs. Selon D. NORTH, les institutions sont alors une combinaison de contraintes mises en place par les individus et qui sont de deux ordres : les contraintes formelles (règles, loi, constitutions) et les contraintes informelles (normes de comportement, conventions, codes de conduite auto imposés). D’autres définitions mettent l’accent sur les organismes, les procédures, les réglementations, les coûts de transactions, les droits de propriété, les normes en somme tout élément permettant surtout de réduire les coûts de transaction, d’économiser de l’information et de représenter la rationalité des agents au regard du problème de coordination. Ainsi, au sens le plus large, les institutions peuvent être comprises comme des règles sociales reconnues et suivies par une même communauté qui contraignent les actions des agents. Celles qui sont requises pour le développement sont de deux types : d’abord les institutions qui encouragent le développement des activités de marché en développant la confiance et en diminuant les coûts de transaction (droit des contrats, normes de comportement facilitant la confiance etc.) et ensuite celles qui canalisent le pouvoir de l’Etat vers la protection de la propriété et non pas l’exploitation (séparation des pouvoirs, fédéralisme, normes anti-corruption etc.). Ces règles typiques constituent un préalable essentiel au développement car les acteurs économiques doivent les maîtriser pour élaborer conséquemment leurs stratégies économiques. Les institutions qui sont requises pour le développement sont de deux types : d’abord celles qui encouragent le développement des activités de marché en développant la confiance et en diminuant les coûts de transaction (droit des contrats, normes de comportement facilitant la confiance etc.) et ensuite celles qui canalisent le pouvoir de l’Etat vers la protection de la propriété et non pas l’exploitation (séparation des pouvoirs, fédéralisme, normes anti-corruption etc.). En effet, les institutions représentent une condition nécessaire pour un fonctionnement harmonieux des marchés. : le temps et l’incertitude qui caractérisent, tout processus de marchés incitent les agents à suivre des règles communes qui conduisent à l’émergence et au développement des institutions qui permettent, à leur tour, en fournissant des modèles stables d’interaction, de réduire l’incertitude qui prévaut sur le marché. 150 Dès lors, la clé du développement découle de la complémentarité entre l’État et le marché. Aussi, les arrangements institutionnels intermédiaires peuvent être des catalyseurs. Les institutions sont des règles sociales reconnues et suivies par une même communauté qui contraignent les actions des agents. Définies d'une façon aussi large, elles comprennent des règles non imposées mais volontairement suivies comme la solidarité sociale ainsi que des règles imposées de façon externe comme les systèmes juridiques. Les règles externes sont des règles formelles et constituent le système juridique. L’établissement de règles de droit est un préalable essentiel au développement car les acteurs économiques doivent connaître les règles du jeu pour élaborer des stratégies économiques. Toutefois, certaines normes sociales sont suivies spontanément par les individus sans qu'ils y soient contraints par la loi (normes sociales internalisées). Il s'agit de règles de morale, de solidarité ou de politesse qui établissent la confiance et réduisent les coûts de transaction entre les agents. Quand ces règles permettent d'accroître la production elles sont quelquefois appelées « capital social » sous ce rapport, elles ont fait l'objet d'une attention récente des chercheurs pour comprendre trois aspects de la micro-économie du développement : la réussite de petits groupes ethniques ou religieux (un phénomène beaucoup observé au Sénégal), la gestion de l'environnement naturel et la microfinance. Les institutions comprennent également les organisations qui sont des combinaisons de facteurs de production ordonnées suivant des règles hiérarchiques pour atteindre certains objectifs. Aussi, toute organisation repose sur des institutions et toute institution demande des organisations pour être mise en œuvre. A ce niveau, la théorie économique des institutions soulève trois problèmes auxquels elle tente d’apporter des réponses souvent en divorce avec les analyses de la théorie standard : Pourquoi les pays qui ont été capables de créer et de développer des institutions propices au développement et à la croissance sont-ils si peu nombreux ? Quelles sont les institutions qui portent le développement ? Que doivent faire les PSD pour mettre en œuvre de « bonnes » institutions ? Les réponses à ce questionnement se ramènent à une évaluation des institutions qui portent le développement et ensuite à l’étude de leur fonctionnement en vue de leur mise en œuvre au niveau des PSD. Ces institutions sont de trois ordres : Les variables significatives: la protection des droits de propriété, le droit des contrats, les libertés civiles, les droits politiques et la démocratie, l’instabilité politique, les institutions qui supportent la coopération. Mais toutes ces variables ne sont pas des institutions: les droits de propriété, l’instabilité sont des résultats, la fragmentation ethnique une condition, les barrières commerciales, la prime au marché noirs reflètent des options de politiques économiques. L’émergence d’un environnement favorable aux acteurs de l’économie et à un fonctionnement concurrentiel des marchés. Les évolutions actuelles de l’économie du développement proposent au moins deux autres formes de coordination, outre le marché et l’État : D’abord la firme qui assure une fonction d’allocation des ressources. WILLIAMSON (1985) montre qu’en présence de coûts de transaction importants liés au recours du marché, ou encore à la difficulté de la collecte et du traitement de l’information, l’organisation peut développer des 151 routines d’allocation des ressources et de circulation des informations plus efficaces, et par conséquent constitue un lieu d’accumulation de compétences et de savoirs spécifiques ; Ensuite la société civile qui est un système où s’établissent des conventions, des règles, des habitudes qui permettent et facilitent par la suite les transactions proprement économiques à travers la formation de réseaux (Granovetter), la création et le maintien de la confiance, la coopération. Elle entretient aussi des relations avec les organisations car elle lui impose des règles qui ne sont pas forcément reconnues par le marché ni par l’Etat. Il apparait ainsi que le duo État/Marché était trop simpliste car l’économie étant en réalité un concours de facteurs plus nombreux et plus complexes. Cela fait que l’économie du développement est devenue systémique et institutionnaliste et impose une vision dynamique et non plus statique ou dogmatique. La place de l’Etat s’en trouve renouvelé au même titre que l’importance du marché, mais aussi des institutions. III/ L’évolution des thèses structuralistes vers le néo- structuralisme. Indubitablement, le courant néo-structuraliste s’inspire du structuralisme traditionnel. Beaucoup des contributions de la pensée structuraliste sont encore pertinentes et sont reprises et enrichies par les « nouveaux structuralistes » parmi lesquels on peut citer F.FAJNZYLBER, R. F. FRENCH DAVIS, A FISHLOW, A.FOXLEY, N.LUSTIG, P. MELLER, J, ROS, M. TAVARES, L.TAYLOR etc. Ces auteurs reconnaissent que l’apport principal du courant structuraliste est d’avoir mis en évidence l’importance des aspects structurels dans l’analyse des économistes du tiers monde à travers l’idée selon laquelle, l’insertion internationale défavorable des pays sous développés est le reflet des différences de structures entre les pays du centre et ceux de la périphérie. L’approche néo-structuraliste attribut un rôle primordial aux différentes dimensions de l’hétérogénéité structurelle : l’hétérogénéité des marchés extérieurs, la diversité des réponses à des incitations suivant les régions et les segments du marché (les petites et grandes) entreprises, les entreprises rurales et urbaines, les firmes naissantes ou déjà bien implantées ), les degrés de mobilité des ressources et de flexibilité des prix qui dépendent de l’intensité de la réponse des différents secteurs et marchés et des perceptions et des anticipations des agents économiques (cf. F.FRENCH-DAVIS L-(1993). Les néo-structuralistes acceptent également l’idée des structuralistes selon la quelle l’unique voie des pays sous développés, de sortir du système Centre / Périphérie qui entrave leur développement est d’impulser un développement industriel. Dans cette dynamique, comme les structuralistes anciens, ils sont favorables à l’intervention de l’État afin d’encourager le processus d’industrialisation. Contrairement à l’analyse libérale, qui conçoit le développement comme un simple produit du fonctionnement spontané du marché (où l’ajustement par les prix serait le principal mécanisme menant au développement), l’approche structuraliste et néostructuraliste envisage le processus de développement comme étant plutôt le produit d’un effort délibéré des pouvoirs publics dans les économies périphériques caractérisées par une profonde hétérogénéité structurelle. D’ailleurs, le jeu spontané des forces du marché s’est traduit dans la région latino-américaine par une tendance 152 structurelle vers le déséquilibre externe, le chômage structurel et les déséquilibres intersectoriels. Pour des micro marchés caractérisés par leur étroitesse et la nécessité d’utiliser des technologies exigeant de grandes échelles de production pour des raisons de rentabilité , cette intégration régionale est considérée comme pouvant offrir aux économies de la région une opportunité de spécialisation industrielle, qui leur permettrait aussi de réduire la sous utilisation du capital et l’inefficacité des processus de production, cependant, en même temps qu’il reconnaît les apports estimables de la pensée structurelle. Le néo-structuralisme prend acte des insuffisances des politiques de développement d’inspiration structuraliste (la stratégie de substitution aux importations) expérimentées dans le continent latinoaméricain. Durant trois décennies, les néo-structuralistes ont observé des visions contradictoires: un pessimisme exagéré par rapport aux possibilités d’exportations, une confiance excessive dans les vertus de l’intervention de l’État dans l’économie, la négligence des aspects monétaires et financiers et la sous-estimation de la nécessité d’un ajustement à court terme de l’économie, ajustement devant suivre des voies bien entendu différentes de celles prônées par les néolibéraux. Dans ce contexte, ils réaffirment certes la nécessite du rôle de l’État dans la promotion du développement économique (le marché doit être assisté par les politiques gouvernementales) mais son rôle doit être circonscrit clairement de sorte à éviter les erreurs liées à une confiance excessive dans les vertus de l’intervention de l’État dans l’économie. La formule ne consiste donc pas à revenir à une régulation extensive et non sélective de l’État, comme cela a été le cas en Amérique Latine lors de la mise en œuvre de la stratégie de substitution aux importations, ou à préconiser la libéralisation générale des marches, comme dans le schéma néolibéral, mais à rechercher la complémentarité (mis en avant par l’approche structuraliste) entre l’État et le secteur prive. En d’autres termes, il faut dépasser le « faux dilemme » entre l’État et le marché par une participation active et complémentaire public/privé dans l’élaboration de la stratégie de développement (BERTHOMIEU, C. EHRHART 2000). Les néo-structuralistes soutiennent que « des contrepoids institutionnels sont nécessaires pour compenser les pressions asymétriques en faveur de plus d’intervention » (J.RAMOS et O. SUNKEL 1993). Les néo-structuralistes considèrent l’industrialisation fondée sur la substitution comme une étape initiale nécessaire du processus de développement. Néanmoins, ces derniers pensent que ce processus a été maintenu trop longtemps et qu’il est temps maintenant de tirer profit de la capacité industrielle créée au moyen de la stratégie de substitution en passant à la seconde étape, celle de l’exportation de produits non traditionnels et spécialement les biens manufacturés. Enfin, les néo structuralistes critiquent de ce fait le pessimisme exagéré quant aux possibilités d’exportation des pays latino-américains qui a résulté de la mise en pratique de l’industrialisation de substitution aux importations. Au terme de cette analyse, on peut retenir que la position des économistes du courant structuraliste et particulièrement les économistes de la CEPAL a évolué: dans les années 50, en raison du caractère asymétrique de la relation entre le centre et la périphérie, l’approche structuraliste s’était focalisée sur l’industrialisation par substitution aux importations; dans les années 90, la réponse proposée par le courant néo- structuraliste au phénomène de globalisation économique est la recherché et l’atteinte d’une compétitivité internationale accrue. 153 CHAPITRE 9 ENTREMÊLEMENT DES THÉORIES ET MODÈLES DE LA CROISSANCE. Le vif regain d’intérêt que connaît actuellemnet la théorie de la croissance, qui a pris naisssance dans les articles de ROMER (1986) et de LUCAS (1988 à partir de ses Leçons sur Marshal de 1985) ne montre ancore aucun signe d’épuisement. L’heure n’est pas au bilan mais l’attention portée à la théorie de la croissance s’est partagée en trois phases successives durant le dernier demi-siècle. La première correspondait aux travaux de HARROD (1948) et de DOMAR (1947). La seconde vague a été celle du développement du modèle néo-classique. La troisième vague, née d’une réaction aux oublis et aux déficiences du modèle néo-classique. Robert SOLOW90 La croissance économique est généralement définie comme l'augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes longues de la dimension et de la structure d'une économie. Cette dimension, à l'échelle de la nation, est mesurée par deux indicateurs : le Produit Intérieur Brut (PIB) et le Produit National Brut (PNB). Pour qu'il y ait croissance, il faut non seulement qu'il y ait augmentation de la production, mais aussi que ce mouvement ascendant soit durable et non aléatoire (on parle parfois de croissance pour traduire le mouvement d'augmentation de la production à court terme, le terme approprié dans ce cas est expansion). La croissance s'accompagne de changement de structure, des modifications des conditions de la production: investissement en hausse, modification des qualifications de la main-d’œuvre, incorporation du progrès technique par les machines nouvelles, nouvelles habitudes de consommation, modification des anticipations des entrepreneurs ; elle s'accompagne également de mutations sectorielles. Toutefois, dans le cas des PSD, la production d’une matière première d’origine agricole ou minière peut augmenter brusquement du fait de meilleures conditions climatiques ou d'une hausse des cours mondiaux accroissant ainsi la production. Mais cet accroissement de la production, qu'un hasard climatique ou une chute des cours peuvent effacer le lendemain, n'est pas synonyme de croissance. On parlera de croissance si l'augmentation de la production est le fait de nouvelles techniques, de l'amélioration des qualifications du travail, d'investissements supplémentaires, etc. Différentes réflexions sur la situation actuelle du continent se ramènent parfois a trois interrogations majeures : Pourquoi la massification de la pauvreté en Afrique ? Pourquoi des pays comme la Corée du Sud, la Chine de Taiwan et certains NPI ont maintenant un revenu réel par tête vingt fois supérieur à celui de l’écrasante majorité des pays subsahariens qui pourtant étaient au même niveau de développement en 1960 ? Certains pays comme la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Sénégal avaient même un niveau de revenu per capita plus élevé. Quelle est la politique économique capable d’élever le rythme de croissance des économies afin de sortir de la trappe de la pauvreté et amorcer le rattrapage de ces pays qui ont résolu les problèmes essentiels du sous-développement en l’intervalle d’une génération ? 90 R.SOLOW : Perspectives on Growth Theory, The Journal of Economic Perspectives,1994 154 Les théories enseignent que la croissance forte et durable dans l’équité est la solution aux difficultés économiques de l’Afrique. La réduction de la pauvreté est directement corrélée au niveau de la croissance. Depuis les Classiques jusqu’aux théoriciens de la croissance endogène la croissance et le développement résultent fondamentalement de l’accumulation du capital qui permet simultanément d’élargir les capacités de production et la productivité des facteurs. Manifestement ces pays accusent une faible base autonome comme l'établit la quantité impressionnante de matériaux statistiques rassemblés. Dès lors, s'ils veulent s'en sortir et lever tous les obstacles qui s'opposent à l'expansion, ils doivent faire de la croissance l'objectif économique et politique majeur. C'est pourquoi la croissance pour ces pays doit atteindre des performances. Elle doit y être rapide avec les taux les plus élevés possibles compte tenu bien sûr des ressources naturelles, financières et humaines qu'ils peuvent mobiliser. En outre, la croissance doit être régulière et débarrassée de toute fluctuation trop forte, en baisse comme en hausse. Enfin, elle doit être équilibrée, c'est-à-dire que les capacités de production et de consommation doivent correspondre et s'ajuster en permanence. En d'autres termes, la croissance doit être au premier rang de toutes les priorités, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une organisation, une articulation des facteurs de la croissance telle qu'entre deux périodes un agrégat significatif de l'activité économique soit le plus élevé possible. Que faire pour y aboutir ? Deux problèmes sont à régler : - les actions de type macro-économique dans le cadre de la politique générale, - les actions ponctuelles pour élever le taux de croissance. Les actions globales soulèvent la question des orientations de nature stratégique pour savoir comment mener la politique d'ensemble de la croissance. A ce propos, deux tendances s'opposent entre croissance balancée (développement équilibré) et croissance non balancée (développement déséquilibré). Le processus de la croissance peut donc être résumé par le schéma suivant : - Stabilité macroéconomique - Investissement en capital humain - Système financier adapté et sûr - Bonne politique de développement - Environnement institutionnel stable Accumulation du Capital - Accroissement du capital humain - Investissement Emploi Utilisation efficace du capital humain sur le marché du travail Progrès technique -Amélioration de la productivité - Evolution technologique Un bref rappel des théories est indispensable pour bien comprendre les schémas de croissance et leurs déterminants. 155 Section 1 : Rappel des théories de la croissance et des schémas d’accumulation productive. Le monde des théories de la croissance est à la fois varié, complexe et fortement nuancé dans les formulations. Dans leur ouvrage sur « Les nouvelles Théories de la croissance», Dominique GUELLEC et Pierre RALLE s’interrogent pour savoir : Pourquoi, la richesse produite dans les pays les plus développés a-t-elle été multipliée par 14 depuis 1820 ? Pourquoi, depuis la Seconde Guerre Mondiale, le Japon a-t-il une croissance beaucoup plus rapide que les pays occidentaux ? Pourquoi les pays africains veulent-ils une croissance rapide et au taux le plus élevé ? 91Différentes théories de la croissance, depuis le 17ème siècle jusqu’à nos jours, cherchent toujours les réponses à ces questions. Le tableau suivant offre un panorama historique des théories et des auteurs depuis la naissance de l’École Classique jusqu’à nos jours. Tableau 7 : Synopsis de principales théories de la croissance Théories de la croissance A. Smith (1776) D. Ricardo (1817) R. Malthus (1799) K. Marx (1867) Origine de la croissance Division du travail Réinvestissement productif du surplus Réinvestissement productif du surplus) Accumulation du capital J. A Schumpeter (1911, 1939) Grappes d’innovations Modèle postkeynésien R. Harrod (1939), E. Domar (1946) Modèle néoclassique R. Solow (1956) Modèle du club de Rome Meadows (1972) Le taux de croissance est fonction du rapport entre le taux d’épargne et le taux d’investissement Population et progrès technique « exogène » Théorie de la régulation Articulation entre régime de productivité et régime Ressources naturelles Traits caractéristiques Croissance illimitée Croissance limitée en raison du rendement décroissant des terres Croissance limitée en raison de la loi de population Croissance limitée dans le monde de production capitaliste en raison de la baisse tendancielle du taux de profit Instabilité de la croissance, théorie explicative du cycle long type Kondratiev Instabilité de la croissance Caractère transitoire de la croissance en l’absence de progrès technique Croissance finie en raison de l’explosion démographique, de la pollution et de la consommation énergétique Diversité dans le temps et dans l’espace des types de croissance . GUELLEC et P.RALLE : Les nouvelles théories de la croissance, Collect. Repères, Édit. La Découverte 2003 91 156 M. Aglietta (1976) de demande R. Boyer (1986) Théories de la Capital physique ; Caractère « endogène » de la croissance technologie ; capital croissance ; réhabilitation de endogène humain ; capital public ; l’État ; prise en compte de P. Romer (1986), R. intermédiaires financiers l’histoire. Barro (1990), R. Lucas (1988) Source : Angus Maddison, l’Économie mondiale 1820-1992, OCDE, 1995. Toutefois, les théoriciens, quelles que soient leurs sensibilités particulières, partagent : une analyse du sous-développement menée en termes quantitatifs et d'économiste, une approche méthodologique de modélisation du processus de croissance économique ; une politique économique de croissance non pas optimum, mais celle qui pourrait être la plus souhaitable parmi celles qui sont possibles. L'étude de ces trois éléments permet d'évaluer les contours des théories qui portent à la fois les instruments et les politiques économiques. L'approche quantitative se veut une analyse du sous-développement qui se fonde exclusivement sur des critères quantifiables. Pour beaucoup d'auteurs, cette méthode présente au moins deux avantages. D'une part, face à l'extrême enchevêtrement des faits, la théorie doit privilégier ceux qui sont les plus édifiants, les plus décisifs, finalement ceux qui peuvent être quantifiables. Cette caractéristique finit par leur conférer une valeur intrinsèque incontestable. D'autre part, la démarche mettant en avant des faits mesurable, répond à un souci d'objectivité et d'impartialité doctrinale car en définitive, elle se borne à rassembler des faits, à faire un bilan des certitudes. Elle pourrait alors, pense-t-on, fournir une base commune à tous les économistes, quelle que soit leur orientation idéologique. Cet empirisme a fait qu'en fin de compte, cette forme d'analyse a permis de rassembler un matériau statistique extrêmement appréciable sur les pays en voie de développement. Le point de départ de toutes les théories est la reconnaissance du rôle fondamental de l’accumulation du capital dans tout processus de croissance et de développement. Cette découverte majeure provient des économistes classiques qui ont formulé au 18 ème et le 19 ème siècle les premières interrogations sur la croissance. Leurs analyses sont marquées d’une part par l’optimisme d’Adam SMITH et d’autre part par le pessimisme de RICARDO et de MALTHUS. L’approche ricardienne admet que la croissance économique est tributaire du profit qui est perçu par les industriels ; cependant, avec la rente différentielle au fur et à mesure que la population s’accroît, la demande des biens de subsistance augmente ainsi que le prix des biens et la rente des propriétaires fonciers. Donc à long terme le profit tend vers zéro, les capitalistes ne vont plus investir, le stock de capital se stabilise vers un bas niveau. C’est alors l’arrêt de l’accumulation du capital qui va conduire le système vers un état stationnaire qui peut être évitée grâce au concours du progrès technique et à la libre importation des produits étrangers. K. MARX a pris le contre-pied de l’école classique libérale et développé une analyse qui remet en cause la possibilité d’une croissance durable dans une économie capitalistique. En effet, le mode de production capitaliste est caractérisé par l’absence 157 de coordination des producteurs individuels ; l’anarchie des activités entraîne des risques de surproduction car la régulation par le marché n’intervient qu’à posteriori. La concurrence conduit les entrepreneurs capitalistes à augmenter sans cesse leur effort d’investissement, il en résulte une augmentation de la composition organique du capital et une tendance à la baisse du profit qui va alors bloquer le processus d’accumulation entraînant l’économie capitaliste dans une crise irrémédiable. À la différence des classiques, l’état stationnaire provient chez K.MARX du progrès technique et du changement des méthodes de production et non de la rareté. L’approche de la croissance par J.SCHUMPETER met l’accent sur des facteurs importants comme l’introduction de nouveaux producteurs, l’introduction d’une nouvelle forme de production, l’ouverture de nouveaux marchés, la découverte et la conquête de nouvelles sources de matières premières et la mise en œuvre d’une nouvelle méthode d’organisation du travail. L’innovation est mise en œuvre par l’entrepreneur qui tire un profit grâce au monopole temporaire que lui confère l’innovation C’est surtout Keynes et ses disciples qui vont élaborer les modèles de croissance qui mettent en évidence l’importance de l’investissement dans les fluctuations de l’activité économique. Nous avons suffisamment insisté sur les travaux de R. HARROD pour qui l’investissement exerce un double effet dans l’économie : un effet de revenu qui détermine le revenu et la demande globale (avec amplification par le biais du multiplicateur qui exprime l’aspect demande) et un effet de capacité par lequel, il accroît également la capacité de production : c’est l’aspect offre. La confrontation des deux aspects offre et demande fait apparaître une dissymétrie que souligne DOMAR : du coté de l’offre, c’est le montant de l’investissement (I) qui détermine la croissance alors que du côté de la demande, c’est plutôt la croissance de l’investissement (delta I). Tous les modèles de croissance qui s'appuient sur les théories keynésienne et néo-classique accordent à l'investissement une fonction motrice. L’enchaînement est simple : le taux de croissance étant une fonction du taux d'accumulation du capital ou encore du taux d'investissement. Comme on l'a souligné plus haut pour réaliser un taux de croissance élevé, il faut investir en capital physique ou social le plus élevée possible du revenu national. On affame pour équiper car des ressources sont extraites ainsi de la consommation. Évidemment, la théorie ne dit strictement rien sur le pourcentage du revenu national qu’il faut consacrer chaque année à l’investissement. W. ROSTOW avance un pourcentage compris entre 15 et 20% du RN. Seulement ses chiffres restent très arbitraires. Pourquoi pas plus et pourquoi pas moins ? Pour lever cette indétermination relative au niveau requis de l'épargne, des recherches ont été entreprises par MAHALANOBIS dans le cas des PSD (Inde) et par N. NEWMANN, J. TOBIN, M. ALLAIS, O. LANGE et TINBERGEN pour les pays industrialisés. Les résultats obtenus à partir d'évaluations économétriques se réduisent principalement à l'idée qu'une politique de croissance doit chercher un juste équilibre entre les intérêts des générations présentes et ceux des générations à venir. L'investissement doit être distribué avec cette considération de ne léser personne. Les hommes d'aujourd'hui se doivent d'être raisonnables et évaluer avec hauteur toutes les conséquences de leurs actes de consommation. Il faut qu'ils résistent à toutes les tentations même celles qui suscitent dans les coins et recoins de leur existence la plus envahissante et active publicité. En somme, on est à la lisière des questions non économiques. Les travaux de VON NEWMANN vont alors tenter d'opérer un lien entre taux d'intérêt et taux de croissance pour évaluer avec plus de rigueur la répartition optimale 158 du revenu entre investissement et consommation. Seulement le modèle élaboré s'est vite révélé comme totalement inapproprié car trop simple et bâti sur une trame d'hypothèses fragiles comme l'abondance des facteurs, l'égalité entre épargne et investissement, l'absence de progrès techniques, d'économies d'échelle. Toutes hypothèses qui n'ont rien de commun avec la réalité des PSD. La croissance équilibrée sera particulièrement défendue par R. NURSKE et approfondie par R. ROSENSTEIN-RODAN. Le processus de croissance devrait concerner tous les secteurs de l'économie qui se développeront alors dans une proportion mutuelle correcte ou ne se développeront pas du tout. Concrètement, il s'agit d'organiser une intervention généralisée dans tous les secteurs. Ainsi, l'accroissement de l'offre induisant celui de la demande, les fameux cercles vicieux de la pauvreté seront levés par suite de l'élargissement des dimensions du marché subséquent aux revenus distribués. En plus, un autre avantage de cette politique réside dans les économies externes qu'elle autorise et qui pourront être optimalisées par une démultiplication des secteurs d'intervention. Cette analyse a été très vivement controversée. Ainsi, F. MACHLUP rejette tout aussi bien le concept que les formulations analytiques. Il observera d'abord que le concept "est un mot qui a tant de significations que l'on ne sait jamais de quoi parlent ceux qui l'emploient : il faut donc l'effacer du vocabulaire des savants". Quant aux analyses, elles sont si globales qu'elles ne peuvent être expressives des changements réels à opérer. A.O. HIRSCHMAN ajoute que cette théorie de la croissance balancée est une application mécanique des résultats de l'analyse du processus de croissance des pays industriels avancés. Elle est donc inadaptée aux pays sous-développés car son application exige une énorme somme de ces aptitudes qui sont rares dans ces pays. En d'autres termes, ajoute A.O. HIRSCHMAN si un pays est en mesure d'appliquer la théorie de la croissance équilibrée, il ne serait pas sous-développé au départ. Cette insatisfaction théorique a fortement contribué à l'élaboration par HIRSCHMAN de la théorie de la croissance déséquilibrée. L'approche se fonde sur des séquences de déséquilibres successifs qui portent sur les investissements d'infrastructures et les investissements directement productifs. Chaque progrès dans la séquence est induit par un déséquilibre antérieur et provoque à son tour un nouveau déséquilibre qui appelle une nouvelle avancée. C'est donc une série infinie d'effets d'entraînement qui affecte de proche en proche l'économie dans son ensemble. Il faut donc amorcer la croissance par des pôles des secteurs décisifs pouvant exercer des effets entraînants sur d'autres secteurs. La polarisation est la politique de croissance la plus opportune. En déterminant ainsi les domaines d'intervention, les analystes soulèvent la question de moyens. Que la croissance soit équilibrée ou déséquilibrée, son niveau est fonction de celui de l'investissement. Une politique de croissance se ramène à investir chaque année une part, la plus importante possible, du revenu national. De plus, pour qu'elle soit équilibrée, il faut que l'investissement soit égal à l'épargne. En somme, le problème de la croissance devient avant tout un problème d'épargne. On redécouvre alors l'ordonnance de ROSTOW selon laquelle les pays sous-développés n'atteindront des taux de croissance élevés que s'ils épargnent et réalisent des investissements élevés. Les expériences des NPI d'Asie semblent confirmer cette constatation comme l'atteste l'évolution suivante du taux d'épargne (épargne brut sur PIB) : 159 Tableau 7 : Évolution du taux d’épargne 1953 1965 Japon 8 31 Corée 5 8 Taïwan 6 20 Hong-Kong 31 Singapour 30 Philippines 21 Thaïlande 19 Malaisie 24 Indonésie 8 Chine 25 Source : Banque Mondiale : World Tables, 1994 1992 Variation 1965-92 34 35 39 31 40 16,5 34,6 38 33 38 +23 +27 +19 +10 -4,5 +15,5 +14 +25 +13 Cependant, Éric BOUTEILLER et Michel FOUGUIN nuancent le rôle de l'épargne dans la croissance des pays asiatiques en soulignant que «le niveau d'épargne n'est pas une condition préalable du "décollage" économique de ces pays. L'épargne de la Corée du Sud, par exemple, était nulle dans les années 50». Les auteurs soutiennent même l'idée que l'épargne élevée est une conséquence de la croissance rapide. En effet, observent-ils, les agents économiques considèrent, dans un premier temps, que les surplus de revenus, qu'ils obtiennent sont provisoires et qu'il vaut mieux les mettre de côté pour les temps difficiles. La croissance rapide de l'épargne seule rend la croissance rapide sur le long terme. Ce n'est pas l'équilibre qui permet au cycliste d'aller vite, mais la vitesse qui lui permet d'être en équilibre. Cette forme de détermination du taux de croissance aboutit à une impasse théorique car les proportions du revenu consacrées à l'investissement et à la consommation ne sont précisées ni théoriquement ni pratiquement. La politique de fixation des taux de croissance devra se fonder exclusivement que sur un jeu de scénarios. Une autre orientation, dans la détermination des taux de croissance part de la formule améliorée de HARROD selon laquelle G = S- C où le taux de croissance est fonction d'une seule variable : le taux d'accumulation du capital. Cette formule peut s'écrire aussi g.c. = s où g est le taux de croissance ; c le coefficient du capital et s le taux épargné. Cette formule se verra affecter un tel pouvoir magique qu'on n'hésitera pas à en déduire une série de conclusions ponctuelles. Cette équation permet formellement d'envisager deux actions possibles pour fixer le niveau du taux de croissance g : une qui part de c (taux d'investissement) et une autre qui s'appuie sur s (taux d'épargne). La structure de la formule montre que si s est donnée, le taux de croissance g varie en sens inverse de celui de c. Autrement dit, (g) sera d'autant plus grand que © est petit. La politique économique à laquelle on est renvoyé se fonde sur la recherche systématique d'équipements de très faible intensité capitalistique. En clair, le modèle d'industrialisation devra développer les branches et techniques légères. La seconde action se fonde sur l'épargne. Si c est donné, le taux de croissance dépendra du taux d'épargne. On revient à l'idée que la croissance est fondamentalement un problème d'épargne. Cette variable est cependant résiduelle car elle se définit comme la partie non consommée des revenus. L'impasse théorique soulignée plus haut se représente à nouveau. 160 Par ailleurs, on peut ramener cette équation à une identité si l'on admet que : ÄY S I g = -- , s = -et C = -Y Y ÄY alors nous pouvons écrire : ÄY I S -•-= Y ÄY Y ou bien encore I S - = Y Y comme I = S, l'équation indiquée devient identité. I/ Les théories de la croissance après KEYNES La théorie keynésienne comportait trois ruptures fondamentales : l'introduction du temps, le lien entre phénomènes réels et monétaires, et l'impossibilité de concevoir l'équilibre comme état naturel de l'économie. C'est sur ces bases que, dans les années quarante, l'économie politique posera les problèmes de la croissance. Sur le « fil du rasoir » (Harrod) n'est rien d'autre que la traduction, sur le long terme, de l'impossibilité d'assurer ex ante l'égalité entre épargne et investissement. En renouant avec la théorie classique de la croissance et de la répartition, KALDOR, ROBINSON et PASINETTI ont démontré qu'une croissance équilibrée est possible grâce à une modification de la répartition du revenu. Plus fondamentalement, ils démontrent que le taux de croissance d'une économie ne dépend que du taux d'accumulation, variable dont seuls les capitalistes disposent du contrôle. Toutefois, les néo cambridgiens, dans une perspective keynésienne et kaleckienne qui se voulait critique de la pensée néoclassique et marginaliste, construisent une théorie de la croissance et de l'accumulation sans le capital. En ce sens, le capital y est réduit, in fine, à une masse d'argent, à un ensemble de moyens de production. La croissance reste ainsi, de fait, confiée à un progrès technique exogène considéré comme neutre, autrement dit, il ne modifie pas la répartition de la richesse, donc la nature du processus d'accumulation. In fine, le problème de la croissance, tel qu'il est posé jusqu'aux années 1980, n'est qu'un problème de croissance à l'équilibre. On maintient une vision matérielle de la richesse, dont les sources restent non expliquées par les modèles. Ainsi, les différences avec le modèle néoclassique et post-keynésien de Solow ne sont que marginales, bien qu'on ne puisse pas nier leur importance. Chez Solow, c'est la parfaite substituabilité des facteurs de production et la flexibilité parfaite des prix qui assure l'équilibre de la croissance, croissance qui s'avère n'être rien d'autre que la reproduction, à l'infini dans le temps, de l'état présent des choses, une sorte de faux mouvement. Dans le modèle de Solow, la croissance n'est qu'un phénomène temporaire. Sous l'hypothèse des rendements décroissants - hypothèse nécessaire au maintien d'une théorie de l'efficience du marché et de l'équité de la répartition du revenu - la théorie économique ne peut tout simplement concevoir l'accroissement de la richesse autrement qu'en assumant une sphère non économique - celle de la science - qui produirait les sources des gains de productivité. Avec SOLOW, l'économie a néanmoins découvert que le capital et le travail ne peuvent pas expliquer à eux seuls la croissance. Un résidu apparaît : ce résidu peut 161 atteindre 80 % de la croissance. Autrement dit, le capital et le travail ne pourraient expliquer que 20 % de la croissance. Que retenir de tout cela ? L'économie politique renonce à expliquer comment on produit la richesse. Au reste, comment la théorie économique de la croissance aurait-elle pu concevoir la croissance en restant dans un monde maudit de rareté des ressources et des rendements décroissants ? II/ Une nouvelle analyse : la croissance endogène Ce sont justement les rendements factoriels « non décroissants » (la productivité marginale des facteurs capital et travail ne diminue pas en fonction de leur emploi croissant dans la production dès lors que leur qualité peut s'accroître et évoluer) et la non rareté des ressources (en particulier, c'est le travail qui, en tant que capital humain, devient une ressource reproductible et accumulable) qui sont au cœur des tentatives d'une nouvelle formulation des problèmes de la croissance dans les années 1980. En effet, les théoriciens de la croissance endogène procèdent à une critique sévère des modèles néo-classiques sous deux angles. D’abord, ils remettent en cause le cadre théorique néo-classique et notamment celui de la fonction de production dont découlent toutes les propriétés de la dynamique économique. Le principal reproche théorique fait à ces modèles de croissance est l’absence d’explication de la croissance à long terme : le taux de croissance des variables par tête à l’état régulier est égal au taux de croissance du progrès technique exogène donc inexpliqué. La seconde critique est d’ordre empirique dans la mesure où les modèles néo-classiques n’expliquent pas la persistance des inégalités de revenus entre pays. Comment ont été construits les modèles de croissance endogène ? La construction des modèles de croissance endogène procède de la remise en cause de la décroissance de la productivité marginale. Le retour à Adam Smith semblait la seule voie possible, en incorporant les apports de SCHUMPETER, d'ARROW, de KALDOR et de MARSHALL. Quatre idées fondamentales sont alors intégrées dans le modèle de croissance équilibrée de Solow de 1956 : la division du travail est une source endogène de la prospérité (SMITH), l'innovation est le moteur de la croissance (SCHUMPETER), l'innovation naît d'un processus d'apprentissage de learning by doing (Arrow), le progrès technique est une fonction de l'accumulation (KALDOR) et des externalités (MARSHALL) générées dans le temps par l'investissement. Ces théories ont alors été intégrées dans le modèle de SOLOW, tout en maintenant l'hypothèse de la capacité autorégulatrice du marché… bien que l'intervention de l'État soit affirmée comme souhaitable pour garantir les infrastructures nécessaires à la production, pour garantir la protection de la propriété intellectuelle, pour garantir également un développement adéquat du capital humain, mais aussi, d'une partie de la R & D. Développés à partir du premier modèle présenté par ROMER en 1986, les modèles de croissance endogène intègrent ainsi les concepts d'externalité, d'apprentissage et de capital humain, pour concevoir la possibilité d'un progrès technique endogène. Autrement dit, les sources du progrès technique permettant la croissance de la richesse doivent être recherchées à l'intérieur de la production - mais au-delà du capital et du travail - et en dehors du marché. En résolvant très habilement la contrainte des rendements décroissants qu'impose l'hypothèse de la concurrence pure et parfaite et la théorie de la répartition fondée sur la productivité marginale des facteurs, ces modèles laissent apparaître un processus de production de capital humain par du capital humain. 162 Mais quels sont les fondements théoriques du capital humain ? Doit-on les chercher du côté du concept de travail vivant ? En réalité, le concept de capital humain, suivant la définition du mainstream (orthodoxie), désigne l’ensemble des capacités intellectuelles et physiques incorporées aux individus (ou groupe d’individus) et pouvant leur permettre de participer de manière efficiente et efficace à l’activité de production. Il englobe divers éléments tels que l’état de santé, la force physique, les connaissances, les qualifications, la nutrition. Pour G. BECKER, le capital humain correspond à la valeur actualisée des revenus futurs que l’individu attend de son travail, compte tenu de ses aptitudes, de ses capacités, de sa qualification, de son expérience. Que le capital humain soit considéré comme un facteur de croissance n’est pas une idée nouvelle. Déjà au 16 ème siècle, Jean BODIN observait qu’« il n’ya de richessse que d’hommes ». Le capital humain comme facteur de production est introduit dans l’analyse économique depuis une trentaine d’années Le concept de capital humain est fréquemment utilisé en économie depuis au moins une trentaine d’années (SCHULTZ, 1961, BECKER, 1964, GBECKER et LUCAS 1988). Il est maintenant acquis que le niveau de développement d’un pays est étroitement lié à son niveau d’instruction au point même d’en dépendre. L’éducation dans ce cadre devient un facteur d’efficacité qui élève la productivité des travailleurs et contribue de cette manière à augmenter la production. L’éducation est ainsi associée aux autres facteurs traditionnels (capital et travail) pour expliquer les performances et les contre-performances. Diverses études ont essayé de tester et de quantifier l’impact de l’éducation sur la croissance économique. Pour cela il y a deux (2) points : -l’impact global de l’éducation sur la croissance. Par deux méthodes différentes d’évaluation, DENISON (1961) et SCHULTZ (1962) ont abouti à des résultats similaires. Ainsi DENISON calcule que 23% de la croissance des États-Unis entre 1930-1960 était imputable à l’accroissement de l’éducation. SCHULTZ par sa méthode du taux de rendement, est arrivé lui aussi à la même conclusion que l’éducation contribue pour une bonne part à la croissance américaine. - les effets indirects de l’éducation sur la croissance économique qui s’articulent autour de deux points essentiels, d’une part les externalités positives que l’éducation engendre et d’autre part la liaison entre l’éducation et les autres types de ressources humaine comme la santé, la nutrition, la pauvreté, la fécondité etc.… Section 2 : Les facteurs déterminants et mesure de la croissance. Après avoir défini la croissance, on peut se poser la question suivante: quels sont donc les facteurs qui font qu'à un moment donné l'économie connaît une forte croissance, une stagnation ou une croissance négative ? La croissance provient de l'augmentation quantitative et/ou qualitative de deux principaux facteurs de production : le travail et le capital. Elle dépend aussi du progrès technique, des ressources naturelles que nous possédons et subit l'influence des politiques économiques, des facteurs institutionnels, voire sociaux et culturels. I/ Les facteurs déterminants de la croissance Les facteurs de la croissance sont de quatre ordres le travail, le capital, la technologie et les institutions. 163 1°) Le travail Il dépend avant tout des individus qui composent une population, plus précisément la population active, c'est-à-dire la population en âge de travailler exerçant ou recherchant un emploi. La population active constitue le premier déterminant de la quantité du facteur travail. Elle dépend à son tour de plusieurs facteurs: croissance démographique, mobilité sectorielle et géographique, migration des populations. Le second déterminant de la quantité du facteur travail est la durée du travail. La qualité du facteur travail dépend quant à lui de l'âge moyen des travailleurs, du capital humain (connaissances et qualifications) ou de l'instruction et de l'intensité du travail. Dans les conditions actuelles de production, il est établi que le capital humain joue un rôle important. Les théories économiques modernes formulées par W. SCHULTZ et G. BECKER92établissent un lien entre croissance et investissement dans l'éducation : il n'est de richesse que d'hommes. Les pays qui ont les investissements dans l'éducation les plus élevés sont ceux qui ont les taux de croissance les plus élevés. 2°) Le capital Le capital représente l'ensemble des biens matériels permettant de créer d'autres biens. La quantité de capital utilisé résulte des investissements nouveaux, de l'amortissement du capital existant et du taux d'utilisation de ce capital. Sa qualité est fonction de son âge et de la technologie. Il est admis qu'un taux d'investissement élevé (rapport entre l'investissement et le PIB) permet d'accroître l'accumulation du capital, d'augmenter les capacités de production de l'économie et de stimuler sa croissance économique. Cela dépend de la nature des investissements qui composent le stock de capital selon qu'il s'agit soit d'investissements nets ou d'investissements de remplacement, soit d'investissements productifs, de la construction de logements, d'équipements collectifs. 3°) Le progrès technique Celui-ci concerne aussi bien la technologie (mise au point de produits nouveaux, utilisation de nouveaux procédés de fabrication) que les progrès dans l'organisation du système productif dans son ensemble (orientation, spécialisation) et de l'entreprise (gestion, organisation du travail). La principale source du progrès technique réside dans les progrès scientifiques réalisés par les centres de recherches aussi bien publics que privés, les entreprises et surtout l'université, à travers la recherche appliquée, la recherche développement et la recherche fondamentale. S'il existe un bon relais entre les fruits de la recherche et les entreprises, il est indéniable qu'une économie qui investit dans la recherche réalisera une croissance plus élevée que celle qui ne le fait pas. Le progrès technique s'accompagne généralement d'une amélioration de la productivité du facteur travail. C'est pourquoi le progrès technologique est aujourd'hui la clef de la compétitivité. Ces trois principaux facteurs peuvent être résumés dans une équation de la manière suivante : Y F ( K , L, T ) . La production Y est fonction du capital K et du travail L utilisés ainsi que de la technologie T qui détermine la manière dont les deux 164 premiers facteurs sont combinés. Le progrès technique permet à facteurs de production donnés d’obtenir au cours d’une période une augmentation de la production. Toutefois il existe 3 façons dont le progrès technique peut influer sur les facteurs de production. On dira que le progrès technique est neutre au sens de HARROD s’il porte sur le travail et permet une croissance du produit au cours de laquelle le rapport capitalproduit reste inchangé à coût réel du capital inchangé. C’est dire qu’il y a neutralité au sens de HARROD lorsque le progrès technique permet d’augmenter l’efficacité du travail. On dira que le progrès technique est neutre au sens de Solow s’il porte sur le capital et permet une croissance du produit au cours de laquelle le produit par tête reste inchangé pour un taux de salaire réel inchangé. Donc il y a neutralité du progrès technique au sens de Solow lorsque le progrès technique permet d’augmenter l’efficacité du capital. On dira que le progrès technique est neutre au sens de Hicks s’il porte sur le produit. A proportion des facteurs inchangée la répartition reste inchangée. Ainsi il y a neutralité au sens de Hicks lorsque le progrès technique permet d’augmenter l’efficacité des facteurs capital et travail. Dans la fonction de COBB-DOUGLAS les trois formes de neutralité sont équivalentes. C’est pourquoi les économistes l’utilisent généralement. En notant le capital K et le travail L la fonction de COBB-DOUGLAS s'écrit : Y AK a ' Lâ dans laquelle A , a ' , â sont les paramètres, A est le coefficient de proportionnalité ou le progrès technique, a ' et â des indices qui caractérisent l'influence de chacun des facteurs sur le volume de la production, c'est-à-dire, les coefficients d'élasticité de la production par rapport au capital et au travail. a ' et â sont calculés par la méthode des moindres carrés. Si l'on dérive la fonction Y AK L par K et L , on obtient les indices correspondants des produits marginaux du capital et du travail. a' â Y Y Y Y a' â et K K L L La production augmente avec K et L , ce qui signifie que ces facteurs de production ont une productivité marginale positive. Par conséquent, les coefficients a ' et â caractérisent le rapport entre la productivité marginale et la productivité moyenne des facteurs. La transformation logarithmique de cette fonction de production permet de déterminer la part respective de chacun des deux facteurs dans l'explication de la production. On a alors sous forme logarithmique : log Y log A a 'log K â log L Le tableau suivant donne les résultats qui ont été trouvé dans le cas de l’économie américaine. 165 Tableau 1.1: Part des facteurs travail et capital dans la fonction de production aux Etats-Unis entre 1899-1922 Y= A L K a) Séries chronologiques Série I Série II Série III Série IV b) Analyses en coupes Instantanées 1889 1899 1904 1909 1914 1919 Moyenne + A 0,81 0,78 0,73 0,63 0,23 0,15 0,25 0,30 1,04 0,93 0,98 0,93 0,84 1,38 1,21 1,35 0,51 0,62 0,65 0,63 0,61 0,76 0,63 0,43 0,33 0,31 0,34 0,37 0,25 0,34 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 1,01 0,97 58,34 106,43 107,40 90,99 81,66 24 4,21 La spécification de ce modèle a conduit de nombreux auteurs à procéder à des vérifications empiriques et statistiques du modèle de Solow. Les études empiriques ont montré aussi que la spécification de la fonction de production du modèle néo-classique semble incapable d'expliquer l'ampleur de la croissance. Dans son article publié en 1957,93 Robert SOLOW a effectué une analyse empirique du taux de croissance en essayant d’imputer comptablement celui-ci aux croissances respectives du capital, du travail, et du progrès technique. En effet, en prenant la dérivée logarithmique de la fonction de production on aboutit à la formule : . . . . Y K L A a' â Y K L A Cette équation montre que la croissance de la production est une moyenne . pondérée de la croissance du capital, du travail et du terme A . Le terme A A est appelé croissance de la productivité totale des facteurs ou croissance de la productivité multifactorielle. Beaucoup d’économiste comme Solow, Edward Denison et Dale Jorgenson ont cherché à expliquer les sources de la croissance au moyen de cette équation. La plus part de ces travaux aboutissent à la même conclusion : les facteurs capital et travail expliquent une faible part de la croissance de la production. Pour . Solow et Denison le terme A A expliquerait 80% de la croissance américaine. L’une des interprétations de la croissance de la productivité totale des facteurs consiste à l’attribuer au progrès technique. Pour ces économistes, le progrès technique est une variable qui est très difficile à cerner et à mesurer. Mais du fait de l’existence d'un écart de taux de croissance inexpliqué on va assister vers la fin des années 80 au rejet du modèle de croissance néo-classique. Ce rejet va alors considérablement renouveler 93 R.SOLOW : « Technological change and the Aggregate Production Function » 166 l'analyse des théories de croissance et sera à l'origine de ce qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler les théories de la croissance endogène. J. TINBERGEN a introduit le facteur temps e rt dans une fonction homogène pour refléter les mouvements de la fonction de production statique sous l'influence de tout un ensemble de changements qualitatifs réunis sous le terme général de progrès technique. Dans ce cas, la fonction s'écrit : Y AK a ' L1 a 'e rt Dans l'hypothèse où á + â = 1 (puisque la fonction est homogène et linéaire) la différenciation logarithmique de cette fonction donne : y a ' k 1 a ' l r où y = taux de croissance de la production ou du revenu k = taux de croissance du capital l = taux de croissance de la main-d’œuvre r = taux de croissance de la production par suite de la hausse de l'efficacité générale ou du progrès technique Après les travaux de J. TINBERGEN, d'autres économistes notamment R. SOLOW, KENDRICK et E. DENISON ont approfondi l'analyse des facteurs de croissance sur la base de la fonction dynamisée de COBB-D 4°) Les facteurs institutionnels Ces aspects sont d’une importance déterminante. En effet, le gouvernement qui prône la croissance doit s'atteler à fournir un cadre macroéconomique et institutionnel incitatif, motivant, et en même temps favorable à l'entreprise et à l'investissement productif : dans l'infrastructure, l'éducation et la formation ; dans les industries naissantes (non pas indéfiniment et aveuglément mais temporairement) et les PMI et dans les activités exportatrices. II/ Comment mesurer la croissance Pour mesurer le taux de croissance de la production d'un pays, il faut comparer l'évolution du PIB entre deux périodes. Mais, il faut signaler que l'augmentation du PIB en valeur peut être la résultante d'un effet quantitatif (augmentation en volume: par exemple des tonnes de riz produits) ou d'un effet prix (accroissement du niveau général des prix), qui dans ce dernier cas masque une stagnation. C'est pourquoi, l'on retient le PIB en volume ou PIB réel pour mesurer la croissance (PIB en valeur corrigé de l'évolution des prix). Le taux de croissance se définit alors comme la variation relative du PIB en volume d'une année à une autre. D'ailleurs une fois connu, on peut projeter la production future selon la formule : Yt = Yo (1 + r)t où Yt = production à l'année terminale Yo = production à l'année de base r = taux de croissance. 167 Exemple : En 1995 et 1996, le PIB en valeur du Sénégal était respectivement de 2,428 et 2,600 milliards, le niveau général des prix (qu'on peut représenter par le déflateur du PIB, base 100 = 1987) de 152 et 156 le taux de croissance du PIB en volume entre ces deux périodes est : 2600 2428 -- -156 152 tx = -------- = 4,33 % 2600 Un taux de croissance positif signifie que la production du pays à augmenté entre les deux périodes. Mais, le PIB étant une grandeur globale, son augmentation signifie t-elle pour autant que l'économie toute entière se porte bien ? Cela n'est effectivement pas le cas, car en dépit de l'augmentation globale de la production intérieure qu'il traduit, la croissance économique s'accompagne d'une modification des structures économiques. L'exemple du Sénégal est édifiant à ce sujet. En tant que pays agricole, la croissance économique du Sénégal peut être générée par une augmentation de la production agricole, tandis qu'au même moment la production industrielle et les services (tourisme par exemple) peuvent connaître un déclin. De même, au niveau du secteur agricole, l'augmentation de la production peut provenir du Bassin Arachidier tandis que la Zone du Fleuve connaît peut être une stagnation. Cela revient à dire que la croissance économique d'un pays repose sur la production de certains secteurs, régions et produits qui connaissent une augmentation soutenue. En d'autres termes, nous voulons montrer que la croissance économique ne signifie pas que tous les secteurs (agriculture, industrie, pêche, tourisme, etc.) connaissent une augmentation de leur production. C'est cela qui justifie la distribution établie par la théorie économique entre croissance équilibrée (investissement proportionnels dans tous les secteurs) et croissance déséquilibrée qui part des pôles moteurs (pétrole, mine). Une analyse de l'origine de la croissance permet éventuellement d'identifier les secteurs, les régions et les produits qui en sont la cause. Il suffit pour ce faire de calculer et de comparer les parts respectives de chaque produit, de chaque secteur et de chaque région dans le PIB global pour s'en apercevoir. En conséquence, il faut garder à l'esprit qu'un taux de croissance élevé du PIB en volume peut aussi s'accompagner de la baisse de certaines productions et du déclin économique de certaines régions. C'est pourquoi on souligne que la notion de développement est plus riche que la notion de croissance. Section 3 : Le débat des années 70 sur la croissance des PSD: croissance déséquilibrée et croissance équilibrée I/ La thèse de NURSKSE et ROSENSTEIN-RODAN Pour ces deux auteurs, le développement doit se faire de façon équilibrée, c’est-à-dire en lançant la quasi-totalité des activités industrielles et agricoles modernes simultanément. C’est la thèse de la «croissance proportionnée» (NURSKE) censée créer des complémentarités entre les firmes et entre les branches. Ainsi se créeront des économies externes pour les firmes. Par ailleurs, il est prévu que l’offre simultanée dans une multitude de branches, en distribuant des revenus, constitue une demande nouvelle pour chaque production et permettre le décollage du marché intérieur. Il faut enfin ne pas négliger les infrastructures économiques et sociales 168 (IES) qui, seules, permettent les communications, les transports, l’éducation et la santé de la main-d’œuvre. Concrètement, il s’agit de créer un big push (ROSENSTEIN-RODAN) dont le financement ne peut être trouvé que dans l’aide extérieure, voire l’endettement. Au regard des principes de l’école libérale, cette approche apparaît paradoxale pour trois raisons : elle néglige d’abord le principe de la spécialisation en fonction des avantages comparatifs, qu’il s’inspire de RICARDO ou de HECKESCHER-OHLINSAMUELSON ; elle renforce le dualisme des économies sous-développées dans la mesure où l’agriculture traditionnelle n’est pas directement concernée par le « big push » ; elle dilue la capacité d’investissement, par définition limitée, sur une masse de petits projets dont la viabilité n’est que rarement assurée (problèmes d’économies d’échelle). II/ La thèse d’HIRSCHMAN et PERROUX Pour HIRSCHMAN, les difficultés du développement sont d’abord dues à l’indécision engendrée par des situations complexes et des comportements contradictoires. Si le planificateur pense le développement en fonction du groupe, la crainte d’un renforcement des inégalités inhibera bien des investissements. Inversement, si l’on favorise l’entrepreneur individuel, celui-ci sera rarement coopératif et cherchera plus qu’ailleurs sont bénéfice personnel en spéculant sans contribuer au développement. Il faut donc «examiner dans quelles conditions les décisions peuvent être provoquées par des dispositifs d’entraînement ou des mécanismes d’induction». Maximiser la part des décisions induites ou routinières devient alors l’objectif du développement. Les effets d’entraînement induisent les décisions d’investissement. Ainsi, la création volontariste d’une industrie A diminuera les coûts de production pour une industrie B utilisant les produits de A comme consommations intermédiaires (effet d’entraînement en aval). Inversement, l’industrie A constituera un débouché pour une industrie C approvisionnant A en consommations intermédiaires (effet d’entraînement en amont). Dans les deux cas, l’investissement sera considérablement facilité par la présence de l’industrie A. III /Des critiques développement. de la croissance aux interrogations sur le Cependant, dès les premiers temps, des voix s’élevèrent aussi bien au nord qu’au Sud, pour rappeler que les êtres humains devaient être l’objet du développement et non pas seulement son agent. On retrouve d’ailleurs ces idées dans les écrits des plus grands philosophes. ARISTOTE déclare ainsi que «de toute évidence, la richesse n’est pas la chose que nous cherchons, car elle est seulement utile et sert à une fin autre». Qu’est ce qu’une «bonne» croissance économique ? C’est une croissance qui favorise toutes les dimensions du développement humain. C’est une croissance qui : - génère le plein emploi et la sécurité des moyens de subsistance ; - encourage la liberté et le contrôle de l’individu sur sa destinée ; - distribue les avantages équitablement ; 169 - favorise la cohésion et la coopération sociales ; - préserve l’avenir du développement humain. Ce ne sont que des objectifs, et les pays peuvent réussir à en promouvoir certains et pas d’autres. Ce qui compte, c’est de les considérer comme des instruments permettant d’évaluer les progrès réalisés. Un pays qui réussit est capable de convertir l’accroissement de sa richesse en progrès sur le plan du développement humain. Section 4 : Une nouvelle approche de l’économie politique du développement : les théories et modèles de la croissance endogène. Depuis le début des années 80, on assiste à une percée d’une nouvelle approche théorique de la croissance, notamment à travers les théories de la croissance endogène, suite aux travaux DE ROMER, BARRO ET LUCAS et autres. Ces théories accordent le primat à l’accumulation du capital et une place prépondérante à la politique économique dont le champ est situé au niveau de l’accumulation des connaissances, du capital humain, des dépenses d’infrastructures publiques et de recherche pour créer et maintenir les conditions d’une croissance durable. La croissance économique doit être reliée aux caractéristiques internes de l’économie. Les auteurs sont en rupture avec la théorie néoclassique sur au moins trois points : d’abord, le taux de croissance dépend des comportements des agents et des caractéristiques du système économique, ensuite le taux ne s’annule pas à long terme malgré l’accumulation de facteurs de production et enfin dans les modèles le progrès technique est rémunéré et l’innovation technologique s’effectue grâce à l’accroissement du temps de formation ou des ressources consacrées à la recherchedéveloppement. Les théories de la croissance endogène identifient quatre déterminants de la croissance : le capital physique, le capital humain, le capital public et l’innovation technologique. Cependant, l’accumulation de tels facteurs ne suffit pas à engendrer une croissance auto-entretenue, encore faut-il la présence d’un mécanisme qui empêche ou compense la diminution des productivités marginales des facteurs de production au fur et à mesure de leur accumulation. C’est en introduisant les externalités dans l’analyse que les modèles parviennent à résoudre ce problème .Il y a externalité lorsque les décisions de consommation ou de production d’un agent affectent la situation autrement que par les relations de marché. 170 Système d’accumulation : Investissements Capital physique Capital humain Innovations technologiques Institutions et capital social Externalités positives Efficacité des acteurs : productivité et compétitivité Croissance économique endogène Accès aux marchés Accroissement du PIB Développement humain par accès aux services sociaux de base Accroissement des emplois et des revenus Les théories de la croissance endogène ont élaboré trois modèles qui ont fortement contribué à éclairer les articulations des facteurs de la croissance comme les ressources humaines et les institutions qui génèrent les innovations technologiques servant de locomotive à la croissance économique. On peut rappeler qu’il s’agit du modèle du prix Nobel, ROMER (1986 ET 1990), DE LUCAS (1988) et de BARRO (1990). Ces modèles ont une caractéristique commune qui est que l’externalité positive peut provenir soit du capital physique (même si les biens en question sont publics), soit du capital humain «learning by doing», soit des innovations technologiques. Cela signifie que l’investissement dans l’éducation et la santé améliore directement le bien-être des populations mais contribue également au renforcement des différentes formes du capital humain. Dans une économie mondiale où les 171 capitaux, les biens et les technologies circulent librement, ce sont les ressources humaines qui vont différencier les performances. Dans ces conditions, les politiques éducatives comme celles relatives à la santé deviennent des composantes Les recherches économiques corroborent largement le retour d’un vieux débat entre croissance et développement. Ces nouvelles théories de la croissance plus adaptées au contexte de l’Afrique sont, par ailleurs, largement confortées par les expériences historiques de développement observées dans le monde, notamment aux États-Unis entre les années 50 et 70, en Europe dans la période dite des «Trente glorieuses» années de croissance (1945-1975) et dans les économies émergentes d’Asie. Ces expériences ont pour dénominateur commun l’utilisation pleine et entière des principales sources de la croissance, à savoir : le capital physique comprenant les infrastructures de base, c’est-à-dire les routes, les chemins fer, les infrastructures portuaires et aéroportuaires, les ouvrages hydro-agricoles, les télécommunications et l’énergie ; et le capital humain dont les composantes sont l’éducation, la santé et la nutrition. Le concept de capital humain désigne la population valorisée par l’éducation et la santé. Il faut expliciter un peu plus les raisons qui fondent l’investissement dans le capital humain. Il est maintenant établi que dans un marché où les produits, les capitaux et les technologies circulent et s’échangent librement, ce sont les ressources humaines qui différencient les performances des divers pays. En conséquence, l’investissement dans l’éducation se présente comme une composante essentielle de la politique économique. Il est bien établi que pour un niveau donné de PIB par tête, les pays à fort taux de scolarisation ont enregistré un taux de croissance plus élevé que celui des pays à faible taux de scolarisation. I/ Le facteur le plus déterminant de la croissance est le capital physique qui se compose de l’infrastructure de base De façon générale, ces infrastructures comprennent : les réseaux routiers (routes internationales reliant le pays à certains de ses voisins, routes nationales et départementales, routes urbaines et pistes de désenclavement) et le réseau d’assainissement ; les infrastructures portuaires et les projets d’extension des ports secondaires ; les infrastructures ferroviaires ; les infrastructures de télécommunication ; le réseau de fourniture d’eau et d’électricité ; les infrastructures aéroportuaires; Dans la quasi-totalité des pays africains, la caractéristique marquante de ces infrastructures est leur insuffisance quantitative et leur état de délabrement très avancé : moins de 30% des routes revêtues sont en bon état, la plupart des ports secondaires ne sont plus fonctionnels, la fréquence des délestages sur la fourniture de l’énergie électrique en dit long sur la vétusté du matériel de production. 94 L’état actuel de cette infrastructure interdit de parler de marché et de libre circulation des biens, des personnes et des services. Elles constituent alors des contraintes sur la production et les exportations des entreprises installées et ajoutent à la morosité du climat des affaires dans nos pays, en détournant ainsi les flux d’investissements directs étrangers. 94 Banque mondiale : RDM de 1994 : Une infrastructure pour le développement,1994 172 C’est pourquoi le développement des infrastructures de base relance les enjeux de l’intégration. Plusieurs gains peuvent être associés à cette intégration qui découle entre autres facteurs, de l’élargissement des marchés, de l’accroissement du stock de capital humain et de la meilleure répartition des ressources productives. En effet, le problème crucial que rencontrent les firmes implantées en Afrique demeure la faiblesse des débouchés pour leur production. Cela résulte d’une part de la faiblesse de la demande intérieure solvable, et d’autre part de l’étroitesse des marchés des facteurs de production, des biens et des services. En permettant l’extension et le décloisonnement de ces marchés dans une optique de croissance endogène, l’intégration serait très bénéfique. L’État est le principal producteur des biens publics d’infrastructures. En effet, ces biens publics ne peuvent pas être produits par le marché sauf dans les cas exceptionnels des biens publics mixtes comme les radios privées et les routes à péage. Les agents privés ne sont pas incités à les produire du fait qu’ils sont difficiles à rentabiliser. Par ailleurs, les consommateurs peuvent en bénéficier sans couvrir les frais d’accès. De plus, en présence de bien public, il n’y a pas d’efficience parétienne, l’environnement économique devenant non décomposable. Globalement, les infrastructures, comme la sécurité nationale, la défense nationale, l’éclairage public, sont des biens publics que le marché n’est pas incité à produire. Ces biens publics produisent des externalités positives, c’est à dire que l’agent privé qui les produirait aurait un avantage marginal à le produire comparé à ce que la collectivité dans son ensemble tirerait comme avantage de cette production. D’où la nécessité pour l’État de les offrir, d’autant plus que leur impact positif sur le processus de croissance et de développement est avéré. II/ Le capital humain variable principale de la croissance: Les modèles de ROMER, LUCAS et BARRO. L’une des grandes découvertes de l’analyse économique contemporaine est relative à la théorie du capital humain à partir des recherches de trois auteurs : SCHULTZ en 1983, G. BECKER, ROMER en 1986 et en particulier LUCAS en 1988 L’investissement dans le capital humain est au cœur des stratégies mises en œuvre par de nombreux pays pour promouvoir la prospérité économique, l’emploi et la cohésion sociale. Les individus, les organisations et les nations sont de plus en plus conscients qu’un haut niveau de connaissances et de compétences est essentiel pour leur sécurité et leur réussite. L’accord sur ces principes a suscité sur le plan politique aussi bien que social de nouvelles attentes concernant la réalisation d’objectifs économiques et sociaux ambitieux, grâce à un investissement accru dans le capital humain. Cependant les investissements ne seront productifs que s’ils sont bien adaptés à leurs objectifs. Manifestement, les insuffisances quantitatives et qualitatives des infrastructures physiques de base, les faiblesses des systèmes éducatifs et de santé comme la dégradation des sols sont les facteurs qui bloquent l’élévation de la productivité et de la compétitivité des économies africaines. Ils expliquent alors les faibles performances du continent. Considérons l’exemple les maladies tropicales endémiques. Non seulement celles-ci détériorent la qualité du capital humain mais elles entraînent des coûts élevés. Ainsi, l’Afrique enregistre annuellement 300 à 500 millions de cas de paludisme qui occasionnent environ un million de décès et coûtent 2 milliards de dollars. Il en va de même pour le fléau que constitue le SIDA. De plus, vivant sous les Tropiques, environ 60% des africains souffrent d’endémies graves et 173 paralysantes qui ont été éradiquées dans d’autres régions du monde. Les 45% de la population africaine sont âgés de 15 ans et vont alors exercer de fortes pressions sur les structures éducatives et de santé. Le concept de capital humain désigne la population valorisée par l’éducation et la santé. Par ailleurs, certains travaux sur le capital humain ont montré qu’entre les années 50 et 70, la contribution de l’éducation à la croissance économique se serait élevée à 12% au Royaume-Uni, 14% en Belgique, 16% aux États-Unis. Plus récemment, une étude de la Banque Mondiale datant de 1993 et portant sur 113 pays révèle que l’éducation primaire est le facteur qui a contribué le plus à la croissance des économies, en particulier celle des pays d’Asie de l’Est. La corrélation est bien confirmée que pour un niveau donné de PIB par tête, les pays à fort taux de scolarisation ont enregistré un taux de croissance plus élevé que celui des pays à faible taux de scolarisation. Dès lors, dans un marché où les produits, les capitaux et les technologies circulent et s’échangent librement, ce sont les ressources humaines qui différencient les performances des divers pays. Ce qui fait dire à L. STOLERU que l’investissement dans l’éducation se présente comme une composante essentielle de la politique économique. En somme, le développement du capital humain constitue un outil aussi bien pour assurer une croissance économique que pour lutter contre la pauvreté. De surcroît, dans un monde dominé par les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), le savoir est un facteur majeur de la productivité des individus et des nations. Les effets externes du type «learning by doing» qui découlent de l’activité du capital humain permettent alors d’accroître la productivité des agents qui en bénéficient. Ainsi, à l’échelle globale, plus l’approvisionnement en capital humain est élevé, plus la production par tête est importante. Les recherches théoriques comme empiriques (SCHULTZ, ROMER95 ET LUCAS) établissent une corrélation positive entre éducation et croissance économique. En effet, l’éducation crée des facteurs et des comportements favorables à la croissance économique, contribue à l’amélioration de la productivité du travailleur, confère aux individus des capacités à saisir toutes les opportunités de production, d’imagination et de création, développe l’esprit d’entreprise, de compétition et de recherche du progrès et enfin permet à l’économie de disposer d’une main d’œuvre qualifiée. Dans une période caractérisée par les TIC et l’intelligence artificielle marquée, l’éducation devient un facteur déterminant de la performance et de la capacité compétitive des économies. Ces techniques ne peuvent être mises en œuvre que par des travailleurs ayant les compétences et les niveaux de qualification requis. Puisque l’éducation est un moyen privilégié d’accumulation du capital humain, les dépenses publiques consacrées à ce secteur apportent alors une contribution essentielle au processus de croissance. D’ailleurs, ce rôle prépondérant de l’éducation est parfaitement confirmé au plan empirique par les recherches de SCHULTZ (1998) qui Paul ROMER note que « Les idées devraient constituer notre principale préoccupation car elles sont des biens économiques d’une importance extrême, bien plus grande que celle des éléments sur lesquels la plupart des modèles économiques mettent l’accent. Dans un monde physiquement limité, c’est la découverte de grandes idées, conjointement avec la découverte de millions de petites idées qui rend possible une croissance économique durable. Les idées sont les instructions qui nous permettent d’organiser des ressources physiques limitées selon des combinaisons toujours plus performantes » (ROMER, 1996) 95 174 ont montré que les périodes de croissance soutenue de la production vont souvent de pair avec des améliorations en matière d’instruction, de santé, de nutrition et de morbidité. Après le capital physique, le capital humain et le capital de la connaissance, certains économistes ajoutent maintenant aux déterminants de la croissance un capital social. Selon COLLIER (1998), la notion de capital social englobe la cohérence sociale et culturelle interne de la société, les normes et les valeurs qui gouvernent les interactions entre les individus et les institutions dans le cadre desquelles ces normes et valeurs entrent en jeu. Encadré 8 : Le modèle de ROMER Le modèle de ROMER fait ressortir le rôle déterminant du capital humain, source d’accélération de la croissance économique. L’argument peut être résumé de la manière suivante : L’économie produit trois biens : le premier est un bien de consommation produit à l’aide de main-d’œuvre, de capital humain et de biens durables ou d’équipement. La production de ce bien se caractérise, en outre, par des rendements d’échelle constants ; le deuxième bien, qui est le bien d’équipement est produit de la même manière que le premier de telle sorte que les quantités de ressources que sa production nécessite soient proportionnelles à celles engagées dans la production d’une unité de bien consommable. La gamme de biens d’équipement utilisable dépend toutefois du nombre ou de la quantité d’inventions ou de “designs” disponibles. Cette quantité qui correspond au troisième bien, ne résulte pas d’efforts de recherche désintéressés, mais obéît plutôt aux mêmes activités de production des deux premiers types de biens. L’intensité de l’activité de recherche dépend évidemment de l’importance du capital humain qui lui est affecté ou qui est attiré, mais elle dépend aussi de l’expérience collective déjà acquise dans ce domaine. Alors qu’il est vrai que toute invention donne lieu à un brevet d’invention qui permet à son auteur de contrôler son utilisation, il reste néanmoins que, exploitable à travers l’information technique transmise par le nouveau bien d’équipement, elle devient alors fonction à la fois du capital humain qui lui est alloué et du stock de technologie déjà disponible. À la différence du modèle traditionnel de SOLOW où le revenu et la consommation par habitant augmentent le long du sentier de croissance régulière au rythme d’un progrès technique exogène, l’introduction de l’activité de recherche dans le cadre d’analyse permet une endogénéisation de la croissance et offre une explication de la diversité des rythmes observés entre pays. En effet, on peut définir la croissance régulière par l’égalité entre le taux de croissance du stock du capital matériel, de la production et du stock d’invention (en supposant que la taille de la population active est constante). De ce fait, ce taux de croissance commun devient alors une fonction croissante du capital humain attiré dans l’activité de recherche. Dès lors et de manière indirecte, compte tenu d’une répartition d’équilibre du capital humain entre activité de production de biens et activité de recherche, il devient également une fonction croissante du stock de capital humain total. 175 De cette analyse se sont dégagées des conclusions de politique économique assez importantes : La première est que bien qu’elle soit un objectif généralement commercial, toute invention génère des effets externes positifs pour l’activité de recherche et de développement de manière générale. Il en découle que sans intervention de l’État, le marché n’est pas capable de fournir la quantité optimale d’inventions ; indirectement il n’est pas capable d’attirer suffisamment de capital humain vers la recherche et le développement. L’objectif d’efficience dicterait alors soit une subvention à cette dernière activité, soit une subvention à la formation du capital humain qui s’orienterait de lui-même vers une activité qui produit des effets externes. Plusieurs pays en développement auraient alors des taux de croissance économique faibles parce qu’ils ont des dotations faibles en capital humain. L'intégration dans l’économie mondiale par l’ouverture sur les échanges avec l’extérieur et la libéralisation leur permettraient, selon cette approche, de bénéficier de l’ensemble du stock technologique disponible à l’échelle internationale ainsi que des externalités qui en découlent. Le modèle de LUCAS met l’accent sur l’investissement en capital humain, comme source de progrès technique et comporte deux secteurs : le secteur de la production et le secteur de la formation du capital humain. Les travailleurs consacrent une part de leur temps à l’activité de production et l’autre part à la formation. Le niveau total de la production dépend ainsi du stock de capital physique disponible et du niveau de capital humain proportionné au temps consacré à la production par les salariés. S’inspirant des travaux de UZAWA (1965) LUCAS formule l’hypothèse de linéarité de l’accumulation du capital humain. En effet, la formation de capital humain dépend des décisions des agents microéconomiques. Dans le modèle de LUCAS (1988) le progrès technique est endogène car dépend des comportements individuels. Toutefois il existe un effet externe de l’éducation car les individus en sous-estiment le rendement. En conséquence : la croissance trouve son origine dans les décisions individuelles même si à long terme les taux de croissance dépendent uniquement de paramètres exogènes. L’Etat qui gère les externalités, doit mettre en œuvre les politiques propres à aiguiller l’économie de l’équilibre concurrentiel qui résulte des décisions individuelles vers l’optimum social où la croissance est plus forte. Donc il faut des politiques publiques d’éducation agissant sur la croissance. Le modèle de BARRO (1990) illustre le rôle de l’Etat non plus comme gérant des économies externes et réconciliant équilibre concurrentiel et optimum social, mais comme le fournisseur de biens particuliers. Conception très ancienne qui remonte à A. SMITH pour qui l’Etat doit défendre le droit de propriété, assurer la défense nationale et entretenir les édifices publics. BARRO considère l’Etat comme le fournisseur de biens et services collectifs caractérisés par un manque d’incitation des privés à les produire. L’hypothèse de BARRO est que les dépenses publiques permettent de financer des biens collectifs dont chaque agent consomme la même quantité. BARRO fait aussi l’hypothèse que les dépenses publiques sont financées par impôt proportionnel prélevé sur l’ensemble des revenus. 176 Ainsi, les dépenses publiques concourent à la productivité des facteurs (infrastructures, dépenses de recherche,…). Quand un individu investit, il accroît les recettes de l’Etat et donc permet de fournir plus de biens collectifs qui améliorent la productivité marginale du capital. L’équilibre concurrentiel est sous-optimal car les agents privés ne tiennent pas compte de cet effet qui est analogue à un effet externe et n’investissent pas suffisamment par rapport à l’optimum en raison de la différence positive entre la productivité marginale sociale et privée du capital. L’Etat peut provoquer l’égalité des deux grâce à l’imposition d’une taxe proportionnelle sur la production. L’analyse de BARRO suggère d’étudier l’impact de la fourniture de biens publics comme de bonnes institutions sur la productivité des facteurs et donc sur la croissance. En effet, si l’Etat définit un cadre institutionnel tel que le respect de l’Etat de droit soit assuré, les coûts de transaction seront réduits, les échanges accrus et la croissance stimulée. Cette analyse rejoint, de ce point de vue, les idées développées par les « néo-institutionnalistes ». Section 5 : Les issues de la croissance Les recherches récentes tendent à créer un lien entre taux de croissance et réduction de la pauvreté et établissent qu’une croissance longue viendra à bout de la pauvreté. Les études DE DEMERY ET WALTON (1998) montrent que si l’Afrique veut réduire de moitié la pauvreté, elle doit réaliser des taux de croissance régulier d’au moins 7% sur une période de 25 ans. L’investissement devrait alors passer de l’ordre de 35 à 40% du PIB de chaque pays ce qui représente environ 65 milliards de dollars. Même en mobilisant le volume global de l’épargne intérieure, les excédents en devises, l’aide extérieure et les capacités d’endettement, le challenge est quasiment impossible. Il faut alors recourir à l’épargne extérieure et aux IDE pour atteindre cet objectif de croissance économique. Il suffit alors d’enclencher une telle croissance par des investissements lourds. Tableau 15 : Taux de croissance et d’investissement nécessaires afin de diminuer la pauvreté en Afrique de 50% d’ici à 2015 Il s’y ajoute que contrairement à d’autres régions notamment l’Asie et l’Amérique Latine, la production moyenne de l’Afrique, par habitant et en prix 177 constants, à la fin des années 1990 était inférieure à ce qu’elle était il y a trente ans et que sa production industrielle comme sa part dans le commerce mondial ont reculé. Plus grave encore, le Continent est en passe d’être laissé à la marge de la révolution mondiale des technologies de l’information et de la communication. À l’analyse, il est peu probable qu’une croissance, même rapide, résorbe la pauvreté dans des délais acceptables. Il est encore invraisemblable que cette croissance puisse être tirée par les seules exportations, comme la Banque mondiale l’a longtemps cru au mépris de l’histoire économique- y compris celle des pays asiatiques. Ce qui est selon P. ENGELHARD un grand aveuglement intellectuel96. L’auteur passe en revue les quatre postulats implicites ou explicites qui sous-tendent l’ajustement : La croissance économique viendra à bout de la pauvreté. En admettant cette articulation, il convient de savoir ce qu’il faut faire si la croissance ne suffit pas à réduire la pauvreté. La critique prend du relief quand on sait qu’il faut un taux de croissance minimal oscillant entre 7 et 10%, or celui-ci est bien en-dessous de ce chiffre La croissance des « riches » a nécessairement un effet d’entraînement sur le revenu des pauvres. Ce postulat est fragile car la structure de la distribution des revenus est mal connue dans tous les pays et au même moment. Ensuite, il n’existe presque nulle part un État capable de redistribuer les richesses. Enfin mais pour ce qu’on en sait, les inégalités sont telles qu’elles exercent plutôt des effets négatifs97. Il n’y a de croissance que dans une économie non déficitaire. Engelhard a parfaitement raison de souligner le caractère fétichiste de ce postulat et qui n’est, de surcroît ; jamais vérifié historiquement98. La croissance saine est celle qui est tirée par les exportations et les IDE. Théoriquement comme pratiquement, cette assertion est fortement discutable L’échec des PAS et l’impuissance des théories et praxis de la croissance ont relancé les recherches et réflexions sur de nouvelles visons et l’élaboration de programmes alternatifs pour l’avenir fondé sur le développement. Pour être complet, celui-ci ne peut avoir pour centre que l’homme et sa volonté de transformation de la société dans laquelle il vit. En effet, durant les années 70 -80, la crise de la dette avait polarisé l’attention vers la recherche de solutions aux problèmes des déséquilibres externes et internes à court terme. Les réflexions sur le développement et la stratégie de développement à long terme sont totalement reléguées à l’arrière-plan. Conséquemment, l’analyse économique du développement, comme le développement lui-même, sont passés aux oubliettes. C’était l’époque où, selon PRENAB BARDHAN, l’économie du développement a été une jeune fille aux mauvaises fréquentations (l’anthropologie, la psychologie, la science politique, etc.) dans sa quête pour comprendre le changement structurel99. Les principaux sujets de préoccupation études et de recherches portaient sur les conditions de la croissance, la stabilisation, l’endettement, l’aide extérieure pour s’achever sur l’Ajustement Structurel. P.Engelhard : L’Afrique miroir du monde ? Édit. Arlea 1998, 222p Mc Namara alors président de la Banque mondiale écrivait que « les politiques qui ont pour effet d’enrichir les riches n’enrichissent pas la nation. Au contraire, elles entraînent inévitablement le déséquilibre économique et l’instabilité sociale. 98 Le postulat ne tient que si l’endettement est insoutenable au point de compromettre les équilibres à moyen et long terme. 99 Cité par Elsa Assidon 96 97 178 CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE Toutes les théories passées en revue des classiques à la synthèse néo-classique servent de cadre de référence à la fois aux analyses du sous-développement et aux politiques et stratégies du développement. Elles partent toutes de l’idée qu’à l’intérieur d’une société, le développement se fonde sur la combinaison de la force de travail et des moyens de production dont une partie sert à reconstituer les moyens de production (amortissement du capital), à recomposer la force de travail (nourriture, logement, formation). Sur cette base le développement et la croissance sont régulés par des processus amples et profonds de génération et d’absorption du surplus compris comme la différence entre la production qu’une société veut ou peut réaliser et la part de cette production nécessaire pour recomposer les forces productives ayant permis cette production. Ce surplus en effet, peut avoir trois (03) usages partiels : accroître les moyens de production, améliorer la force de travail, financer les dépenses improductives. Toutes les théories du développement et de la croissance avec des outils, des méthodes et des démarches différents s’efforcent d’apporter des réponses à la formation et à l’utilisation des surplus (encore appelés profits, plus-value, fonds accumulés selon les auteurs, les écoles, épargne). Dans cette optique, les théories de la croissance qui s’appuient sur l’augmentation soutenue d’une grandeur de dimension nationale ont fini par s’imposer. C’est d’ailleurs la crise de 1929 qui a amené les économistes à « réinventer » la problématique de la croissance et à retrouver la trace des Grands Ancêtres A. SMITH, et D. RICARDO et mieux quelquefois, à s’apercevoir de l’existence de MARX. Cela correspond à la première vague dont parlait R.SOLOW avec les modèles des néo-keynésiens HARROD DOMAR. Toutefois, il convient d’observe aujourd’hui que les théories de la croissance, si elles ont amené une quantité impressinnantes d’étudesempiriques rigoureuses sur la dynamique des sociétés(surtout capitalistes), si elles fourmillent de formulations astucieuses et sophistiquées, elles ont quelque peu échoué devant ce qui étaient leurs deux (02) objectifs essentiels : donner une traduction simple mais totale de la dynamique de la croissance, dégager les bases d’une politique effective de croissance optimum. Les modèles élaborés en direction particulièrement des PSD souffrent d’un excès de globalisme et de mécanismes qui les rend parfois impropres à l’explication et à l’action. Aucun d’eux n’a entièrement réussi à appréhender la complexité du phénomène de la croissance car ces modèles reposent pour la plupart sur un petit nombre d’hypothèses schématiques. C’est la raison pour laquelle, aucun de ces modèles n’a pu véritablement mener à une découverte théorique de grande importance qui n’ait été faite sous d’autres formes avec d’autres méthodes. Ce sont ces insatisfactions qui expliquent la multiplication des recherches théoriques actuelles, cela d’autant plus que pour les pays sous-développés, la question centrale n’est pas : que faire pour assurer une croissance rapide et harmonieuse ? Mais : que faire pour commencer à croître ? Dans cette optique, la théorie doit changer de terrain et s’orienter vers des processus plus amples qui impliquent la prise en charge des réalités des structures, des systèmes productifs et celles des acteurs de terrain. Egalement des changements doivent s’opérer au niveau des méthodes. 179 Ce sont là quelques corrêction de trajectoire, les nouveaux axes de réflexion que tentent d’ouvrir les auteurs que je regroupe sous le vocable de «structuralistes», qui partagent une vision historico-séquentielle du développement. L’étude de la morphologie du sous-développement devrait permettre de mieux appréhender ces réalités qui font l’objet de multiples controverses au sein de la pensée économique. 180 181 Cette partie de l’ouvrage est certainement la plus importante car elle traite de la morphologie du sous-développement et présente une introduction générale aux objectifs, stratégies et instruments de gestion de ce phénomène. Depuis le temps que les économistes débattent des questions du sous-développement, ils sont encore dans l’incapacité de formuler une définition consensuelle du phénomène. Il est tantôt compris négativement comme tout ce qui est en dessous du développement ou alors plus positivement, il est analysé comme l’état d’une économie qui ne peut surmonter le cercle vicieux de la pauvreté et enclencher un processus cumulatif de production de richesses pour satisfaire les besoins de base. Cette conception normative est souvent sévèrement critiquée et remplacée par un état de retard économique identifié par un certain nombre de critères quantitatifs et mesurables comme le PIB, le Revenu par habitant etc. Cette méthodologie introduite par les Institutions financières internationales (Banque mondiale, FMI et autres) permet alors une classification des PSD en pays à faible revenu, pays à revenu moyen, pays moins avancé, pays pauvre très endetté etc. Le sous-développement exprimant une réalité complexe et variée qui suscite autant de controverses, la meilleure démarche méthodologique est d’en établir une morphologie qui permet d’en cerner toutes les caractéristiques les plus essentielles. Cette connaissance factuelle du phénomène permettra alors de mieux comprendre « ce qui est et ce qu’il faut faire ». Dans ce cadre on circonscrit plus clairement les objectifs que les pays se fixent, les stratégies et les politiques qu’ils mettent en place et les instruments de gestion du développement qu’ils utilisent. Les stratégies et politiques de développement vont apparaître comme des tests et de validité des théories et des instruments de l’analyse économique. Ces politiques et stratégies montreront leurs capacités à élever le niveau des forces productives matérielles et humaines ; construire des systèmes productifs performants et capables d’une insertion gagnante dans la mondialisation devenue inéluctable ; relever le niveau de vie des populations. C’est en réalisant de tels objectifs, que ces politiques et stratégies s’avéreront pertinentes pour sortir les pays du sous-développement. Dans cette optique, cette deuxième partie comprendra cinq chapitres : Ce premier chapitre analyse précisément les traits typiques du sousdéveloppement qu’il importe de prendre en compte dans l’élaboration des politiques économiques. Cette morphologie est présentée sous deux catégories de caractéristiques économiques et non économiques du sous-développement. Le second chapitre traite des questions démographiques et d’urbanisation qui sont deux éléments que les analystes présentent souvent comme un handicap majeur au développement. Bien que le Continent soit relativement sous-peuplé, sa croissance démographique est explosive et, pendant un temps, supérieure à celle de la production. Cette expansion démographique est accompagnée par une urbanisation accélérée, deux phénomènes conjugués qui risquent de générer des problèmes socio-économiques et environnementaux graves en somme des ruptures d’équilibre comme l’amplification de la crise alimentaire. Alors où en est le débat théorique autrement dit, la démographie est-elle un frein ou une opportunité pour le développement et social de l’Afrique ? Le vieux débat introduit par Malthus ne réapparait-il pas aujourd’hui à 182 savoir : « les hommes peuvent se reproduire plus rapidement que les ressources naturelles dont ils ont besoin pour survivre. En conséquence, la population humaine en arriverait finalement à dépasser les capacités de son environnement, ce qui pourrait conduire à sa propre disparition ? ». Le troisième chapitre est une introduction générale aux objectifs, stratégies et instruments de gestion du développement. Les objectifs du développement économique élément premier et déterminant de la stratégie dépendent d’une part des finalités de la société et, d’autre part de la structure socio-économique de celle-ci ainsi que des instruments d’action et de gestion. Pour des PSD caractérisés par le faible niveau des forces productives matérielles et humaines, la croissance est l’objectif auquel tout le système économique et social doit être subordonné. Le choix d’une stratégie est d’une importance capitale et devrait permettre de coordonner les objectifs, les moyens et les acteurs dans une société marquée par la coexistence de plusieurs structures obéissant à une pluralité de centres de décision et l’existence de beaucoup de contraintes de nature diverse. Bien évidemment, la stratégie de développement et de croissance doit se traduire concrètement d’une part dans le choix de leviers qui la feront passer dans les faits et d’autre part, dans le choix des instruments adéquats de la politique économique et financière. La planification s’offre alors comme un instrument de pilotage d’une gestion économique à moyen et long terme. Le quatrième chapitre est relatif aux institutions d’encadrement et de gouvernance et au retour de l’État dans le jeu économique. Depuis longtemps la corrélation entre institutions et développement à été bien établie. L’avènement du « tout marché » avait plus ou moins distendu ce lien que la recherche a maintenant parfaitement rétabli suite aux nombreux programmes de recherche sur les institutions. La stratégie du développement n’est plus uniquement d’ordre économique ; elle est aussi d’ordre humain et institutionnel, c’est ce que montrent les développements dans ce chapitre. L’Etat est ainsi réhabilité et réinséré dans le jeu économique et social. Le cinquième chapitre analyse le modèle proposé de libéralisation des économies africaines à savoir les Programmes d’Ajustement Structurel issus du Consensus de Washington. L’importance et la diversité des questions soulevées dans cette partie rendent indispensable de repréciser les concepts de stratégie et de politique de développement pour éviter toute confusion sur ces idées clefs. D’abord, le développement doit être strictement distingué du concept de croissance. La croissance économique est comprise comme «l’augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes longues … d’un indicateur de dimension ; pour la Nation, le produit national brut ou net en termes réels»100. En fait, dans une optique de croissance, ce qui croit, c’est directement le produit mais elle n’éclaire ni sur les facteurs causatifs qui auraient pu la rendre plus forte, ni sur le jeu des structures favorables ou non ; ni sur la répartition des fruits. C’est pourquoi on peut bien concevoir, comme nous le verrons plus loin « une croissance appauvrissante » qui se 100 François PERROUX : l’Économie du XXe siècle, pp. 558-559. Édit. PUF. 183 produit lorsqu'un pays améliore ses performances sans que certains acteurs ou secteurs économiques en bénéficient. Au contraire, le développement est un phénomène moins répétitif et moins quantitatif. Selon François PERROUX, le développement débouche sur des structures sociales, des institutions, des habitudes d’esprit qui ne sont pas justiciables de formes courantes des équilibres micro et macroéconomiques. En somme, le développement englobe et soutient la croissance. C’est sur cette base que, F. PERROUX définit alors le développement comme «la combinaison de changements mentaux et sociaux d’une population qui la rendent apte à faire croître cumulativement et durablement, son produit réel global». En d’autres termes, si la notion de croissance est partielle et strictement quantitative, celle de développement est plutôt synthétique, à la fois quantitative et qualitative. C’est pourquoi le concept de développement est beaucoup plus riche que celui de croissance ; il peut s’observer dans les expériences historiques des pays une croissance sans développement. Le concept de politique économique est, à son tour, assez controversé et fait l’objet de plusieurs compréhensions. Ainsi, MEYNAUD la définit comme «l’ensemble des décisions gouvernementales en matière économique, gouvernement étant pris au sens large comme couvrant les diverses autorités publiques d’un pays donné»101. Alors que pour O. FANTINI, la politique économique est «l’ensemble des règles et d’actes par lesquels l’État intervient au nom de l’intérêt général dans la vie publique et privée». Dans l’Encyclopédie de l’économie et de la gestion « la politique économique est une action délibérée de la puissance publique se traduisant par la mobilisation d’un certain nombre de moyens pour atteindre des objectifs définis en fonction d’une certaine philosophie ou idéologie »102. La définition proposée par le « Dictionnaire d’économie » est plus large encore « La politique économique vise à la réalisation d’un certain nombre d’objectifs économiques et sociaux parmi lesquels figurent notamment la croissance du niveau de vie et du produit national brut, le plein–emploi des ressources en hommes et en équipements, la stabilité des prix, l’équilibre des échanges et des paiements extérieurs. Une hiérarchie de ces divers objectifs est fréquemment établie en fonction d’une part des contraintes et de l’environnement économique et social du moment, d’autre part des conceptions politiques des dirigeants ».103 Le Professeur TINBERGEN avance une parfaite synthèse en considérant, qu’en définitive, «la politique économique consiste dans la manipulation délibérée d’un certain nombre de moyens mis en œuvre pour atteindre certaines fins». De cette claire définition, il peut ressortir que les politiques de développement pourraient être comprises comme les diverses options sectorielles initiées par les pouvoirs publics pour atteindre des objectifs préalablement définis. Cela suppose l’utilisation de moyens matériels et financiers appropriés mais aussi le recours à des techniques et structures institutionnelles de gestion du développement ainsi que des mutations des structures d’encadrement culturelles et mentales qui accompagnent ces politiques. MEYNAUD : Politique Économique comparée Encyclopédie de l’économie et de la gestion, Édit. Hachette, 1994, p.349 103 Dictionnaire d’économie et des faits économiques et sociaux contemporains, Édit. Foucher, 1999, p 464 101 102 184 CHAPITRE 10 LES CARACTÉRISTIQUES ÉCONOMIQUES ET NON ECONOMIQUES DU SOUS-DÉVELOPPEMENT Il est après tout assez facile de définir à priori une politique de développement et de se livrer à un volontarisme économique pour l’appliquer. Il n’est pas sûr qu’une telle méthode puisse donner des résultats probants, réalistes et efficaces. Sans aucun doute, la meilleure démarche consiste à analyser au préalable les structures et le fonctionnement d’une économie sous-développée avant de définir les politiques de développement qu’il importe de mener. Au départ, il sied de mettre en lumière les structures économiques et sociales auxquelles s’applique la politique de développement dont il faut préalablement dégager les principes généraux qui guident son élaboration. Section 1 : Les Caractéristiques d’une économie sousdéveloppée. L’analyse du sous-développement et de ses diverses représentations constitue, depuis un quart de siècle, selon G.D. DE BERNIS, le microcosme de l’évolution de la théorie économique. En effet, lorsque l’on traite d’une économie sous-développée, on a l’habitude d’énumérer un certain nombre de caractéristiques communes soit quantitatives (critères) ou/et qualitatives (typologie structurelle historique) ; toutefois, une énumération même exhaustive ne suffit pas à produire une définition cohérente. Or c’est d’une définition dont la théorie a besoin comme outil d’analyse. René GENDARME a réuni 21 définitions du sous-développement, ce qui est une bonne indication de la complexité du phénomène mais également de sa diversité. Il est impossible de lister toutes ces définitions, mais au moins trois semblent assez caractéristiques. La première est celle des Nations-Unies qui comprennent le sous-développement comme « la non exploitation optimale de toutes les ressources économiques et humaines disponibles sur un territoire ». La limite saute aux yeux car l’optimum de mise en valeur se retrouve sur tous les espaces territoriaux si tant est que ce concept ait un sens scientifique. La deuxième compréhension, la plus usuelle, assimile le sous-développement à un retard en comparaison avec des pays qui ont atteint un niveau avancé de production, de consommation et d’échange. Cette vision est à la fois simpliste et artificielle, ce que nous avons souligné dans le découpage grossier des étapes de la croissance de W.ROSTOW. Une troisième tentative de définition provient des structuralistes, F. PERROUX, C.FURTADO qui voient dans le sous-développement un processus historique autonome et non pas une étape par laquelle serait passées les économies ayant déjà atteint un certain stade supérieur de développement. Il est un phénomène contemporain du développement, conséquence de la façon dont la révolution industrielle s’est déroulée jusqu’à nos jours ». Cette définition n’est pas très éloignée de celle des marxistes qui considèrent le sousdéveloppement comme le produit du développement capitaliste, une déstructuration sectorielle issue de la domination impérialiste. Dans cette ligne de pensée, Samir AMIN estime que l’analyse du sous-développement occulte la réalité qui est celle d’une formation sociale capitaliste dominée, exploitée et façonnée par l’impérialisme. « La transition au capitalisme périphérique est alors la construction d’une formation 185 sociale capitaliste spécifique à la périphérie à partir de la colonisation et de l’exportation de capital sur la base des modes de production précapitalistes »104 Ces quelques trois définitions montrent l’impossibilité d’un consensus sur l’appréciation du phénomène. 105 Maurice BYE avertit clairement que « La science est d’abord vocabulaire, ensemble de concepts clairement définis. Toute définition doit servir l’analyse qui en usera. Il faut donc savoir, pour donner un sens au terme « sous-développement, à quel service ce mot se trouve destiné. » 106 L’ambiguïté et l’imprécision du concept explique, sans nul doute, que la littérature économique le concernant relève d’abord d’un domaine de controverses, d’évolution rapide des faits et de confusion de l’analyse et de la norme.107 Pourtant, il faudrait pouvoir en rendre compte comme d’une pensée vivante, même lorsqu’elle s’accompagne inévitablement de branches mortes108. Beaucoup d’auteurs, face à la diversité des approches, finissent par traiter d’une économie sous-développée par une énumération de critères et d’indicateurs du sous-développement (voire la douzaine de critères répertoriés par Yves LACOSTE et qui constituent le fondement même de l’analyse critériologique). Il reste qu’une énumération, même exhaustive, ne suffit pas à offrir une définition cohérente. Or c’est d’une telle définition que nous avons besoin comme outil d’analyse. Dans ce cadre, l’analyse du sous-développement se présente comme une combinaison subtile de faits, d’intérêts, de théories, de pouvoirs et de mythes au sein de laquelle cependant, les enchaînements s’expliquent fort bien. Pour dépasser cette diversité apparente et rechercher les éléments qui permettent une caractérisation acceptable de l’état de sous-développement, on va considérer une l’économie sousdéveloppée d’abord par sa structure productive primaire et dualiste, ensuite par son fonctionnement instable et dépendant, et enfin par son incapacité à rompre le « cercle vicieux de la pauvreté ». Cette interprétation s’efforce de regrouper des traits de structures et de fonctionnement en vue de faire apparaître la conséquence majeure : le cercle vicieux de la pauvreté. I/ La première caractéristique est la structure primaire et dualiste 1°) L’économie sous-développée est une économie dominée par des activités productives primaires d’origine agricole et minière Toutes les statistiques établissent qu’une économie sous-développée se caractérise par la prédominance des activités économiques primaires d’origine agricole et minière correspondant à la valorisation des ressources du sol et du soussol. Ces activités occupent la plus grande partie de la population active et fournissent l’essentiel de la production intérieure et des exportations. En ce qui concerne la population active, plus de 60%, sont concentrés dans le secteur agricole et les exploitations minières. Le secteur des industries de Samir AMIN : L’accumulation à l’échelle mondiale, IFAN-Dakar, Édit. Anthropos, 1971 pp163-193. Yves LACOSTE soulignera que « le sous-développement est un phénomène à la fois global et éminemment complexe qui se manifeste dans chaque territoire par une imbrication de symptômes économiques, sociologiques et démographiques et il procède d’une combinaison de facteurs imbriqués les uns aux autres. Cette combinaison n’est pas statique, elle évolue sous l’effet d’un jeu de forces complexes » 106 Maurice BYE : Préface à l’ouvrage de J.FREYSSINET, Le concept de sous-développement 107 G.Destanne DEBERNIS : op. cit. p 103 108 G. Destanne DEBERNIS : Sous-développement, analyses ou représentations, Revue Tiers-Monde, tome XV, n°37 Janvier-Mars 1974 104 105 186 transformation n’emploie qu’une très faible partie de cette force de travail, tandis que l’on enregistre dans beaucoup de pays à une hypertrophie du secteur tertiaire composé essentiellement de l’économie informelle qui a connu une expansion extraordinaire dans la quasi-totalité des PSD. Ce qui s’explique par le développement d’activités commerciales et d’exportation dans les régions côtières, les ports, les grandes agglomérations urbaines ; la prolifération d’intermédiaires de tous ordres, de courtiers, de changeurs, de prêteurs ou d’usuriers, de trafiquants divers et le développement des services personnels (domestiques) en raison du faible coût de la main-d’œuvre faisant suite à l’exode rural massif. Tableau 8 : Pourcentage de la main d’œuvre utilisée dans l’agriculture, l’industrie et les services en Afrique. Année 1980 1985 1990 1996 Agriculture 70 67 65 62 (en%) Industrie 11 12 13 15 (en%) Services 19 21 22 23 (en%) Source : BAD, Rapport sur le développement en Afrique, année 2005 La conséquence de cette répartition de la population active est une utilisation improductive de la force de travail et, plus particulièrement, le chômage déguisé dans l’agriculture qui se traduit par une productivité marginale du travail nulle et une baisse du rendement par actif rural. Il est devenu important pour les politiques agricoles d’évaluer avec exactitude le chômage déguisé. Cela peut se faire en calculant le nombre d’hommes qu’il faut dans l’agriculture pour obtenir une certaine production, compte tenu des cultures, des techniques et de l’équipement. La situation de sous-développement est aussi révélée par la structure primaire de la Production Intérieure du pays. Celle-ci se compose principalement de produits agricoles et miniers à savoir: les produits agricoles servant à la subsistance de la population ; les matières premières agricoles affectées à l’exportation; les matières premières minières destinées à l’exportation. Quant à la production industrielle, sa part dans le PIB est faible. Cette donne sectorielle sera approfondie dans l’analyse des politiques économiques dans les deux secteurs que sont l’agriculture et l’industrie Enfin les exportations sont révélatrices de la situation de sous-développement. Celles-ci se concentrent sur un ou deux grands produits de base (d'origine agricole ou minière). L’étude de la structure de la production intérieure et des exportations fait apparaître le caractère paradoxal de la spécialisation dans les pays sous-développés : la spécialisation est très forte par rapport au commerce extérieur, mais elle est très faible par rapport au marché intérieur, de sorte que ces pays doivent importer de l’étranger certains produits de consommation qu’ils ne réussissent pas à produire eux-mêmes. 187 2°) Le sous-développement est marqué par un dualisme sectoriel de l’économie L’économie sous-développée est dualiste en ce sens qu’elle comprend deux secteurs économiques juxtaposés ayant de très faibles relations interindustrielles : un secteur précapitaliste et un secteur moderne d’essence capitaliste qui se subdivise en un sous-secteur constitué d’un capitalisme étranger et un sous-secteur capitaliste autochtone très faiblement industriel, mais surtout commercial et immobilier. L’économie dualiste est une économie « désarticulée » selon l’expression de M. François Perroux, c’est-à-dire qu’il n’existe entre les deux secteurs que de très faibles relations. Le premier secteur développé est articulé au système mondial dont il est le prolongement alors que le secteur autochtone stagne et ne reçoit pas de l’extérieur les impulsions nécessaires. L’étude du caractère dualiste et désarticulé des économies sous-développées apparaît mieux encore quand on discute du rôle joué par les firmes étrangères dans le pays sous-développé : pour apprécier ce rôle, on peut se placer à divers points de vue de l’orientation des activités, de la distribution des revenus, des investissements et au point de vue social. II/ La deuxième caractéristique est relative au fonctionnement d’une économie sous-développée. 1°) le fonctionnement de l’économie sous-développée est instable C’est le premier trait caractéristique du fonctionnement d’une économie sousdéveloppée. Il se manifeste à un triple niveau celui de la production, des exportations et des termes de l’échange. D’abord concernant la production, son instabilité provient de la forte corrélation de la production agricole aux aléas de la nature : de bonnes récoltes peuvent alterner avec de mauvaises. Pour ce qui est de la production minière, son volume est fonction du volume des exportations, qui elle-même dépend de la demande extérieure des acheteurs étrangers et des firmes étrangères qui dressent des plans de production pour l’ensemble de leur espace mondial d’implantation, sans tenir compte des intérêts particuliers des pays producteurs où elles exercent une partie de leurs activités. Ensuite pour ce qui est des exportations : les débouchés sont soumis à de fortes fluctuations liées à plusieurs facteurs qui échappent complètement aux pays producteurs : fluctuations du volume des exportations ainsi que celles des prix. Les conséquences de cette instabilité dans les exportations sont graves pour l’économie sous-développée : évolution erratique des recettes d’exportation qui provoquent d’une part des fluctuations décalées dans les importations et aggravent d’autre part la situation générale de l’économie sous-développée en ce sens que les phases d’expansion favorisent le développement de productions marginales ou additionnelles qui provoquent en fin de compte une surproduction. De plus, l’instabilité des prix des produits exportés incite les acheteurs étrangers à développer les produits de substitution (produits synthétiques) qui ont des prix prévisibles et facilitent ainsi le calcul des coûts de production. Enfin, dans le domaine des termes de l’échange sur lesquels nous reviendrons plus en détail, dans le cas des PSD, les prix à l’exportation sont, en première analyse, les prix des produits primaires ; les prix à l’importation sont les prix des produits 188 manufacturés importés. Dans ce contexte, l’instabilité des prix à l’exportation des produits primaires explique l’instabilité des termes de l’échange de ces PSD. Le phénomène le plus important en ce qui concerne les termes de l’échange est leur évolution de longue période qui peut être caractérisée par deux mouvements opposés : la détérioration et l’amélioration. Dans ses travaux M. Raul PREBISCH constate que les changements observés dans les termes de l’échange indiquent que les PSD ont permis la croissance du niveau de vie dans les pays industrialisés sans recevoir, dans le prix de leurs propres produits, une contribution équivalente à leur propre niveau de vie. « Tandis que les centres gardèrent l’entier bénéfice du développement technique de leurs industries, les contrées périphériques leur transférèrent une part des fruits de leur propre progrès technique ». On notera que les théoriciens de l’échange inégal s’inscrivent dans les mêmes lignes de conclusion. Cependant, pour C. P. KINDLEBERGER, le problème central des pays sous-développés n’est pas tant celui des termes de l’échange que celui de la très faible mobilité des ressources. Cette immobilité relative est aggravée par la technologie utilisée dans les productions primaires, qui permet souvent une entrée facile dans une activité économique, mais une sortie difficile en raison des faibles possibilités d’adaptation de l’économie sous-développée : « le développement économique est accéléré davantage par la recherche d’une qualification pour la force de travail à tous les niveaux, par le flux de capitaux nouveaux, par la flexibilité et l’action de l’entrepreneur, que par des efforts en vue de manipuler les termes de l’échange ». 2°) le fonctionnement dépendant de l’économie. L’économie des PSD est triplement dépendante de l’extérieur. Globalement ce sont des économies qui fonctionnent par et pour l’économie mondiale. La première dépendance se manifeste vis-à-vis des grandes firmes multinationales qui exploitent les matières premières agricoles et minières et qui en assurent les exportations. Cette dépendance est la conséquence de la spécialisation. La seconde dépendance concerne les importations de biens manufacturés et de services. En analysant les importations des PSD, on constate trois postes importants : les biens d’équipement et de consommation intermédiaire destinés aux industries locales ; les importations de produits alimentaires destinées à couvrir le déficit alimentaire ; les biens de consommation finale de luxe de la minorité privilégiée par la fortune. Cette dernière catégorie de biens de consommation a fait l’objet de plusieurs réflexions à cause de son incidence négative sur l’équilibre extérieur. À l’heure de la mondialisation, beaucoup de moyens permettent le jeu de l’effet de démonstration et un mimétisme de consommation se traduit dans les pays sous développés par une aspiration à des niveaux de vie de type américain ou européen. Cet effet entraîne un accroissement des importations de biens de consommation, souvent non essentiels, ce qui provoque des déséquilibres de la balance des paiements et une utilisation improductive des devises obtenues par les exportations ou par l’aide extérieure. 189 Tableau 9: Composition des exportations régionales : part des matières premières en %. RÉGION 2000 2002 Amérique du Nord 10 10,7 Europe Occidentale 9,4 9,4 Asie 6,5 6,6 Amérique Latine 18,4 19,3 Afrique 12,9 15,8 Source : BAD, Rapport sur le Développement en Afrique, 2005 La troisième dépendance est relative aux importations de capital en provenance de l’étranger. Le déficit d’épargne contraint les PSD à recourir aux Investissements Directs Étrangers pour financer les investissements, à l’Aide Publique au Développement et aux divers prêts des Institutions Financières Internationales. Cette mobilisation de ressources externes demeure indispensable malgré les observations pertinentes et opportunes de A. LEWIS, qui écrit : « Aucune nation n’est assez pauvre pour ne pas pouvoir épargner 12% de son revenu national, si elle le désire ; la pauvreté n’a jamais empêché les nations de se lancer dans les guerres, ou de gaspiller leurs substances d’autres façons. Moins que les autres, ces nations ne peuvent plaider la pauvreté, dans lesquelles 40% environ du Revenu National sont détenus par les 10% supérieurs des titulaires de revenu, vivant luxueusement de leurs rentes. Dans de tels pays, l’investissement productif est faible, non pas parce qu’il n’y pas de surplus, mais parce que le surplus est utilisé … à construire des pyramides, des temples et d’autres biens durables de consommation, au lieu de créer du capital productif. Si ce surplus allait sous forme de produits aux capitalistes ou, sous forme d’impôts, à des gouvernements ayant une inclination pour la productivité, des niveaux beaucoup plus élevés d’investissement seraient possibles sans inflation » (p. 236). 109 Tableau 10 : Les IDE en Afrique et dans le monde de 1980 à 2005 en milliards de dollars EU aux prix courants. 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Années Monde 55,3 201,6 1409,5 832,2 617, 7 557,8 710,5 916,3 Économies en développement 7,7 35,9 254,6 210,5 162,1 172,8 260,2 320,7 Afrique 2,8 9,6 19,9 13 18,5 17,2 30,7 22,6 148 112 96,1 110,1 156,6 199,6 0,4 Éonomies en développement 0,66 d’Asie Source : CNUCED, Manuel de Statistiques 2006. 109 A. LEWIS: The Theory of Economic Growth (1956), 190 III/ La troisième caractéristique : le sous-développement incapacité à briser le « Cercle Vicieux de la Pauvreté » comme Le cercle vicieux de la pauvreté se définit comme une sorte de causation circulaire selon laquelle la pauvreté engendre la pauvreté à travers des revenus très faibles et en conséquence une épargne faible pour permettre un investissement substantiel générateur de croissance, donc d’accroissement des revenus. Tout se passe comme s’il existait des mécanismes qui empêcheraient le pays sous-développé de connaître un accroissement d’activité. Cette notion peut revêtir deux aspects : un aspect stationnaire qui induit ce que R. NURKSE appelle un équilibre de sousdéveloppement et un aspect dynamique à partir de processus cumulatif renforçant la constellation circulaire de forces maintenant l’économie sous développée en état de pauvreté. Cet aspect a été mis en relief par G. MYRDAL qui a étudié ces processus cumulatifs de croissance ou de régression, qui augmentent les inégalités entre régions à l’intérieur des nations ou entre nations à l’intérieur de la communauté internationale. Figure 7: Cercle vicieux de la pauvreté DU COTE DE L’OFFRE GLOBALE DU COTE DE LA DEMANDE GLOBALE Faiblesse des revenus Investissem ent réduit Faible capacité d’épargne Manque de capital Faible productivité Faible productivité Faiblesse des revenus Demande insuffisante Incitation à investir réduite 1°) L’aspect stationnaire L’équilibre de sous-développement peut s’expliquer d’abord par la formation du capital nouveau, limitée par l’insuffisance de l’épargne résultant du faible niveau du revenu réel, l’offre de capital est alors déficiente. Également, la demande de capital est déficiente parce que les occasions d’investissement sont insuffisantes et l’incitation à investir inexistante. On constate au niveau des PSD trois situations : une demande de consommation intérieure faible, par suite des faibles niveaux de revenus, ce qui déprime la demande d’investissement dans toutes ces branches, une absence de main d’œuvre qualifiée nécessaire à l’application des techniques modernes de production, une insuffisance des infrastructures économiques sans lesquelles une entreprise de type moderne ne peut s’établir et se développer. Lesdites infrastructures sont les ports, les voies de communication, le système bancaire, les centres de production et de distribution de l’énergie. 191 Pareille situation produit deux conséquences particulières : d’abord, l’investissement international privé se concentre dans les activités d’exportation et non dans la production pour le marché intérieur. En effet, les capitaux privés tendent toujours à se déplacer vers les pays où existe un marché massif et prospère, non vers les pays où le capital est peu abondant et où sa productivité marginale serait pour cette raison plus élevée. Ensuite, si une épargne se forme dans un pays sousdéveloppé, chez les titulaires de revenus élevés (et on sait combien la répartition du revenu est inégale dans un tel pays), elle n’est pas affectée à l’investissement productif, mais à des emplois souvent improductifs et peu favorables à la croissance de l’économie (placements dans les pays étrangers développés, thésaurisation sous des formes diverses, constructions résidentielles de luxe, encaisses spéculatives.) Dans les PSD, les titulaires de hauts revenus ont parfois des excédents substantiels d’épargne mais le principal problème est de savoir comment détourner cette épargne vers des emplois plus productifs. 2°) L’aspect dynamique du cercle vicieux Il s’agit d’un élargissement du cercle conformément à l’analyse de G. MYRDAL qui considère qu’autant le développement appelle le développement, la pauvreté appelle une plus grande pauvreté. G. MYRDAL a mis en relief ces processus cumulatifs de croissance ou de régression, qui augmentent les inégalités entre régions à l’intérieur des nations ou entre nations à l’intérieur de la communauté internationale. En effet, le jeu des forces du marché a pour conséquence que tout centre d’expansion industriel ou commercial exerce une attraction d’hommes, de marchandises et de services, de capitaux, de vie intellectuelle et sociale et diffuse deux séries d’effets : d’appauvrissement des régions moins favorisées (backwash effects), qui se manifestent sous des formes diverses : émigration des éléments jeunes et actifs de la population, émigration des capitaux, le système bancaire captant les épargnes des régions pauvres pour les orienter vers les régions en plein essor, disparition des industries concurrencées par celles des régions développées qui disposent de marchés plus vastes et travaillent dans la zone des rendements croissants, régressions de l’agriculture qui demeure l’activité prédominante mais dont le niveau de productivité est en baisse, insuffisance des services publics (routes, voies ferrées, services sociaux, etc.) d’entraînement (spread effects) sur les régions environnantes, qui balancent les effets d’appauvrissement. Mais ces effets sont d’autant plus faibles que le pays est plus pauvre ; leur intensité est fonction du niveau de développement. En appliquant ce schéma à l’économie internationale, on en déduit que les relations internationales, les échanges d’hommes, de produits et de capitaux, se font en faveur des centres développés tandis qu’ils vont dans le sens d’un appauvrissement progressif des régions sous-développées : élimination de l’artisanat local, développement des productions primaires en vue de l’exportation vers les régions développées, exportation de capitaux par les capitalistes des pays sousdéveloppées, qui justifie la formule selon laquelle on ne prête qu’aux riches. 192 Comme les effets d’entraînement sont faibles ou nuls dans les pays sousdéveloppés, les effets d’appauvrissement s’exercent sans y être de quelque façon contrebalancés. L’étude du « cercle vicieux de la pauvreté » dans ses aspects statistique et dynamique nous conduit à deux conclusions : d’abord, elle met en relief les nécessités nationales d’une politique de développement et indique les voies d’action qui doivent être suivies, et ensuite elle montre que la croissance des économies sous-développées impose une prise de vue mondiale des problèmes à résoudre et appelle des solutions à l’échelle mondiale. De même que les phénomènes de sous-développement traduisent l’absence d’une communauté internationale structurée et organisée, le succès de tout effort de développement dépendra de l’instauration dans les consciences, dans les institutions et dans les politiques, du désir de réaliser une telle communauté. 3°) Une vision de la Banque mondiale des cercles de causalité. Cette approche très proche de l’analyse « des cercles vicieux » consiste à proposer la configuration de notions à fortes interactions cumulatives des cercles de causalité qui peuvent être dits soit vertueux, soit vicieux. « La réussite dans un volet d'un des cercles facilitera l'amélioration dans d'autres, mais on peine à concevoir que l'Afrique prenne sa juste place au 21ème siècle à moins qu'il n'y ait progrès dans la résolution des problèmes dans tous les cercles. Le programme en chantier peut être réparti dans quatre de ces cercles : amélioration de la gouvernance et résolution des conflits; investissement dans la population; augmentation de la compétitivité et diversification de l'économie; enfin, réduction de fa dépendance envers l'aide et renforcement des partenariats »110. 110 Banque mondiale : L’Afrique peut-elle revendiquer sa place au 21ème siècle p 47 et suivantes 193 IV/ L’Approche marxiste du sous-développement à travers l’analyse de S. AMIN Les formations sociales périphériques constituent la partie centrale de l’ouvrage de Samir AMIN qui mène son analyse non plus en termes de mode de fonctionnement, mais en termes de modes de production et de formations sociales. La construction d’une formation sociale capitaliste spécifique à la périphérie s’effectue à partir de la colonisation et de l’exportation de capital sur la base des modes de production précapitalistes. La théorie de la transition au capitalisme périphérique livre deux séries de résultats: d’une part, en ce qui concerne les conditions nécessaires pour que s’établisse le mode de production capitaliste à la périphérie « celles-ci sont au nombre de deux essentiellement : la prolétarisation et l’accumulation du capital argent 111 ce qui insiste sur la dissolution des anciens rapports pour libérer la force de travail nécessaire à l’établissement de rapports de production capitalistes, libération obtenue le plus souvent par la violence, et d’autre part en ce qui concerne la dynamique de l’accumulation : « Le mode de production capitaliste tend à devenir exclusif c’est-àdire à détruire les autres modes de production. Sur ce dernier point Samir AMIN développe la spécificité du mode de production capitaliste dans les formations sociales capitalistes de la périphérie qui réside dans la carence des rapports de production à dominer le développement des forces productives, ce qui conduit d’un côté à la non industrialisation, et de l’autre à la consolidation des rapports de production capitalistes. 111 S.AMIN : idem p 165 194 Le développement du capitalisme périphérique ou le développement du sousdéveloppement se manifeste selon S. AMIN par trois distorsions :112 une distorsion décisive en faveur des activités exportatrices qui absorberont la fraction motrice des capitaux en provenance du centre ; une distorsion en faveur des activités tertiaires qui traduit les contradictions particulières au capitalisme périphérique et les structures originales des formations périphériques ; une distorsion dans les choix des branches de l’industrie en faveur des branches légères, accessoirement en faveur des techniques légères. Plus spécifiquement, les formations sociales capitalistes périphériques africaines partagent trois caractéristiques communes : la prédominance du capitalisme agraire et commercial dans le secteur national, la constitution d’une bourgeoisie locale dans le sillage du capital étranger dominant, la tendance du développement bureaucratique original, propre à la périphérie contemporaine. Cette troisième caractéristique engagerait les formations sociales vers un « capitalisme d’État » parfaitement compatible avec les exigences du centre et la reproduction des rapports capitalistes internes aux pays sous-développés.113 Section 2 : Les développement caractéristiques extra-économiques du Le Japon est le seul pays de peuplement non blanc et de culture non occidentale à avoir réussi à faire fonctionner efficacement un système politique démocratique et une économie libérale performante en ne se fondant que sur ses valeurs propres de civilisation. L’une de ces valeurs est l’investissement sur l’homme considéré comme le capital le plus précieux. Dans ces conditions, un PSD ne peut entreprendre et réussir un développement durable que si les structures d’encadrement sont compatibles avec les stratégies et politiques de développement. On peut se demander au premier abord si l’économiste a quelque compétence pour étudier les rapports entre civisme et développement. Dans la pensée économique néo-classique dominante, le développement se réduit à des conceptions strictement économiques et ne met en jeu que des variables de même genre, techniques et quantifiables, découlant des postulats de rationalité de l’homo economicus qui est une créature se présentant de façon isolée sur le marché, dépourvu de passé historique, d’opinions politiques et de relations sociales en dehors des simples échanges marchands. Dans cette optique, les relations hors marché et les institutions n’entrant pas dans le cadre du marché sont supposées n’avoir aucune répercussion significative sur 112 113 S.AMIN : idem pp. 197-338 Moustapha KASSE : La transition du sous-développement au socialisme, Édit. Silex 195 les activités de développement économique et social. En conséquence, les économies ont une nature statique et dépourvue de passé, le changement et les évolutions marquantes ne résultent que des seules variables économiques et technologiques. Ainsi débarrassées des relations sociales et de leur dynamisme historique, les économies sont réduites à de simples appareils techniques servant à l’allocation des ressources rares. Cela permet aux théoriciens de s’installer dans un monde d’hypothèses universelles et de modèles formels. Toutefois, il est généralement admis que les performances économiques dérisoires des politiques de développement appliquées depuis plus de deux décennies prennent leur source pour l’essentiel dans le caractère réducteur de ces analyses étroites et simplistes qui ignorent la complexité des réalités socio-économiques des PSD. Cette vision technocratique du développement est fondamentalement erronée. Il est aujourd’hui globalement admis que la viabilité de toute stratégie de développement dépend d’une multitude de paramètres extra-économiques. En effet, il est impossible d’étudier les problèmes du développement sans prendre en considération le contexte social de l’activité, les relations que les hommes nouent entre eux et les choses. En conséquence, tout développement économique doit, à mon sens, s’insérer dans une synergie sociale. Deux attitudes sont alors possibles : celle de l’ingénieur qui s’en remet à la mécanique et à la technique et celle du biologiste qui tient compte de tous les éléments de l’environnement. Cette deuxième vision est plus féconde et exige alors de compléter l’analyse en intégrant des variables non économiques. Cette opinion peut être appuyée par le référentiel d’économistes classiques comme contemporains qui, dans leurs esquisses d’une théorie valable de la croissance et du développement, font une très grande place aux variables extra-économiques. Déjà, J. S. MILL, dans ses Principes d’Économie Politique (1848), observait qu’au titre des moyens de réaliser l’accumulation du capital dans les autres pays, il faut ajouter « 1°) un meilleur gouvernement ; 2°) l’amélioration de l’information du public, le déclin des usages ou des superstitions qui empêchent l’efficacité de l’industrie ; la croissance de l’activité mentale qui éveille les esprits à de nouveaux objets de désir ; 3°) l’introduction des arts étrangers et l’importation du capital étranger ». Dans la même lignée de réflexion A. MARSCHALL note que « la longue période est celle où il faut faire intervenir non seulement la possibilité de variation du capital fixe, mais encore de nombreux autres facteurs variables tels que l’état des connaissances, les goûts des sujets économiques, etc.… ». C’est surtout J. SCHUMPETER qui va insister sur ces variables non économiques déterminantes : « Abandonnons le domaine des considérations purement économiques, tournons-nous maintenant vers le complément culturel de l’économie capitaliste, si nous voulons parler de langage de Marx, et vers la mentalité qui caractérise la société capitaliste, en particulier la classe bourgeoise ». C’est après avoir étudié la « Civilisation du Capitalisme » que Schumpeter répond à la question de savoir si le capitalisme peut survivre. Ce système dit-il n’est pas menacé sur le plan proprement économique, « il est en péril parce que les murs qui le soutiennent sont croulants : les structures sociales protectrices, les idéologies et les représentations mentales liées au capitalisme sont menacées de destruction ou en voie de transformation ». Le professeur YOSHIMORI s’est posé la question de savoir « Pourquoi les japonais se sont mis à se développer, à s’industrialiser et pourquoi les japonais ont-ils réussi sur le plan économique ? C’est paradoxalement la réponse japonaise donnée au 196 défi occidental. Avant la moitié du siècle dernier, les japonais vivaient tranquillement, en paix, isolés du reste du monde, dans de petites îles où le système féodal avait réglé la vie pendant près de trois siècles. Un jour, vers le milieu du siècle dernier, un bateau noir était venu. Il s’agissait d’un bateau des américains qui avait forcé la porte du Japon en raison du ravitaillement pour les Américains qui naviguaient entre les États-Unis et la Chine. Les japonais voyaient de plus en plus les pays asiatiques colonisés par les puissances occidentales (la Chine, d’autres pays), et ceci était ressenti par les japonais comme une réelle menace à l’intégrité nationale du Japon. La seule solution pour les japonais face à ce défi technologique tout à fait énorme est de concurrencer les Occidentaux sur leur propre terrain, c’est-à-dire en empruntant, en assimilant systématiquement les technologies occidentales. Les japonais étaient, et sont aussi fiers, fiers de la tradition, et ce n’était pas facile pour les japonais, à cette époque-là, de faire quelque chose, d’adopter les produits de la civilisation occidentale. Donc, on a inventé une formule : même si on assimile au Japon les technologies occidentales. C’est par le biais de l’âme japonaise que les japonais le feront. C’est ainsi que l’âme japonaise et la technologie occidentale étaient devenues une espèce de slogan pour les japonais. Et le but de cette assimilation de la technologie occidentale était de préserver au Japon son intégrité territoriale et également son identité politique et culturelle dues. Ce sont ces deux éléments, l’un géographique et l’autre historique, qui sont à la base de la modernisation et de l’industrialisation du Japon. » Dans le même sens, le Professeur LISSOUBA observe que « certaines réalités culturelles peuvent constituer de graves entraves aux efforts de développement. Il nous faut pour cela admettre d’emblée deux postulats : Tout d’abord, le développement n’est pas seulement croissance ni synonyme d’extension de marchés. Il appelle toutes les dimensions de l’homme, comme l’ont rappelé les précédents orateurs, une analyse simultanée des politiques au sens strict, des politiques économique, des idéologies, ce mot étant pris dans son acception qui privilégie le culturel, ou dialogue avec le réel ». Encadré 7: Culture, créativité et marchés Dans son Rapport mondial sur la culture, A.SEN montre que la réussite qui était au départ l'apanage du Japon, s'est progressivement généralisée à toute la région et qu’elle a donné naissance à de nouvelles théories sur le rôle de la culture asiatique dans la réussite économique aussi bien que dans l'affirmation politique. La question est donc d'évaluer le potentiel économique des valeurs culturelles de l'Asie. Sa démarche s'appui sur les constatations suivantes : Les valeurs culturelles de l'Europe ont paru tout d'abord les plus fécondes pour expliquer sa suprématie; Ensuite, l'héritage des règles des traditions, et des valeurs propres aux Samouraï été invoqué pour expliquer l'industrialisation rapide du Japon; Récemment d'autres régions asiatiques ont connu la même réussite. L'attention s'est alors portée sur les vertus spécifiques du confucianisme, un lien culturelle qui unit le Japon, La Chine et la majeure partie de l'Asie orientale; Les valeurs du Bouddhisme radicalement différentes de celles du confucianisme, sont aujourd'hui sollicitées pour expliquer la réussite récente de la Thaïlande et de ses voisins on y ajoute le potentiel économique de l'Islam pour rendre compte de l'essor de l'Indonésie; Plus récemment encore, l'Inde connait une croissance économique supérieure à celle de l'Europe et de l'Amérique. Les interprétations passés qui présentaient l'apathie et le fatalisme comme les causes de la 197 stagnation sont prises de court pour expliquer le dynamisme actuel. Amartya SEN en tire deux conclusions: la culture européenne n'est pas la seule voie vers une modernisation réussie et le développement de l'Asie orientale présente certaines particularités, notamment un rôle plus marqué de l'éducation et de la formation, ainsi que l'établissement des relations plus harmonieuses et plus coopératives entre le marché et l'État. Mais ceux ne sont pas là des aspects propres aux " valeurs asiatiques " en tant que telles, ni des exemples que d'autres pays ne peuvent suivre. À chacun ses valeurs, chacun son idéal de progrès, à chacun sa route pour s'en approcher. Source : Amartya SEN (Prix Nobel 1998) Dès lors, il faut identifier l’ensemble des conceptions, des valeurs éthiques, des croyances, des idéologies et des représentations des « faiseurs de développement » qui ont longtemps été masquées par des modèles de développement qui semblaient fonctionner sans elles. Ces variables sociologiques, morales, politiques et sociales ont la forte capacité de commander ou d’orienter l’activité économique comme l’ont clairement établi les travaux de Max WEBER sur l’influence de l’éthique protestante dans le décollage économique des pays capitalistes ou ceux de SOMBART sur la contribution de la mentalité juive dans la réalisation de la révolution industrielle en Europe. Pour ce deuxième auteur, trois attitudes paraissent essentielles pour le développement économique et social, du fait des valeurs qu’elles véhiculent et qui influencent très fortement la croissance économique et le développement mais aux quelles il faut ajouter deux autres: l’attitude à l’égard du travail social considéré comme le principal créateur des biens matériels et des services ; l’attitude à l’égard du progrès perçu au double niveau d’une quête permanente des innovations créatrices et de l’accumulation de ressources à des fins d’investissements productifs ; l’attitude à l’égard du temps, autrement dit le temps est-il un bien rare qui a un prix ou alors est-il l’attribut d’une divinité ? l’attitude face à la corruption l’attitude à l’égard du service public. Attitude à l’égard du travail Attitude à l’égard du progrès matériel Attitude à l’égard du temps Attitude face à la corruption Volonté de transformer son état : acceptation du développement Acceptation de son état : refus du changement Attitude active à l’égard du développement Attitude à l’égard du travail Développement ou processus cumulatif de transformation Immobilisme Stagnation régression Attitude à l’égard de l’Etat et du service public Ces cinq attitudes forment les structures mentales ou l’outillage mental compris comme l’ensemble des concepts, des croyances et des représentations qui ont 198 cours dans une société et que l’on peut infléchir dans un sens favorable au développement. Elles expliquent pour une très large part la conception que l’homme se fait de ses relations avec les principaux facteurs de croissance, conception active ou conception passive, acceptation de son état ou volonté de le transformer et de l’améliorer. C’est pour cette raison qu’il est souvent souligné que le développement est une question de mentalité. On comprend dans cette optique le rôle éminemment positif que peut jouer le civisme accepté comme un ensemble de valeurs et de comportements qui agissent sur la conscience de l’être humain, pour lui inculquer une attitude positive, se traduisant par le respect de soi-même, le respect d’autrui, le respect des institutions que les populations se sont données librement. Les règles de civisme invoquées ou imposées par un donneur d’ordre peuvent alors entraîner des attitudes favorables au développement économique. La crise persistante des économies africaines malgré l’application par les pays africains depuis plus de deux décennies, des programmes d’ajustement structurel ravivent le débat sur les modèles de développement et leur pertinence. Ceux-ci reposaient sur trois postulats majeurs à savoir : une conception mécaniste et linéaire de l’histoire et du développement selon laquelle toutes les sociétés humaines passeront par les mêmes stades avant de décoller ; une approche technocratique de la gestion et du développement institutionnels, qui part de l’idée que la modernisation passe obligatoirement par un mimétisme à l’égard de la civilisation occidentale ; et une conception ethnocentrique de la culture fondée sur l’idée que toutes les sociétés doivent tendre à épouser les mêmes valeurs que celles des pays développés, notamment l’esprit d’entreprise, la recherche du profit maximum, la sécurité matérielle et l’intérêt personnel. La conclusion toute logique de cet ensemble de postulats est que le développement du continent africain devra être impulsé de l’extérieur. Il suffit simplement d’organiser la mobilité des capitaux, de transférer les technologies et les cultures qui les accompagnent. Pour rompre avec cette philosophie, il importe d’analyser les valeurs socio-culturelles ainsi que les attitudes et comportements des acteurs face à ces valeurs. I/ Les attitudes à l’égard du travail Le travail est à la fois le fondement de la valeur des biens et services et la principale source de la richesse des nations. Ce propos peut être illustré par certains exemples bien édifiants : un exemple religieux : « tu gagneras ton pain à la sueur de ton front », recommandation du Tout-Puissant à Moïse sur le Mont Sinaï ; un exemple de théorie économique : la valeur d’un bien est déterminé par le temps de travail socialement utilisé pour sa fabrication ; des exemples de politique économique : les différentes révolutions industrielles en Europe et dans le Monde se sont déroulées dans des conditions de travail surexploité. Plus édifiant encore sont les « ateliers de sueur » qui ont permis aux pays 199 asiatiques de vaincre le sous-développement dans l’intervalle d’une génération et d’être le pôle émergent qui fournira plus de la moitié du surcroît de la production mondiale. La question qui découle de ces exemples est celle de savoir quelle est l’attitude des acteurs sociaux à l’égard du travail ? Trois faits massifs méritent d’être soulignés et sérieusement analysés. Le premier concerne les cérémonies familiales et les nombreuses activités de loisirs qui démobilisent tout le corps social et particulièrement sa composante la plus valide : la jeunesse. Le second est relatif à la multiplicité des fêtes officielles qui sont des charges exorbitantes pour les entreprises et partant diminuent, leur compétitivité structurale. Le troisième fait est la faible productivité du facteur travail dans tous les secteurs d’activité. En prenant le cas de l’agriculture on s’aperçoit que les hommes consacrent au travail 103 jours, soit 600 heures par an et les femmes 155 jours, soit 1.100 heures. Dans les mêmes climats et sur les mêmes sols, le rendement moyen par actif rural et par hectare cultivé est presque 10 fois plus élevé en Asie. Que faut-il alors faire pour promouvoir une société de travail, c’est-à-dire une société qui se construit autour des valeurs qui agissent sur la conscience des citoyens pour leur inculquer en permanence des attitudes favorables au travail productif et créatif. Il faut certainement aller bien au-delà de simples appels à la conscience professionnelle. II/ L’attitude à l’égard du progrès matériel Si nous réduisons le progrès matériel à deux variables fondamentales, l’acceptation des innovations technologiques et l’accumulation productive, il devient intéressant de savoir si la recherche de ce progrès est tenue pour une finalité de l’activité des citoyens sénégalais. Pour ce qui est des innovations, la réceptivité des sénégalais est presque parfaite : vivacité d’esprit, intelligence ouverte à toutes mutations, très forte propension à l’initiation, système éducatif et de formation de bon niveau. Toutes ces raisons font que la dotation de notre pays en ressources humaines est une des meilleures en Afrique francophone. Cette situation est renforcée par la présence d’une Université qui est aujourd’hui un des pôles de compétence et d’excellence de la sous-région. Concernant l’autre volet du progrès (à savoir l’accumulation), elle soulève les questions suivantes : la richesse est-elle source de consommation, moyen de prestige ou instrument de progrès économique par accumulation et investissement ? Commençons par élucider le lien entre accumulation et développement. Notre pays a besoin d’une croissance rapide, accélérée, harmonieuse et aux taux le plus élevé possible compte tenu des ressources disponibles. Or, le taux de croissance est une fonction directe du taux d’accumulation, donc de l’épargne. En conséquence, il ne peut exister de développement sans une conciliation entre les capacités de génération et d’absorption des surplus. Historiquement, les richesses qui se formaient étaient systématiquement détruites par des mécanismes divers (cérémonies, legs, dons, …) ; cela pour maintenir la cohésion et empêcher toute différenciation sociale remarquable. Cette tradition s’est renforcée aujourd’hui entraînant une véritable dilapidation des ressources à l’occasion de cérémonies de tous ordres. L’interférence de deux valeurs l’une traditionnelle le « navle » et l’autre moderne le « pouvoir d’achat » entraîne une surenchère dans les dépenses somptuaires qui finissent par liquider ou amoindrir les capacités d’épargne des individus. Les ressources publiques 200 comme celles provenant de la corruption seront détournées par les individus au profit de la famille élargie ou des groupes ethniques. La conséquence est que l’épargne sera faible ainsi que les possibilités de financer les investissements personnels. Il nous faut réfléchir sur les expériences des pays asiatiques dont le mode d’organisation sociale n’est pas trop éloigné du notre. L’individu y acquiert son identité par son appartenance à la famille. La société est un tout où l’individu, quel qu’il soit, est enserré dans un réseau de relations préétablies. Toutefois, les relations interpersonnelles sont très fortement hiérarchisées si bien que chacun cherchera à établir des liens sociaux verticaux (de supérieur à inférieur), plutôt qu’horizontaux (entre égaux). Selon la formule de CONFUCIUS « Que le prince soit prince, que le sujet soit sujet, que le père soit père et que le fils soit fils ». Dans ces sociétés asiatiques, les taux d’épargne sont très élevés car les agents économiques considèrent, dans un premier temps, que les surplus de revenus qu’ils obtiennent sont provisoires et qu’il vaut mieux les mettre de côté pour les temps difficiles. Différemment, le système africain, par ses réseaux de solidarité, offre un filet permanent de sécurité sociale. Comment ajuster les comportements d’épargne des individus pour qu’ils soient d’une part plus favorables à l’investissement et d’autre part mieux corrélés aux risques et à l’incertitude ? Comment imposer un civisme dans la gestion des ressources individuelles ? Faut-il agir sur le modèle de consommation, sur l’environnement social ou sur les incitations ? III/ L’attitude à l’égard du temps La question est importante. Il s’agit de savoir si le temps est un élément sur lequel l’homme n’a aucune prise ou alors si le temps est un bien rare qui doit être aménagé et qui a un prix. Dans la société sénégalaise d’aujourd’hui, c’est la première perception qui prévaut, ce qui se traduit par un attentisme dans l’élaboration comme dans l’exécution des décisions. IV/ L’attitude à l’égard de la corruption Cette question est décisive dans les économies de marché où la transparence devrait permettre un fonctionnement efficace des relations marchandes et des règles de compétition. Les Institutions Financières Internationales s’intéressent bien après les théoriciens, à l’économie politique de la corruption. Analysant ce phénomène, un auteur comme le Prix Nobel G. BECKER estime qu’il s’agit de la confrontation d’une offre et d’une demande selon les principes de l’économie du crime qui permet à des individus de disposer d’avantages indus sans payer ou d’une rente de situation. Les contractants comparent les gains probables et les risques potentiels. En revanche, pour la société comme pour les citoyens la corruption impose des coûts moraux, politiques, sociaux et économiques. Ces coûts économiques se traduisent par le gaspillage des fonds publics, l’octroi de rentes de situation parasitaires, la concurrence déloyale pour les entreprises, des pertes de revenus budgétaires et de crédibilité pour l’ensemble du système social. Par ailleurs, elle remet en question l’égalité de traitement des citoyens et l’égalité des chances des entreprises en régime de concurrence. En conséquence, si on laisse la corruption s’incruster et se développer, il va se former des échanges sociaux complexes avec des 201 réseaux qui vont viser à sécuriser les transactions délictueuses hors marché au détriment de l’économie nationale. Que convient-il de faire ? Souvent les sociétés démocratiques organisent des mobilisations anti-corruption en appelant au civisme et aux valeurs républicaines. Est ce suffisant ? V/ L’attitude à l’égard de l’État et du service public Les économistes ont beaucoup discuté ces dernières années sur les fonctions de l’État avec la critique de l’interventionnisme par les institutions financières internationales. À la limite, l’État doit se cantonner à un rôle de veilleur de nuit sur l’économie nationale. Il devrait se recentrer sur deux fonctions principales : l’une de production des externalités positives, à savoir la sécurité, l’éducation, la santé, l’environnement, et l’autre de corrections des dysfonctionnements des marchés. Cependant cette analyse est très partielle car l’État est un instrument irremplaçable dans le développement économique et social. En Asie, il a joué un rôle massif et efficace dans l’organisation de l’économie et dans l’allocation des ressources vers des projets porteurs. Les problèmes qui sont soulevés concernent plutôt l’État africain qui accuse en vérité une faillite instrumentale par suite d’une marginalisation par le haut de la part du système mondial et d’une précarisation par le bas par le secteur informel. La faillite est aussi financière et se manifeste dans le déficit budgétaire chronique, le déficit du secteur public, l’endettement interne et externe. À la racine du mal on découvre le caractère patrimonial et prédateur du système étatique, du fait des comportements anti-civiques vis-à-vis des biens collectifs. À plusieurs occasions les hommes politiques dénoncent cette situation sans réussir à éliminer les malversations financières, la gestion non transparente et gabégique du secteur public, la démultiplication des passe-droits, la promotion et la protection de l’incompétence, la violation des règles d’une compétition stimulante, etc. Pour sûr, de tels comportements conduisent le pays à la ruine. La formule consacrée est aujourd’hui la bonne gouvernance qui est un moyen et un objectif de développement garantissant la participation populaire, la stabilité politique, le développement institutionnel et le respect des droits de l’homme. Les réformes et l’amélioration de l’économie sont donc indissociables des réformes de l’Etat et de son système de gouvernance. Sous ce rapport, les questions essentielles qui se posent au niveau de la gouvernance ont trait à : une organisation plus efficiente du secteur public, plus responsable, plus transparente et plus axée sur la satisfaction des besoins des populations ; une organisation et une gestion plus efficiente des ressources humaines ; un renforcement des capacités de formulation des politiques gouvernementales et de suivi de leur application ; un renforcement des systèmes de contre-pouvoirs (pouvoir législatif, judiciaire, société civile, groupe de pression) afin de leur donner la capacité de suivre et d’évaluer les politiques élaborées et appliquées ; un renforcement de l’état de droit et des libertés fondamentales. La bonne gouvernance ainsi analysée appelle un ensemble de comportements civiques des citoyens concernés par la chose publique. 202 Il reste beaucoup d’autres attitudes importantes qui devraient être analysées comme par exemple celles concernant la confiance qui facilite les transactions entre agents économiques et celles relatives à l’acceptation des décisions dans un système démocratique ou également « le patriotisme économique ». FACTEURS HUMAINS FACTEURS MATÉRIELS Entraves fondamentales au développement Croissance très rapide de la population Manque de technologies appropriées et d’innovat. socioculturelles Manque de capital humain Manque d’infrastructure de base Importance relative Déficit Epargne et capital fincier Mauvais fonctionnement des Institutions : Politiques de prix inadéquates Etat- Marché Court terme Marxistes Néo-classiques Classiques Contraintes Politiques Domaine d’étude des économistes Keynésiens, structururalistes Long terme Environnement très contraignant Contraintes socioculturelles Evolution des marchés mondiaux FACTEURS ECONOMIQUES 203 Section 3 : Techniques développement de quantification du sous- Un phénomène aussi complexe que le sous-développement est-il mesurable ? Beaucoup d’auteurs se sont essayés à trouver des indicateurs de mesure qui soient précis et quantifiables. I/ La critériologie Les premières tentatives sont réalisées par Yves LACOSTE114 sous le nom de critériologie. Cette méthode selon J. FREYSSINET est née « d’une volonté d’objectivité et d’empirisme, elle veut se débarrasser de tout préjugé scientifique, de tout postulat de valeur implicite pour se consacrer à l’observation des faits. Cette méthode présente un double intérêt. En premier lieu, face à l’enchevêtrement souvent souligné des facteurs, la critériologie réalise une sélection et une mise en œuvre des facteurs communs à tous les pays sous-développés et, parmi ces facteurs, sélection de ceux qui sont jugés essentiels. En second lieu, la critériologie répond à un souci d’objectivité, s’opposant à la partialité des analyses doctrinales.» La critériologie devrait fournir une base commune à tous les économistes quelle que soit leur orientation idéologique »115. Ces critères sont au nombre d’une quinzaine pouvant se classer en 6 catégories : les critères liés à la production et concernent la prééminence des activités agricoles et minières, l’hypertrophie des activités tertiaires, la faible industrialisation, la faible productivité, les techniques de production arriérées, etc. critères d’ordre démographique ; taux élevé de natalité, de fécondité et de mortalité, explosion démographique, jeunesse de la population, etc. les critères relatifs à la consommation : faible consommation d’énergie, faible niveau de consommation alimentaire, etc. critères sociaux : structures sociales déséquilibrées avec faiblesse des classes moyennes, structures sociales désarticulées avec absence mobilité sociale verticale, faibles niveaux de revenus, des infrastructures sanitaires, pauvreté de masse, chômage endémique affectant surtout les jeunes, précarité de la condition féminine, etc. critères politiques : détérioration de l’espace politique, faible démocratisation, régimes autoritaires, administration inefficiente et corruption, etc. critères d’ordre spatial : territoires désarticulés. 114 115 Yves LACOSTE:Les pays sous-développés J. FREYSSINET : op.cit. p15 204 Encadré 8 : Les indicateurs du développement L’Arithmétique Politique fondée par William PETTY , établissait en "nombres, poids, mesures" la richesse relative des nations… sous le contrôle attentif des princes. Avec la naissance des comptabilités nationales, le développement comparé des nations s'évalue à coup d'agrégats macroéconomiques (Produit national, Disponibilité alimentaire globale...) et détermine les rapports macro- géographiques: Nord/ Sud, Tiers-Monde, Pays Moins Avancés, etc. En apparence, ce type d'évaluation a peu de sens sur le plan microéconomique: comment savoir que vous êtes plus sous- développé que moi ? Néanmoins, compte tenu de nouvelles exigences éthiques, les indicateurs du développement désignent autant la réussite économique d'une nation que l'amélioration du bien-être d'une ou plusieurs personnes. Sur cette base macro et microéconomique, ces indices sont produits exclusivement par les grandes institutions du développement qui les inscrivent à la fois dans le passé par leurs constats, dans le présent par les modes de l'expertise dans le futur comme impératif suprême. Faut-il se contenter des indicateurs des institutions de développement ? Ces indicateurs sont dérivés de leurs conceptions théoriques, par exemple en matière de compétitivité internationale ou de développement humain. Depuis 1990, il existe une intense compétition sur le "marché des indicateurs" entre la Banque Mondiale et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Ainsi le rapport du PNUD de 1992 est un modèle de contestation à la fois du FMI et de la Banque Mondiale. La première institution n'a pas exercé son autorité vis à vis des pays riches mais a abusé de la conditionnalité vis à vis des pays pauvres. La Banque n'a pas su être l'intermédiaire financier capable de recycler les excédents des pays riches en faveur du développement des pays pauvres. Réciproquement la Banque accuse le PNUD de normer son Indice du Développement Humain (IDH ) sur le niveau des pays les plus riches. Mais le développement ne passe pas forcément par les institutions. En considérant la pauvreté comme un des symptômes majeurs du sous développement, les agents économiques concernés n'attendent pas passivement les projets des experts et réagissent stratégiquement aux contraintes de leur milieu. Existe t-il des indicateurs du développement révélés ou décentralisés ? On peut ainsi distinguer le catalogue des indicateurs de développement autour du PNB, la recherche d'une vision synthétique du développement humain, et s'interroger enfin sur l'opposition entre les conceptions normatives du développement "décrété" et les paradoxes du développement "révélé". François Régis Mahieu II/ Les critères de la comptabilité nationale Parmi les indicateurs utilisés pour mesurer le sous-développement, on repère deux indices de la comptabilité nationale qui, principalement, a pour objet de représenter de façon simplifiée l’ensemble des opérations qui se déroulent dans le cadre de l’activité économique d’un pays. Ces deux indicateurs sont le Produit Intérieur Brut et le Revenu National. Ces deux indicateurs se retrouvent dans tous les Rapports des Institutions Financières internationales comme la Banque mondiale, le FMI et le PNUD et sont qualifiés d’instruments fiables de mesure permettant une comparaison internationale du niveau d’activités économiques et sociales des pays. Le sous-développement est alors repéré par un niveau faible du PIB ou du RN par tête d’habitant. Ainsi tous les pays ayant un revenu national inférieur à 500 dollars rentrent dans la catégorie des PSD. Toutefois, le PNUD se démarque de plus en plus 205 de cette appréciation et privilégie l’Indice de Développement Humain Durable qui est annuellement calculé pour tous les pays membres de l’ONU et qui sont classés en conséquence par le niveau que prend cet indicateur. À partir de cette méthode, la Banque mondiale établit un classement des pays en quatre groupes : - le groupe de pays à faible revenu ayant moins de 785 dollars, - le groupe de pays à revenu intermédiaire compris entre 786 et 3125 dollars, - le groupe de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure entre 3126 et 9655 dollars, - le groupe de pays à revenu élevé au-delà de 9656 dollars. Quelle est l’origine de ces indicateurs et surtout, ont-ils le degré de fiabilité et de pertinence qui leur est accordé ? 1°) le Produit Intérieur Brut (PIB) l’étalon international de mesure du niveau des activités économiques et sociales. L’agrégat Produit National concerne plus précisément la production finale qui se rapporte à la valeur de l’ensemble des biens et services crées et non utilisés à des fins de consommation intermédiaire productive. Autrement dit, il s’agit de l’ensemble des richesses créées et affectées aux différentes utilisations finales (Consommation Finales, FBCF, variation des stocks, exportations)116. Ainsi peut-on écrire la relation suivante : Production Finale= CF+Investissements +Exportations nettes avec CF = Consommation Finale Investissements=FBCF+Variation des stocks Exportations nettes=Solde positif ou négatif de l’Excédent des Exportations sur les Importations. Le deuxième membre de cette égalité constitue la Demande finale qui recouvre tous les emplois en biens et services sauf la consommation intermédiaire. D’un autre point de vue, cette production finale (qui exclut les utilisations intermédiaires productives) peut se concevoir comme représentant la sommation de la contribution productive nette de tous les secteurs institutionnels à la formation du produit global ; or cette contribution productive étant constituée par la valeur ajoutée du secteur, cela permet la deuxième relation suivante : Production Finale=Somme des Valeurs ajoutées Brutes marchandes et non marchandes Cette optique permet alors de calculer le Produit Intérieur Brut PIB =VAB (marchande et non marchande) + TVA grevant les produits +Droits de douane et taxes assimilées -Ajustement pour services bancaires imputés Dès lors, dans la sphère réelle on dispose de trois méthodes d’évaluation du Produit Intérieur Brut117 : D’abord la Valeur ajoutée Valeur ajoutée=Valeur de la production- Dépenses intermédiaires afférentes à Moustapha KASSÉ : « Éléments de Comptabilité Nationale », Polycopie de 1ère Année de Sciences Économiques, FASEG, Dakar, 1994 117 André MARTENS-B. DECALUWE : Le cadre comptable macroéconomique et les pays en développement HMH, Canada 1996, p. 35 116 206 cette production Le Produit Intérieur Brut PIB= somme des valeurs ajoutées des activités PIB= somme des revenus distribués dans l’économie Le Produit Intérieur Brut PIB=somme des dépenses finales Encadré 9: Les problèmes liés à la mesure par le PIB Le PNB est toujours le principal indicateur malgré les critiques habituelles ayant trait à la distribution, la sous-estimation des services, la non prise en compte des activités non marchandes, la dégradation du capital écologique ou humain. Des critiques plus récentes montrent que l'augmentation du PNB peut diminuer le bien être, soit à court terme (en aggravant le sort des plus pauvres) ou à long terme en dégradant la qualité de l'environnement et plus généralement de la vie. La relation PNB/ population doit être appréciée en fonction des deux éléments de la relation. À une richesse relativement faible du point de vue du PNB devrait être associée la richesse de la population (il n'est de richesse que d'hommes). Comment dès lors laisser des pays comme la Chine et l'Inde au milieu des pays les plus pauvres de la planète ? À un PNB très faible, peut correspondre un optimum, soit un état d'équilibre réalisable, préféré à tous les autres. Un développement décrété peut très bien se traduire par des situations sub-optimales par rapport à la situation précédente. En d'autres termes, les compensations du développement (l’augmentation du revenu national) ne rétablissent pas la mise en cause des préférences individuelles. D'autre part, il faut estimer ce PNB dans une unité de compte internationale, à savoir le $ US au risque de nombreuses distorsions. La correction la plus fréquente consiste à utiliser les Parités de Pouvoir d'achat (PPA). Le principal problème dans une économie ouverte tient à la prise en compte des prix (l’économie est fatalement price-taker). Comment calculer un PNB en dollars à partir des données en monnaie locale ? On propose alors, au moyen de la parité des pouvoirs d'achat (PPA) de corriger le PNB évalué au taux de change nominal par les prix et plus généralement par des facteurs de conversion. La Parité des Pouvoirs d'Achat équivaut au nombre d’unités d'une monnaie étrangère requises pour acheter les mêmes montants de marchandises et services sur un marché d'un pays donné qu'un dollar achèterait aux USA. Encore faut-il parier sur une valeur d'échange incontestable entre les deux marchandises, ce que contestait déjà RICARDO (1817). La PPA permet un premier reclassement qui favorise les USA (par définition), les NPI et un certain nombre de "petits" pays (Suisse, Belgique, Autriche, Luxembourg). Mais le calcul est déjà fluctuant et le calcul en PPA apporte quelquefois des surprises médiatiques, pouvant très bien faire apparaître la Chine ou la Russie dans les cinq premières "puissances" économiques mondiales ( Cf. la base des données du CEPII in fine.) Source : François Régis Mahieu 2°) le revenu national. En reprenant le tableau général des comptes intégrés des secteurs institutionnels, on observe qu’à partir de la VAB et des subventions d’exploitation éventuellement reçues, sont assurés le règlement des salaires (y compris les charges sociales) ainsi que le paiement des impôts liés à la production. Ensuite l’EBE (excédent brut d’exploitation) ainsi obtenu, avec l’apport éventuel de certains revenus complémentaires, servira à payer les dividendes, les intérêts, les loyers, les impôts sur 207 le revenu et sur le patrimoine, les primes d’assurance, etc. Ainsi le compte d’exploitation et le compte de revenu des sociétés et quasi-sociétés non financières montrent comment la valeur ajoutée, c’est-à-dire la contribution des entreprises au produit intérieur, est répartie entre divers groupes d’agents économiques. Cette valeur ajoutée constitue donc la source des revenus des agents économiques. Ce qui permet d’écrire : Somme des Valeurs ajoutées= Somme des Revenus créés par la production Or, on avait démontré précédemment que Somme des Valeurs ajoutées=Production Finale. Alors dans l’optique du revenu de la comptabilité nationale, on peut écrire : Production Finale=Somme des revenus créés par la production Au niveau du TEE, le calcul s’effectue de la manière suivante : PIB =Rémunération des salariés +Impôts liés à la production et à l’importation +EBE -Subventions d’exploitation De cette échelle de revenus le circuit devrait se refermer par l’analyse de la dépense, bien que cet indicateur ne bénéficie d’aucune importance. Étant donné que les utilisations finales faites de la production finale (somme des valeurs ajoutées) sont en valeur, elles constituent alors les dépenses des agents économiques. C’est du reste ce qui justifie l’expression optique de la dépense qui permet de décrire les relations suivantes : Production finale = somme des Dépenses à caractère finale De ce point de vue, on procède au niveau du TEE (Tableau économique d’ensemble) pour la détermination du PIB de la manière suivante : PIB= Consommation finale +FBCF +Variations de stocks +Exportations de biens et services -Importations de biens et services En somme, le PIB ainsi calculé étant identique dans les trois méthodes d’évaluation, on remarquera que les trois optiques de la comptabilité nationale représentent en fait trois points de vue différents sur une même réalité. En effet, c’est au cours du processus productif que se forment les revenus et les emplois faits des biens et services ainsi créés, exprimés en valeur et qui forment les dépenses des agents économiques.118 3°) Ces instruments de mesure ont-ils le caractère infaillible et pertinent qui leur est prêté ? Ce n’est pas l’objet de notre propos mais il faut souligner que la Comptabilité nationale n’est pas un instrument neutre et présente d’innombrables limites techniques et même idéologiques surtout quant elle est appliquée aux PSD dont les économies sont désarticulées, déséquilibrées et les marchés touchés de part en part de multiples distorsions qui leur donnent toujours un fonctionnement imparfait. Selon J. MARZEWESKI, la comptabilité nationale est à la fois utile à la théorie économique et indispensable à la politique économique des États. L’interdépendance de plus en plus étroite qui s’établit entre ses agents fait qu’une économie moderne ne 118 Moustapha KASSÉ : op.cit. pp54 et suivantes 208 peut fonctionner qu’à condition de disposer d’un mécanisme de coordination. Or, le jeu du marché est souvent faussé obligeant l’État à prendre à sa charge la tâche ingrate mais indispensable d’arbitre général.119La comptabilité nationale est le produit de l’analyse néo-classique qui situe dans le marché (au sens large) le point de départ et le point d’arrivée de l’activité économique et donne de ce fait une définition particulière des sujets et des rapports de production. Dans cette optique, observe une critique de la CN, « comme l’activité économique y est censée avoir pour objet, la satisfaction de ses besoins ou de ceux des autres (production pour la consommation), le personnage essentiel en est le consommateur, défini par un revenu, un pouvoir d’achat (contrainte budgétaire). Les rapports qui s’établissent entre les hommes pris comme une collection d’individus, sont des rapports de comparaison des besoins et des possibilités de les satisfaire en fonction de la plus ou moins grande rareté des biens et services disponibles révélés par les quatre grands marchés des biens et services, du travail, de la monnaie et de change. La société ainsi décrite est une société sans classes, sans groupe d’aucune sorte, où les individus exercent tour à tour des fonctions de production, de consommation, d’épargne, d’investissement, etc.»120 Il existe des remarques plus techniques encore, relatives au cadre comptable, à la définition des agents économiques, aux comptes et à leur articulation, au secteur financier et à l’allocation par les marchés. À ces limites viennent s’ajouter d’autres propres aux structures des PSD : caractère désarticulé de l’économie, les trop fortes inégalités de revenu, l’importance des relations hors marchés (autoconsommation), les multiples distorsions des marchés et la montée d’une nébuleuse : le secteur informel. L’insuffisance de l’appareil statistique de collecte et de traitement des données vient couronner cette kyrielle d’insuffisances qui appelle une utilisation prudente des indicateurs de la CN. III/ Les critères du développement humain À partir de son Rapport de 1994, le PNUD va jouer un rôle déterminant dans la réflexion théorique, la conception et la définition de la problématique du développement. Ce Rapport en dissociant le cycle de la croissance de celui du développement, marque un tournant significatif dans la rupture avec l’économisme dominant. Il est observé que «le nouveau paradigme du développement devra être axé sur les gens, considérer la croissance comme un moyen et non comme une fin, préserver les perspectives offertes aux générations actuelles comme aux générations futures, et respecter les écosystèmes dont dépend l’existence de tous les êtres humains. Ce paradigme du développement doit permettre à tous les individus de développer pleinement leurs capacités pour les utiliser au mieux dans tous les domaines : économique, social, culturel et politique». (PNUD, 1994). L’homme est ainsi replacé au cœur de la logique du développement. Désormais, la qualité de la vie d’une population ne se réduit plus à l’importance de son PIB. Le contenu de ce dernier, la façon dont il est réparti avec plus ou moins d’inégalités, la capacité de chacun à pouvoir accéder aux services de base que sont l’école, la santé, le logement ou l’eau courante et la qualité des services en question, tous ces éléments jouent autant, sinon davantage que le simple niveau du PIB. 119 120 J MARZEWSKI : La Comptabilité nationale, Édit. Cujas J.C. DELAUNAY : Essai marxiste sur la Comptabilité nationale, Édit. Sociales. 209 1°) Définition et structure de l’IDH Le développement humain étant défini comme étant le processus d'élargissement des possibilités s'offrant aux individus de la collectivité (une longue vie, une bonne santé, une accession à la connaissance, aux biens matériels, à l'emploi et au revenu) pour un niveau de vie décent. Toute mesure du niveau du développement humain atteint par cette collectivité doit tenir compte nécessairement de ces différents éléments. L’indicateur du développement humain (IDH) sera alors un indice composite qui apprécie la situation moyenne d’un pays à partir de trois dimensions représentées à travers : le niveau de longévité exprimé par l’espérance de vie à la naissance le niveau d’éducation mesuré aux 2/3 par le taux d’alphabétisation et au 1/3 par le taux de scolarisation toutes catégories confondues ; et le niveau décent évalué par le revenu par habitant exprimé en francs constants, c’est-à-dire corrigé des différences de pouvoir d’achat (PPA). Pour calculer l'indice du développement humain (IDH) pour une population ou une catégorie de population donnée, on doit disposer de ces trois variables: soit X1 la mesure de la longévité et de la bonne santé de cette population: l'espérance de vie à la naissance étant la variable la plus appropriée au stade actuel de la recherche pour refléter cet aspect du développement humain; X2 l'acquisition des connaissances: le taux de scolarisation et celui d'alphabétisation; et X3 la richesse de la population: le revenu. Pour le calcul de l'IDH, on définit pour chacune des ces variables un seuil (ici on a retenu le maximum et le minimum) jugé acceptable au sein de la population à étudier. Puis on calcule pour chaque individu j de la population la valeur des écarts ou le manque (en pourcentage) pour chaque variable i par rapport au seuil défini (indice Iij). Pour chaque individu j on fait la moyenne arithmétique simple (Ij). Alors l'IDH; l'indicateur recherché pour l'individu j est égal à la différence par rapport à l'unité de cette moyenne Ij : La 1ère étape On calcule pour chaque catégorie de la population un indicateur de manque (Iij) par rapport à chaque variable. Cet indicateur est défini comme suit: I ij = ( max X ij - X ij ) ( max X ij - min Xij ) La 2ème étape Pour chaque tranche j de la population, on calcule la moyenne arithmétique simple des indicateurs Iij de manque sur les trois variables X1, X2 et X3; soit Ij 210 La 3ème étape Alors l'indice du développement humain (IDH) pour la catégorie j de la population est égal à: (IDH)j = 1 - Ij Modalités de calcul de l’IDH Des valeurs minimales et maximales ont été fixées pour chacun des indicateurs cités plus haut: Espérance de vie à la naissance: 25 ~ 85 ans; Alphabétisation des adultes: 0% ~ 100% ; Taux de scolarisation: 0% ~ 100% ; PIB réel par habitant: 100$ ~ 40.000$ Les indicateurs qui entrent dans la composition de l'IDH se calculent selon la formule générale: IDH = (val. réelle xi - val. minimale xi)/(val. maximale xi - val. minimale xi) Par exemple, si l'espérance de vie à la naissance est de 47,7 ans au Sénégal, la valeur de l'indicateur d'espérance de vie du Sénégal sera alors : (47,7 - 25)/(85 - 25) = 0,378 La composition de l'indicateur de revenu est un peu plus complexe. La valeur du seul (y*) est fixée au revenu mondial moyen de 1992, soit 5120 dollars en PPA (parité pouvoir d'achat), et tout revenu supérieur à ce seuil est ajusté en appliquent la formule de l'utilité marginale décroissante du revenu : W(y) = y* pour 0<y<y* = y* + 2[(y-y*)1/2] pour y*£y£2y* = y* + 2(y*1/2) + 3[(y-2y*1/3] pour 2y*£y£3y* La valeur corrigée du revenu maximum de 40.000$ PPA se calcule comme suit: W(y) = y* + 2(y*1/2) + 3(y*1/3) + 4(y*1/4) + 5(y*1/5) + 6(y*1/6) + 7[(40.000 - 6y*)1/7] Selon cette formule la valeur corrigée du revenu maximum de 40.000$ PPA s'établit à 6311 PPA. Le principal problème est qu’elle opère une très forte correction du revenu au delà de la valeur de seuil, ce qui pénalise de fait les pays dans lesquels le revenu est supérieur à cette valeur. C’est pour cette raison que des perfectionnements ont été apportés pour le traitement de la variable revenu afin de remédier à ce problème. C’est ainsi que l’indicateur du revenu est calculé selon la formule suivante : W(y) = (LOG(y) – LOG(ymin)) / (LOG(ymax) – LOG(ymin)) 211 Cette façon de procéder comporte plusieurs avantages. Tout d’abord, la correction du revenu est moins sévère que la formule utilisée précédemment. Ensuite, elle s’applique à tous les niveaux de revenus et non à ceux qui dépassent un certain seuil. Enfin, elle évite de pénaliser les pays à revenu intermédiaire. L'IDH est alors la moyenne arithmétique de la somme des indicateurs de durée de vie, du niveau d'éducation et du PIB réel corrigé par habitant 2°) Le classement des pays selon l’IDH. Quels enseignements peuton tirer de l’IDH annuellement calculé par es RMDH. Pendant une bonne décennie, les Rapports Mondiaux sur le Développement Humain (RMDH)121 se sont attelés à la conception et à la construction d’indicateurs de mesure et de comparaison des niveaux de pauvreté et de développement humain dans le monde qui dépassent le cadre restrictif du PNB. L’élaboration de ces indicateurs a permis de mesurer l’énorme retard des pays d’Afrique subsaharienne en matière de développement humain et conséquemment, l’état de leur pauvreté. Tableau 11 : Indicateurs économiques et sociaux dans le monde PIB/hbt en 1998 Espérance de Taux IDH (en francs vie d’alphabétisation français de 1999) (en années) des plus de 15 ans (en %) Pays de l’OCDE 134 000 76,4 97,4 0,89 Europe de l’Est et 40 900 68,9 98,6 0,78 CEI Amérique Latine 43 000 69,7 87,7 0,76 Asie de l’Est 23 500 70,2 83,4 0,72 (Chine incluse) Pays arabes 27 300 66 59,7 0,63 Asie du Sud (Inde 13 900 63 54,3 0,56 incluse) Afrique 10 600 48,9 58,5 0,46 subsaharienne Ensemble du 43 000 66,9 78,8 0,71 monde Source : Rapport mondial sur le développement humain, 2000 Le RMDH de 2000 révèle ainsi que l’IDH de l’Afrique subsaharienne atteint en moyenne 0,46 ; ce qui traduit un gap de 0,536 en matière de développement humain. Depuis 1990, environ 35 des 50 pays classés derniers en fonction de l’IDH sont africains. Compte tenu de l’aggravation de la pauvreté et des inégalités dans le monde, et particulièrement dans les PVD, il apparaît aujourd’hui nécessaire d’aller au-delà de l’aspect statistique des analyses menées pour adopter une démarche dynamique qui fasse le lien entre ces indicateurs de qualité de vie et le profil de la Moustapha KASSÉ : Consultation pour le PNUD sur « Le Rapport Mondial sur le Développement Humain : quelques éléments de réflexion sur sa pertinence pour l’Afrique subsaharienne » 121 212 croissance économique. Cela renvoie aux différents acteurs pouvant améliorer le niveau des indicateurs. En effet, on peut difficilement nier qu’il est plus facile d’être en bonne santé dans un pays riche que dans un pays de l’OCDE : l’ensemble des pays de cet espace affiche un niveau d’IDH plus élevé (0,9 soit 10 % en dessous du meilleur niveau). En revanche, pour la quarantaine de pays les moins avancés du point de vue du revenu par tête, l’IDH moyen est à 0,44. De plus, on constate que les vingt pays où l’IDH a reculé depuis 1990 sont tous des pays où le revenu par tête a également diminué, à l’exception du Botswana. On ne peut arguer qu’il existe forcément un lien de cause à effet. Seulement, la pandémie du sida qui frappe massivement l’Afrique subsaharienne provoque à la fois une chute de l’espérance de vie et une baisse de la capacité productive des pays concernés. Alors qu’à l’inverse, les pays où l’IDH a le plus augmenté sont aussi ceux où la croissance du revenu par tête a été particulièrement forte, telle la Corée du Sud. 2°) Quelles sont les limites de l’IDH ? D’abord, l’état actuel des statistiques montre que les bases de données sociales sont inexistantes ou alors totalement dérisoires. Les deux premiers indicateurs peuvent être évoqués pour illustrer les problèmes liés à la qualité des données, et le dernier à sa significativité quant on sait que non seulement les revenus et leur répartition sont inconnus mais que les activités du secteur informel pouvant aller jusqu’à 60% du PNB sont non prises en compte dans l’évaluation de l’indice. Le PNUD n’utilise que les données disponibles or pour avoir l’espérance de vie à la naissance, il faut disposer d’une table de mortalité récente qui se calcule lors de l’analyse des données de recensement. Or la plupart des pays Africains n’ont pas respecté la périodicité décennale des recensements, par exemple le dernier recensement du Togo date de 1984, celui de la République démocratique du Congo date de 1984, celui du Cameroun date de 1987, celui du Sénégal date de 1988 pour ne citer que ceux-là. On a besoin des effectifs de la population récente pour avoir le dénominateur de la plupart des indicateurs qui rentrent dans le calcul de l’IDH, les effectifs sont obsolètes, ce qui augmente l’imprécision de la qualité des résultats. Ensuite, à l’échelle globale, l’IDH présente un grand intérêt en ce qu’il permet de classer les pays, mais au plan strictement intérieur, il demande des corrections multisectorielles. Si par exemple un pays est dernier du point de vue de l’IDH, sur quelle variable devra-t-il s’appuyer pour redresser sa situation ? Il existe d’autres indicateurs spécifiques du développement humain : pour mieux faire ressortir les disparités entre sexes ou inégalités de genre, les indicateurs de base (espérance de vie à la naissance, alphabétisation et taux de scolarisation, revenus) ont été ajustés en tenant compte des écarts entre hommes et femmes. Enfin, une limite de l’IDH est l’importance secondaire accordée aux revenus dans le calcul de l’indice. En prenant l’exemple de la France et de l’Argentine, le premier pays a un revenu de 18430 dollars par habitant (corrigé PPA) avec une note de 0,948 et le second pays a un PIB de 5120 dollars avec une note IDH de 0,948. La différence de 13310 entre ces deux pays se réduit à 225 dollars une fois l’ajustement calculé. En fait la déflation des revenus rend l’indice très peu expressif. En définitive, il apparaît nettement que l’IDH est un instrument de comparaison internationale. Toutefois, il ne permet pas de savoir quelle est sa composante qui sera la cible du programme pour améliorer le niveau ou le classement du pays dans la hiérarchie internationale établie. Si l’indicateur est performant pour faire des comparaisons entre pays, il l’est moins au niveau 213 opérationnel dans le pays. On sait que dans tel pays, ou tel district sanitaire, la qualité des soins est mauvaise, mais on ne sait pas sur quelle variable jouer pour améliorer la qualité des soins (7). Encadré 9 : Un indice synthétique de bien être économique soutenable ? La notion de "développement soutenable" a été introduite en 1987 par la commission mondiale sur l'environnement et le développement dans son rapport sur " Our common future". Après que la Banque Mondiale lui ait consacré son rapport sur le développement de 1992, l'écologie sera sans doute l'une des principales entrées de l'IDH. Le rapport sur le développement humain tente de donner quelques indices sur l'environnement et la pollution mais ceux ci restent épars dans les premières versions. Les problèmes du " développement soutenable" sont analysés dans le rapport annuel du World Resources Institute des Nations Unies sans pour autant fournir un indice synthétique. À ce titre, l'indice du développement économique soutenable ( Index of Sustainable Economic Welfare, ISEW) de Herman Daly et John Cobb tente de mesurer le bien-être économique à long terme en corrigeant l'indicateur de la consommation des ménages par des facteurs environnementaux et sociaux. Cet indice renforce le constat pessimiste sur la divergence entre la croissance économique et le bien-être. Il permet de pénaliser les pays les plus destructeurs du cadre de vie. Par exemple, le Royaume Uni n’a pas augmenté son ISEW depuis 1950 malgré une augmentation du PNB de 200 %. François R. MAHIEU 214 CHAPITRE 11 : DÉMOGRAPHIE ET URBANISATION ACCÉLÉRÉE : FREIN OU CHANCE DU DÉVELOPPEMENT « Un nénuphar sur un étang double sa surface tous les jours. Sachant qu’il lui faut trente jours pour couvrir tout l’étang, étouffant alors toute vie aquatique, quand en aura-t-il couvert la moitié, dernière limite pour agir ?»… Les riches s’enrichissent et les pauvres ont des enfants….Existe-t-il des limites physiques à la poursuite de l’expansion démographique ? Combien d’êtres humains peuvent être accueillis par notre planète avec quelles conditions d’existence et pendant combien de temps ?». Club de Rome : Halte à la croissance122 « Avec 5 milliards et demi répartis pour un quart dans les pays riches et trois quarts dans les pays pauvres, nous avons déjà d’énormes problèmes. Qu »n sera-t-il demain avec à peu prés la même population dans les pays riches mais 4 à 5 milliards de plus dans les pays pauvres ? Ce rapport sera de 1 à 9. Et aux tensions géopolitiques s’ajouteront avec acuité des problèmes écologiques… Face à ce problème certains cherchent une solution démographique. Or, c’est elle qui conduit à 10 milliards en 2050 à 12 milliards en 2150. Car si rien ne changeait on devrait être à 700 milliards. » Jacques VALIN123 La démographie a de tout le temps préoccupé tous les chercheurs en sciences sociales : économistes, philosophes, sociologues et politiques. Cela s’est traduit dans l’extrême variété des doctrines et théories démographiques malheureusement réduites souvent à l’approche de MALTHUS124 qui su paniquer des générations de personnes sur les effets de l’explosion des « bouches à nourrir » sur notre propre bien-être. Cette vision contraste avec celle d’A. SMITH qui lie la loi du peuplement avec celle de l’offre et de la demande. « C’est ainsi que la demande d’hommes règle nécessairement la production des hommes, comme fait la demande à l’égard de toute autre marchandise : elle hâte la production quand celle-ci marche trop lentement et l’arrête quand elle va trop vite. C’est cette demande qui règle et qui détermine l’état où est la propagation des hommes dans tous les pays du monde dans l’Amérique septentrionale, en Europe et en Chine».125 C’est pourquoi, « Il n'est de richesses que d’hommes » cette idée émise par Jean BODIN (1530-1596) dans un contexte de mercantilisme, révèle toute l’importance attachée à la question démographique dans la stratégie de création de richesses. Elle sera reprise par différents auteurs à des moments historiques déterminés. L’Homme joue un double rôle : d’un coté il est le bénéficiaire ultime et de l’autre il constitue l’intrant essentiel du mouvement de croissance et de transformation de la production. L’homme est ainsi placé au cœur du processus de développement économique car les deux entretiennent des rapports très étroits. Pour Club de Rome : Ce mot ouvre la préface du Rapport MEADOWS, cette formule de pure logique appelle la limitation des naissances avant qu’il ne soit trop tard. 123 J.VALIN : Pratiques de fécondité, Revue Histoire de Développement, n° d’octobre 1993. 124 L’Essai sur la Population de Malthus, a souvent été interprété en dehors de son contexte de la « Révolution démographique en Europe » au XIXème siècle et sa pression sur l’économie. 125 A. SMITH : La richesse des Nations 122 215 que le développement économique soit effectif il convient d’orienter la variable démographique par un ensemble de mesures qualitatives et quantitatives à savoir la formation, l’éducation, les politiques natalistes et antinatalistes. Ce qui mène vers les conceptions du capital humain comme composante essentielle des théories de la croissance. Presque tous les économistes, depuis l’École classique jusqu’aux contemporains, se sont intéréssés aux problèmes démographiques pour découvrir les logiques d’évolution des populations. Dans sa réflexion sur l'unité et la diversité du Tiers-Monde, Yves LACOSTE en est venu, vers la fin des années 1970, à considérer qu'un critère commun et presque unique unissait ses constituants : l'ampleur de la croissance démographique. Dans les PSDS, ce phénomène n'a jamais eu d'équivalent, la croissance démographique toujours supérieure à 2% par an, elle reste sensiblement inférieure à ce seuil dans le reste du monde. Elle n'a jamais dépassé 1% l'an dans l'Europe du XIXe siècle. À cette époque, la croissance démographique résultait d’une évolution endogène de la société dans sa production, ses techniques médicales et sa pratique de l'hygiène. Pour la plupart des PSD marqués par une explosion démographique, ce phénomène est analysé à la fois comme signe et cause de sous-développement. D’abord, elle est signe de sous-développement en ce qu’elle traduit des attitudes à l'égard de la vie quotidienne, des relations personnelles et sociales (plus de mise dans des sociétés marquées par l'allongement de l'espérance de vie), de l'investissement dans l'éducation ou encore de la sécurité sociale (où l'enfant est coûteux plus qu'utile). Ensuite, elle est cause dans la mesure où elle provoque des tensions supplémentaires dans des économies peu productives où la proportion d'inactifs s'est brutalement accrue, tant par l'accroissement du nombre des personnes âgées que par le fourmillement des enfants : deux conséquences des progrès «importés» de la médecine de masse. Dans les années 70, le Club de Rome s’appuyant sur l’analyse néo-classique de l’optimum économique (versus optimum de population) alerte l’opinion mondiale, dans un style extrêmement malthusien, que l’humanité court à la catastrophe si on ne limite pas les naissances. Les enjeux démographiques sont de nouveau posés en relation avec la croissance et le développement économique et social. La démographie mondiale a connu au fil des temps de nombreuses mutations qu’il faut comprendre et intégrer dans les processus de développement. Ces mutations dues à de nombreux et complexes facteurs comme les guerres, les maladies, les calamités naturelles, les progrès de la médecine constituent-elles un avantage ou un handicap pour le développement et la croissance ? Les individus comme les pays n’ayant pas le même niveau d’avancement, l’inégalité ainsi observée entraîne des mouvements de populations des pays moins développés vers ceux qui sont plus développés. Cette migration qui prend de plus en plus de l’ampleur au cours de ces dernières années se fait entre continents, entre pays, au sein du même pays. Elle est alors un des facteurs de la croissance des grandes métropoles africaines, qui a par moment atteint 10 % par an et serait difficilement supportable avec les normes convenables d'équipement et d’infrastructures sociales de l'Europe d'avant-guerre ; elle est, bien évidemment, inconcevable selon les références de l'Europe d'aujourd'hui. De là découlent plusieurs interrogations : Quels sont les facteurs de la croissance démographique ? Qu’est ce qui explique les migrations à l’échelle nationale et internationale ? Quelles en sont les conséquences ? Les tendances 216 démographiques globales et urbaines en Afrique sont-elles un handicap ou une chance ? Section 1 : Les théories et pratique démographiques. Les relations entre la croissance démographique, les changements technologiques et le niveau de vie ont donné lieu à de multiples analyses. La plus célèbre, celle de MALTHUS soutient que le niveau de la population s’auto-équilibrera et surtout stagnera. Si elle a pu être pertinente pour une grande partie de notre histoire, les changements observés depuis 1750 la remettront en cause. Nous y considérons plusieurs modèles couvrant la transition entre les trois régimes distincts ayant caractérisé le processus de développement économique : les régimes « malthusien », « post-malthusien », et « croissance moderne». Encadré 10 : quelques éléments théoriques le courant malthusien ► L’ouvrage de Malthus Essai sur le principe de population (1798) dont la première édition était anonyme est d’abord un pamphlet contre les partisans de la loi sur les pauvres. ► Pour Malthus la population croît selon une progression géométrique (double tous les vingt-cinq ans) tandis que les subsistances croissent selon une progression arithmétique. ► Dès lors, soit la population accepte volontairement de limiter sa croissance (soit la moral restreint ou abstention du mariage), soit la population sera détruite par la guerre, la famine, la peste. Aider les Le courant populationniste ► Ce sont les mercantilistes qui initient ce courant. Ils reprennent la formule de J. Bodin selon laquelle « il n’est de richesse que d’hommes ». ► La croissance de la population a une influence positive par plusieurs canaux : - l’augmentation de la demande qui en résulte incite à accroître la production ; - elle pousse à une organisation plus efficace de la production d’où des gains de productivité ; - une population plus grande permet d’étaler les frais généraux d’une société. ► Par opposition aux malthusiens, A. Sauvy souligne qu’à « chaque fois que se produit une différence, un écart entre deux grandeurs, deux choses qui devraient être 217 L’optimum de population ► L’idée d’optimum de population cherche à réconcilier les deux courants précédents. ► Du point de vue économique, le critère de l’optimum de peuplement est la réalisation du produit (ou du revenu) maximal par habitant. ► Certains éléments définissent le niveau optimal de la population : état des techniques, volume des ressources utilisables, équipement technique, possibilités du commerce extérieur). ►D’autres Le courant marxiste ► Pour Marx, la surpopulation n’est pas liée à une démographie trop dynamique des classes les plus pauvres de la société. Elle résulte du mode d’organisation des économies et de la répartition des richesses. ► La surpopulation est le produit du mode de production capitaliste parce qu’elle est utile à l’accumulation de richesse. ► Les capitalistes ont, en effet, intérêt à avoir des hommes en trop qui constitueront l’armée de réserve industrielle. Cette dernière permet un maintien d’un taux de chômage élevé et bloque le niveau de salaire. Ce dernier reste ainsi au pauvres revient à encourager la croissance démographique et à terme sa destruction. ► La théorie malthusienne de la population est un des piliers de la théorie de l’Etat stationnaire de Ricardo. Schumpeter dans son ouvrage Histoire de l’analyse économique souligne combien Malthus doit à Botero et à Quesnay pour la construction de sa théorie. au même niveau, il y a deux façons de rétablir l’équilibre, aligner vers le haut ou vers le bas. En annonçant qu’il y a excès de quelque chose, l’optique malthusienne suggère instinctivement de niveler par le bas ». éléments définissent la structure optimale de la population : structure par âge, rapport entre la population active et non active, entre consommateurs et producteurs, structure professionnelle de la population, répartition géographique de la population. ► Enfin, des éléments définissent l’optimum dans le temps : rythme de croissance de la population, rythme du progrès technique, taux de croissance du revenu national. minimum vital et permet l’augmentation de la plus-value. ► La pauvreté est une logique du mode de production capitaliste et non d’un excès de population. L’accroissement démographique peut être absorbé à condition que le système de répartition des revenus se trouve modifié. Toute politique démographique serait ainsi inutile. Source : Problèmes économiques, (Mars 2000), « Six milliards d’hommes… et après ? », n° 2656-2657 p. 30-31 I/ Les approches Malthusiennes et néo malthusiennes Thomas MALTHUS (1766-1834)126 était un prêtre britannique, mais également un économiste libéral. Sa thèse est bien connue de tout le monde : la population croît selon les termes d’une suite géométrique (1, 2, 4, 8, 16…), alors que les subsistances (la production agricole) croient selon les termes d’une suite arithmétique (1, 2, 3, 4, 5…). D’où le fait est qu’il y aura nécessairement pénurie ! MALTHUS ici se sert de la « loi des rendements décroissants » de la production agricole pour expliquer ce décalage entre les ressources et la population. On notera cependant que MALTHUS écrivait à une période où la transition démographique était à son paroxysme en Angleterre, c’est-à-dire avec un accroissement naturel considérable. Il est alors important de prendre en compte ce contexte pour mieux comprendre le caractère alarmant de la thèse de MALTHUS. Pour lui, la seule solution (radicale) reste la contrainte morale, c’est-à-dire l’abstinence et la chasteté, puisqu’il faut à tout prix limiter la croissance démographique, pour éviter qu’elle ne dépasse les potentialités de la production. Ces idées de MALTHUS ont été poursuivies et approfondies par les néomalthusiens qui avancent un certain nombre d’arguments qui plaident en faveur 126 Problèmes économiques, (Mars 2000), « Six milliards d’hommes… et après ? », n° 2656-2657 p 30- 31 218 d’une croissance démographique faible (mais ces arguments concernent plus directement le développement que la croissance économique en tant que telle). Ainsi à l’échelle microéconomique, le premier argument consiste à dire que réduire le nombre d’enfants par femmes permet d’augmenter le niveau de vie. Au niveau macroéconomique, les ressources naturelles étant limitées, le fait de ne pas maîtriser la croissance démographique, implique que l’on surexploite le sort des générations futures. Finalement le malthusianisme préconise une faible croissance démographique pour assurer une meilleure croissance économique (ou en tous les cas ne pas l'entraver). Mais les arguments du courant « récent » restent des arguments essentiellement qualitatifs, c’est-à-dire qui concernent le développement plutôt que l’augmentation des richesses (quantitatifs). Mais aujourd’hui, si ce discours néo-malthusien est particulièrement alimenté par la forte croissance démographique des pays du Tiers-monde, il est pourtant théoriquement critiqué par un ensemble d’auteurs qui s’appuient sur des arguments développés d’abord par les contemporains de MALTHUS et approfondi par les théoriciens de la croissance endogène qui voient en l’homme « le capital le plus précieux ». 1°) Les critiques de l’approche malthusienne et le populationnisme Jean BODIN (1530-1596)127 développait, bien avant MALTHUS, l’idée qu’« Il n’est de richesses que d’hommes ». Cette thèse populationniste est l’opposé de la thèse de MALTHUS. Des auteurs comme VAUBAN, F. QUESNAY et J. BODIN voyaient dans l’homme la seule richesse d’un royaume. Leurs théories étaient que si les hommes sont la force d’une nation et que leur nombre augmente, la production suivra et le pays n’en sera que plus puissant. Ce qui revient à dire que la croissance démographique est un facteur permissif de la croissance économique. C’est surtout Karl MARX (1818-1883)128 qui fut un des premiers à rejeter les thèses de MALTHUS et surtout l’idée de « loi naturelle » indépendante des conditions de production. Pour lui, la surpopulation n’est que relative et la conséquence de l’état des techniques à un moment donné. Pour lui, les limites de la planète évoluent avec le progrès technique et le niveau de développement : « La surpopulation relative n’a pas la moindre relation avec les moyens de subsistances comme tels mais avec la manière de les produire »129 Le courant néo populationnisme est souvent illustré par la thèse d’Esther BOSERUP (milieu des années soixante), encore appelée la thèse de la pression créatrice : la croissance de la population fait pression sur l’amélioration des techniques de production (hausse du progrès technique et de l’innovation favorisée). En fait, pour cet auteur, ce n’est pas la richesse qui détermine la population, mais la population qui détermine la richesse, grâce notamment à cette pression créatrice qu’elle génère. En définitive, pour les néo populationnistes, la croissance démographique ne constitue en rien un frein mais plutôt un stimulant pour la croissance économique. 2°) La thèse d’A. Sauvy ou la thèse de l’optimum de population Selon les études de cet auteur, il n’y a pas de corrélation directe entre croissance démographique et croissance économique, puisque tous les cas existent. Voir Problèmes économiques (op. cit.) Voir Problèmes économiques (op. cit.) 129 K. MARX, Œuvres, tome 2, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 1977). 127 128 219 En effet, on peut avoir le cas d’une faible croissance démographique avec en parallèle une faible croissance économique (exemple de la France entre les deux guerres) ou bien encore la situation d’une forte croissance de la population avec une faible croissance économique (exemple du Tiers-Monde) ou enfin le cas d’une faible croissance démographique et d’une forte croissance économique (exemple du Japon dans les années soixante-dix, quatre-vingt). Pour A. SAUVY130, il est nécessaire de faire une étude cas par cas, puisqu’il n’existe pas de cas général où la corrélation entre croissance démographique et croissance économique serait directe. Tout dépend du pays et de sa situation (pyramide des âges, choix sociaux et politiques, etc.). II/ Les thèses natalistes Les politiques natalistes ou antinatalistes peuvent aussi influencer la fécondité et la natalité. Il est possible ainsi, que le fait de verser des allocations familiales à des familles en difficultés matérielles, permette de soutenir la fécondité. Rares sont pourtant les pays qui consacrent des sommes très importantes à soutenir massivement la fécondité. En France, une politique nataliste timide a été mise en place pendant la seconde guerre mondiale, sous le gouvernement PETAIN 131, et semble avoir joué un rôle dans la reprise de la natalité. Elle n'explique cependant pas le baby boom, car celui-ci a été observé dans d'autres pays où aucune politique nataliste n'avait été mise en place. À l'inverse, il semble bien clair que les politiques anti-natalistes, comme celles mises en oeuvre par le gouvernement Chinois, puissent exercer des effets très nets sur la fécondité et la natalité, avec des conséquences sévères sur la pyramide des âges, comme l'illustre cette pyramide des âges de la Chine. Figure 8 : Pyramide des âges de la Chine en 2005 Quelques statistiques commencent à être recueillies sur des indicateurs qui peuvent renseigner sur les comportements en matière de reproduction. Mais 130 131 Voir Problèmes économiques (op. cit.) Gouvernement installé en France après l’occupation allemande en 1940 220 l'interprétation de ces indicateurs reste limitée par l'absence de données systématiques et par la difficulté même de comprendre les décisions liées à la fécondité. Ces indicateurs sont les suivants : Pourcentage de femmes d'une population qui vivent en union consensuelle (terme utilisé pour désigner la vie en couple par consentement mutuel), ce qui inclut non seulement les femmes mariées, mais aussi toutes les autres formes de vie en couple durable. Pourcentage de femmes d'une population qui ont entre 15 et 49 ans (l'âge de la fécondité). C'est le seul indicateur clair, plus il y a de femmes d'âge fécond dans une population, plus il y a de naissances dans cette population, en raison de l'effet de taille. Le tableau 1 nous donne ici l’évolution de la proportion de femmes fécondes au niveau mondial. Tableau 12 : Pourcentage de femmes fécondes (15-49 ans) au niveau mondial Année 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 Milliers 623 947 706 966 855 325 1 058 712 1 315 357 1 559 721 1 763 267 1 878 362 1 984 651 2 037 965 2 063 159 Pourcentage 49,4 46,8 46,4 47,9 50,2 51,6 51,8 49,7 48,5 46,8 45,3 Source: World population Prospects: the 2004 revision population database Les chiffres après 2005 sont des prévisions basées sur une hypothèse moyenne d'évolution de la fécondité. On comprend mieux en regardant ces chiffres pourquoi la population mondiale va augmenter jusqu'en 2050, alors que pourtant les taux de reproduction ou les indices de fécondité sont en dessous du seuil de reproduction dans déjà la moitié de l'humanité. Pourcentage de femmes qui utilisent des moyens contraceptifs : il existe des chiffres dans les pays occidentaux, basés sur des enquêtes ou sur des chiffres recueillis par les services de santé, mais les données restent fragmentaires, pas nécessairement fiables et de toute façon difficiles à interpréter. On profitera ici de l'occasion pour faire la distinction entre la fertilité et la fécondité, deux mots qui sont parfois considérés comme synonymes mais qui pourtant ont un sens différent en démographie. La fertilité, désigne normalement la possibilité biologique d'avoir des enfants. C'est donc le contraire de la stérilité. La fécondité, c'est le fait d'avoir effectivement des enfants. Une femme fertile peut donc rester inféconde. Par contre, 221 une femme féconde est forcément fertile. Pour comprendre la différence, il suffit de songer au cas des femmes fertiles (qui peuvent avoir des enfants parce que non stériles) mais qui restent infécondes parce qu'elles ne veulent pas avoir d'enfants et qu'elles utilisent par exemple des moyens contraceptifs. Nombre d'avortements : le nombre d'avortements déclarés, dans les pays où l'avortement est légal, comme en France (où il reste néanmoins encadré sévèrement par la loi et souvent mal accepté par les populations dans les faits), reste assez peu élevé. Il est difficile de penser que c'est la possibilité légale d'avorter qui est à l'origine de la baisse de la fécondité. Section 2 : La démographie au niveau mondiale À partir des années 1950, les pays industrialisés sont rentrés dans une transition démographique. Avant d’aborder ce sujet, il convient de faire l’historique de la population mondiale. I/ Historique de la population humaine. La population humaine a connu une augmentation plus ou moins permanente depuis l'apparition de la vie sur la terre, mais la croissance s'est accélérée depuis deux cents ans et jusqu'à une période très récente. On peut distinguer quatre phases dans l'histoire démographique de l'humanité: L'ère préagricole : elle a duré certainement cinq cent mille ans et se caractérise par une densité démographique assez faible: le taux de natalité était probablement élevé, mais le taux de mortalité l'était également presque, le rythme d'accroissement naturel était très faible. A la fin de cette phase la population du globe atteignait peut être un maximum de cent millions d'habitants. La phase de l'agriculture sédentaire à la Révolution industrielle est marquée par l'introduction de l'agriculture sédentaire. La Révolution industrielle, survenue à la fin du XVIIIème siècle et au début du XIXème siècle voit l’accroissement de la production alimentaire ce qui va entrainer une baisse du taux de mortalité, une élévation de l'espérance de vie et l’accélération progressive de la croissance démographique. En 1800, la population mondiale s'élève à environ 1.7 milliards d'habitants. La troisième phase va de la Révolution industrielle à la Seconde Guerre Mondiale avec le démarrage de la croissance économique moderne et le renforcement du potentiel démographique de la terre. Aux innovations industrielles correspondent des innovations agricoles, qui permettent le transfert d'actifs vers l'industrie, tout en élevant suffisamment vite la productivité des travailleurs agricoles restants pour assurer l'alimentation d'une population urbaine en expansion. Les importants progrès dans beaucoup de domaines vont améliorer la croissance démographique : la médecine, l'hygiène et l'industrie pharmaceutique, facteurs qui réduisent le taux de mortalité. La croissance démographique s'accélère pour atteindre 1% par an environ au moment de la Seconde Guerre Mondiale. Quand 222 cette troisième ère démographique prend fin, en 1945, la population mondiale est légèrement inférieure à 2.5 milliards d'habitants. La dernière phase est celle l'après-guerre marqué par de nouveaux développements révolutionnaires dans la production alimentaire et la lutte contre les maladies. Les techniques introduites au cours de l'ère précédente dans les pays développés connaissent une extension mondiale. La chute brutale des taux de mortalité dans de nombreuses régions porte le taux d'accroissement naturel à 2%, voire 3% ce qui instaure désormais l’ère du doublement de la population mondiale qui va atteindre 5 milliards d'habitants en 1987 pour dépasser dans ce troisième millénaire 6 milliards d'habitants. À l'évidence, cette quatrième ère sera marquée par un ralentissement de l’accroissement démographique. De nombreux pays en développement suivent les pays industriels sur la voie d'une transition démographique. II/ La transition démographique depuis 1950 Le demi-siècle qui vient de s’écouler est marqué par la généralisation et l’accélération de la démographie dans l’ensemble du monde. Dans le même temps, la croissance de la population mondiale s’est sensiblement ralentie. En moins de cinquante ans elle aura tout de même doublé passant de 3 milliards en 1960 à 6 milliards en 1999. Si le chiffre des 7 milliards d’habitants devrait être atteint entre 2010 et 2015, la croissance devrait, au-delà, nettement ralentir sauf en Afrique. Deux «révolutions» ont provoqué ces rapides bouleversements démographiques : la révolution sanitaire et la révolution contraceptive. D’abord l’amélioration des conditions sanitaires (accès à l’eau potable, construction d’égouts, ou encore couverture vaccinale) a été déterminante dans l’allongement de l’espérance de vie. Les pays en développement ont ainsi gagné en moyenne près de vingt deux années. Il reste aujourd’hui peu de pays dans lesquels l’espérance de vie demeure inférieure à 45 ans. Ensuite un mouvement de baisse de fécondité a lieu en l’espace de quelques décennies sur l’ensemble de la planète, quelle que soit, la culture ou la géographie des pays. La transition démographique cause une augmentation dramatique des disparités démographiques d’un pays à l’autre avec des pays surpeuplés et des pays sous peuplés comme l’indique le tableau qui suit : Encadré 11 : répartition de la population mondiale. Les régions à taux de fécondité élevé comme l’Afrique et l’Amérique Latine ont un produit national brut (PNB) par habitant plus bas et une croissance démographique annuelle plus élevée que les régions plus développées. Principales régions du Population courante Accroissement naturel monde 1998 (en millions) annuel de la population Monde 5926 1,4 Pays développés 1178 0,1 Pays moins développés 4748 1,7 Afrique 763 2,5 Amérique du Nord 301 0,6 Amérique Latine et Caraïbes 500 1,8 Océanie 30 1,1 Asie 3604 1,5 Europe 728 -0,1 223 Source: Population Reference Bureau (1998), World Population Data Sheet. Section 3 : Les tendances démographiques globales en Afrique. Le continent Africain, à l’opposé du Nord est caractérisé par une croissance relativement importante de sa population. Déjà en 1995, la population de l’Afrique était estimée par les Nations Unies à 728 millions d’habitants. À la même date la population du monde était de 5,72 milliards de personnes. L’Afrique représentait ainsi 12,7% de la population mondiale. En 1998, d’après l’hebdomadaire « Problèmes économiques », elle est estimée à 763 millions soit une croissance moyenne annuel de 1,18%. Ainsi, les taux de croissance les plus élevés se situent dans les pays les plus pauvres, donc en majorité en Afrique, qui sont les moins préparés à offrir les services de base et les emplois nécessaires aux effectifs croissants des jeunes. Dans 62 pays d’Afrique principalement, d’Asie et d’Amérique latine, plus de 40% de la population sont âgés de moins de 15 ans. L’Afrique, région du monde où la croissance démographique est la plus rapide, est aussi la plus jeune : l’âge moyen y est seulement de 18 ans. On peut exprimer le potentiel de croissance d’une population en calculant son temps de doublement. Pour une population au rythme d’augmentation constant, celui-ci s’élève à 70 environ, divisé par le taux de croissance. Ainsi la population qui s’accroît de 1% par an double en environ 70 ans, tandis que celle qui augmente constamment de 2% par an doublera exactement en 35 ans. La formule de l’accroissement exponentiel est : Pt = P0 ert où P0 représente la population de l’année de référence, Pt la population au bout de t années, e la base du logarithme et r le taux d’accroissement annuel. Si Pt =2P0, alors : 2P0 = P0 ert 2 = ert Il s’ensuit que 2 = e7 (approximativement). Cela signifie que rt, égal à la multiplication du taux d’accroissement et du nombre d’années, doit être égal à 0,7. Par exemple, avec un taux d’accroissement annuel de 2%, 0,02 X 35 = 0,7. I/ Le recul de la mortalité et l’amélioration de l’espérance de vie Tous les pays africains ont entamé leur transition dans la mesure où la baisse de la mortalité est un constat général partagé par tous. Mais les situations sont très diverses : si dans certains pays la mortalité a beaucoup baissé, d’autres payent encore un lourd tribut. Tableau 2 : Évolution des indicateurs de mortalité Taux brut de mortalité Espérance de vie Période (en %0) Afrique Monde Afrique Monde 1950 - 1955 26,8 19,8 37,8 46,4 1960 – 1965 22,9 15,6 42,0 52,3 1970 – 1975 19,2 11,7 46,0 57,9 1980 – 1985 16,5 10,3 224 49,4 61,3 1990 – 1995 13,7 9,3 53,0 64,4 Source : Francis GENDREAU, Démographies africaines, Éditions ESTM. II/ La transition démographique, conséquence modernisation économique et sociale. du processus de Le taux brut de natalité du continent est encore élevé (42%0) même si son évolution récente marque une tendance à la baisse : il aurait diminué de près de 15% depuis les années cinquante. Les différents pays africains connaissent ainsi une fécondité encore forte. En 1999, dans onze d’entre eux, tous situés dans l’Afrique continentale noire, les femmes ont en moyenne au moins 7 enfants. À l’opposé, six pays ont un indice synthétique de fécondité inférieur à 4. Les théoriciens de la transition démographique font de la démo-économie et tentent alors d’établir le lien entre évolution générale de la population et celle de l’économie. Les auteurs accordent aux facteurs économiques et sociaux un rôle prépondérant (NOTESTEIN, DAVIS, THOMPSON, A. LANDRY). Pour ces auteurs, les changements démographiques apparaissent comme la conséquence de la « vie industrielle-urbaine » (NORSTEIN, 1945), de l’ « industrialisation »(THOMPSON), de la « modernisation ou du développement socio-économique ». Selon Annie VIDAL « paradigme central de la science démographique, la transition s’entend comme le passage d’un régime traditionnel d’équilibre démographique à mortalité et fécondité fortes, à un régime moderne d’équilibre, à mortalité et fécondité basses »132 Mais a-t-on affaire à une théorie, à un schéma, à un modèle ? S’il y a accord sur la signification du concept, la question de son statut demeure controversée. Pour J. C. CHESNAIS, trois paradigmes peuvent être envisagés : d’abord, le principe d’antériorité de la baisse de la mortalité, ensuite le modèle de la transition reproductive en deux phases (limitation des mariages, puis limitation des naissances) et enfin l’influence de l’entrée dans la croissance économique moderne… sur le déclenchement de la baisse séculaire de la fécondité. Cela apparaît dans les trois phases qui montrent que la corrélation entre développement économique n’est pas figée et passe par trois phases. La première est celle que MALTHUS a bien analysée et elle se traduit par des taux de natalité et de mortalité élevés. La croissance démographique est alors rythmée par les phénomènes naturels comme les famines et les épidémies. D’où la fameuse boutade de MALTHUS : « Au banquet de la nature, il n’y a point de couverts pour eux ; la nature leur commande de partir et elle ne manquera pas de mettre ce commandement en exécution ». Dans la deuxième phase interviennent deux phénomènes : d’une part les progrès de la médecine abaissent le taux de mortalité et d’autre part les ménages prennent conscience des charges des enfants et de l’amélioration du statut social de la femme pour adopter des comportements qui vont faire baisser la natalité. La troisième phase est celle d’un équilibre de bas niveau démographique. 132 Annie VIADAL : La pensée démographique, Édit. PUG, Collection L’économie en plus, 1994 225 Figure 9 : La transition démographique L’Afrique est au début de la seconde phase avec cependant un écart entre taux de natalité et de mortalité pas encore assez écrasé particulièrement au niveau des couches populaires où l’on observe encore des rigidités des comportements démographiques. Différentes statistiques démographiques concordent pour établir que l’explosion démographique africaine va se poursuivre pour les années avenir comme en témoigne le tableau qui suit établissant les évolutions marquantes d’ici 2025 : Population rurale et urbaine de l’Afrique par grande région en 1990 et 2025 (en milliers d’habitants). Rurale Urbaine Totale Est Centre Sud Ouest Sud du Sahara 1990 2025 1990 2025 1990 2025 154 013 43 596 17 761 130 740 345 970 288 398 70 014 21 010 213 290 592 712 42 860 26 458 22 465 62 962 154 745 254 138 122 328 59 123 294 165 729 754 196 873 70 054 40 086 193 072 500 715 542 536 192 342 80 133 507 455 1322 466 Source : Nations-Unies, World Urbanisation Prospects. La population de l’Afrique Sud Saharienne devrait passer de 500 millions d’habitants en 1990 à 1,300 milliard en 2025 ce qui équivaut à une multiplication par 5 dans la période. Selon E.V. de WALLE, l’Afrique détient le record mondial de la fécondité avec 6 à 8 enfants par femme en moyenne… Du côté de la mortalité, les projections supposent que l’espérance de vie continuera à augmenter de deux ans tous les 5 ans. Les progrès de la médecine, de l’hygiène, de l’agriculture ont contribué à l’augmentation de la population. Cette dernière est inégalement repartie dans l’espace d’un pays, d’une région ou d’un continent. Dans la plupart des cas la ville reste le principal bénéficiaire. C’est autant dire que l’un des corollaires de la croissance démographique est sans conteste l’urbanisation. Cette dernière correspond à l’arrivée des populations rurales dans les principales villes provoquant ainsi une explosion démographique. La question qui se 226 pose alors est celle de savoir : la ville est-elle un facteur ou un frein au développement ?quels sont les problèmes posés et les solutions préconisées ? Pour répondre à ces questions nous allons analyser comment la ville pourrait être un facteur de croissance ou un frein au développement. Section 4 : Urbanisation et développement : la ville encore un facteur de croissance et de développement ? est-elle Au niveau des pays industrialisés, la ville a joué un rôle primordial. Le phénomène d’urbanisation semble être déclenché en Angleterre pendant la seconde moitié du 18ème siècle par la naissance de l’industrie à laquelle elle a fortement contribué. Tirant les leçons de cette expérience, la pensée économique, toutes tendances confondues, a considéré la ville comme un important facteur de développement et d’émancipation économique et sociale du fait précisément des inégalités favorables des revenus, des effets d’attraction et de polarisation des activités industrielles et des infrastructures de base, de la meilleure connexion avec les marchés internes et externes etc. Egalement, dans les villes s’établit un nouveau type de division du travail. À une répartition des tâches fondées sur l’âge, le sexe, l’ethnie, succède une organisation liée aux aptitudes des individus. La ville connaît par voie de conséquence une structuration en classes sociales qui n’existait pas toujours dans la société rurale. Les migrations réalisées vers la ville provoquent un brassage ethnique qui favorise l’évolution des structures sociales. La ville constitue également un centre de décision économique, politique et administrative. La concentration des élites qui s’y réalise est un facteur de dynamisme. La ville diffuse son influence sur le milieu rural ambiant et contribue à l’évolution de celui-ci. On note en particulier que les structures foncières, les techniques de production se transforment plus rapidement à proximité de la ville et que la mobilité de ces structures se réduit au fur et à mesure que l’on s’éloigne. Partout dans le monde les tendances à l’urbanisation sont devenues lourdes : actuellement plus de 45% de la population vivent dans des zones urbaines et se chiffre pourrait passer à 60% vers 2030. Dans les faits, la dynamique urbaine est particulièrement portée par les PSD d’Asie, d’Afrique et d’Amérique Latine. Toutefois, contrairement au rôle qu’a joué la ville dans le développement des pays industrialisés, dans les pays du tiers monde, la ville apparaît comme un poids, un cancer, un frein au développement. En effet, dans ces pays le phénomène urbain commence à poser de sérieux problèmes relatifs à l’emploi, au logement, aux transports, à l’assainissement, à la santé, à l’éducation. Cela présage que les villes sont des volcans en ébullition. I/ Urbanisation accélérée et chaotique en Afrique. S’il est vrai que l’existence des villes est un phénomène ancien en Afrique, c’est néanmoins la colonisation qui lui a imprimé le caractère qu’elle connaît de nos jours. Les grandes villes actuelles ont été choisies en fonction des considérations liées aux besoins de la colonisation. Les ports maritimes ont été généralement favorisés : Lagos, Dakar, Abidjan, Luanda… et la localisation des grands centres urbains reste marquée par cette extraversion. Dès cette époque, les investissements ont été concentrés dans des capitales où résidait l’essentiel des cadres dirigeants de l’administration coloniale. En dehors des vieilles villes marchandes sahélo227 soudanaises et de la civilisation Yoruba, les villes de l'Afrique noire sont nées avec la colonisation comme ville-capitale administrative ou ville-portuaire. Elles ont pour site des points privilégiés de la ligne d'interface océan-continent, les intersections de lignes de transport intérieur et les points de rupture de fret : escales sur les fleuves (Kinshasa 1881), intersection ferroviaire, contact fleuve/chemin de fer et lac (Kisangani). Depuis les indépendances, la croissance urbaine a été explosive et chaotique avec un taux de croissance d’environ 10% par an jusque dans les années 1990. En 1950, on dénombrait pour l'ensemble de l'Afrique, 3 villes millionnaires, 25 en 1990, 30 en 1995 et 42 en l'an 2000. Elles concernent maintenant plus de 40 % de la population totale. De 1950 à 1990, la population urbaine a été multipliée par 10 en Afrique sub-saharienne, tandis que la population totale triplait. Cette dynamique urbaine procède de la conjugaison de plusieurs facteurs : forte concentration des activités économiques et sociales et des infrastructures, faillites des politiques agricoles etc. Les initiatives peuvent aussi provenir de décision politique pour décongestionner la grande agglomération ou alors se démarquer de l'empreinte coloniale : la capitale de la Côte d' Ivoire transférée à Yamoussoukro (1983) et celle du Nigeria à Abuja (1974), Ouagadougou 2000. Aujourd’hui, les plus grandes villes d’Afrique se hissent dans le groupe des 10 villes les plus peuplées du monde dépassant les 10 millions d’habitants parmi elles, le Caire et Lagos. Cette dernière agglomération au rythme actuel de sa croissance comptera 25 millions en 2025. A ces mégalopoles s’ajoutent Kinshasa (4 million d’habitants), Alexandrie et Alger (3,5 million d’habitants), puis viennent Casablanca, Tripoli, Abidjan et le Cap. En définitive, si l’urbanisation africaine a été tardive, elle est en train de s’accélérer avec rapidité. Cette évolution apparaît clairement dans le tableau qui suit : Tableau 17 : Proportion de la population urbaine de 1960 à 2006 (en %). Sous-régions 1960 1975 1985 2000 2004 2005 2006 Afrique Occidentale Afrique Orientale Afrique du Nord Afrique Centrale Afrique Australe 13,4 7,3 30,0 18,2 42,2 20,0 12,8 40,5 29,6 46,5 26,0 18,9 47,7 39,3 52,1 36,6 29,4 58,1 52,2 61,1 - - - Total Afrique Monde Régions développées Régions en développement 18,4 33,6 60,3 21,4 25,6 8,3 68,7 7,1 32,1 1,6 72,4 31,7 8,2 77,8 40,4 39,1 - 39,6 - 40,1 - Sources : Afrique contemporaine du 1er trimestre 1988, BAD statistics pocketbook 2007. Ce tableau révèle que l’Afrique connait un rythme élevé d’urbanisation depuis les indépendances. En effet, la population urbaine est passée logiquement de 18,4% en 1960 à 40,1% de nos jours. Le Maghreb reste la région la plus urbanisée avec 58,1% de citadins en 2000. %. Malgré cette accélération urbaine, le continent compte parmi les moins urbanisés. En effet, le monde affichait en 2000 un taux d’urbanisation de 48,2% pour les PSD et une moyenne de 77,8% pour les pays développés. 228 Certains économistes et urbanistes tentent de démontrer que la ville est un moteur indispensable du développement, de la modernité et de la socialisation et la campagne en est le pourvoyeur de sa main-d'œuvre, éventuellement de ses approvisionnements surtout alimentaires. Pourtant, pour le Bureau International du Travail (BIT), au delà d’un million d’habitants, la ville pose de nombreux problèmes de gestion avec des charges de plus en plus lourrdes pour les différents équipements urbains, les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité, de voies publiques, de transports. De façon globale, toutes les villes africaines posent à des degrés divers des problèmes liés : aux infrastructures de base : routes, électricité, écoles, structures de santé au foncier et à la crise du logement l'étalement spatial et la fragmentation du tissu urbain manifestent l’impossibilité des autorités à canaliser l’avancée anarchique du front d’urbanisation ou la surdensification des centres. On rappellera que 40 à 70 % des citadins vivent dans des constructions illégales. aux transports la question est posée en termes d’inégalité spatiale pour les classes populaires rejetées en périphérie qui doivent effectuer de longs déplacements journaliers vers le centre pour y exercer leurs activités marchandes. A l'environnement : accès à l'eau potable, évacuation ou traitement des déchets. A l’insécurité donnée importante de la vie urbaine : l’insécurité sanitaire plane sur les quartiers d’habitat spontané et se double de l’insécurité foncière menaçant les familles récemment installées A la pauvreté et au chômage Tous ces problèmes montrent que le phénomène urbain constitue une préoccupation majeure, même dans le cas des centres urbains moins peuplés car le rythme de leur croissance démographique est sans rapport avec des capacités de production économiques. C’est surtout sous la pression des émeutes des banlieues que le monde a pris conscience de l’ampleur du phénomène urbain avec les implosions des bidonville, taudis, gourbi, ghetto, slum, township, favela, mocambo…Des vocables qui évoquent les espaces qu’on pourrait qualifier d’infraurbains qui exprime l’extrême précarité.133 Une urbanisation accélérée a des effets négatifs sur le développement : importance du chômage, impossibilité d’assurer une croissance urbaine cohérente, développement des bidonvilles dans lesquels vit un prolétariat misérable, coût considérable des infrastructures urbaines, prélèvements en moyens financiers et en personnel qui aboutissent à un sous équipement du reste du pays. L’hypertrophie urbaine peut ainsi devenir une cause nouvelle de mauvais développement en entretenant et en amplifiant les inégalités. D’autre part le développement ne peut résulter de la simple croissance d’une ville tentaculaire. Il implique un aménagement de la hiérarchie urbaine de manière à ce qu’il se crée une spécialisation fonctionnelle des villes et une complémentarité dans leurs activités et dans leurs zones d’influences. Or cette condition est rarement satisfaite dans les pays en voie de développement : de nombreuses régions ne sont soumises à l’attraction d’aucun centre urbain important. Les zones d’attraction 133 Mike DAVIS: Le Pire des mondes possibles. De l’explosion urbaine au bidonville global, traduit de l’anglais par Jacques MAILHOS Editions La Découverte, 252 pages. 229 urbaine sont souvent isolées et non intégrées ni hiérarchisées, la grande ville tend à exercer son emprise sur l’ensemble du pays (voir indice de primatie tableau 4) et empêche ainsi l’industrialisation des centres secondaires en l’absence de politiques volontaristes. Il apparaît donc en conclusion sur ce point que la politique d’aménagement urbain devrait être l’une des principales préoccupations des responsables du développement, mais l’observation nous montre que dans la réalité l’urbanisation est souvent le domaine de l’anarchie. II/ Corrélation entre défis démographiques et crise économique. Quel est le rapport existant entre la démographique et l’économie ? La démographie est-elle une variable favorable ou défavorable à la croissance économique ? Qu’en est-il aujourd’hui des analyses malthusiennes ? Y’a-t-il une corrélation entre démographie et économie (démo économie) ? Plus précisément encore, la croissance économique africaine est-elle capable d’absorber le croît démographique ? La question n’est pas nouvelle bien qu’elle ne trouve pas encore une réponse adéquate c’est-à-dire la population optimale en relation avec les ressources disponibles. A. SAUVY a tenté de trouver l’optimum de population en relation avec les disponibilités en ressources dans un espace donné. Les résultats des recherches dans le domaine sont assez minces. On sait seulement que pour résorber le croît démographique, un pays doit maximiser sa croissance économique et minimiser la variable démographique. La Chine, le Japon et même l’Inde jadis surpeuplés s’en sortent, aujourd’hui, en réalisant des processus soutenus de croissance souvent supérieur à deux chiffres et en tentant de limiter de manière drastique leur accroissement démographique. Un Nigéria de 400 millions d’habitants, un Mali, un Sénégal et Burkina de 40 à 50 millions, un Kenya avec 100 millions peuvent-ils s’en sortir au regard de leur situation de crise économique, du caractère très peu diversifié de leurs systèmes productifs, de l’extrême faiblesse de leur rythme de croissance et de leur taux élevé croît démographique ? Comme le note E.V. de WALLE « aujourd’hui, confrontés à une masse croissante de main-d’œuvre sous-employée, il faut raisonner en termes de capital humain, de productivité, de qualification et de niveau d’instruction. L’accumulation de paysans illettrés sur des terres fragiles n’offre guère de potentiel de croissance économique pas plus que le trop-plein qui s’écoule vers des villes sans infrastructures et sans industries».134 Il semble que la jeunesse de la population africaine est un atout de taille. Qu’en est-il exactement ? III/ La jeunesse de la population africaine est-ce vraiment un atout ? À l'heure actuelle, on compte 1,3 milliard de jeunes âgés entre 12 et 24 ans dans l'ensemble des pays en développement. La question de la jeunesse est relativement nouvelle dans le domaine de l’économie du développement. Cependant, elle n’est autre qu’une nouvelle facette des théories sur le capital humain de la nouvelle école de Chicago. La théorie du capital humain « aide à rendre compte des phénomènes comme les différences de salaires selon les personnes et selon les lieux, la forme des profits des salaires selon l’âge, la relation entre âge et salaires, et l’effet de la spécialisation sur la compétence. 134 Etienne van de WALLE : La démographie de l’Afrique au Sud du Sahara, Revue Etude, octobre 1993. 230 Dans les pays en développement, particulièrement en Afrique ou les jeunes constituent une large part de la population, la question de la jeunesse commence à être une préoccupation majeure. Mieux, on commence à prendre conscience du poids qu’elle pourrait jouer dans le processus de développement à long terme, bien que, selon la Banque mondiale, près de la moitié de cette population est actuellement sans travail. En plus, un nombre considérable de jeunes ne sait ni lire ni écrire. C’est dire que la scolarité secondaire et l'acquisition des compétences correspondantes ne peuvent avoir de sens que si la scolarité primaire a pleinement porté ses fruits. D’où l’impérieuse nécessité de porter les efforts d’éducation à ce niveau. Source : Banque Mondiale, RMD 2007. Note : La barre pleine dénote le taux de chômage des jeunes dans un seul pays; la portion claire indique le taux de chômage des adultes dans le même pays. Dans son Rapport de 2007 portant sur « Le développement et la prochaine génération », la Banque mondiale souligne que la prédominance de la jeunesse comporte des risques mais ouvre aussi des opportunités immenses. En effet, comme le souligne Paul WOLFOWITZ, Président de la Banque mondiale, « Le fait qu'un nombre aussi important de jeunes vivent dans les pays en développement présente de grandes opportunités, mais aussi des risques. Cela présente de grandes opportunités dans la mesure où de nombreux pays auront une main-d'œuvre plus nombreuse et plus qualifiée, et moins de personnes à charge. Mais il faut que ces jeunes soient bien préparés de manière à créer et trouver de bons emplois»135 Le premier aspect soulève le volume important d’investissements à consentir sur la jeunesse et qui ne sont pas toujours à la portée des Etats. En prenant simplement le cas de l’éducation, les investissements requis pour le primaire et le secondaire se chiffrent à environ 70 milliards de dollars pour les PED : cela représente 3% de leur PIB. Il convient d’y ajouter d’autres charges comme la préservation contre les grandes pandémies et la création d’emplois. François Bourguignon, économiste en chef et premier vice-président de la Banque mondiale pour l'économie du développement. 135 231 Aussi, la situation de la jeunesse actuelle en Afrique offre une opportunité unique pour accélérer la croissance et réduire la pauvreté que moyennant trois actions déterminantes : Investir massivement dans l’éducation avec une amélioration permanente de la qualité des systèmes éducatifs en évitant les effets d’éviction Répondre à la demande de compétences Faciliter l’accès au marché du travail Toutes ces mesures rentrent dans la politique de formation d’un capital humain plus productif capable de porter les innovations. Il s’agira principalement d’investissements dans l’éducation, mais aussi dans la santé, garantir l’accès au marché par une meilleure planification de l’emploi, auxquels la Banque mondiale ajoutera l’exercice du civisme. Encadré 19 : L’investissement dans les jeunes est très rentable : Estimation des effets à long terme et interactifs de l’investissement dans le capital humain Des chercheurs ont adapté un modèle à générations imbriquées qui a servi à estimer l’impact macroéconomique du sida pour l’appliquer récemment à une gamme plus élargie d’investissements dans le capital humain en Afrique : « En tuant essentiellement les jeunes adultes, le sida ne fait pas que détruire le capital humain qu’ils incarnent, il prive leurs enfants des choses mêmes dont ils ont besoin pour devenir des adultes économiquement productifs — les soins des parents, leurs connaissances et leur capacité à financer l’éducation ». Dans une étude récente qui modélise explicitement les effets de l’enseignement secondaire, les auteurs estiment que l’épidémie du sida, qui a frappé le Kenya en 1990, a réduit le capital humain et le revenu par habitant à tel point que l’on ne retrouvera pas les niveaux de 1990 avant 2030. Un investissement dans l’éducation — sous la forme d’un programme de 30 ans pour subventionner l’enseignement secondaire, d’un coût de l’ordre de 0,9 % du PIB, à compter de 2000 et passant à 1,8 % du PIB en 2020 — se traduira par un revenu par habitant supérieur de 7 % au niveau qui aurait été atteint sans cette intervention, les avantages continuant de se produire bien au-delà de 2040. La valeur actuelle nette des avantages, à des taux d’actualisation réalistes, serait 2 à 3,5 fois supérieure à celle des coûts — un investissement fort rentable. En raison de la synergie qui a toujours existé entre l’enseignement post-primaire et la santé des jeunes adultes, il serait encore plus avantageux d’associer à cette subvention des mesures directes pour lutter contre l’épidémie du sida et traiter ses victimes. Un programme associant une subvention moins importante et des mesures pour lutter contre la pandémie et traiter ses victimes permettrait d’obtenir, avec le même montant d’argent, des avantages encore plus spectaculaires. Ces avantages sont imputables non pas seulement au fait que l’on sauve des vies humaines, mais aussi au fait que l’on est encouragé à investir davantage dans l’éducation suite à la réduction de la mortalité. Source: Banque mondiale, Rapport mondial sur le développement 2007 Section 5 : La problématique de la migration internationale « Pour l’émigration, on peut se poser la question de savoir si elle est gérée collectivement ou si elle est uniquement la réponse d’individus face à des problèmes économiques ou sociaux. Que peut-on dire par exemple de la grande migration européenne vers l’Amérique du Nord ? Etait-ce la gestion collective d’un excédent démographique ou un exutoire pour des problèmes individuels ? Ce mouvement a, enfin de compte été bénéfique et pour l’Europe et pour les nouvelles populations 232 d’Amérique du Nord…. Si l’on imagine comme l’ont dit certains sans aucun fondement que 50 millions d’africains débarquent en Europe, qu’est ce que cela va changer ? En soit le chiffre paraît important mais que représente-t-il par rapport à 500 millions d’européens ? Un dixième. Si nous ne sommes pas capables de gérer cela, nous sommes vraiment minables. Cela ne modifiera pas nos problèmes…Les mouvements migratoires sont indispensables pour renouveler une société ». Jacques VALIN. I/ Le phénomène migratoire Les facteurs explicatifs des migrations sont à la fois nombreux et très complexes. Certains sont dus à des situations d’ordre économique, des troubles, des guerres, aux famines, aux effets d’imitation, bref à la recherche de meilleures conditions de travail et de bien être. L’une des causes principale de la migration des personnes est l’amélioration des conditions de vie des migrants. En effet, ces populations vivant dans la misère, sans travail ne trouvent d’autres solutions que de quitter leur région, leur pays voire leur continent. En agissant ainsi, les migrants espèrent trouver ailleurs mieux que ce qu’il y a chez eux. Les personnes quittent aussi leur lieu d’origine pour une meilleure gestion du risque. Le modèle HARRIS-TODARO montre le passage du secteur rural au secteur urbain et soulève le passage du domaine du certain au domaine risqué. Selon BAUDASSE136 (2003), il est clair en effet que si l’espérance de revenu dans le secteur urbain est suffisamment grande, celle-ci peut compenser le risque encouru : il faudra pour que les individus acceptent de migrer que l’équivalent certain (espérance de gain diminuée de la prime de risque) de la loterie constituée par l’activité urbaine soit supérieure au revenu rural (supposé certain), donc il faut et il suffit que l’espérance de gain en ville soit supérieure à la somme du revenu rural et de la prime de risque. Encadré 12 : Modèle Harris-Todaro Dans leur article pionnier de 1970, Harris et Todaro présentent un modèle d’équilibre général à deux secteurs, rural et urbain, ce dernier se caractérisant par la persistance du chômage à l’équilibre. Les stocks de capital par secteur sont fixes, de même que l’offre totale de travail. Le problème central à analyser est celui de l’allocation de la main-d’œuvre entre les secteurs. Leur conclusion est que le mouvement de la main d’œuvre du milieu rural vers le milieu urbain se poursuit jusqu’à ce que le salaire agricole (WA) égalise le salaire espéré en milieu urbain (WEU). Ce dernier est égal au salaire urbain (WU) que multiplie le taux d’emploi en milieu urbain, qui mesure la probabilité perçue par un chercheur d’emploi d’être embauché dans le secteur manufacturier. LU E WA = W U = WU (LU + CU) LU , CU: respectivement l’emploi et le chômage en milieu urbain. BAUDASSE T., « Les théories économiques des migrations », laboratoire d’économie d’Orléans, document n° 2003-01 136 233 Source : MAROUANI M. A., (1999), « Libéralisation commerciale et emploi en Tunisie : un modèle d’équilibre général avec salaire d’efficience ». http//www.dial.prd.fr Les individus migrent également afin d’améliorer leur revenu relatif dans un groupe de référence. Ce groupe de référence est selon certains auteurs, le secteur d’émigration, par exemple le village de provenance des migrants potentiels. La migration est vue comme une manière d’accroître la place de la famille ou du ménage dans le village. Ceci se fait alors en envoyant certains membres de cette famille en ville pour travailler. Notons que la migration se fait le plus souvent des pays en développement vers les pays développés. Les migrants sont en majorité de jeunes, de plus en plus de femmes. Encadré 13 : La migration comme gestion du risque Si on reprend les observations faites par Fiels (1975), le revenu urbain serait plus de deux (2) fois supérieur au revenu rural, tandis que le taux d’emploi serait rarement inférieur à 80 %. Supposons un individu risquophobe dont la fonction d’utilité dans l’incertain serait U(x) = √x, supposons que l’activité urbaine fournisse un revenu de 200 avec la probabilité de 0.8 et 0 avec une probabilité de 0.2, et l’activité agricole un revenu de 100 avec certitude : - l’espérance d’utilité de l’activité agricole est de √100 = 10 - l’espérance d’utilité de l’activité urbaine est 0.8*√200 + 0.2*√0 = 11.31 La migration est donc avantageuse dans un tel cas, malgré l’aversion pour le risque. Source : Thierry Baudasse (2003), « Les théories économiques des migrations », Laboratoire d’économie d’Orléans, document N° 2003-01, pages 14 et 15 La migration volontaire a débuté il y a 200 ans. On distingue différentes typologies de migrations : La migration de travail qui est difficile à évaluer en raison du manque de chiffres dû à l’existence du secteur informel. Ces flux migratoires concernent 100 millions d’individus. Selon des évaluations récentes, les principaux foyers d’accueil des migrants de travail se trouvaient en Inde et au Canada. De nombreux pays tels que l’Espagne, l’Italie, La France, les États-Unis emploient une main d’œuvre abondante saisonnière étrangère au moment de la culture ou de la récolte manuelle de certains fruits et légumes. Ces travailleurs sont le plus souvent mal logés, mal payés et avec une couverture sociale imparfaite ou inexistante, tout en étant exposés aux pesticides et à divers infections. La migration des réfugiés est justifiée par des mouvements de contrainte telles les persécutions ethniques, religieuses, régimes politiques injustes, les guerres civiles. 50% de ces déplacements concernent l’Afrique subsaharienne. II/ Les mutations et tendances de la migration internationale. La migration mondiale a connu quatre grandes mutations au cours des 50 années qui ont suivi la seconde Guerre Mondiale. La première concerne la chute de l’émigration des citoyens européens, en raison d’importants mouvements au sein de l’Europe (y compris la Turquie).En 234 2000, les étrangers d’origine européenne constituent 10.3 % contre 1.3 % en 1950. L’Europe de l’Ouest et du Sud a accueilli des migrants provenant de l’Asie, du Moyen-Orient et de l’Afrique. Aussi, depuis l’effondrement de l’Union Soviétique, l’Europe de l’Ouest a reçu les migrants de l’Europe de l’Est. L’effectif des migrants de l’Europe a donc monté en flèche dépassant celui des États-Unis, et ceci sans compter l’effectif des clandestins. La seconde mutation est celle de l’immigration de l’Europe de l’Est vers l’Ouest, avec l’ouverture des économies Polonaises et Roumaines, de la chute du mur de Berlin. Les flux provenant de ces économies ont quadruplé entre 1985 et 1989, plus d’un million de personnes par an jusqu’en 1993. La troisième mutation est celle qui concerne l’Amérique Latine d’antan, grand pôle d’immigration, est devenue un important foyer d’émigration. En 1960, elle comporte 1.8 million d’immigrés, 1.8 million d’émigrés en 1960.Cette situation est causée par la présence de son voisin au Nord plus prospère. La quatrième mutation a lieu après la seconde Guerre Mondiale. Une importante vague de migrants en provenance d’Asie, d’Afrique et du Moyen Orient a été observée. La première phase du processus d’industrialisation et de transition démographique a fait le piège de la pauvreté et déclenché une importante poussée d’émigration. En 2005, le nombre de migrants dans le monde est évalué entre 185 et 192 millions, soit environ 2.9 % de la population mondiale totale. 63 % des migrants vivent dans les pays développés contre 34 % dans les pays en développement. L’Amérique de Nord et l’Océanie comptent plus de 10 % de migrants, l’Afrique, l’Amérique Latine et l’Asie moins de 2% de la population de chaque région. En 2050, les démographes prévoient 230 millions de migrants pour une population totale de 9 milliards. Le tableau 2 retrace l’effectif et le pourcentage des migrants dans le monde. Tableau 14 : Effectif des migrants dans le monde. Pop. totale Migrants Régions (milliers) (milliers) Pays 1 193 872 104 119 développés % 59,57 Réfugiés (milliers) 5 008 Pays en développement 4 876 709 70 662 40,43 13 631 (dont pays les moins avancés) Afrique (667 757) (10 458) (5,98) (6 551) 795 671 16 277 9,31 6 060 Asie 3 679 737 49 781 28,48 8 450 Europe 727 986 56 100 32,09 5 649 Amérique Latine et Caraïbes Amérique du Nord Océanie 520 229 5 944 3,40 576 315 915 40 844 23,37 1 051 31 043 5 835 3,34 85 235 Monde 6 070 581 174 781 100 21 871 Source : Migration humaine. Une des nouvelles tendances de la migration internationale est le nombre croissant des femmes migrantes. Selon le Fond des Nations Unis pour la Population, (UNFPA)137, les femmes représentent aujourd’hui près de la moitié des migrants internationaux dans le monde entier, elles sont 95 millions. Pour certaines femmes, la migration ouvre les portes d’un monde nouveau, leur apportant plus d’égalité, un soulagement à l’oppression et à la discrimination qui limitent leur liberté et réduit leur potentiel. Chaque année, ces femmes envoient dans leur pays d’origine des centaines de millions de dollars. Cet argent permettra de nourrir des personnes, de les habiller mieux, d’instruire des enfants, bref à la lutte contre la pauvreté. Plus d’un (1) million de dollars en rapatriement de salaire ont été envoyés au Sri Lanka en 1999, 62 % ont été versés par les femmes. Au Philippines, six (6) milliards sont envoyés par an dont le tiers par les femmes. Ces dernières envoient un montant moindre que les hommes, mais elles le font régulièrement. III/ Les effets des mouvements migratoires Les migrants échappent aux impôts dans leur pays d’origine, mais sont imposés dans les pays d’accueil. De même, ils renoncent à certains services pour en bénéficier dans les pays d’immigration. Ces services peuvent être la défense nationale, la protection policière, l’environnement naturel, les écoles publiques. Cependant, les migrants ne peuvent pas déterminer à leur niveau le gain ou la perte due à l’émigration. 1°) Effets dans le pays d’origine L’émigration suppose qu’un ou plusieurs individus renoncent à certains services dans leur pays d’origine. Le poids de cette renonciation ne se sent pas dans la mesure où la protection policière par exemple, ne va pas croître. Par contre, le fait d’échapper aux impôts peut avoir des conséquences pour les finances du pays. En effet, les individus ont tendance à migrer au début de l’âge adulte ; ce qui signifie qu’ils n’auront pas à payer l’impôt sur le revenu, alors qu’ils ont bénéficié de l’enseignement public aux frais du contribuable. 2°) Effets dans les pays d’accueil En général, l’on pense que les émigrés utilisent plus de services qu’ils ne payent d’impôts dans les pays d’accueil ; ce qui n’est pas le cas. Aux États Unis, au Canada et même dans l’Union Européenne, jusqu’à la fin des années 80, les immigrés payaient plus d’impôts par rapport aux services dont ils bénéficiaient. Mais la situation s’est inversée au cours de ces dernières années. Les immigrants utilisent plus de ressources par rapport aux impôts qu’ils versent. Les immigrés illégaux payent plus d’impôts que les légaux. UNFPA, (2006), « État de la population en 2006, les femmes et la migration internationale ». http// www.unfpa.org 137 236 Le continent Africain est l’un des continents dont le flux migratoire est de plus en plus croissant. Depuis 1990, on observe une expansion des migrations clandestines dans toute l’Afrique. IV/ Les flux migratoires africains Les pays africains sont confrontés à de nombreuses difficultés. En effet, ces pays enregistrent le taux de croissance démographique le plus rapide (3%) pour un taux moyen de 1.7 % tout continent confondu. L’effectif de la population qui était de 221 millions en 1950 sera de 1.3 milliards en 2025 et 1.76 milliards en 2050. La pauvreté est quasi présente dans presque tous ces pays. Aussi, le taux de croissance du PIB qui était de 6% par an entre 1965 et 1970 est passé à près de 0% à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Comme nous l’avons déjà vu, globalement, la proportion des populations vivant dans l’extrême pauvreté avec moins d’un dollar par jour est passée de 56 % entre 1965 et 1969, à 65 % entre 1995 et 1999. L’endettement extérieur de ces pays est en forte croissance ; Il a multiplié de 3,3 fois en 20 ans, passant de 60.6 milliards de dollars en 1980, à 206.1 milliards de dollars en 2000. Devant les difficultés dont ils font face dans leur pays, les jeunes africains, filles et garçons espèrent trouver en Europe et aux Etats-Unis de meilleures conditions de vie et de travail. Les principaux continents de migration sont alors l’Europe et les États-Unis. Il existe une pluralité de voies de passage particulièrement pour l’immigration clandestine. Les chiffres tirés de différentes sources montrent que le nombre de migrants sud sahariens accédant au Maghreb par ses frontières sahariennes est entre 65000 et 80000 annuellement au cours des dernières années. 80% des migrants se dirigent vers la Libye et 20 % vers l’Algérie. En ce qui concerne les Etats-Unis, les immigrants africains sont en majorité des professionnels, des cadres et des techniciens. Le nombre des immigrants entre 1980 et 1990 a doublé, passant de 2 900 à 5 800 annuellement (figure 2).138 Selon l’organisation Internationale du Travail, OIT, en 2005, 160 à 250 milliards de dollars sont envoyés par les émigrés dans leur pays d’origine. 138 Après avoir échappés « aux passeurs escrocs », à la noyade, aux barbelés, les candidats arrivent enfin à destination. Une fois en Europe ou aux États-Unis, certains déchantent. En effet, pour la plupart sans formation, ni diplôme, certains ont du mal à trouver un travail, d’autres plus chanceux arrivent à travailler mais dans la clandestinité en effectuant des travaux agricoles, de gardiennage. Ils arrivent par conséquent à faire des transferts dans leur pays. Cependant, les moins chanceux seront rapatriés faute de papiers. Lors de leur rapatriement, les migrants sont abandonnés à leur sort. L’exemple le plus récent est celui du rapatriement des immigrés africains par le canal du désert. Ceuxci sont balancés d’un pays à un autre, abandonnés aux frontières maghrébines, dont les autorités s’empressent de s’en débarrasser. 237 Figure 10 : Immigrants africains admis aux États-Unis 19881998 Source : ARUN P.L., (2006), « Le visas de diversité des États-Unis provoque une fuite des cerveaux en Afrique ». http//www.prb.org Les migrations internationales des africains, c'est-à-dire les migrations ordinaires de travail sans compter les guerres civiles se font surtout sur le continent lui-même. L’Afrique de l’Ouest en est un exemple. VI/ La migration interne : le cas de l’Afrique de l’Ouest La carte migratoire en Afrique de l’Ouest se présente comme suit : Encadré 16: Les principaux mouvements migratoires en Afrique de l’Ouest en 1990 Source: GENTLINI C., « Etude de cas : A la découverte du Sénégal », Académie de Rouen. La mobilité a joué un rôle important dans l’adaptation des populations Ouest africaines aux mutations de leur environnement. En effet, les indépendances et l’entrée dans l’économie de marché ont entraîné des changements dans le paysage économique. Les exportations se développent très rapidement, entraînant une 238 croissance rapide dans les zones de culture de rente. Selon le Club du sahel (1998), on a surtout assisté à une taxation de cette richesse par les jeunes États, et à sa redistribution pour la création de relais administratifs dans le territoire et pour le développement dans les capitales. Cette mutation a entraîné la migration de la population Ouest-africaine, qui a suivi trois (3) grandes directions : un mouvement du Nord vers le Sud du pays, un mouvement général de l’intérieur de la région vers les zones côtières, un mouvement rapide des campagnes vers les villes. On observe sur l’encadré 7 un déplacement des populations des pays enclavés tels que le Niger, le Mali, le Burkina Faso, mais aussi côtiers, tels la Mauritanie, la Guinée (en raison de la répression), le Ghana (en raison du déclin) vers les pays côtiers notamment la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Nigeria. Cette attractivité était due au développement des cultures de rente pour le cas de la Côte d’Ivoire, de l’exploitation du pétrole pour le Nigeria. Ces pays ont connu la plus forte croissance de ces dernières années avec un taux d’immigration de 0.4 % par an. En 1990, l’effectif de la population étrangère en Côte d’Ivoire est de 4.512.515 pour une population résidante totale de 12.568.011. Cinq ans plutôt, les étrangers étaient de 3.175.585 pour une population résidante de 10.092.735 comme nous le montre le tableau 4. On peut observer que les migranhts s’établissent aussi bien dans le milieu rural que dans le milieu urbain. En 1990, on compte 2.485.124 étrangers résidants dans le milieu rural contre 1.496.687 dans le milieu urbain. Tableau 15 : Perspectives d’évolution de la population résidente totale et de la population étrangère (par milliers) en Côte d’Ivoire de 1965 à 1990. 1965 1975 1980 1985 1990 Population résidente Population étrangère totale Effectif 4 210 000 6 709 600 8 189 544 10 092 735 12 568 011 Effectif 980 000 1 506 020 2 218 651 3 175 585 4 512 515 % 23.3 12.4 27.1 31.5 35.39 Population étrangère en milieu rural Effectif % 764 128 16.7 1 152 591 23.0 1 678 898 28.8 2 485 124 36 Population étrangère en milieu urbain Effectif % 741 892 34.6 1 066060 34.31 1 496 687 35.2 2 027 392 35.8 Source : CODESRIA, (1987) « Population et développement en Afrique », édité par Hedi JEMA, page 149 Les flux migratoires nécessitent donc une meilleure gestion de la part des différentes parties concernées. VII/ Gestion efficace de la migration Plusieurs études scientifiques, conférences et initiatives ont été mises en œuvre afin de trouver des solutions, qui permettront de mieux gérer la migration. 239 1°) Les études scientifiques de gestion de la migration HARRIS ET TODARO139 ont essayé de trouver des solutions à travers diverses études. Ils préconisent une Policy mix. Ceci permettra d’une part de limiter physiquement les migrations et d’autre part à la distribution d’une subvention aux salaires urbains. En procédant à une limitation de la migration, on s’assure qu’aucune ressource ne sera gaspillée du fait de la non utilisation de facteur de production (chômage) et en subventionnant de manière adéquate l’emploi urbain, on s’assure que la production manufacturière s’établira au niveau désiré par la société, malgré l’existence du salaire minimum urbain. BHAGWATI ET SRINIVASAN (1974)140 proposent une politique qui consiste à distribuer un subside au salaire aussi bien dans le secteur urbain que le secteur rural. Cette politique permettra d’augmenter l’emploi et la production dans le secteur urbain, cette augmentation d’emploi ne va pas attirer d’avantage de ruraux qui sont à la quête d’un emploi en ville, du fait de l’existence d’un subside aux salaires ruraux. 2°) L’initiative de Berne et la conférence Euro- Africaine de Rabat L’Initiative de BERNE lancée les 14 et 15 Juin 2001 lors du symposium international sur la migration a pour objectif d’instituer un processus de consultation propre aux États afin de stimuler l’échange de vues et de promouvoir la compréhension des diverses réalités et des divers intérêts dans ce domaine. Le symposium international a conclu qu’il pourrait être utile de mettre sur pied un cadre international informel de principes directeurs afin de faciliter la gestion de la migration. Ces principes seraient une compréhension des pratiques réelles dont les gouvernements pourraient s’inspirer pour gérer plus efficacement la migration aux niveaux national et international. La conférence ministérielle Europe Afrique tenue à RABAT en Juillet 2006, sur la migration et le développement, les Ministres se sont engagés à : « créer et à développer un partenariat étroit entre nos pays respectifs pour travailler de façon conjointe, suivant une approche globale, équilibrée, pragmatique et opérationnelle dans le respect des droits fondamentaux et de la dignité des migrants et des réfugiés, sur le phénomène des routes migratoires qui touchent nos peuples ». Encadré 17 : La communauté internationale face à l’immigration A l'aube du XXIème siècle, la communauté mondiale comprend désormais beaucoup mieux comment gérer de telles tensions - et c'est par la collaboration internationale et par le respect et la promotion des droits humains. L'une des plus grandes conquêtes du XXème siècle a été l'élaboration d'un système international des droits humains qui défend la dignité humaine et la satisfaction des besoins fondamentaux à laquelle tout être humain a le droit de prétendre - quelles que soient ses origines nationales. Ce legs tire son origine de la fondation même de l'Organisation des Nations Unies, qui comprend aujourd'hui une communauté de 191 nations chargées de trouver des solutions humainement acceptables aux difficultés que comporte le fait de vivre dans un univers mondialisé. Une gestion efficace de la migration internationale suppose une coopération mondiale, régionale et bilatérale. Ces dernières années, le dialogue 139 Voir encadré 4 Thierry Baudasse (2003), « Les théories économiques des migrations », Laboratoire d’économie d’Orléans, document N° 2003-01 140 240 intergouvernemental s'est intensifié. Grâce à l'élan communiqué par les récents engagements de haut niveau, l'année 2006 est importante pour la migration internationale et la définition de politiques mondiales, qui atteindra son point fort avec le dialogue de haut niveau sur la migration internationale et le développement. C'est là où réside le défi. Les gouvernements, les parlementaires, les employeurs et la société civile tiendront-ils la promesse des droits humains faite à près de 200 millions de migrants internationaux ? Le monde aura les yeux fixés sur eux. Source : UNFPA, (2006), « État de la population en 2006, les femmes et la migration internationale, chapitre 5 ». http//www.unfpa.org Ces mouvements migratoires ont pris de l’importance pendant ces dernières années à cause de nombreux facteurs dont la mondialisation qui a accentué la pauvreté des uns et la richesse des autres. Au niveau international, les efforts doivent être orientés vers l’insertion des pays d’origine des migrants dans le commerce international. Mais cela soulève une autre question, celle de savoir si les investissements réalisés dans les pays d’origine des migrants sont capables de réduire ou d’arrêter les flux migratoires entre les villes et entre les pays ? 241 CHAPITRE 12 : INTRODUCTION GÉNÉRALE AUX OBJECTIFS, STRATÉGIES ET INSTRUMENTS DE GESTION DU DÉVELOPPEMENT. Jamais dans l’histoire, la planète n’a accumulé autant de richesses matérielles, financières et techniques. Jamais les hommes et les femmes n’ont été aussi conscients des perspectives réelles pour la satisfaction de leurs besoins, non seulement au sens strictement économique mais encore au sens social et humain plus large. Et pourtant, jamais les disparités n’ont été aussi fortes entre le Nord et le Sud. Jamais la pauvreté n’a été aussi massive. La mondialisation caractéristique dans la production, les finances et les échanges apparaît ainsi comme un phénomène fortement asymétrique et clivé. Les stratégies suivies par les pays riches comme pauvres semblent toutes conduire l’humanité à des impasses, du point de vue des perspectives nationales comme de celui de l’ordre mondial.141 Les stratégies de développement telles qu’elles se sont déployées durant le dernier quart de siècle ont multiplié les problèmes des nations et des individus qui les peuplent. Paradoxalement, l’abondance n’a pas apporté de manière substantielle l’amélioration du niveau ou de la qualité de la vie aux populations. Elle a plutôt pollué l’environnement, gaspillé de gigantesques ressources, engendré la peur et le doute relativement aux relations intergénérationnelles. L’incapacité à maîtriser les turbulences des systèmes économiques et financiers, à gérer les risques et les incertitudes et à gouverner l’ordre mondial sont quelques manifestations évidentes du fait que des changements fondamentaux sont, aujourd’hui, indispensables et urgents, dans toutes les sphères des sociétés. Concernant les PSD, non seulement la pauvreté est grandissante, mais les populations sont de plus en plus insatisfaites et impatientes et les jeunesses frustrées de leur pénurie quant aux nécessités les plus élémentaires de la vie : éducation, emploi, nourriture, soins médicaux, logement, eau potable. Or, il est bien connu qu’un monde qui désespère est un monde qui va exploser. Que faire ? À quoi servent toutes les théories et les modèles ? Sont-ils capables de transformer pareille situation par la force des idées ? La question de la scientificité de l’économie est à nouveau posée. En vérité ce n’est pas une question désincarnée : l’économie n’est une science que si elle aide à comprendre le monde (théorie positive) et à dégager des instruments pour le transformer (théorie normative). En conséquence, la communauté des économistes, surtout africains, devrait partager un système de référence et des informations suffisantes, relatives au cadre conceptuel qui a influencé le processus du développement et qui a abouti à l’élaboration du Consensus de Washington, fondement doctrinal des Programmes d’Ajustement Structurel. Toutefois, les résultats mitigés et les multiples contestations de cette épure imposent aujourd’hui, un nouveau questionnement sur les stratégies du développement qui, tenant compte des enseignements du « grand miracle » des pays d’Asie, devraient déboucher sur de nouvelles formulations du développement africain. 141 Moustapha KASSÉ : Consultation du BIT sur « La mondialisation et ses conséquences sociales, Dakar, et Arusha, 2004 242 Section 1 : Les objectifs en matière de développement Ces objectifs sont ceux que les techniciens du développement posent à l’appréciation des décideurs et autres acteurs chargés de conduire les politiques économiques et de choisir, en dernière instance, les instruments et moyens de leur mise en œuvre. Ces objectifs sont reliés aux facteurs ou structures de nature économique, politique ou sociale qui facilitent ou au contraire brident les politiques économiques. Ils peuvent être classés en deux catégories ceux qui sont relatifs à l’économie interne et ceux concernant les relations avec l’extérieur dans une économie ouverte. I/ Les objectifs internes L’analyse des caractéristiques économiques et même extra-économique des PSD a montré à souhait que les structures économiques, politiques et sociales des PSD sont traversées par des distorsions structurelles et des dysfonctionnements qui constituent autant de handicaps ou de freins pour le succès des politiques économique et sociale. Ces éléments sont bien connus et fonctionnent comme des contraintes qu’il faut préalablement lever. Il s’agit de la croissance, de l'intégration de l'économie et sa diversification, de la mise en place d’institutions démocratiques et de la formation des ressources humaines. 1°) La croissance comme la priorité des priorités. Quelle que soit la société dans laquelle les citoyens désirent vivre, seule la croissance permet de sortir des manques issus du sous-développement et de donner des marges de manœuvres aux politiques. Aujourd’hui et dans le cadre des PSD, elle n’est plus le résultat d’un système économique (libéral, socialiste ou tout autre) mais un objectif que vise tout pays lancé sur les sentiers du développement pour accroître le niveau des forces productives matérielles et humaines et le bien être des populations. Étant le produit de la combinaison de plusieurs facteurs, il revient aux économistes et aux techniciens du développement d’élaborer les politiques possibles de croissance, de fixer le taux que durablement le pays peut soutenir, compte tenu des ressources dont il peut disposer. Il leur revient également de sélectionner les moyens cohérents pour atteindre les objectifs retenus. Tous ces schémas et leur réalisation sont alors soumis à l’arbitrage des décideurs qui les transforme en volonté politique. 2°) Le deuxième objectif interne diversification de l'Économie est l'Intégration et la La plupart des pays africains présente un ensemble de désarticulation structurelle de l’espace qu’il faut corriger pour créer une plus grande cohérence permettent une libre circulation des hommes et des biens préalable au fonctionnement d’un marché. On observe une véritable fracture territoriale qui procède à une distribution très inégale de la population par suite d’une urbanisation rapide et chaotique avec plus de 50% se concentrant sur un espace bien réduit du territoire. Cet effet de polarisation sera aggravé par le gigantisme des mégalopoles africaines : de grosses têtes sur de petits corps. Ce mouvement s’accompagne avec son corollaire : le déclin continu des régions. De plus, la mégalopole exerce des effets 243 d’attraction sur les hommes, les capitaux, les marchandises, les services, la vie intellectuelle et sociale. Alors, il s’opère un double jeu d’un côté des effets d’attraction (spread effects) et de l’autre des effets d’appauvrissement (backwash effects) pour les régions de l’intérieur. Ces derniers effets se manifestent sous des formes diverses : émigration des éléments les plus jeunes et les plus actifs vers la mégalopole, émigration des capitaux, faibles opportunités d’investissements et d’industrialisation, régression de l’agriculture et insuffisance des services publics. Pour corriger ces déséquilibres, il faut alors développer conséquemment les infrastructures de base, les moyens de communication et de transport qui brisent les petites économies fermées et autarciques et les rattachent au réseau des échanges internes, promouvoir la décentralisation des infrastructures et institutions de modernisation de la vie économique et sociale : école, santé, réseau d'institutions de crédit spécialisées et adaptées aux conditions existantes. Ce point est important pour la formation d’une économie monétaire et d’une bonne propagation des flux monétaires. Un sous objectif décisif est la recherche de la diversification de l'économie. La forte spécialisation des économies sous-développées est régressive et renforce la dépendance et l’instabilité de la croissance économique. Il importe alors d'y remédier par l’organisation d’une économie diversifiée, avec le développement d'activités économiques qui se soutiennent mutuellement et suscitent une demande suffisante. Cela appelle un développement équilibre et articulé des divers secteurs économiques : agriculture, industrie et tertiaire. Comme l’observe J.K. Galbraith, «un pays purement .agricole a toutes chances d'être non progressif, même dans son agriculture»142 3°) Le troisième démocratique objectif est la construction d’un cadre Il y eut une époque, où dans la pensée économique la conviction la plus forte était que la gestion de l'économie ne relevait pas d'un processus de négociation politique, mais au contraire, c’est l'immixtion des questions politiques dans la sphère économique qui perturbait cette dernière. Il était alors exclu d'évoquer toute question qui n'était pas strictement économique, et notamment les questions politiques et sociales. Progressivement, pourtant, il est apparu qu'il était extrêmement difficile de mener des réformes économiques sans considération de leur environnement normatif et institutionnel, ni de leur légitimité politique et sociale.143 Beaucoup de pays africains ont parcouru un long chemin sur la voie de l'achèvement d'une démocratie ouverte, libérale, pluraliste, favorable au développement de l'initiative privée et à la bonne marche des affaires. Dans la bonne moyenne des pays africains, la construction d'un État de Droit appuyé sur des institutions administratives et judiciaires indépendantes est une condition sine qua non du développement. Dans ce cadre comme le note Eric Weil, «l'administration doit être l'organe de la rationalité technique dans la société particulière»144 Le pluralisme politique, le contrôle de légalité, ainsi que, désormais, la décentralisation, ont fini par former un cadre juridique au sein duquel les "prérogatives exorbitantes du droit commun", le "fait du prince" et autres privilèges J.K. GALBRAITH: Conditions for Economic Change in Under- developed countries. Journal of Fam Economies, p. 690, nov. 1951 143 Pr. Moustapha KASSÉ: Démocratie et développement, Collection « Le Point Sur » NEA, 1991 144 1) Philosophie politique, (Éd. Vrin). 142 244 dont la puissance publique pouvait se prévaloir, ont été progressivement limités. Il doit être loisible aux citoyens d’aller et venir, de participer à la gestion des affaires publiques comme d’entreprendre, sans que ces libertés puissent être obstruées ni remises en cause par la puissance publique. Cette dernière tente au contraire d’accompagner leurs efforts en les gênant le moins possible. La meilleure preuve en est la souplesse avec laquelle l’administration contrôle le développement des activités économiques, que ces dernières relèvent ou non du secteur formel. Au lieu d’adresser des commandements tatillons, et suivant en cela des choix politiques, elle tente plutôt d’accompagner les initiatives privées dans la voie de leur croissance et de leur modernisation. Également, le transfert à l’échelon local de compétences auparavant détenues par le pouvoir central témoigne de la volonté de gérer les affaires publiques au plus près des besoins des populations, dans le respect de l’intérêt général. Le fonctionnement régulier d’un cadre démocratique doit se généraliser en Afrique et se mesurer à l'aune de lois et règlements qui assurent et facilitent : D’abord, la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ; Ensuite, l’existence et le fonctionnement de contrepouvoirs comme une société civile forte et active, un organe anti-corruption indépendant, une commission indépendante des droits de l’homme et des structures d’harmonisation et d’exécution des activités liées aux femmes En outre, la mise en place d’un système électoral transparent capable d’organiser des élections libres et disputées pour que la sanction démocratique puisse effectivement s'exercer ; Enfin, le fonctionnement sans entrave d’une administration publique à la fois compétente, efficace, souple et transparente. Bien souvent, si les politiques tardent à produire des résultats, ce serait essentiellement à cause d'une administration inefficiente dont il faut limiter l'inclinaison à la corruption. 4°) Le troisième objectif est la formation des ressources humaines pour le développement économique et social Dans un monde où les produits, les capitaux et les technologies circulent et s’échangent librement, ce sont les ressources humaines qui font la différence. Comme l’observe Samuel PISAR c’est la ressource humaine qui différenciera les performances des divers pays. Dans ces conditions, il devient nécessaire d’opérer des investissements massifs dans la formation des hommes. II/ Les objectifs externes Ils se réduisent à la recherche de voies et moyens pour tirer grand profit de la mondialisation. Il est complètement douteux que les PSD puissent se déconnecter du système mondial d'échanges et de paiements : ils le sont déjà de fait. Le problème est plutôt de s’ouvrir par des exportations en vue de trouver les recettes nécessaires au financement des importations d’équipement. Également ils doivent aménager leur environnement pour le rendre plus incitatif pour attirer les IDE surtout dans le contexte actuel de baisse drastique de l’aide publique au développement. Dans le cas de l’Afrique il faudra développer le commerce intra africain par des processus d’intégration dont l’analyse sera approfondie ultérieurement. 245 Section 2 : Les stratégies de développement économique : le débat entre anciens et nouveaux économistes, entre orthodoxes et hétérodoxes. I/ Les anciennes approches des stratégies de développement. Le cadre intellectuel qui a influencé les différentes approches des processus de développement économique du dernier quart de siècle gravitait autour de la croissance économique considérée comme voie unique de sortie du sousdéveloppement. Les pays qui s’engageaient dans ce processus devaient réaliser une croissance accélérée, au taux le plus élevé possible compte tenu des ressources disponibles. De plus, il était souhaité que cette croissance fût harmonieuse, équilibrée et débarrassée de toute fluctuation trop forte en baisse comme en hausse. L’adaptation du modèle aux pays en développement allait inclure d’autres facteurs comme la quantité et la qualité «réelles» de l’aide étrangère et des transferts de technologie destinés à compléter le capital local insuffisant. Les faibles efforts de mobilisation internes des ressources, rendaient les estimations concernant les possibilités de croissance rapide sans grande valeur pratique dans le modèle. Les études de la Banque Mondiale (BM) et du Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) ont largement montré que les aides et les transferts de technologie ont principalement servi à créer des sociétés «molles» et à augmenter l’endettement extérieur qui devient aujourd’hui insoutenable. C’est pourquoi, le Président Abdoulaye WADE, dans «Le Plan Oméga pour l’Afrique» montre justement que le binôme aide–endettement était entré dans une impasse totale, ce qui impose de nouvelles formules pour le financement du développement. En ce qui concerne la fameuse question du transfert de technologie, les firmes multinationales qui furent les principaux vecteurs de cette politique ont tiré de leur «know-how» et de leurs équipements un prix excessif. En conséquence, la technologie «empruntée» pour la substitution aux importations et qui est à haute intensité de capital, n’avait que de très faibles liens avec la valorisation des ressources naturelles et la main-d’œuvre, ou avec le reste de l’équipement technologique existant dans les pays récepteurs. C’est pour enquêter sur la réalité et les résultats des efforts d’aide et de développement international des années 50 à 60 et pour les ajuster aux besoins de modernisation des pays pauvres que la COMMISSION PEARSON fut créée en 1968 par la Banque Mondiale. Le Rapport Pearson jugea que l’écart grandissant entre pays développés et pays en développement était devenu l’un des principaux problèmes de notre temps. Comme solution, il recommandait pour ces derniers pays un taux de croissance de 6% par an, une réduction des barrières douanières des pays développés, l’augmentation de l’aide étrangère privée et un transfert de 1% du PNB des pays développés aux pays en développement. Il fut dès le départ évident que la Commission avait sous-estimé l’importance de la crise mondiale menaçante et minimisé les extraordinaires privilèges des pays riches dans une tentative de restaurer l’ancien mythe d’«un monde unique». Ses vues sur le développement se situaient dans le vieux cadre intellectuel décrit ci-dessus et ne cherchaient nullement à aller au-delà. 246 II/ Le Consensus de Washington : l’instauration d’un modèle d’économie de marché. La crise économique des années 70 et 80 réactive le débat de fond sur «le sous-développement et ses solutions», en particulier entre groupes de spécialistes des sciences sociales désireux d’une part, d’aller au-delà du Rapport Pearson et de son référentiel normatif d’analyse économique et d’autre part, d’examiner toutes les réalités économiques, mais aussi sociales et historiques dissimulées par l’ancien schéma analytique du développement. Tandis que le débat se développait, deux Ecoles pouvaient clairement être identifiées. 1°) L’École orthodoxe et les réformes pour une économie de marché. La première École, celle des tenants de l’orthodoxie de l’économie libérale, estime qu’il faut redéfinir la philosophie et les objectifs du développement qui se réduisent pour l’essentiel à la croissance économique. Dans les années 80, suite à la crise de la dette, l’intervention des Institutions de Bretton Woods dans le débat sur le développement va s'accompagner de profondes transformations, tant dans la pratique que dans la réflexion. Une nouvelle ère en matière de développement est ouverte, que les spécialistes vont assimiler au "Consensus de Washington" qui remettait en cause la théorie du développement et la spécificité des sociétés sousdéveloppées. Il constitue en somme une sorte de revanche de la théorie néo-classique qui, sur la base de l'échec des stratégies de développement et des théories qui les portent, va étendre le champ d'application de son cadre d'analyse aux sociétés sousdéveloppées. Encadré : Le Consensus de Washington. L’expression consensus de Washington est née sous la plume de John WILLIAMSON (1990). Elle constitue le couronnement de la doctrine néo-libérale « recommandée » par la communauté financière internationale aux pays en voie de développement pour les amener à s’ouvrir au processus de mondialisation. Elle est fondée sur une série de principes dont le plus importants sont la discipline fiscale c’est-à-dire des équilibres budgétaires et la baisse des prélèvements fiscaux ; la libéralisation financière avec la fixation des taux d’intérêt administrés en faveur des investissements prioritaires ; la libéralisation commerciale avec la suppression des protections douanières ; l’ouverture totale des économies aux mouvements des capitaux et, en particulier à l’investissement direct ; la privatisation de l’ensemble des entreprises ; la déréglementation c’est-à-dire l’élimination de tous les obstacles à la concurrence ; la protection légale des droits de propriété intellectuelle des multinationales. Le consensus de Washington a constitué le fondement des politiques menées par la Banque mondiale et le Fonds Monétaire International (FMI) basés sur le triptyque stabilisation, libéralisation, privatisation. Mais cette doctrine a fait l’objet de vives critiques par suite des dégâts qu’elle a causés. Au début des années 2000, à la suite de leurs échecs, la Banque mondiale et le FMI ont infléchi leur doctrine reconnaissant qu’il faut également s’inquiéter de la démocratie, des inégalités et du fonctionnement de l’Etat. Dominique PLIHON : Le nouveau capitalisme, Collection Repères, La Découverte, Paris 2003. p 24 247 Du point de vue théorique, le Consensus de Washington remet en cause toute forme d'interventionnisme étatique et proclame la suprématie du marché dans l'allocation des ressources. Ce discours se rattache à la doctrine de l'équilibre général qui conçoit la possibilité d'une économie décentralisée suite, à l'émergence des prix d'équilibre résultant de la confrontation sur le marché de l'offre et de la demande des agents économiques. D'autre part, le consensus de Washington remet à l'ordre du jour les théories de l'avantage comparatif pour critiquer les choix d'importsubstitution ou d'industrialisation liée au marché interne, et pour justifier une insertion internationale basée sur les dotations en facteurs des pays sous-développés. Ainsi, désengagement de l'État, régulation marchande et avantages comparatifs seront les maîtres-mots des années 80, mais aussi les piliers de l’ajustement structurel. Confrontés aux déséquilibres financiers, à la montée de l’endettement et à la stagnation de la production pendant la décennie des années 80, les pays d’Afrique ont été contraints de privilégier les politiques d’ajustement et de stabilisation par rapport aux politiques de développement et aux plans à moyen et long terme. L’approche en termes d’ajustement structurel est largement justifiée par le gaspillage des ressources, l’inefficacité de l’économie administrée et le poids des distorsions introduites dans le système de formation des prix et des revenus sur les marchés des biens et services, du travail, des capitaux et des changes. Les PAS cherchaient à mettre en place un volet stabilisation afin de réduire les déficits et de promouvoir une série de réformes structurelles pour assurer une plus grande régulation privée de l'économie et accroître l'insertion des économies nationales dans une mondialisation jugée incontournable et irréversible. Pour cette École orthodoxe les PAS constituent une solution appropriée à la crise économique africaine des années 80 et de celle provenant en grande partie des politiques économiques erronées des années 60 et 70. Après plus d’une décennie de réforme introduite par les PAS dans les pays subsahariens, la Banque Mondiale (World Bank, 1994) conclut, en se basant sur les éléments d’appréciation recueillis dans 29 pays engagés dans la voie de l’ajustement, que les réformes ont été payantes et que les pays qui ont fait un effort particulier ont bénéficié d’un retournement tant au plan de la croissance que de la situation socio-économique, bien que ce retournement soit encore fragile. Les contre-performances (ou l’absence de développement) observées dans les années 90 seraient alors en grande partie attribuées au fait que les politiques «rationnelles» que comportaient les PAS n’ont pas été correctement appliquées. Les facteurs qui paraissent avoir empêché le bon déroulement des réformes sont nombreux. Diverses études de la Banque Mondiale notent des contraintes telles que : les difficultés à faire passer des réformes institutionnelles politiquement délicates (en raison de la puissance des groupes de pression) ; le fait que les gouvernements concernés n’ont pas assumé la paternité des réformes ; l’insuffisance des financements extérieurs ou de crédits pour la mise en œuvre des programmes ; pour les pays subsahariens, la faiblesse des moyens administratifs et institutionnels disponibles pour la mise en œuvre des réformes ; et, dans certains cas, le manque de réalisme des concepteurs des divers programmes quant à la rapidité et la chronologie des réformes à mettre en œuvre. 248 Au demeurant, si les PAS ont permis à certaines économies d'améliorer et de rétablir leurs déséquilibres macroéconomiques, ils n'ont pas réussi à initier de nouvelles dynamiques de croissance durable, suite à l'essoufflement des stratégies d'import-substitution. Par ailleurs, ces réformes se sont traduites par une détérioration des conditions de vie des populations et par un accroissement de la pauvreté. Également, les programmes n'ont pas favorisé la construction de nouvelles normes économiques et sociales pour succéder aux normes en crise. Au contraire, ils ont accéléré la décomposition des normes en crise et approfondi ainsi la régression économique et sociale. Cette crise économique et sociale a eu des conséquences politiques importantes à travers la contestation de la légitimité de l'État. Par ailleurs, le désengagement de l'État et la libéralisation économique se sont traduits par l'émergence, dans la plupart des pays, de nouveaux acteurs politico-financiers qui ont cherché à contrôler l'économie. L'affaiblissement de l'Etat et son extinction programmée dans certaines régions ont conduit parfois au développement de la corruption et à la constitution de fortunes sur la base de situation de rente. 2°) L’École hétérodoxe et la réhabilitation de l’État Ces médiocres résultats ont été à l'origine de la remise en cause des fondements théoriques et des choix de développement du consensus de Washington par l’École dite hétérodoxe. En effet, une ère nouvelle est ouverte dans le champ de l'économie du développement depuis le milieu des années 90 qu'on qualifiera de période de post-ajustement qui est caractérisée par des interrogations sur la pertinence et les performances des PAS et la recherche dynamique et plurielle de nouvelles stratégies de développement. À ce niveau, les derniers Rapports de la Banque Mondiale sur le Développement offrent une illustration de cette évolution. Désormais, l’État et les institutions sont réintégrés dans le champ de l’analyse et de la praxis. Un Rapport d’un groupe d’experts de l’Université des Nations-Unies sur le Développement Humain et Social avait contesté cette approche des fondamentalistes en déclarant catégoriquement que «le développement n’a fondamentalement rien à voir avec les chiffres de revenu national et sa croissance; il n’a rien à voir avec seulement les taux d’épargne et les coefficients de capital; il a à voir avec les êtres humains, par eux et pour eux. Le développement doit, par conséquent, commencer par l’identification des besoins humains. Son but est de relever le niveau de vie des masses et de donner à tous les hommes une chance de développer leurs potentialités. Cela implique que l’on réponde à des besoins comme ceux d’un travail permanent, de salaires réguliers et convenables, d’écoles plus nombreuses et de meilleure qualité, d’un meilleur service médical, de transports bon marché, d’un niveau général de revenu plus élevé. Cela implique aussi que l’on satisfasse les besoins et désirs non matériels : auto-détermination, autonomie, liberté politique et sécurité, participation à la prise des décisions affectant travailleurs et citoyens, identité nationale et culturelle, et désir de sentir que la vie et le travail ont un sens». L’École hétérodoxe composée pour l’essentiel des différents courants marxistes et néo-marxistes ainsi que des institutionnalistes et des «tiers-mondistes», reprend à son compte certaines de ces critiques de l’Université des Nations-Unies mais avec des formulations techniques nettement améliorées. Malgré son caractère idéologiquement hétérogène, les auteurs s'éloignent du modèle walrassien en reconnaissant les imperfections du marché et l'incapacité des politiques de 249 stabilisation et d'ajustement orthodoxe à opérer les transformations nécessaires à une reprise durable de la croissance dans le Tiers-Monde. Dans ce sens, J. STIGLITZ, ancien économiste principal de la Banque mondiale estime que «si les politiques économiques issues du consensus de Washington se sont avérées aussi peu performantes dans ce qui était leur objectif principal à savoir l’instauration d’un processus vertueux de croissance économique harmonieuse ; c’est parce qu’elles ont confondu les moyens avec les fins». En effet, même «un taux de croissance élevé n’a constitué et ne constitue pas une garantie contre une aggravation de la pauvreté» (MAHBUB UL HACQ : Banque mondiale). La libéralisation, la recherche des grands équilibres, les privatisations sont prises comme des fins plutôt que comme des moyens d’une croissance durable et équitable. De plus, ces politiques se sont beaucoup trop focalisées sur la stabilité des prix plutôt que sur celle de la croissance et de la production. Elles n’ont pas su reconnaître que le renforcement des institutions financières est aussi important pour la stabilité économique que la maîtrise des déficits budgétaires et de la masse monétaire. Elles se sont concentrées sur les privatisations, mais elles n’ont guère attaché assez d’importance à l’infrastructure institutionnelle nécessaire au bon fonctionnement des marchés, et particulièrement à la concurrence et à la compétitivité. Depuis les années 90, la médiocrité persistante des performances économiques et financières a continué de se manifester à travers la détérioration généralisée des indicateurs macroéconomiques, la désintégration des structures de production et des infrastructures et la détérioration rapide du bien-être social notamment l’éducation, la santé publique et le logement, a appelé le nécessaire ajustement de l’ajustement. En effet, pour beaucoup d’économistes partisans de cette approche hétérodoxe, l’échec du développement dans les pays subsahariens est avant tout le produit : de l’échec des politiques économiques adoptées après l’indépendance, dans les années 60 et 70 ; de l’échec des PAS mis en œuvre dans les années 80 pour remédier aux faiblesses structurelles des économies et des institutions des pays subsahariens. Ces faiblesses tiennent pour l’essentiel à la distorsion de la structure des échanges (à cause de la place excessive des produits primaires), au manque de modernisation de l’agriculture, à l’étroitesse et à la faiblesse de la base industrielle, et avant tout au niveau extrêmement faible de développement des ressources humaines ainsi qu’à l’insuffisance du réseau des transports et des équipements d’infrastructure dans les régions rurales (CORNIA, 1991). Pour ces économistes, l’analyse de la stratégie de développement à long terme montre qu’il est vital de trouver des solutions pour remédier à l’insuffisance des ressources humaines et des infrastructures. D’ailleurs, si les analystes ne semblent pas imputer totalement la stagnation économique des pays subsahariens aux seuls programmes d’ajustement en tant que tels, ils soulignent cependant qu’en accordant une prépondérance quasi absolue aux mesures de stabilisation à court terme, au lieu de s’attaquer aux problèmes structurels fondamentaux, ces programmes ont en fait amené les économies africaines à s’écarter de la voie d’une croissance durable (CORNIA, 1991 ; STEWART, 192). Certains estiment même avec force arguments tirés de l’analyse économique qu’un cadre de développement modifié peut encore fonctionner «efficacement» : si la justice sociale ou distributive est intégrée dans les modèles ; s’il existe des institutions fiables, démocratiques et transparentes de coordination des transactions des acteurs, et qui soient capables de 250 faire fonctionner un système de planification techniquement rénové essentiellement du haut vers le bas («top down») ; si la participation populaire dans la gestion du développement est assurée ; et si les Institutions Financières Internationales et le système économique des Nations Unies assurent un processus continu de transfert pour une part raisonnable des ressources des pays riches aux pays pauvres. En définitive le continent africain est à la recherche d’une nouvelle vision, d’un paradigme et d’un programme alternatif de développement considéré comme une transformation de la société. La question centrale est alors : comment mettre en place un système économique et financier performant et jeter les bases de fonctionnement d’une société démocratique ? Dans ce contexte, il faut tirer, pour le continent africain, toutes les leçons du miracle asiatique. La croissance rapide des pays d’Asie de l’Est a montré que le développement était possible et qu’il pouvait s’accompagner d’une réduction de la pauvreté, d’une amélioration largement partagée du niveau de vie et même d’un processus de démocratisation. Évidemment, dans la phase ascendante des PAS les expériences du miracle est-asiatique étaient considérablement dérangeantes pour les défenseurs des solutions orthodoxes, car ces pays ne se sont pas conformés aux prescriptions habituelles des Institutions Financières Internationales. Dans la plupart des cas, l’État a joué un rôle efficace de création et d’orientation des ressources vers des projets à long terme. Cet État a été qualifié d’État «pro» c’est-à-dire promoteur, producteur, prospecteur et programmeur. Les gouvernements ont suivi certaines des prescriptions techniques habituelles, comme la politique macroéconomique stable, mais ils ont ignoré les autres. Par exemple, au lieu de privatiser, ils ont crée des entreprises hautement productives et plus généralement ils ont mené une politique industrielle pour développer certains secteurs. Les pouvoirs publics intervenaient dans le commerce, même si c’était plus pour favoriser les exportations que pour limiter les importations. Également, ils se sont engagés dans un timide encadrement du secteur financier, en abaissant les taux d’intérêt et en augmentant la rentabilité des banques et des entreprises. III/ La nouvelle stratégie de l’émergence dans le contexte africain. Théoriciens et praticiens sont de plus en plus d’accord sur le fait qu’un nouveau cadre de concepts tels que celui évoqué ci-dessus est nécessaire pour la remise en cause des phénomènes critiques (et interdépendants) qui affectent partout le développement et pour nous aider à comprendre la nature des nouvelles forces qui apparaissent partout dans le monde et qui poussent au changement. Cette remise en cause ne doit pas seulement refléter une réforme de l’ancien cadre du développement économique, rendu un peu plus efficace par l’incorporation d’un peu plus de justice sociale et distributive. Elle doit également redéfinir les orientations (approche positive) et les politiques à mettre en œuvre (approche normative). Cette redéfinition doit être tentée en étudiant l’expérience historique des pays développés ou en développement, et non plus à partir de théories a priori totalement détachées des réalités. Des sous-modèles spécifiques à un pays pourraient être élaborés pour chercher à opérationnaliser le nouveau cadre. Un cadre de concepts différents, constitué par un nouvel ensemble d’objectifs et par un nouveau processus, 251 reste cependant une condition préliminaire et nécessaire pour que les sous-modèles puissent être applicables et politiquement valables. Un cadre international de soutien devrait également être élaboré. Mais avant que ce nouveau cadre international puisse apparaître, il faudra peut-être le détacher d’abord des relations globales existantes pour le faire rentrer, à de nouvelles conditions, dans de nouvelles institutions. La tâche des économistes, toutes options idéologiques confondues, est d’appréhender la situation d’ensemble des pays africains, d’identifier les éléments sur lesquels il y a accord afin de définir le nouveau cadre général de concepts en phase parfaite avec l’axiomatique de la rationalité économique. Les éléments à inclure dans ce cadre de concepts peuvent être jugés en fonction des critères ci-après : la définition d’objectifs strictement économiques qui permettent de s’engager dans la voie d’un développement durable et d’échapper au piège de la pauvreté; la restructuration des institutions de gouvernance et la reconstruction de l’État en vue de la création d’un environnement institutionnel plus incitatif pour les politiques de développement ; la mise en œuvre de politiques sectorielles pertinentes dans le cadre d’une estimation réaliste de la dotation en ressources naturelles, et qui accordent à l’agriculture et aux technologies un rôle moteur dans la réalisation de la croissance ; l’élaboration de politiques publiques efficaces d’allocation optimale des ressources en faveur des activités productives; le choix d’une politique de redistribution des revenus qui maximise les potentialités endogènes de développement ; la mobilisation de la communauté internationale dans le cadre d’un nouveau partenariat qui accroisse les ressources financières à long terme et les investissements privés directs étrangers. 1°) Approche positive de l’émergence économique Dans la littérature, il n’existe pas de définition universelle du concept d’économie émergente. Les conceptions diffèrent d’un auteur à un autre et surtout d’une institution à une autre. L’émergence n’est pas seulement un concept dynamique, elle est un concept plus global qui ne se polarise pas seulement sur un marché, une bourse, une place financière, elle concerne le pays tout entier. Dès lors, un pays peut être considéré comme émergent pour deux raisons bien distinctes. D’une part, il connaît un taux de croissance relativement élevé sur une période longue, parce qu’il a réussi à développer son commerce extérieur et à accroître sensiblement ses exportations ; notamment de produits manufacturés dans lesquels il s’est spécialisé : il s’est alors intégré au marché mondial. D’autre part, il a institué ou réactivé un marché financier sur lequel les transactions peuvent se développer parce qu’il a incité les entreprises à se financer de cette façon à partir de l’épargne nationale aussi bien qu’étrangère; il a probablement rendu sa monnaie convertible et libéré les flux de capitaux : il s’est intégré à la finance internationale. Le maintien de ce double mouvement devrait déclencher un processus de rattrapage économique des pays développés. Vu sous cet angle, quatorze pays sont retenus comme pays émergents ; Hong Kong, Singapour, Malaisie, Taïwan, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Corée du Sud, Colombie, Chili, Mexique, Brésil, 252 Argentine et Venezuela (Banque Mondiale dans sa revue «Working Paper»). Pour couper court à toute confusion entre pays émergents et nouveaux pays industrialisés, la Banque Mondiale retient seulement les pays émergents d’Asie de l’Est comme les nouveaux pays industrialisés. La célèbre revue«The Economist» dans sa section «Emerging Market Indicator» publie des informations statistiques sur un ensemble de pays comprenant en plus des pays retenus par la Banque Mondiale, la Grèce, Israël, le Portugal, la Pologne, la Turquie, la Hongrie, la Russie, la République Tchèque et l’Afrique du Sud. D’autres auteurs, tout en acceptant le point de vue de la Banque Mondiale, se demandent si la Tunisie, le Botswana, et l’Île Maurice ne peuvent pas être considérés comme des pays émergents du Contient africain. Au regard des deux critères avancés, ils ne le sont pas, ce qui permet alors d’introduire le concept médian de pays subémergents c’est-à-dire des pays qui mettent toutes les conditions en place pour devenir des pays émergents. 2°) Approche normative et pré-requis de l’émergence. Lorsqu’on analyse la performance supérieure de l’Asie, pendant ces 30 dernières années, elle est attribuable selon LINDAUER ET ROMER (1993) à trois éléments interdépendants comme le mode de gouvernance et la qualité des institutions de l’économie, l’utilisation optimale des facteurs de production disponibles et le contenu de la stratégie de développement. La conjugaison de ces éléments a généré l’ouverture sur les marchés extérieurs, le dynamisme du secteur privé, l’efficience de l’administration, des systèmes financiers, de la main d’œuvre, les infrastructures et les institutions d’encadrement. Il faut chercher à quantifier tous ces éléments pour mieux comprendre le processus de génération de cette croissance durable en Asie. Dans leur essence, les réformes entreprises qui ont doté ces économies des caractéristiques suivantes : a) L’ouverture sur le marché international La théorie économique depuis ses pères fondateurs Adams Smith et David Ricardo a toujours mis l’accent sur le commerce international ; les avantages rattachés à une ouverture se résument à: une plus forte spécialisation basée sur la théorie ricardienne des avantages comparatifs ; un plus grand accès aux innovations technologiques ; une pression plus forte pour l’amélioration de la compétitivité des entreprises locales ; une réduction des activités improductives. b) Le développement du système financier À travers la théorie du multiplicateur, l’analyse keynésienne a montré que l’investissement est un élément clé de la croissance, or l’investissement n’est optimal que si le système bancaire accorde des crédits. Pour le développement du système financier, les pays d’Amérique Latine ont procédé dans une première étape à une 253 libéralisation tous azimuts avant de mettre en œuvre des mesures d’accompagnement à la libéralisation initiale. Le dynamisme du secteur financier sera mesuré par le ratio de crédits alloués au privé sur le PIB. c) La libéralisation du marché du travail Le cadre de concurrence accru liée à la mondialisation rend indispensable que les entreprises aient le moins de contraintes possibles. Ces contraintes allant de la rigidité des salaires à cause de puissantes organisations syndicales et de normes institutionnelles (salaire minimum) à des conditions d’embauche et de licenciement très onéreux. En fait, l’objectif de plein emploi n’est réalisable qu’avec un marché du travail flexible qui permet l’ajustement entre l’offre et la demande de travail. Les réformes qui ont eu lieu dans ce domaine visaient à lever l’ensemble des distorsions, y compris celles relatives aux effectifs pléthoriques de l’administration. Pour tenir compte de cet aspect, on retiendra comme indicateur le ratio constitué de l’emploi dans le secteur public sur l’emploi total dans le secteur non agricole. d) La réduction de la taille du secteur public L’objectif visé est d’une part, le remplacement du grand nombre d’entreprises publiques extrêmement protégées et inefficientes par des entreprises privées plus compétitives et, d’autre part, la suppression des monopoles pour que la fonction allocative du marché puisse être optimale. Au début des années 80, les pays émergents ont réduit significativement leurs emprunts publics, ce qui a attiré un tiers (1/3) des fonds privés destinés aux infrastructures en Amérique Latine et la moitié (1/2) en Asie de l’Est. e) L’utilisation efficiente et optimale des ressources publiques La littérature économique atteste qu’une bureaucratie lourde ne rime pas avec des performances économiques car en fait, une large part des ressources devant servir à l’investissement est utilisée pour entretenir cette bureaucratie à des fins de consommation somptuaire. En vue de mesurer les progrès obtenus dans ce domaine par les pays émergents, le ratio des salaires de l’administration sur les dépenses primaires est utilisé. f) La répartition équitable des fruits de la croissance Pour ce faire, les gouvernements ont dû convaincre les élites économiques de la nécessité de partager les fruits de la croissance avec les couches pauvres. C’est ainsi que le pourcentage des populations vivant au dessous du seuil de pauvreté n’a cessé en effet de baisser dans ces pays : il est passé de 59% en 1962 à 26% en 1986 en Thaïlande et de 58% en 1972 à 17% 10 ans plus tard en Indonésie. Dans tous ces pays, la stratégie économique a été l’œuvre de technocrates compétents, propres et à l’abri des ingérences publiques. En plus, les gouvernements ont mis en place des cadres juridiques et réglementaires favorables à l’initiative privée. Ils ont également favorisé un dialogue permanent entre les milieux d’affaires et le pouvoir public, ce qui a permis de rendre les règles du jeu claires et transparentes et de susciter la confiance du privé. 254 Encadré : Les "Six E" de la réussite de l'Asie orientale : Une originalité usurpée Malgré la crise financière d'août 1997 et les retombées récentes, les performances de l'Asie Orientale restent remarquables ces dernières décennies. Les origines de la forte croissance ont été répertoriées et résumées par les " six E " de la réussite qui sont les suivantes : 1- État interventionniste et autoritaire dans le domaine social 2- Épargne prioritaire et frugalité des consommateurs 3- Éducation efficace largement financée par les ménages 4- Entrepreneurs choyés par le régime 5- Exportations évolutives et flexibles à la demande mondiale 6- Exploitation de la main d'œuvre. En fait, ces conditions ont été déjà réunies ailleurs dans le passé. Par exemple: L'État guidait les entrepreneurs japonais au début de l'ère Meiji. Il crée lui même des entreprises puis les cède aux Zaibatsu enrichies dans le négoce. Il reste fortement présent par la suite. Partout l'État contrôle de près le mouvement ouvrier. L'épargne est la vertu cardinale de la bourgeoisie entrepreneuriale dans l'Europe du XIXème siècle L'éducation est considérée comme une composante du progrès dès la fin du XVIIIe siècle. Danton affirmait qu’ « Après le pain c'est de l'instruction qu'à besoin le peuple ». L’entrepreneur est dans tout l’Occident le héros schumpétérien de l’industrialisation. Les exportations sont devenues le moteur de la croissance industrielle en Allemagne et au Japon dès la fin du XIXe siècle. Enfin aucun pays capitaliste dans le passé, n'a réalisé sa première industrialisation sans favoriser l'épargne des entreprises au détriment des salaires et de la consommation. D’où le slogan « affamer pour développer ». Paul KRUGMAN, Professeur au Massachusetts Institut of Technology (MIT) présentait dans une entrevue avec la presse en juillet 1998 la réussite du modèle asiatique, plutôt comme le fruit de la transpiration que de l'inspiration et concluait certes, l'Asie finira par représenter la majeure partie du produit mondiale mais pour la seule raison qu'elle regroupe la plupart des hommes de la planète (CINCEE international, n° 465, juillet1998). Section 2 : Les préalables d’une politique de développement. Il peut paraître assez facile de définir de manière volontariste une politique de développement et de chercher les moyens de la réaliser ; pareille démarche n’est ni réaliste ni efficace. Le développement requiert des préalables économiques, financiers, technologique et institutionnels qui doivent être sérieusement analysés à la lumière des options idéologiques que les décideurs politiques se sont librement données. La démarche la plus rigoureuse consiste à réaliser un diagnostic complet et sans complaisance : des options idéologique adoptées par les décideurs politiques : libéralisme, socialisme, voie intermédiaire en relation avec les autorités politiques et les agents du développement dont la collaboration est indispensable car, comme l’indique F.PERROUX, une politique de croissance économique est impérativement une œuvre collective. 255 des structures et du fonctionnement de l’économie pour connaître avec exactitude ses potentialités réelles, les institutions qui les gouvernent des options sectorielles consistant à la définition de la politique agricole, industrielle, à l’élaboration des politiques économiques de services, de technologie, de financement interne et externe des cadres chargés de l’élaboration des politiques économiques d’administration et de gestion de la définition des instruments et techniques de gestion du développement Ce diagnostic constitue le point de départ obligé de toute politique de développement, surtout pour les PSD nouvellement indépendants. C’est cette importance qui explique qu’elles ont suscité de vives polémiques dans la pensée économique marxiste et universitaire. Ces réflexions théoriques de quelque côté idéologique que l’on se situe, tournent autour d’une triple problématique : les voies de l’industrialisation, la stratégie de développement agricole et ses relations avec l’industrie, la place des relations économiques internationales dans le processus interne de transformation. Chaque problématique implique diverses options qui n’ont pas les mêmes conséquences : les dilemmes qui en résultent ne peuvent rester ouverts en permanence et sont autant de questions auxquelles il faut apporter des réponses très précises. Il nous faut en conséquence les analyser pour déceler les solutions adéquates sur lesquelles peuvent se fonder des politiques économiques claires. I/ Quel modèle d’industrialisation ? La politique d’industrialisation est une composante essentielle de toute stratégie de développement économique et social. Elle consiste à mettre en place des capacités physiques de production susceptibles non seulement de valoriser les matières premières afin d’en tirer le maximum de plus-value mais aussi de garantir l’autonomie économique nationale en biens industriels. L’objectif primordial est de créer une capacité d’offre de substitution aux importations et de valorisation à l’exportation, après transformations industrielles des productions agricoles et minières. Conformément aux théories économiques dominantes dans les années 50, l’industrie avait pour fonction d’assurer la transformation de la production agricole et minière, et de fournir aux agriculteurs les intrants et le matériel dont ils avaient besoin pour élever la productivité. En retour, le surplus dégagé par le secteur primaire devait servir à financer l’industrie naissante, laquelle devait être en mesure d’employer une main-d’œuvre excédentaire libérée par l’accroissement de la productivité dans le monde rural. L’exportation des produits agricoles et miniers devait de leur côté servir à l’achat de biens d’équipement importés nécessaires à l’industrie tandis que celle-ci devait générer elle-même les devises indispensables. Dans ce contexte, le modèle d’industrialisation par substitution aux importations et celui des industries industrialisantes (développement de filières) appliqué depuis les années 30 en Amérique Latine avaient séduit de nombreux pays en développement. Dans ce modèle, les industries de produits finis ont été 256 vigoureusement protégées au moyen de barrières douanières (tarifaires ou non) accompagnées de taux de change multiples et surévalués (pénalisant pour les exportations), de subventions et de monopoles. Incontestablement, cette politique a permis à certains grands pays d’Amérique Latine (Brésil, Mexique, Venezuela) de se doter d’un tissu industriel diversifié (sidérurgie, automobile, chimie, agroalimentaire, etc.) sans prendre en compte leurs avantages comparatifs. Aujourd’hui, il apparaît nettement que cette stratégie d’industrialisation s’est essoufflée en produisant un ensemble de conséquences négatives dans les économies notamment : des déséquilibres internes et externes avec déficit budgétaire, hyperinflation et surendettement; dépendance accrue vis-à-vis de l’extérieur (biens d’équipements et biens intermédiaires) ; faible compétitivité et fragile positionnement commercial dans le système international. La crise de la dette, l’approfondissement des déséquilibres internes et surtout, l’isolante expansion de l’Asie du Sud-est à partir d’une stratégie d’industrialisation par promotion des exportations (IPE) amènent à s’interroger sur les possibilités réelles de l’ISI, notamment pour des PVD Plus gravement on peut se demander si aujourd’hui l’industrialisation est possible, particulièrement pour les PSD africains ? Théoriquement le modèle d’industrialisation dans la pensée économique est une conséquence issue des schémas de la reproduction élargie développés par K. MARX. Sans reprendre le fonctionnement des schémas, on peut apporter quelques précisions pour comprendre les formes industrielles qu’ils impliquent. En effet, dans la reproduction élargie, la totalité de la plus-value qui se forme n’est pas improductivement consommée, une part est utilisée pour l’achat d’éléments additionnels du capital productif ; ce qui suppose que le montant du capital variable et de la plus-value de la section qui produit les biens de production doit être supérieur au capital constant de la section productrice des biens de consommation. C’est là la condition de base de la reproduction élargie. La réalisation de cette condition exige que le capital variable et la plus-value de la première section augmentent plus rapidement que les mêmes éléments de la section deuxième. En clair, un modèle d’industrialisation est précisément rapide parce que la production des moyens de production est plus rapide que celle des biens de consommation, ce qui s’exprime dans l’élévation permanente de la composition organique du capital. Cet aspect de la question a été développé dans le «Capital » de Marx»qui raisonnait à partir d’une composition organique invariable. Dans le système capitaliste, ce qui croît avec le plus de rapidité, c’est la production des moyens de consommation et le plus lentement, la production des moyens de production» À partir de ces considérations, la loi de la priorité de l’accroissement de la production des moyens de production a été mise en œuvre – G. DESTANNE DE BERNIS l’appelle « les industries industrialisantes » ? En faisant un peu d’histoire, on constate que ce schéma a permis l’industrialisation accélérée des pays du socialisme réel. Les théoriciens post-Marxistes ont surtout développé cette idée selon laquelle le socialisme ne peut être édifié que sur la base de la grosse industrie mécanisée qui est seule capable de réorganiser l’agriculture145. Cela se comprenait parfaitement car l’expérience socialiste se déroulait dans des pays agraires donc 145 Idem. : Thèse développée lors du l’IIIe Congrès de l’Internationale Communiste. 257 industriellement arriérés. C’est surtout STALINE qui a élevé cette conception au rang d’une option rigide selon laquelle une prépondérance absolue doit être accordée « à l’accroissement de la production des moyens de production » car cette production a le devoir d’assurer l’équipement de ses propres entreprises et des entreprises de toutes les autres branches économiques ; mais aussi parce que sans elle, il est absolument impossible de réaliser la reproduction élargie146. Désormais, le centre de l’industrialisation aura sa base dans le développement de l’industrie lourde147. L’avènement de ce dogme s’est fait sur la liquidation successive de deux conceptions qui se dessinaient depuis la NEP : celle de N. BOUKHARINE et celle de l’opposition de la gauche représentée par L. TROTSKY et E. PREOBRAJENSKY. Le premier soutenait que la priorité dans le développement devait être accordée à l’agriculture qui peut créer un surplus disponible pour l’exportation et l’expansion du secteur industriel. Ce développement de l’agriculture permettrait une nourriture correcte des villes et de plus, fournirait les matières premières nécessaires pour l’industrie. Cette dernière disposerait de débouchés pour ses produits. Ces positions théoriques ont été vivement prises à partie par l’opposition de gauche qui défendait l’idée qu’il fallait développer l’industrie par une mobilisation des ressources disponibles. Celles-ci doivent nourrir de nouveaux investissements productifs. Elles proviendraient d’une restriction des consommations au niveau d’une agriculture intégralement socialisée. Une synthèse de ces deux positions théoriques est réalisée avec l »imposition d’une collectivisation forcée de l’agriculture permettant une mobilisation obligatoire des surplus pour le financement de l’industrialisation. C’est donc sur cette base que se développe la croissance prioritaire de l’industrie lourde qui doit permettre de rattraper et de dépasser le pays capitaliste le plus avancé : les États-Unis. Les théoriciens soviétiques de l’époque remarquaient que l’Union Soviétique était en retard d’une cinquantaine d’années sur les pays avancés et qu’elle devait parcourir cette distance en dix ans. Sur cette base va se consolider la thèse selon laquelle l’industrialisation véritable a pour fondement la loi de la croissance prioritaire du secteur I que Marie LAVIGNE formule de la manière suivante «dans les conditions de la grande production moderne, la croissance plus rapide de la production du secteur I par rapport à celle du secteur II est une nécessité»148. II/ Les relations entre l’industrie et l’agriculture Ces relations sont apparentes à partir de l’élucidation du rôle de l’agriculture dans la stratégie de développement économique et social. En fait, dans les PSD, les activités agricoles occupent une place décisive et accomplissent les fonctions économiques et sociales exorbitantes. L’agriculture est l’activité dominante de la majorité de la population active. Elle fournit l’essentiel des recettes d’exportation qui assurent les finances publiques. Pourtant, le rang de l’agriculture dans la hiérarchie sociale est bien en-deçà de cette place dans le procès de production. Toutes les statistiques établissent que dans les formations sous-développées, le niveau de vie des paysans est extrêmement faible par suite d’une distribution trop inégalitaire des revenus et des diverses ponctions opérées par l’État et les autres couches sociales intervenant dans le secteur agricole. J. STALINE : Les problèmes économiques du Socialisme. Idem. : La situation économique de l’Union Soviétique et la Politique du parti. 148 Marie LAVIGNE : Les économies socialistes soviétiques et européennes, p. 190. 146 147 258 Plus grave, le capitalisme périphérique accentue cette situation au lieu de l’améliorer. Il en résulte que la participation effective des masses rurales au développement est faible car l’agriculture ne remplit pas sa triple fonction de centralisation des surplus pour le secteur. L’accomplissement normal de ces fonctions permet l’amorce d’un développement autocentré et d’autres avantages, dont l’amélioration des conditions d’existence et de travail du monde rural. Dès lors, la transition appelle une stratégie impliquant une politique économique claire dans le secteur agricole. Cette stratégie passe par une remise en question des structures, de l’orientation de la production et des conditions de travail. En effet, on a déjà vu que la distorsion en faveur des activités exportatrices était à la base de la spécialisation dans la dépendance. La production s’effectue dans des conditions de très faible productivité préjudiciable aux producteurs immédiats et à l’économie nationale. L’extension de telles activités se fait au détriment des cultures vivrières et il en résulte une accentuation du déficit alimentaire. L’agriculture est placée dans une situation de crise. On l’a réellement condamné à ne plus accomplir les autres fonctions vitales, notamment les investissements productifs pour l’élargissement de la production. Il est d’ailleurs arrivé à un seuil limite de pression où les agriculteurs se sont révoltés en refusant systématiquement d’assurer l’approvisionnement des villes. C’est dire toute la délicatesse du problème qui est un élément fondamental de la répartition des revenus dans la transition. L’État doit veiller au respect d’un certain équilibre qui assure une reproduction normale dans tous les secteurs économiques. L’État a pour autre tâche de trouver une place aux relations économiques internationales pour que celles-ci ne reproduisent les mécanismes de l’échange inégal qui entraînerait un transfert de ressources des formations sous-développées vers le système capitaliste mondial. Il importe alors d’avoir une orientation précise en matière de relations commerciales avec l’extérieur. III/ Les relations économiques internationales dans la stratégie de développement Ce problème analysé sous plusieurs angles montre chaque fois, que les relations extérieures dans les PSD occupent une place centrale en matière d’exportations des matières premières, d’importations des biens d’équipement et de consommation mais aussi de recherche de transferts financiers et technologiques. La politique des échanges extérieurs a pour objectifs principaux de corriger les conséquences d'une spécialisation fâcheuse- et de préparer l'adaptation de l'économie au commerce international en facilitant sa diversification et la formation du capital. C’est ainsi que J. VINER affirme que la théorie de la division internationale du travail et du commerce international de Smith et de Ricardo avait mieux résisté à l’épreuve du temps que les autres aspects de leur doctrine. G. HABERLER, autre auteur contemporain, faisant autorité en la matière, considère lui aussi qu’en comparaison des autres éléments de la doctrine classique, cette théorie « a conservé sa valeur d’une manière étonnante. Elle a survécu à la révolution marginaliste et keynésienne sans grand dommage pour ses thèses essentielles ». Selon G. MEIER, « la théorie classique du commerce international a fait preuve qu’elle était capable d’assimiler les modifications apportées par le progrès de la théorie économique générale. La principale conclusion à tirer de la théorie d’HECKSCHER-OHLIN, est que chaque pays a intérêt à se spécialiser dans la fabrication et l’exportation de marchandises exigeant de nombreux facteurs de production qui y sont relativement abondants et, de ce fait, relativement bon marché. Ces deux auteurs ont déduit leur 259 analyse de l’expérience de la Suède qui était parmi les pays les plus « commerçants » du monde. Le contingent d’exportation de l’industrie suédoise était très élevé, environ 55 à 60% de la production du pays sont vendus à l’étranger. Cette dépendance du pays à l’égard du marché extérieur explique le grand intérêt que les économistes suédois avaient porté aux problèmes du commerce extérieur. Les théories néo-classiques estiment que les relations extérieures doivent compenser les infériorités relatives dans les dotations comparées en facteurs à partir d’un commerce sans entraves. Cependant, il reste et, ce sera démontré plus loin, que les chances de développement sont inégales et se répartissent en fonction de la taille des nations. Les relations commerciales ont-elles permis de réduire les écarts technologiques et de développement, le déficit extérieur et l’endettement des formations sous-développées ? Les théories de l’échange inégal, affirment que les relations économiques internationales opèrent diverses formes de transfert de ressources des PSD vers les pays développés. La détérioration des termes de l’échange est présentée comme une manifestation de tels transferts. Pourtant, elle ne représente que la partie visible de l’iceberg, il y a bien d’autres formes cachées et parfois occultes de transferts. C’est dire que l’économie mondiale ne régule pas harmonieusement et égalitairement les ressources financières comme l’affirme la théorie de la croissance transmise. Dans ces conditions, les PSD doivent trouver une stratégie du commerce avec l’extérieur qui n’annule point les effets positifs de la politique économique interne par le transfert de ressources rares au système mondial. Les éléments d’une telle stratégie sont d’une conceptualisation facile et consistent en une double action dialectiquement liée à l’accroissement de l’offre des biens d’exportation et d’autre part, à une diminution des importations. Si en l’apparence, les actions sont simples, elles suscitent dans leur concrétisation d’énormes difficultés que seule une planification adéquate peut résoudre. Pour que cette planification ne soit point une coquille creuse, elle doit être portée par des politiques claires d’exportation et d’importation. Au niveau des exportations, le problème est d’abord de connaître les biens exportables qui fournissent pour un pays des avantages comparatifs importants. Sur cette base pourra se développer une industrie et des activités agricoles travaillant exclusivement pour l’extérieur. Une fois le choix opéré sur les biens, le plan pourra fixer un seuil d’efficience des exportations. Ensuite, il s’agira de dégager les allocations d’investissements destinées au secteur exportateur. Pour les importations, le problème n’est point de les minimiser dans l’absolu, mais plutôt d’opérer une sélection sur les biens importés en fonction de deux (02) critères de nécessité dans le processus d’expansion et d’opportunité alternative. Le premier pose que certains biens indispensables dans la structure nationale doivent être nécessairement importés. C’est donc un choix impératif car l’expansion dans ce cas ne peut se poursuivre que par un accroissement des importations, il n’existe pas d’autre choix. Le second suppose que l’importation soit réalisée lorsqu’elle présente des avantages plus grands que si les biens concernés étaient localement produits. Dans un cas comme dans un autre, le planificateur procède à des arbitrages tenant compte des avantages économiques réels que l’économie nationale peut tirer les importations. Globalement d’ailleurs, les formations sous-développées qui sont pour la plupart de petits pays « ne peuvent développer la production de toute la gamme de machines nécessaires à une économie moderne et fabriquer tous les produits intermédiaires, étant donné le coût du capital requis et les déséconomies d’échelle». 260 Le planificateur doit avoir en matière de commerce extérieur des objectifs précis à réaliser. Bien que ceux-ci soient multiples et multiformes, un au moins nous semble essentiel : la couverture des importations ou la diminution de leur niveau réel. En effet, dans des formations sociales où existe un déficit systématique et chronique de la balance commerciale, une politique de couverture des importations est une impérieuse nécessité, mais elle passe par un développement des activités exportatrices. Dans cette optique, la problématique des relations avec l’extérieur pose l’allocation des ressources aux secteurs d’exportation. L’objectif visé peut être également une diminution des importations obtenue par des mesures administratives, protectionnistes ou monétaires. Dans un cas comme dans l’autre, une planification efficiente exige un contrôle, une maîtrise des opérateurs économiques établissant le joint avec l’extérieur. En plus, la planification appelle une rigoureuse politique monétaire d’accompagnement, laquelle doit être assise sur l’état effectif des réserves disponibles au moment où le pays amorce la transition. À titre illustratif, Serge KOLM estime que différentes actions sont possibles selon les réserves héritées de la société antérieure. Dans une situation, par exemple, de liquidités excessives, on peut envisager une politique d’achat de biens utiles ; ce qui aurait pour conséquence immédiate un alourdissement du déficit de la balance commerciale, mais qui n’entraîne pas en réalité une baisse de la valeur internationale de la monnaie. La dévaluation peut également se présenter comme une autre formule d’utilisation des excédents de liquidités surtout lorsque la situation de sous-emploi est caractéristique. Elle contribue alors à augmenter les prix extérieurs et partant à décourager les importations. Ces considérations, sans doute très vagues, ne peuvent refléter toutes les situations particulières des formations sociales en transition et les diverses attitudes que prend l’environnement international. Disons simplement que toute planification efficiente du commerce extérieur s’accompagne nécessairement d’une politique monétaire, car comme l’observe S.C. KOLM, «ce problème monétaire extérieur peut être anodin ou mortel selon qu’on en tient compte à temps ou trop tard»149. Nous avons passé en revue les divers domaines où des options très claires doivent être prises. Ces options éclairent et conditionnent les actions conjoncturelles à court terme que les autorités (qui ont à la charge la politique économique) doivent comprendre. Ces diverses actions sont réalisées avec des instruments techniques au premier rang desquels on a la planification et ceux liées au marché. Section 3 : Fonctions et techniques de la planification, de la prévision et de la prospective au niveau des PSD. Il est difficile de trouver une définition consensuelle de la planification bien qu’elle occupe dans plusieurs pays une place centrale et joue un rôle déterminant pour les pouvoirs publics qui, parfois, en font un instrument technique d’éclairage de leur processus décisionnel, de la cohérence et de la pertinence de leurs choix économiques et sociaux. Approximativement, la planification est un interventionnisme de l’État visant à organiser l’économie nationale en s’assurant de l’atteinte des objectifs poursuivis dans une période de temps. Dans un système socialiste caractérisé par une appropriation collective des moyens de production, elle Serge Christophe KOLM : La transition socialiste, la politique économique de gauche, p. 137. Édit. Cerf, Paris, 1977. 149 261 doit rendre possible ce que le marché ne permet pas, à savoir la définition d’une vision à long terme et la recherche de l’intérêt général. À cette planification impérative s’oppose une planification indicative qui a eu ses lettres de noblesse avec Pierre MASSE et tente de concilier Plan et marché c’est-à-dire que le Plan est impératif pour l’État mais indicatif pour tous les autres acteurs de l’économie nationale. Ses objectifs sont de trois ordres : réduire les incertitudes, servir de cadre à moyen terme à la politique économique et servir à l’État de budget pluriannuel. Socialistes comme libéraux en ont une compréhension et une utilisation au service de la réalisation de leurs objectifs : planification centralisée et rigoureuse au service d’une économie largement appropriée par l’État et planification indicative, directive et incitative en complémentarité avec les mécanismes du marché dans la pure tradition libérale. La mixture des deux conceptions est utile aux pays qui ne sont ni dans l’une, ni dans l’autre des deux situations idéologiques et qui rejettent le manichéisme et tentent une synthèse utilisable. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la planification connut une diffusion et une application de plus en plus importantes, sous des formes diverses, à travers le monde et plus particulièrement dans les pays sous-développés dont certains venaient d’accéder à l’indépendance nationale. Cette évolution tient essentiellement à l’influence conjuguée de trois principaux facteurs : d’abord, la planification soviétique commencée depuis 1928 et dont les résultats spectaculaires vont influencer largement la théorie du développement naissante ; ensuite, la planification européenne d’après-guerre mise en place pour l’accélération de la reconstruction notamment en France et Hollande ; enfin, la théorie keynésienne et néo-keynésienne dont les mécanismes cumulatifs d’investissement, de création de richesse et de distribution de revenus permettent de relancer et de dynamiser à fond les économies. C’est ainsi que de 1950 à nos jours, il a été recensé quelques 300 plans nationaux de développement à travers l’ensemble des PVD. En 1983, 80 pays du Tiers-Monde avaient un plan. Le Mali (de 1960 à 1967) et l’Algérie représentent en Afrique les plus grandes expériences en matière de planification. Globalement, les objectifs visés par les plans, bien que très divers, peuvent être regroupés en quatre catégories : La promotion de l’accumulation primitive interne en vue de l’investissement : pour cela, les plans devaient s’employer à mobiliser toutes les ressources nationales en vue du financement du développement. De la sorte, on espérait accélérer l’élévation des forces productives sur des bases endogènes. La valorisation maximale des effets d’entraînement des investissements sur l’économie nationale : à ce titre, cette priorité devait être accordée aux projets ayant d’importants effets multiplicateurs et suffisamment intégrés en vue du renforcement des relations inter-sectorielles. Elle devait également l’être à l’utilisation de technologies appropriées qui évite de désarticuler l’économie à travers des effets pervers indésirables. L’édification d’une économie nationale mieux articulée, à forte capacité de résistance vis-à-vis des chocs exogènes et à redistribution plus équitable des richesses produites : pour ce faire, l’investissement se devait d’être prioritairement orienté vers des productions (de biens et services) destinées à satisfaire les besoins de base des populations (alimentation, habitat social, éducation, santé entre autres…). De même, 262 il revenait au plan d’explorer et d’expliquer utilement l’ensemble des voies et moyens susceptibles de réduire le plus possible la dépendance extérieure du pays. La mise en place de dispositifs complémentaires d’ordre administratif pour lutter contre les tendances à l’inégalité économique et sociale dans le cadre de la croissance économique. I/ Considérations générales sur le processus de planification La généralisation de l’utilisation du concept et de la pratique de la planification dans les pays sous-développés est un trait dominant de la vie sociale. Au double point de vue pratique et théorique, la planification est d’origine soviétique, même si les idées qu’elle recouvre peuvent remonter très loin dans l’histoire. La pratique démarre avec le premier plan de 1928 qui était établi selon une prévision des rythmes et des proportions de développement économique. Dans la nouvelle République des Soviets en pleines mutations structurelles et totalement coupées de la division internationale capitaliste du travail, il fallait trouver une technique de mise en œuvre consciente et rationnelle des ressources nationales en vue de leur utilisation optimale au service des objectifs socio-économiques nettement spécifiés. La planification se perfectionnera pour devenir en dernière instance l’instrument qui définitif les tâches et objectifs du développement ainsi que les méthodes et moyens de les réaliser. Enfin, il fixe les ressources à mobiliser et détermine les délais de réalisation. Le plan est alors un instrument de régulation et de direction de la vie économique et sociale. Pourtant, les fondements théoriques de départ de la planification étaient extrêmement réduits. C’est une discipline dans laquelle la pratique a devancé la théorie. On ne trouve pas dans les travaux scientifiques des économistes une solide, complète et cohérente formulation du processus planifié d’une économie nationale. Tout au plus, dans tel ou tel ouvrage théorique, on peut découvrir quelques allusions, quelques approximations totalement incapables de fonder une praxis consistante. Autant la position implicite de MARX au sujet du principe de la planification est claire, autant il est difficile de trouver dans ses ouvrages des références explicites, mêmes indirectes, tandis que fait défaut toute prise de position directe et générale. En clair, les planificateurs sont partis uniquement armés des instruments qu’ils se sont forgés eux-mêmes150. Ce sont toutes ces raisons qui ont naguère fait apparaître la planification comme un attribut des économies socialistes. Après leur accession à l’indépendance, les PSD ayant opté pour des politiques de croissance accélérée en vue de combler leur retard économique, moderniser leur système productif dans tous ses secteurs et résoudre les problèmes d’emploi de la main-d’œuvre, ont eu recours à la planification mais à la suite de vives polémiques et controverses. L’adhésion à l’idée de planification n’est pas tombée sous le sens et a été accueillie au départ avec méfiance. Deux tendances aux visions très différenciées se sont vivement opposées sur l’opportunité et la nécessité d’amorcer un processus planifié des économies151 . BOBROWSKY souligne avec pertinence que ni la théorie soviétique, ni à plus forte raison la théorie bourgeoise ne leur ont fourni des instruments valables et utilisables. Ils ont donc été leurs propres maîtres. 151 Voir le point réalisé par Michel GAUD : Les premières expériences de la planification en Afrique Noire. 150 263 La première tendance était parfaitement hostile, estimant que la planification est une technique impossible à appliquer dans les formations sahéliennes caractérisées par le sous-développement économique et social. Une série d’arguments est avancée pour appuyer cette thèse. D’abord, la planification est un instrument de réduction des incertitudes et s’appuie sur un appareil statistique et des modèles scientifiques de prévisions. Or, ces éléments déterminants sont encore très loin d’être réunis. Ensuite, elle est une technique de maîtrise du développement. Là encore, la dépendance qui est un trait dominant au niveau des économies subsahariennes fait que celles-ci fonctionnent par et pour l’économie mondiale qui est le centre de décision ultime. Enfin, la lecture des expériences de planification centralisée établit que la planification est souvent synonyme de lourdes bureaucraties inefficientes et coûteuses. Également, elle apparaît comme liée à la démultiplication de procédures stérilisantes qui annihilent toute initiative. À tout cela s’ajoutent aussi les déficiences quantitatives et qualitatives des cadres susceptibles d’actionner le plan. Pour toutes ces raisons, les tenants de cette conception recommandent l’observation d’une démarche prudente et la prise en considération de préalables sans lesquels le processus de planification est irrémédiablement voué à l’échec, à savoir : la disposition d’une base statistique large et de cadres compétents, le contrôle de l’économie et l’existence d’une structure institutionnelle fonctionnelle. La seconde tendance développe des arguments inverses. Elle part de l’idée que l’action de l’homme dans un environnement instable et hostile ne saurait être abandonnée à la turbulence des forces de la nature et du marché. La technique de la planification doit permette l’organisation de cette nécessaire maîtrise du développement dans cet environnement incertain et à risque. En plus, elle est la seule alternative à l’anarchie héritée des mécanismes et rouages de l’économie coloniale de traite. Elle seule permet d’indiquer les voies et moyens pour discipliner les efforts collectifs et atteindre les objectifs de croissance économique et sociale préalablement fixés. En conséquence, non seulement le plan indique les actions à entreprendre, mais également désigne explicitement ou implicitement «une éthique des valeurs sociales et une philosophie de la condition humaine». Comme on le voit, ces controverses théoriques passionnées sont empreintes d’arrière-pensées et préjugés idéologiques et politiques. Cependant, elles seront déterminantes quant à la fixation des cadres mêmes de la planification et des conditions de mise en œuvre d’un processus planifié des économies sousdéveloppées. Le débat établira, en dernière analyse, que si la planification est une nécessité pour une accélération et un contrôle du développement, pour une utilisation optimale et efficiente des ressources et la promotion au niveau global du principe de non gaspillage, son instauration dans les PSD appelle l’adaptation de ses méthodes et techniques aux réalités socio-économiques qu’elle doit servir, et la progressivité quant à l’instauration des mécanismes et structures institutionnelles caractéristiques du processus planifié. Sur le premier point, tout le monde s’accorde pour reconnaître qu’il n’existe pas de planification en soi, autrement dit, il ne saurait exister un modèle universel de planification car cette technique est « appliquée pour résoudre des problèmes socioéconomiques bien déterminés»… Ainsi, le pessimisme relatif à l’utilisation éventuelle, par les pays d’Afrique, de la planification occidentale ne signifie en aucune manière le recours à l’autre l’extrémité : copier aveuglément la planification socialiste. En effet, il semble que la transplantation automatique dans les pays d’Afrique des formes et des 264 méthodes de la planification contemporaine socialiste relève de l’aventurisme économique152. Les méthodes et techniques de la planification doivent, en toute conséquence, s’adapter aux particularités historiques, sociales et économiques du pays. Même en s’inspirant des expériences entreprises d’ailleurs qui peuvent conduire au succès, le planificateur africain est condamné à trouver la juste mesure entre les traits universels de sa science et les traits particuliers. La seconde condition concerne la progressivité du processus planifié des économies. Elle prend appui sur les déficiences des statistiques, permettant d’éclairer les décisions, la méconnaissance des mécanismes économiques et l’insuffisance de cadres techniques compétents et de structures institutionnelles effectivement appropriées. Ces éléments constituent des obstacles, des goulots d’étranglements qui imposent l’observation d’un étatisme dans l’installation des mécanismes et techniques de la planification. Les débats théoriques qui ont induit certaines conditions pour l’accession à la planification ont, en définitive, imposé partout dans les PSD, des systèmes hybrides tenant à la fois de la planification souple appliquée dans les pays à économie de marché et de la planification centralisée des pays socialistes. La méthodologie dans un tel cadre est forcément à mi-chemin entre le pragmatisme et l’économétrie. Le pragmatisme découle du fait que : le marché est libre et détermine le système des prix qui restent ainsi des indicateurs de rareté, les moyens de production et les unités économiques ne relèvent pas de la propriété sociale même s’il existe un secteur public, les économies sont articulées à la division internationale du travail, ce qui leur interdit d’avoir une conjoncture autonome. Les moyens d’action dont disposent les planificateurs sont extrêmement réduits. Le plan se présente alors comme un conglomérat de projets publics et privés et ne lie que très peu les divers agents économiques. Il mémorise les actions à entreprendre. Quant à l’aspect économétrique, il réside dans l’utilisation de modèles simples établissant les liens entre les variables décisives de l’économie et le recours à la prévision normative. Ainsi, si l’on retient un taux de croissance estimé suffisamment performant, le planificateur procède à des déductions lui permettant de fixer le volume désiré d’investissement, d’épargne, le besoin de financement complémentaire, le volume de l’emploi, etc. L’économétrie permet d’établir le niveau de toutes les grandeurs macroéconomiques. Si toutes les choses restent comme voulues par les hypothèses retenues de croissance économique, ce niveau ainsi calculé des grandeurs indique les actions à entreprendre en matière de politique fiscale et budgétaire, de relations économiques internationales. En définitive, tout aussi bien en matière de fixation des objectifs et des indices à atteindre, de prévision macroéconomique qu’en matière d’élaboration et d’application de mesures destinées à atteindre les objectifs, la planification sahélienne reste très empirique. C’est cela qui explique que les plans de cette région sont considérés, par certains auteurs, comme des coquilles creuses, élaborées par les techniciens du développement, sans aucune participation populaire. Ces dernières années, il y a eu de sérieuses amélioration portant sur : 152 Youri POPOV : Aspects méthodologiques de la planification. Revue algérienne, n° 1, mars 1967. 265 les méthodes d’élaboration, d’exécution et de contrôle, les cadres institutionnels et organes de gestion de la planification. Au niveau des méthodes, les planificateurs de la "deuxième génération" appréhendent avec plus de clarté les problèmes qu’ils doivent résoudre à savoir : II/ Synopsis des étapes d’élaboration d’un Plan L’élaboration du Plan de l’économie nationale pourrait suivre les 6 étapes qui suivent : 1. Évaluation du cadre socio-économique du pays, évaluation des ressources, analyse de l’état de l’économie au début du plan et des tendances du développement économique qui se sont faits jour dans la période précédente. 2. Prévision des options fondamentales du développement, du niveau des besoins sociaux et des ressources pour l’avenir, prévision du progrès scientifique et technique. 3. Définition des objectifs et des tâches du développement économique pour la période du plan, coordination de ceux-ci avec les objectifs du développement à long terme, définition des options fondamentales du développement de l’économie nationale et des méthodes de la politique économique. 4. Définition des taux et des coefficients de proportionnalité du développement, projection des grands agrégats retenus de l’économie sur la période considérée 5. Rédaction détaillée du plan de l’économie nationale et ses démembrements au niveau local, régional, 6. Définition des tâches des organes de suivi et d’évaluation des tâches du plan à tous les échelons de concrétisation. Si des efforts remarquables ont été réalisés au niveau méthodologique en Afrique, ils le sont beaucoup moins dans la définition de cadres institutionnels de gestion du processus planifié. Au plan politique, on peut observer la création du Ministère du Plan dans tous les pays. Cela constitue incontestablement un important pas en avant par rapport à la situation antérieure où la planification était confiée souvent à une simple direction rattachée au Ministère de l’Économie et des Finances. Le plus important dans cette nouvelle gestion devrait être le renforcement des tendances nettes à la décentralisation du plan. Ce sera peut être la conception la plus positive des plans de la deuxième génération. Les objectifs proclamés se résument à : la répartition spatiale plus rationnelle des activités productives, la promotion de l’initiative locale en matière d’élaboration, d’exécution et de contrôle du plan ; cela permet alors une meilleure prise en considération des conditions et potentialités économiques des régions, une meilleure répartition des secteurs et de l’infrastructure. Dans cette optique, la planification peut désormais aider à la promotion économique de chaque collectivité locale, de chaque région en exploitant toutes les potentialités, ce qui permettrait de résoudre progressivement le dualisme structurel et les distorsions de l’économie sous-développée. En effet, l’héritage économique et structurel se caractérisait par les traits suivants : grands écarts de revenus entre les différentes régions153, répartition inégale des infrastructures économiques et sociales, répartition inégale des activités productives, faibles liens économiques entre les On se souvient de la boutade célèbre du Professeur René DUMONT : Dakar, une grosse tête sur un petit corps, entendez les sept autres régions du Sénégal. 153 266 diverses régions. Ces déséquilibres sont à la base de l’exode rural, de l’inégalité des niveaux de vie et de revenu, des tendances et velléités sécessionnistes, etc. Une décentralisation bien menée devrait permettre à terme d’apporter quelques corrections154 aux multiples distorsions, lourdes conséquences socio-politiques. Cela exige au moins trois tâches importantes : d’étude et d’analyse : la réalisation des recherches et des études sur les structures sociales du Sahel, les systèmes de production, les modes de consommation et les visions philosophiques du monde. L’élaboration de programmes économiques à long terme. Ces Programmes donnent aux planificateurs non seulement une marge de certitude, mais facilitent la recherche de la cohérence intertemporelle du Plan. L’établissement d’instruments expressifs de quantification, comme les paramètres de la production de la consommation, de la répartition du revenu, les taux d’accroissement des divers secteurs et le taux de croissance de l’économie, les indices et paramètres d’évaluation du commerce extérieur et la fixation des indicateurs sociaux et de mesure du bien-être et de la qualité de la vie. La définition des domaines, normes et formes d’intervention de l’État Ces tâches ne se posent pas de façon identique dans tous les pays. Elles ressortent au titre des préoccupations spécifiques, des questions auxquelles les planificateurs doivent trouver réponse s’ils veulent avancer. C’est pour cette raison que tous les plans en Afrique comportent des volets de financement de recherches sociales, de perfectionnement des appareils de collecte et de traitement de la statistique, d’évaluation des indicateurs socio-économiques. Les études prospectives ont eu un regain d’intérêt dans tous les PSD. Les décideurs et planificateurs comprennent que la complexité des problèmes que soulève la dynamique de développement économique et social nécessite une analyse prospective ; cela d’autant plus que l’environnement est très instable. Elles permettent en effet d’envisager tous les scénarios possibles de développement et en conséquence éclaire les choix, les domaines d’action, les mesures qualitatives et quantitatives et les moyens à mobiliser. Elle est alors un auxiliaire indispensable et irremplaçable de la planification155. Il y a là un travail extrêmement difficile qui exige d’abord une assez solide organisation, et ensuite la définition des liens entre plan nationale et plan régional ; cela pour éviter toute velléité d’autonomie préjudiciable à l’économie dans son ensemble. D’autres nécessités s’imposent : des méthodes et formes de répartition de moyens de développement, des facteurs de production, des infrastructures, des critères de rationalité et d’efficacité du développement régional, des rapports entre les gestionnaires nationaux et régionaux de la planification. La régionalisation a tout logiquement entraîné une collaboration de plusieurs services : forme pratique d’une organisation interdisciplinaire. 155 Moustapha KASSÉ : Les stratégies alternatives au Sahel. Institut du Sahel, Bamako. Il est indiqué dans ce projet les problèmes auxquels la prospective doit s’attaquer dans le Sahel à savoir : 1°) Les zones géographiques et leurs potentialités agricoles, pastorales et hydrauliques. 2°) L’évolution démo-économique et démo-alimentaire. 3°) Les stratégies des équilibres globaux. Les réflexions sont faites en direction de la réalisation de l’autosuffisance alimentaire. 154 267 Ce sont des éléments de structuration du plan régional qui entraînent des modifications profondes. La planification telle qu’elle est conçue et organisée dans les pays africains peut-elle assumer de tels changements ? Pour y répondre, il s’avère nécessaire d’en dégager les limites. II/ Les limites du processus planifié des économies sous-développées Il s’agit de s’interroger sur les obstacles véritables au processus planifié avant d’apprécier plus loin les résultats obtenus par vingt (20) années de planification des économies. À réfléchir sur la planification, trois (03) éléments méritent de retenir l’attention : d’abord, la construction théorique qui fixe les bases profondes de la praxis, ensuite, les méthodologies et instruments employés, enfin, les cadres institutionnels et administratifs de gestion de la planification. 1°) Les faibles constructions théoriques en matière de planification La planification au Sahel et dans la plupart des pays sous-développés est au service des politiques de croissance que l’on veut régulière, équilibrée, harmonieuse et rapide. Ces politiques elles-mêmes sont portées par des modèles d’inspiration néoclassiques et keynésienne156, c’est-à-dire qui reposent sur les hypothèses conjuguées : de complémentarité et de la substitualité des facteurs dans la fonction de production, de la concurrence pure et parfaite, de la rationalité des entreprises fondées sur la recherche du profit maximal, du comportement de consommation motivé par la recherche de la satisfaction optimale, de la répartition optimale du revenu national, du libre jeu absolu de tous les mécanismes et rouages économiques, de la non intervention systématique de l’État. Dans une telle approche, l’État est présenté comme une espèce d’interprète de l’intérêt général et comme un agent de synthétisation des références individuelles, et la planification devient le substitut de main invisible. En effet, si toutes les conditions d’une économie concurrencée sont réunies, les prix du marché se présentent comme les instruments d’allocation des ressources « les signaux en fonction desquels sont prises et coordonnées les décisions individuelles des agents économiques ». Il existe une tendance extrêmement malheureuse à réduire et à assimiler toutes les théories non marxistes à la théorie néo-classique. Cela procède d’une lecture et d’une réflexion peu profonde sur les divers courants de la pensée économique contemporaine où tous les grands courants se diluent en nuances et variantes. C’est également être complaisant de la récupération théorique opérée notamment par P. SAMUELSON. Dans tous les cas, les paradigmes néo-classiques son trop éloignés. Le fait que les formulations théoriques de la croissance soient néo-classiques et les politiques économiques d’inspiration keynésienne, ne doit nullement mener à des dissimulations abusives et théoriquement fausses. KEYNES est plus près de MARX que celui-ci est éloigné des conceptions néoclassiques. Il faudra voir sur ce point les critiques faites par les keynésiens (J. ROBINSON, L. PASSIREETH) de l’édifice théorique néo-classique mais aussi des points établis entre KEYNES et MARX par P. BARAN et Maurice DOBB. 156 268 En définitive, «le système des prix par des ajustements incessants assure la coordination des décisions individuelles»157. L’univers hypothétique n’étant pas effectif, notamment dans les pays sous-développés du Sahel, les fonctions de coordination des marchés seront assumées par le plan. On voit que ce qui limite particulièrement la planification, c’est son soubassement théorique qui fait du plan une cellule plus ou moins complexe d’enregistrement des projets décidés en toute autonomie par des agents privés ou l’État. Cela va s’en dire que les critères échappent totalement au planificateur dont le rôle se réduit à vérifier si le projet contribue ou pas à la réalisation des grands équilibres. Le système de planification ne pouvait alors qu’être indicatif donc absolument pas à mesure de réaliser et de gérer les transformations structurelles indispensables pour l’amorce d’un processus irréversible et soutenu de développement économique et social. La planification ne possède ni les orientations, ni les techniques, ni les structures pour opérer de telles transformations. Il s’avère donc nécessaire d’infléchir les orientations et options de politique économique et les théories qui les portent. La planification suivra automatiquement car quelles que soient ses qualités intrinsèques, elle ne saurait être le substitut d’une politique économique adéquate, cohérente et intégrale, c’est-à-dire qui prend en ligne de compte toutes les dimensions de la vie socio-économique trace des objectifs et spécifie les moyens matériels et financiers de leur réalisation. Elle n’est qu’un moyen, certes puissant, mais n’est pas la fin qui est le développement. Si on abandonne alors dans les PSD d’Afrique les théories et les pratiques limitées menées en termes de croissance économique, la seule alternative d’une stratégie du développement s’articulerait autour : du développement prioritaire de l’agriculture pour la rendre apte à satisfaire les besoins fondamentaux des populations, d’un modèle d’industrialisation fondé principalement sur des filières de valorisation des produits agricoles et de mise à la disposition de l’agriculture des facteurs modernes de production, d’une ouverture maîtrisée sur l’économie mondiale. La réalisation d’une telle stratégie sera incorporée dans un profond processus de planification. Bien sûr, même s’il faut s’inspirer des expériences des pays socialistes158, il faut bien admettre que les pays africains caractérisés par une pluralité structurale ne possèdent ni les moyens, ni l’homogénéité structurelle nécessaire pour l’application d’une planification centralisée. L’existence nécessaire d’un secteur privé comme centre autonome d’initiative de production et de consommation impose la prise en compte dans la planification du caractère mixte de l’économie. L’État, à partir du plan, déterminera les orientations générales du développement économique en s’appuyant sur un secteur public important. On ne soulignera jamais assez que plus le domaine d’action directe de l’État est restreint, plus il est difficile de mettre sur pied et de réussir une politique économique cohérente et intégrale. La planification devra organiser la coexistence de l’ensemble de ces structures et secteurs diversement impliqués dans le développement. Théoriquement se trouve ainsi formulée la nécessité d’une option qui pourrait concilier l’orientation et la détermination des objectifs généraux par l’État et le secteur privé. Cette voie moyenne de partenariat public/ privé comme toute formule J.C. BERTHOLON : Méthode ONUDI et théorie économique, in Méthodologie de la Planification. Dans ce sens, BOROWSKY a certainement raison de considérer que «les pays, hier sous-développés, aujourd’hui socialistes dont l’économie se caractérise par une croissance rapide et une transformation profonde des structures peuvent servir de référence». 157 158 269 hybride, est forcément complexe et difficile à mettre en œuvre. Toutefois, c’est l’alternative la plus crédible pour longtemps dans les pays africains. Les objectifs économiques et sociaux à atteindre se réduisent l’accroissement soutenu des forces productives, matérielles et humaines, la mise en valeur des ressources pour une satisfaction des besoins de base des populations. Pour les atteindre, de profondes transformations structurelles sont indispensables. Cela va se traduire par la fixation d’objectifs quantitatifs sectoriels et d’objectifs qualitatifs structurels. De fait, la planification devra embrasser les indices essentiels de la production agricole et industrielle des transports et des services, des sources d’accumulation et leur utilisation dans les différentes branches économiques, des équilibres, des relations avec l’extérieur, des besoins en main d’œuvre et en cadres, de la santé, de l’enseignement et du pouvoir d’achat. Elle devra également insister sur les mesures, les réformes et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. Encore une fois, tout cela est la conséquence rémanente de l’abandon des hypothèses de raisonnement fondées sur la croissance économique159. 2°) Les limites planification méthodologiques et instrumentales de la Dans la quasi-totalité des pays africains, la planification est indicative et s’inspire du modèle français de planification indicative selon lequel les organes de planification indiquent une série d’objectifs estimés désirables au double plan micro et macroéconomique. À partir de cette base, les planificateurs tentent, par divers moyens et instruments mis à leur disposition, de diriger l’ensemble des forces économiques et sociales vers ces objectifs. S’il y a des efforts certains d’adaptation de la méthodologie, des instruments et des formes d’intervention aux conditions spécifiques des pays africains, les limites d’un tel type de planification sont lourdes. Les systèmes planifiés n’atteignent jamais leurs objectifs et finissent par être un catalogue de vœux pieux destinés plus à convaincre les bailleurs de fonds qu’à servir le développement. Par ailleurs P. JACQUEMOT résume les critiques les plus fréquemment adressées à la planification du développement : Les plans sont trop formalistes et prétendent vainement embrasser l’ensemble des activités. Les plans sont un catalogue de projets mal évalués au niveau des coûts et des charges récurrentes non hiérarchisés Absence de mécanismes institutionnels qui leur permettraient de coordonner les activités liées à la gestion financière à court terme avec l’analyse des politiques d’investissement à long terme Le plan mobilise très peu d’acteurs sociaux Liens non définis avec le Budget de l’État. Ces critiques renvoient à la trop grande faiblesse de la base méthodologique et instrumentale de la planification indicative et cela, particulièrement pour trois (03) séries de raisons : Il faut réaffirmer que ce qui est en cause dans les théories de la croissance, c’est d’une part cette glorification des objectifs quantitatifs, cette volonté de rattraper les pays capitalistes en imitant leurs propres formes de développement et surtout d’une industrialisation qui sacrifie systématiquement les intérêts de larges souches sociales. Si les théories de la croissance sont rejetées, c’est d’abord à cause de leurs fragiles bases méthodologiques et c’est ensuite parce que les préoccupations qu’elles soulignent ne sont pas celles des pays sous-développés et enfin parce qu’elles se trompent de domaine et d’instruments d’action. 159 270 d’abord, cette planification n’a pas rompu avec la logique et les structures de l’économie de marché ; ensuite, la méthode de détermination des variables et indices essentiels se fonde principalement sur l’itération ; enfin, les instruments d’action sont inefficients. Il nous faut considérer de plus près ces raisons qui sont révélatrices des limites, des techniques mais aussi de l’inefficacité de la planification qui n’a su ni pu endiguer les catastrophes socio-économiques du Sahel. Pourtant, si on mobilise tant de ressources humaines, matérielles et financières dans la planification, c’est bien pour mieux lutter contre les aléas et incertitudes et infléchir dans la bonne direction les évènements économiques par une action volontaire à moyen ou long terme160. Nous devons donc savoir situer les raisons de cette inefficience au plan méthodologique et instrumental. a) La première série de raisons tient au fait que la planification indicative en cours n’a rompu ni avec la logique, ni avec les structures de l’économie de marché. Dans les formations sous-développées du Sahel, le marché est en pleine formation et en conséquence, il se trouve dans l’incapacité de remplir normalement toutes ses fonctions. Dès lors, on a fini par penser que le plan pouvait parfaitement combler ces lacunes et fixer les bases sur lesquelles les mécanismes du marché pourront fonctionner. Cette importance accordée au marché est sans rapport avec son effectivité et ses possibilités. On finit par ne plus savoir qui du marché ou du plan doit réduire les incertitudes et rationaliser les anticipations. Le marché a été incidemment retenu, il a fourni des réponses à la fois mauvaises et assez partielles. Même si l’on s’accorde, comme le fait Ota SIK à reconnaître qu’il existe une corrélation dialectique entre le plan et le marché, il faut affirmer la primauté du plan comme instrument de cohérence éclairant la rationalité collective et préparant les grandes décisions pour contrer les aléas et les incertitudes161. Ce problème devra être clairement résolu dans les plans de la troisième génération qui doivent alors opérer cette espèce de répartition des tâches décisives pour la prise de certaines décisions. b) La deuxième série de raisons de l’échec des plans africains provient de la fragilité de leur base méthodologique. Sur ce point, trois observations peuvent être faites : d’abord, le plan est confectionné à partir de techniques itératives, ensuite, le choix des investissements n’est pas déterminé par les organes centraux de la planification, enfin, la prévision du développement économique et social n’est pas envisagée objectivement. Michel DUMAS : dans «Où en est la planification en Afrique Noire». (Présence Africaine n° spécial 1971) a raison de ne point sous-estimer les difficultés auxquelles on se heurte mais les meilleurs gouvernements et plans doivent pouvoir faire quelque chose contre l’effondrement brutal des cours mondiaux. S’il n’en était pas ainsi, la planification du commerce extérieur n’aurait absolument aucun sens. Si les contraintes extérieures sont considérables, il faut en tenir compte. 161 Si nous partons de la nécessité de l’organisation d’une économie mixte, la planification ne peut fonctionner sans un fonctionnement du marché, c’est-à-dire qu’il sera difficile d’aboutir à l’équilibre économique sans une mise en jeu, le mécanisme du marché qui est la meilleure régulation dans certains domaines. Bien entendu, il ne faut pas attendre que le marché résolve des problèmes qui le dépassent comme la réalisation de la nationalité collective, la prise de décision pour réduire les aléas et l’incertitude, etc. Il faut donc que marché et plan procèdent ensemble et parallèlement. 160 271 Sur le premier point, on peut dire que tous les plans des pays du Sahel, notamment ceux de la première génération ont été élaborés sur la base d’une méthode itérative procédant donc par approximations successives pour aboutir à la version finale. C’est ainsi que l’on a déterminé les variables essentielles comme le taux de croissance globale de l’économie et de la démographie. Une fois les indices retenus, on procède à des tests macroéconomiques d’acceptabilité et de faisabilité des taux. Donc, on recherche les cohérences : des équilibres fondamentaux des agrégats caractéristiques, des équilibres entre ressources et emplois, des implications pour les divers sous-systèmes de production, des procédures. En définitive, les choix fondamentaux et les objectifs déterminants ne sont pas établis sur la base d’études exhaustives des économies nationales et de leurs potentialités, mais déduits de simples hypothèses. Le plan confectionné sur cette base est une série de vœux pieux, «un art de cultiver des illusions dans le jardin des hypothèses»162. Il est alors un document à usage externe et non un instrument désignant les changements de structures et de comportements et les prenant en charge. Le second point concerne la détermination du volume et de la répartition des investissements. Cette variable-clé dans les politiques de croissance n’est pas contrôlée par le planificateur qui ne dispose que des moyens d’action indirecte souvent totalement inefficaces pour la susciter ou l’orienter. Dès lors, les choix d’investissement, donc des techniques de production échappent au plan. Dans d’assez rares cas, le planificateur peut proposer des critères de choix cadrant avec les objectifs et contraintes du développement. D’une manière générale, les organes de planification ne disposent que de très faibles bases de manœuvres pour stimuler, dissuader, répartir les investissements. La conséquence sera que le plan ne pourra point opérer une intraversion véritable des activités économiques, notamment celles des firmes étrangères. Celles-ci décident en toute autonomie de leur domaine d’action, de leur forme d’intervention et de la répartition de leurs surplus. Les mesures de rétorsion n’existent pas. En effet, les instruments sont principalement d’action indirecte. Le troisième point de la faiblesse méthodologique est l’absence de leviers dont pourrait disposer le Plan pour réaliser les objectifs impartis. La planification indicative, se proposant de préserver un fonctionnement sans entrave des mécanismes du marché, se dote de trois moyens à savoir : les finances publiques, les interventions monétaires, le contrôle sur les prix et le commerce extérieur. L’utilisation de la fiscalité s’est faite principalement dans le sens positif d’encouragement à l’investissement. Au niveau mondial, le mouvement de flux et de reflux des capitaux obéit à des lois très complexes, des conditions qui ne relèvent pas toujours d’une logique économique pure. Pour promouvoir les investissements privés directs étrangers (IDE), les décideurs prennent des mesures juridiques dérogatoires au droit des sociétés, accordant de larges concessions fiscales qui s’accompagnent de clauses de garantie contre toute forme de nationalisation. Le code des Dans cette direction, le groupe AMIRA observe que le doute s’accentue si la planification utilise non plus seulement des techniques d’optimisation car, il apparaît illusoire de rechercher à maximiser une fonction objective à un niveau très agrégé comme le niveau national. Une solution optimale est presque toujours sensible aux contraintes et aux aléas de l’environnement. 162 272 investissements se présente ainsi comme une sorte d’appel d’offres, un contrat de désarmement fiscal qui va avoir pour conséquence une perte de recettes. En effet, pour apprécier si le désarmement fiscal et douanier était justifié, il aurait fallu savoir au préalable si l’investissement n’aurait pas eu lieu même en l’absence de code, et si par ailleurs d’autres moyens de stimulation n’étaient pas disponibles. Quoi qu’il en soit, les codes des investissements n’ont pas produit les effets attendus163. Quant aux interventions monétaires, elles ne peuvent se faire que dans les limites extrêmement étroites des engagements souscrits dans le cadre des Zones Monétaires auxquelles les monnaies africaine sont rattachées Cependant, il n’est pas évident, qu’en l’absence des accords, les responsables des politiques économiques auraient des initiatives hardies, tellement ils sont obnubilés par l’orthodoxie monétaire selon laquelle la stabilité monétaire est une fin en soi. La preuve est apportée par le fait que les faibles possibilités d’action monétaire qui leur sont offertes ne sont nullement exploitées. Par contre, les plans mentionnent la nécessité d’une lutte contre l’inflation, comme si elle était forcément la priorité des priorités dans le domaine monétaire et financier (stérilisante et perturbatrice). Au total, dans les politiques économiques, la monnaie est considérée comme un élément passif. Les axes de la politique monétaire et financière se réduisent à encourager l’accroissement de l’épargne et à définir une politique de crédit qui ne pérennise pas les fondements de l’économie de traite car ne s’exerce véritablement que pour les grands produits agricoles et les facteurs de productions nécessaires à ce secteur. Dans un cas, l’objectif visé est d’assurer une stabilité des revenus des producteurs directs et dans l’autre, de diminuer les prix par des subventions pour généraliser l’utilisation des facteurs. La méthode administrative de contrôle des prix ne fonctionne que partiellement. Pourtant, la structure des prix dans les pays du Sahel est très loin de refléter les conditions de production et d’échange. Par ce contrôle, il devrait être possible de maintenir une certaine correspondance entre cette structure des prix et les conditions économiques d’ensemble. Il en va de même pour le commerce extérieur, qui bien qu’il occupe une place importante, n’est nullement l’objet d’une planification rigoureuse qui n’existe d’ailleurs que pour les grands produits agricoles et les facteurs de production agricole. En repassant en revue ces instruments utilisés, on se rend compte qu’ils sont liés, peu efficaces pour opérer les mutations et modifications structurelles. Ils ne permettent même pas de bien orienter toutes les décisions des agents économiques vers la réalisation des objectifs. Manifestement, ni la méthodologie, ni les instruments ne confèrent à la planification une utilité et une efficacité. Dès lors, on comprend les réajustements incessants dont les plans sont constamment l’objet et qui sont autant de réadaptations par suite de défaillances des partenaires privés ou de l’État. c) La troisième série de raisons qui limitent la base méthodologique et instrumentale tient aussi à l’absence d’une prévision scientifique du développement économique et social. Tout effort sérieux de planification est une exploration qualitative du futur pour projeter l’image globale de la société à édifier. Cette vision à long terme permet, comme l’affirme Mouhamed DOWIDAR, de donner au planificateur une marge de Moustapha KASSÉ : Tourisme international : évaluation de l’impact sur le développement. Tome 2, pp. 220-237. 163 273 certitude et, en même temps, de lui faciliter le travail de la cohérence intertemporelle164. Cette nécessité de la prévision n’est pas reconnue particulièrement par les défenseurs de la planification indicative. Ils estiment que dans les pays comme ceux qui composent le Sahel, qui se caractérisent par l’existence de plusieurs structures, des rapports de production transitoires et plusieurs centres de décisions autonomes, la prévision est totalement impossible même si on établit sa nécessité objective. Il s’agit là d’une grave erreur qui constitue une entrave grave au processus planifie des économies. Dans cette optique comme l’observe S. KOUZMINE «tout phénomène de quelque importance dans l’évolution de la Société a son germe ou son prototype dans les réalités et l’expérience du passé et du présent. Par conséquent, la connaissance des lois du développement actuel définit déjà en soi les limites plus ou moins nettes des changements possibles, établissant ainsi des "repères" ou des "points d’appui" pour ces jugements, arguments sur l’avenir»165. C’est donc la recherche de ces points d’appui qui constitue la prévision et qui doit indiquer les actions à entreprendre. Bien entendu, la qualité de la prévision "dépendra des travaux ou de l’analyse structurale du système socioéconomique, du degré de précision et de profondeur de la détermination des liens de cause à effet, du dégagement des paramètres fondamentaux qui agissent sur le sens et la rapidité des transformations qualitatives de ce système". Dès lors, pour atteindre ces buts, il faut opérer : l’étude des structures socioéconomiques, des systèmes productifs, des formes et structures économiques qui coexistent, la détermination des principaux indices macroéconomiques et leur dynamique, l’analyse des facteurs externes du développement, c’est-à-dire du rôle et de la place des rapports réels et monétaires avec l’extérieur, l’étude des aspects territoriaux du développement, c’est-à-dire la répartition des forces productives, de l’infrastructure de base, l’urbanisation et ses tendances, les marchés effectifs et potentiels. De telles études permettront une parfaite connaissance des sociétés sahéliennes, des structures et systèmes de production, des habitudes et modes de consommation, elles permettront non seulement de savoir les décisions à prendre dans l’espace et dans le temps, mais aussi les obstacles à lever et les contraintes. C’est seulement maintenant, c’est-à-dire après les catastrophes que l’on s’aperçoit que le Sahel est sous étudié, sous analysé et que l’on ne sait que très peu de choses sur les écosystèmes, le milieu agro-climatique, le bilan hydrique. Cette méconnaissance ne permettrait pas une effective planification du développement rural, c’est-à-dire de l’activité qui concerne plus de 80% de la population et fournit plus de la moitié des ressources. Voilà une faiblesse caractéristique du processus planifié des économies sahéliennes qu’il faut redresser. Il importe après ces considérations, d’analyser la dernière limite liée au cadre administratif et institutionnel. Mouhamed DOWIDAR : Les schémas de reproduction et la méthodologie de la planification socialiste, Éd. Tiers-monde, Alger. 165 Stanislas KOUZMINE : La méthodologie de la prévision du développement du Tiers-Monde. Revue Sciences Sociales, n° 1, 1975, de l’Académie des Sciences de l’URSS. 164 274 III/ Les limites liées au cadre administratif de gestion du processus planifié On a souvent assimilé le système planifié à la création d’une lourde machine bureaucratique qui écrase toute initiative individuelle et à la multiplication des normes nécessitant des appareils coûteux de transmission et de contrôle. Un tel système d’administration, pensait-on, serait inefficient et risquerait d’absorber les surplus déjà maigres et d’immobiliser les rares compétences techniques. Un tel excès se manifeste dans le système centralisé. Pour le Sahel, c’est le phénomène contraire qui prédomine. Ils ont hérité de l’ancien régime colonial un appareil d’État peu maniable dont les vocations étaient principalement une gestion administrative et politique. Les nouveaux dirigeants ont pensé que la tâche essentielle était de réaménager l’appareil et d’installer les nouveaux cadres aux anciennes fonctions. On était donc convaincu qu’ainsi s’amorcerait un nouveau style de modernisation et d’africanisation de l’administration qui la rendrait apte à gérer la nouvelle situation politique et économique. Il a fallu, cependant très vite désenchanter car les processus de transformations et les nouvelles tâches économiques exorbitantes ne pouvaient nullement être assumées par le vieil appareil d’État colonial. Le problème des structures administratives adaptées était ouvert et l’est encore dans une très grande mesure. La planification devrait nécessiter des changements assez profonds dans le sens de la création : d’organismes administratifs spécialisés chargés de préparer le plan, de tracer les domaines et les directions des modifications des conditions de fonctionnement et de développement de l’économie ; d’organismes locaux, maillons décisifs du plan ayant vocation de promouvoir l’économie régionale ; de cadres institutionnels rendant possible une concertation de tous les services et techniques du développement ; d’organismes de participation et de mobilisation des populations car la planification doit susciter et discipliner les efforts productifs de toutes les couches de la nation. En clair, il s’imposait de créer un tout autre appareil administratif capable de garantir de meilleures conditions de fonctionnement et de gestion de la planification de l’économie nationale. Cette tâche n’a jamais été clairement perçue par les responsables des politiques économiques. Ils se sont réduits à créer des bureaux centraux de planification qui étaient des excroissances des ministères chargés de l’économie et des services de la statistique. Ces bureaux avaient des responsabilités extrêmement limitées dans la conduite de l’économie et se présentaient plutôt comme des cellules d’enregistrement des projets privés et publics. L’absence d’un appareil d’administration économique avec l’existence d’organes compétents pour exécuter des tâches et opérer une gestion des ressources est une limite essentielle des plans de la première génération. Des corrections s’amorcent mais peuvent-elles être efficaces tant que la forme indicative de la planification est maintenue ? En effet, cette forme ne s’accommode pas de l’existence de leviers économiques et administratifs fonctionnels et impératifs. En conclusion, cette analyse nous aura particulièrement révélé les faibles bases méthodologiques et techniques de la planification dans le Sahel qui font qu’elle s’est totalement avérée incapable d’indiquer et d’amener les transformations structurelles. 275 Comme elle a été incapable de prévoir les calamités, de gérer l’imprévisible ou d’en déduire les effets. Seulement, il ne pouvait en être autrement car depuis vingt (20) ans, la planification est au service de stratégies de développement fondamentalement erronées. Section 4 : L’indispensable réhabilitation de la planification et des études de prospective stratégique. « Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va » SENEQUE « L’Avenir appartient à ceux qui ont la mémoire la plus longue » NIETCHZE « Préparer l’avenir ce n’est pas y rêver. C’est choisir, dans le présent, ce qui est capable d’avenir ». G. BERGER I/ La planification, instrument de management des crises et des risques La mondialisation que vivent les économies en développement est marquée du sceau des incertitudes et de la montée des risques d’une rare gravité. L’économie mondiale est marquée de turbulences quotidiennes au triple niveau économique, financier et technologique. Les éléments de fragilité du système mondial sont à la fois multiples et complexes et ont le pouvoir de déstabiliser tous les pays et particulièrement les plus faibles d’entre eux. Ils conduisent inexorablement au crash, à la catastrophe économique et financière aux conséquences sociales incalculables. Observons qu’en 40 ans l’économie mondiale a connu 4 crises majeures : La crise des années 1970-1975 qui fait suite aux « Trente glorieuses années ». Elle est celle du premier choc pétrolier et désordre monétaire La crise des années 80 qui correspond au second choc pétrolier, au resserrement de la politique monétaire américaine (1979) et au déclenchement de la crise de la dette. La crise du début des Années 90 subséquente à la politique monétaire indûment expansionniste et aux excès d’investissements, avec la multiplication des créances douteuses La crise issue d’un dysfonctionnement du Système financier international Cette situation d’instabilité avait conduit Robert FOGEL (prix Nobel d’économie) à se demander s’il y avait un pilote dans l’avion mondial. Paradoxalement, les marchés financiers sont à la base de dysfonctionnements aux conséquences incalculables (crise financière mexicaine et asiatique). Elle appelle dans le fond trois interrogations majeures : Les Institutions Internationales de Régulation (FMI, BM, OMC, BRI, OCDE, Groupe des 7) peuvent-elles et ont-elles les moyens de gérer les risques et toutes incertitudes nées de la libéralisation internationale ? Peuvent-elles encore veiller sur la santé de l’économie mondiale ? Quel modèle de gouvernance de l’ordre économique et financier international faudra-t-il instaurer ? Comment prendre en charge les préoccupations de l’Afrique prise dans le tourbillon de la mondialisation, de l’instabilité monétaire, 276 des crises financières à répétition, des fluctuations incessantes des cours des matières ? Dès lors, la crise de la gouvernance mondiale (que devraient exercer les institutions internationales) n’assure point la protection des plus faibles par des mécanismes non marchands et n’apporte guère de correction aux déséquilibres qui naissent des rapports de force inégaux. Les PSD doivent gérer toutes ces incertitudes et risques. Cela requiert une planification plus rigoureuse appuyée sur des études de prospective pour prévenir les crises et tirer le plus grand profit des opportunités qu’offre le système mondial pour la solution de problèmes comme le transfert de ressources et de technologie, l’endettement etc. Dans ce cadre, la planification se présente comme un instrument essentiel de réduction des incertitudes et de maîtrise du Futur. Elle aide à explorer des avenirs économiques possibles, à construire un nombre limité d’images du futur et de cheminements possibles et à élaborer des scénarios contrastés qui reposent sur une hiérarchisation des variables significatives traitées comme pouvant être certaines, ou incertaines, probables ou aléatoires, possibles ou plausibles. L’ampleur du travail de planification impose une reconstruction technique des schémas adossés sur des études prospectives complètes et bien menées. II/ Impérative nécessité d’opérer des études prospectives au niveau national, régional et continental Les études prospectives sur le futur doivent retrouver un nouvel élan grandissant en Afrique. Dans le passé, plusieurs travaux de prospective ont été effectivement entrepris depuis la fin des années 70 : Études présentées au Colloque de Monrovia en 1979166, le Plan d’action de Lagos de 1980167, le Rapport Berg168 et l’étude ILTA169., l’Étude du Club de Rome170 . Aujourd’hui, plus que jamais, avec la montée des instabilités et des incertitudes, la multiplication des crises et des risques, (ainsi que leur relatif rapprochement), les changements multiples dans les règles du jeu économique et financier mondial, l’élargissement de la sphère de la spéculation dans les domaines réels et monétaires de l’économie mondiale et la progression fulgurante des Technologies de l’Information et de la Communication, tous ces facteurs rendent l’exercice de prospective indispensable.171 Le PNUD a parfaitement compris les enjeux de la Prospective avec le financement du Projet d’étude du Futur Africain172. Il s’agira principalement de penser différents cheminements évitant "la myopie du marché et la dictature de l’instant". OUA, 1979. Quelle Afrique pour l’an 2000 ? Rapport final sur les perspectives du Développement de l’Afrique à l’horizon 2000. Monrovia 12-16 février 1979 - Genève, Institut International d’études sociales 167 OUA, 1981. Lagos Plan of Action for the Economic Development of Africa 1980-2000. OUA 168 Banque mondiale, 1981. Le développement accéléré de l’Afrique au Sud du Sahara. World Bank, Washington D.C. 169 SCET International, SCET Agri, SEDES, 1984. Une image à long terme de l’Afrique au Sud du Sahara. Commission des Communautés européennes, Caisse des Dépôts et Consignation, Paris. 170 Club de Rome:l’Afrique face à ses priorités, Éditions Économica, 1987 171 Giri J. (1989), Le Sahel au XXIème siècle. Un essai de réflexion prospective sur les sociétés sahéliennes. Paris, Karthala. Godet, Michel, 1997. Manuel de prospective stratégique. 2 tomes. Dunod, Paris. 166 Il est très important, sous les angles théorique et pratique de définir les grandes tendances de l’évolution d’un système économique, quand on veut donner une valeur scientifique à la stratégie du développement économiques. 172 277 CHAPITRE 13 LE RETOUR DE L’ETAT ET DES QUESTIONS DE GOUVERNANCE POUR LA BONNE GESTION DU DEVELOPPEMENT « Aujourd’hui, ce sont les fanatiques du marché qui dominent le FMI. Ils sont persuadés que le marché, très généralement, ça marche et que l’État, très généralement, ça ne marche pas… Dans les cinquante dernières années, la science économique a expliqué quand et pourquoi les marchés fonctionnent bien, et quand ils ne le font pas. Elle a montré pour quelles raisons ils peuvent aboutir à sous-produire certains facteurs – comme la recherche fondamentale – et à en surproduire d’autres – comme la pollution. Leurs échecs les plus dramatiques sont les crises périodiques, les récessions et les dépressions qui ternissent le blason du capitalisme depuis deux cents ans : elles laissent un grand nombre de travailleurs sans emploi et une grosse partie du stock de capital sous-utilisé… L’État peut jouer un rôle essentiel - et il l’a fait-, non seulement pour tempérer ces échecs du marché, mais pour assurer la justice sociale… Dans les pays qui ont le mieux réussi – les ÉtatsUnis, l’Asie Orientale – l’Etat a pris en charge ces tâches et, dans l’ensemble, s’en est relativement bien acquitté. Il a assuré à tous une éducation de qualité, et a mis en place une grande partie des infrastructures Adam Smith était bien plus conscient des limites du marché – notamment des menaces de la concurrence imparfaite – que ceux qui s’en disent aujourd’hui les disciples. Il était aussi beaucoup plus conscient du contexte social et politique dans lequel toute économie doit opérer. Pour qu’une économie fonctionne, la cohésion sociale compte. » Joseph STIGLITZ173 Que recouvre exactement ce terme « institutions » ? De quelle manière peuton créer de bonnes institutions favorables à la croissance et au développement? Depuis les économistes classiques du 17ème siècle, les facteurs et les structures institutionnels sont considérés comme déterminants dans le processus de la croissance économique. Ainsi, A. SMITH, dès 1776, estimait que l’État était indispensable car il doit protéger la société de la violence et de l’invasion d’autres sociétés, protéger chaque membre de la société de l’injustice et de l’oppresseur et enfin entretenir certaines constructions et institutions publiques. Plus explicitement encore, Stuart MILL (1848) dans ses « Principes d’Economie Politique » observe que les moyens de réaliser l’accumulation du capital sont : un bon gouvernement, l’amélioration de l’information du public, le déclin des usages ou des superstitions qui empêchent l’efficacité de l’industrie, la croissance de l’activité mentale qui éveille les esprits à de nouveaux objets de désir et l’introduction des arts étrangers et l’importation du capital étranger. L’État est le lieu de fortes controverses autour de ses sens, de sa nature et de ses fonctions. La première controverse oppose la conception marxiste de l’État comme l’instrument de domination de classe et les autres conceptions, l’État mou, 173 J. STIGLITZ173 : La Grande Désillusion, 2002 278 l’État surchargé, l’Etat patrimonial et l’Etat prédateur. Il est intéressant de mettre en évidence, d’une part les théories de l’État développées par les grands courants de pensée qui ont traversé ou qui traversent encore les études économiques et d’autre part, l’intérêt des réflexions en termes de propriété. La théorie néoclassique analyse l’État comme la somme des individus agissant collectivement. (L’intérêt collectif étant considéré comme un intérêt individuel commun à plusieurs personnes). En principe, le marché détermine un équilibre unique et stable et dans ce cas, l’État n’intervient que pour réduire les obstacles techniques qui empêchent la réalisation de l’allocation optimale des ressources (monopoles, effets externes, biens collectifs purs). L’action de l’État dans la politique économique est donc subsidiaire en tout cas déterminée par les contraintes du marché et la prééminence des actions décentralisées. La théorie keynésienne accorde à l’État un rôle essentiel dans l’activité économique. La théorie marxiste souligne le comportement déséquilibré et conflictuel du fonctionnement du capitalisme qui conduit à l’accroissement des dépenses de l’État qui n’est en fait que l’émanation de la classe dirigeante. En ce qui concerne J.M.KEYNES, il théorise l’interventionnisme de l’État en dégageant une politique économique menée par l’État avec ses deux instruments traditionnels : la monnaie et le budget. Il propose tout à la fois une méthode : la macroanalyse, un but : le plein emploi et un moyen l’investissement. Cette conception procède d’une volonté « d’économie concertée et « d’économie contractuelle » car pour KEYNES. « l’État devra faire ce que les entreprises ne peuvent pas faire » en leur créant, par exemple, des externalités positives qui les rendent plus compétitives et en favorisant leurs fusions et concentrations. Schéma 2.L’État dans la pensée économique Etat neutre Au service de l’intérêt général Régulation Économique Keynes École de Cambridge : Robinson développement : Rostow, Chenery Économie néoclassique Économie du bien être : Pigou, Arrow, Debreu Économie publique : Musgrave, Samuelson Economie Libéralisme : Friedman, Hayek Supériorité de l’État Marx École française de la Régulation : Boyer Supériorité marché Nouvelle Économie Politique Recherche de rente : Krueger, Bhagwati Théorie de groupes : Olson Choix publics : Buchanan, Tullock Théorie de la bureaucratie État « politisé » Au service de groupes particuliers Source : SophieThoyer, Courier de la planète n°41, juillet-Aout1997. 279 Au plan strictement technique et schématiquement, toute croissance économique est le produit des politiques publiques qui doivent réaliser une combinaison optimale des déterminants que sont le travail, le capital, la technologie et les ressources naturelles. De l’École classique anglaise (A. Smith, Ricardo) jusqu’aux théoriciens contemporains de la croissance endogène (ROMER, LUCAS, BARRO) en passant par les keynésiens (KEYNES, HARROD-DOMAR, KALECKI, HICKS) et les néo-classiques (SOLOW, VON MISES ET HAYEK), les différentes formulations théoriques enseignent que croissance et développement dépendent fondamentalement de l’accumulation de capital physique, humain, technique et social. Si les déterminants quantitatifs sont bien connus puisque assez bien analysés, il n’en va pas de même pour la capital social compris comme un ensemble de valeurs, normes comportementales, d’obligations et de canaux d’informations visant à instaurer la confiance, à garantir l’application des contrats, à instituer des mécanismes d’assurance et à favoriser l’apprentissage social (PUTNAM, 1993) et les institutions. Si ces variables quantitatives et mêmes qualitatives sont bien connues, ce qui l’est moins, c’est la compréhension de leurs enchaînements, de leur mise en œuvre dans les politiques économiques appropriées. La combinaison de ces déterminants qui fixent le niveau de la croissance économique et social dépend de la qualité des institutions publiques qui devient en conséquence le facteur essentiel du développement. Suite au triomphe mondial du néo-libéralisme, le débat des années 1980 tournait autour du démantèlement de l’État et de ses institutions au profit d’une libéralisation de tous les secteurs par privatisation. Les nouvelles exigences du modèle mondialo-libéral se résument à imposer le marché comme instrument exclusif de régulation. Cette vision est fortement contestée par le Président brésilien Fernando H. CARDOSSO qui estime tout au contraire que la mondialisation impose de nouvelles tâches à l’État qui « au lieu de s’affaiblir devrait plutôt se renforcer pour être à même de promouvoir le développement. En réalité, le rôle de l’État est bien complexe. Outre les fonctions de sécurité, la santé, l’éducation, il doit accueillir dans un cadre démocratique les demandes croissantes pour plus d’équité, pour plus de justice, pour un environnement sain, pour le respect des droits de l’homme. Une citoyenneté plus exigeante doit correspondre aussi un raffinement plus grand des actions de l’État. Un État uni et organisé donc fort, aura de meilleures conditions de faire face aux besoins de la mondialisation » Dans le cas de l’Afrique, au moment des indépendances des années 60, la stratégie de développement appliquée par la plupart des pays visait notamment à transformer profondément le système productif et l’appareil administratif. Les politiques publiques avaient alors réalisé de lourds investissements dans l’équipement et l’infrastructure sociale mais également dans les secteurs d’activités économiques. Ces investissements se sont révélés, par la suite, massifs, peu réalistes, coûteux et d’une faible efficacité. Dans le même temps, la grave rupture survenue entre les structures de production – alimentaires en l’occurrence – et les structures de consommation, a fondamentalement contribué à opérer une double extraversion : celle de la production et celle de la consommation. Il en est résulté un approfondissement du déséquilibre entre la production intérieure et la demande globale au sein de laquelle prédominait une consommation finale excessive, entraînant un accroissement du déficit en ressources. Celui-ci sera artificiellement entretenu et financé par l’endettement extérieur et l’aide publique. Le boom pétrolier avait favorisé des emprunts publics à des taux relativement faibles. À la faveur de l'augmentation de la dette publique dans les années 70/80, les marchés financiers 280 sont arrivés aux commandes. Cela s'est traduit par une augmentation des taux d'intérêt dont le niveau avait dépassé non seulement l'inflation, mais la croissance. Les États qui avaient un fort niveau d'endettement sans être producteurs de pétrole ont alors eu de plus en plus de mal à clore leurs exercices budgétaires. Il a fallu emprunter pour rembourser les emprunts passés, à des taux qui promettaient d'engendrer de nouvelles difficultés. Faute de remèdes radicaux, cette situation vouait irrémédiablement les pays africains à la faillite. S’y ajoutait dans la plupart des cas, une énorme distorsion entre l’affectation théorique et l’utilisation effective de la dette extérieure, qui n’a pas favorisé la création de conditions adéquates d’extorsion de surplus nécessaires à l’amortissement régulier du service de la dette (principal et intérêts échus). Cette situation risquait de constituer assurément le fondement d’une crise de paiements dont la perpétuation, si rien n’était entrepris, pouvait déboucher sur une crise sérieuse de solvabilité. La cessation de paiements se traduirait alors par un retrait des financements extérieurs et un effondrement des importations qui aurait des incidences sur la production par le biais des nombreux secteurs qui recourent à des biens d'équipement importés. Ces difficultés ont été le propre de la majorité des États qui avaient financé leur croissance sur l'endettement. Elles ont naturellement été plus aiguës au Sud, mais les problèmes n'ont pas épargné le Nord, où l'Etat Providence a subi de nombreuses attaques, tandis que les politiques d'offre se sont partout substituées à la régulation par la demande. Cette montée des déséquilibres, de l’endettement et la stagnation de la production ont rendu inéluctable les politiques de stabilisation et l'ajustement structurel. Aussi a-t-elle fait durement ressentir ses conséquences, du fait de la compression drastique des dépenses en vue d’une réduction des créances futures. Le choix, à l'époque, n'était pas entre le refus d'une telle politique et son acceptation passive, mais entre la possibilité d'entrevoir, au prix de sacrifices, un avenir meilleur, et la certitude de s'enfoncer dans la voie du déclin. La conjugaison de toutes ces situations avait conduit progressivement tous les États africains à adopter des programmes de stabilisation et d’ajustement et les mécanismes de gestion qui les accompagnent, avec l’appui de la Banque mondiale et du FMI au détriment des stratégies planifiées de développement. À une politique volontariste orientée vers la modernisation des bases du développement a ainsi succédé un ensemble de programmes de gestion des déséquilibres macroéconomiques qui ont conduit à la remise en cause de la capacité de régulation macroéconomique, de l’efficacité des politiques redistributives et du niveau de dépenses publiques et parfois même de la capacité réglementaire des États. La régulation macroéconomique menée par les États passait jadis par la maîtrise de leur politique budgétaire et du taux d'intérêt ; or la globalisation financière semble exiger l’abandon de cette intervention. En ce qui concerne la redistribution, la remise en cause procède de la mondialisation de haute compétition qui impose aux entreprises une exigence de rentabilité au niveau de l'embauche, ce qui entraîne les exclusions permanentes du marché du travail. Enfin pour les dépenses publiques, elles doivent être maintenues tant qu’elles concernent les infrastructures publiques, les services publics et l'administration efficaces, le niveau d'éducation et de santé des ressources humaines qui sont des facteurs-clés de compétitivité. Cette vision qui a dominé pendant les années 80 et 90 a été ébranlé par l’échec des PAS appuyée par les IFI et l’avènement des nouvelles théories de la croissance endogène qui remettent fortement en question les politiques inspirées de l’analyse néo-classique dominante inscrite dans un monde virtuel où la concurrence est pure et 281 parfaite, l’environnement stable, le chômage uniquement volontaire et où l’individu responsable et organisé peut se mettre à l’abri de l’incertitude. Les nouvelles recherches ont alors rétabli le rôle de l’État et des institutions dans la croissance économique. Les institutions sont ces ensembles complexes de normes, de règles, et de comportements conçus pour une fin collective et qui permettent de réduire les coûts des transactions. Elles sont de trois ordres : la mise en place d’arrangements institutionnels compatibles avec les objectifs fixés ; les investissements importants dans le capital humain (éducation et santé) et un bon État géré par un bon gouvernement. Tableau 18: Fonctions de l’Etat Fonctions minimales Fonctions intermédia ires Pour remédier au disfonctionnement des marchés Fournir des biens publics purs : Défense Protection de la propreté Stabilité macroéconomique Santé publique Se soucier des externalités : Réglementer les monopoles : Éducation de base Protection de l’environnement Réglementation des services d’intérêt public Politique antitrust Combler les lacunes de l’information : Assurance (santé, vie, retraites) Règlementations financières Protection du consommateur Coordonner les activités du secteur privé : Fonction de type interventio nniste Promotion du marché Renforcement des filières Pour assurer l’équité sociale Protéger les pauvres : Programme de lutte contre la pauvreté Secours aux sinistrés Fournir une assurance sociale : Retraites par redistribution Allocation familiale Assurance chômage Assurer une redistribution : Redistribution des actifs Source : Banque mondiale, Rapport sur le développement dans un monde, 1997 : L’État dans un monde en mutation. Ces institutions sont accompagnées par des règles et comportements éthiques compatibles avec les objectifs de développement. Elles doivent être socialement acceptés et appliqués par les principaux acteurs de la vie économique et sociale. Les règles appliquées dans la pratique sont au nombre de quatre : s’appuyer sur ses propres forces, concentrer ses ressources là où on a un avantage concurrentiel, choisir le domaine le plus étroit possible et avoir la détermination. Quant aux acteurs, ils se subdivisent en trois catégories : les entrepreneurs qui sont des hommes de talents exceptionnels caractérisés par leur souplesse et leur agilité ; les élites intellectuelles et techniques issues des politiques de valorisation des ressources humaines permettant d’élever le niveau de qualification de la main-d’œuvre et l’État qui est le principal architecte du développement et des transformations 282 Du point de vue du rôle de l’État dans le développement, trois questions méritent examen (SADOULET, 1991, J.P. LAFFONT 1998). : Comment faire participer les acteurs au développement ? Beaucoup de travaux récents –en particulier à la suite de recherches d’histoire comparative menées par EVANS, RUESCHMEYER et SKOCPOL (1985) et WADE (1990)- ont porté sur les mesures que peut prendre un État pour favoriser le développement, notamment l’affectation de fonctionnaires et de responsables élus ayant pour objectifs la croissance et la satisfaction des besoins fondamentaux. Ce sont les États asiatiques qui ont surtout retenu l’attention. Comment préserver la primauté de l’État sur les groupes de pression ? S’il est vrai que l’action des groupes de pression a un coût en termes de gaspillage des ressources, elle est inévitable en ce sens que les incitations de ces groupes et de l’État sont compatibles entre elles (c’est-à-dire cohérentes avec un optimum individuel contraint). Comment assurer l’efficacité de la politique ? Pour un État, le pouvoir est la capacité de mener à bien ses décisions : il doit pour cela maintenir sa primauté face aux demandes des groupes de pression et mener une politique qui assoit sa crédibilité. La non-crédibilité peut avoir son origine dans une information imparfaite du secteur privé sur l’engagement réel de l’État, ou dans la facilité avec laquelle l’État change d’orientation, ce qui condamne la continuité dans le temps. La mondialisation dont aucun pays ne peut s'exclure sans se priver des bénéfices des progrès technologiques et des échanges, impose aux acteurs engagés dans le processus à produire de façon compétitive, à attirer les investissements directs et les capitaux. Cela appelle la présence d’un État qui devient l'élément crucial des réussites économiques. Section 1 : Les aspects institutionnels de la croissance et le retour de l’État dans le jeu économique. « Le développement est le fait de changement dans les institutions. Les décisions qui déterminent les grandes lignes directrices du développement concernent aussi les cadres qui régissent les activités de l’homme. Il faudrait insister sur la nécessité d’adapter ces cadres et de ne point se limiter à une copie servile des pays industrialisés. Se contenter de transplanter des appareils de production, sans tenir compte des comportements, des attitudes et des valeurs traditionnelles, c’est probablement susciter des entraves supplémentaires préjudiciables au développement »t. F. PERROUX Quand on tente de formuler une politique de développement on se heurte à une série de problèmes auxquels les autorités responsables n’ont pas toujours accordé l’attention nécessaire. Préoccupés par les aspects économiques du développement, les dirigeants orientent leurs efforts sur les options à prendre en matière d’industrialisation ou de modernisation de l’agriculture, de pratique d’une économie ouverte ou repliée sur elle-même. Ils se penchent aussi sur les questions monétaires et fiscales, sur les problèmes stratégiques de financement. Toutefois écrit E. GANANGE, les éléments d’une telle politique économique restent de faible 283 efficacité, s’ils ne s’accompagnent pas de transformations dans les structures de base. Le développement ne se limite pas à l’économie ; il plonge ses racines aussi dans les institutions.174 Les recherches contemporaines sont revenues sur les questions institutionnelles avec D. NORTH ET WILLIAMSONS si bien que nous avons maintenant une meilleure connaissance des structures institutionnelles et organisationnelles qui permettent d’obtenir le rythme et les caractéristiques voulues du changement économique. Ainsi, D. NORTH (1994, 1997) souligne que les institutions représentent « les règles du jeu dans la société ou les contraintes humainement disponibles pour former les interactions humaines. Il ne s’agit pas seulement des règles formelles (constitution, lois et règlements) mais aussi des contraintes informelles (normes de comportement, conventions, codes de conduite auto-imposés). C’est de l’ensemble de ces règles, normes et conditions de mise en pratique que dépend la performance économique ». À partir d’un objectif d’économie de coûts de transaction, les entreprises et les marchés mettent en place des institutions pour la gestion des contrats, de l’investissement et des affaires privées (O. WILLIAMSON, 1995). Plusieurs modes d’organisation sont possibles : organisation de marché, organisation mixte, organisation hiérarchique, action publique. Chacun de ces modes déterminent des incitations et des contrôles différents qui entraînent différents degrés de coopération ou de concurrence, différentes conditions crédibles d’investissement et de contrats. Ces institutions améliorent l’efficacité de l’allocation des ressources Les années 80 vont voir le triomphe théorique de l’analyse néo-classique et conséquemment l’acceptation du marché comme mode quasi exclusif de régulation de la vie économique. Au-delà de sa fonction allocative analysée par N. KALDOR, il est souligné que le marché s’adapte plus facilement aux changements qu’un système d’autorité et de plus il favorise les innovations, le progrès technique, la mobilité. Dans cette fonction créative, il contribue à la croissance en déplaçant vers le haut la courbe des possibilités de production. Enfin, l’économie de marché entraîne l’habitude de la décentralisation et de l’individualisme liés à terme à la montée des institutions pluralistes et démocratiques. Dans ce contexte, le marché se présente alors comme un instrument d’efficacité et d’allocation optimale. Cependant, il va révéler des imperfections, des défaillances et des insuffisances qui vont justifier le retour de lÉtat à une période ou les économistes institutionnalistes commencent à souligner que l’économie de marché a besoin d’institutions et d’un pouvoir pour les faire respecter. Les imperfections du marché communément soulignées sont de trois ordres: Les imperfections liées aux marchés financiers et d’assurance qui peuvent empêcher de réaliser certains projets socialement rentables mais trop risqués par rapport aux possibilités de couverture privée, Les imperfections tenant à la présence d’externalités positives, c’est-àdire de situation où l’action de l’entreprise a un impact positif sur le reste de l’économie, sans que l’entreprise soit capable de récupérer la totalité des bénéfices, Les imperfections issues de l’existence des rendements croissants et d’économies d’échelle. Dans ce cadre, les théoriciens de la croissance endogène et ceux des institutionnalistes vont alors réhabiliter l’intervention publique pour favoriser certaines formes d’accumulation du capital, des infrastructures, de la recherche et de la formation. La pratique des politiques économiques a fait le reste en conférant dans 174 E.GANNAGE : Institutions et développement, Revue du Tiers-Monde, 1966 284 des pays à fortes performances économiques (Asie) un rôle prépondérant à l’État. La question de l’État dans le développement de l’Asie est, selon E.BOUTEILLER et M. FOUQUIN, l’occasion d’une grande confusion. En bien comme en mal, l’Etat a joué et joue toujours un rôle essentiel dans le développement. Il demeure le grand ordonnateur sans lequel les différents éléments du puzzle ne se mettraient pas en place spontanément. Rien n’est plus étranger aux conceptions libérales que l’expérience japonaise ou celle de la Corée du Sud, de Taiwan ou même de Singapour avec son système d’épargne forcée et sa planification omniprésente. L’État en Asie est un Etat développeur … L’industrie lourde, l’industrie de haute technologie, les infrastructures ne sauraient apparaître spontanément. Dans ces domaines, l’État est moteur, les entreprises publiques omniprésentes…L’État décide, le marché sanctionne, l’un ne va pas sans l’autre. Toutefois pour l’Afrique, le problème réside plutôt dans la mauvaise qualité de l’État précarisé en amont par la mondialisation et informalisé à l’intérieur par le volume de ses déficits et un secteur informel qui lui échappe totalement, alors même qu’il est écrasé par l’ampleur des surcharges sociales. Dans ce contexte, sa réforme est indispensable. Il reste que l’État doit agir avec le marché et non contre lui. Par rapport aux autres agents selon le mot de J. M. KEYNES : « l’important pour l’État n’est pas de faire ce que les individus font déjà et de le faire un peu mieux ou un peu moins mal, mais de faire ce que personne d’autre ne fait pour le moment ». L’État en tant qu’institution doit être organisé officiellement pour protéger les contrats entre privés et instaurer ainsi une bonne efficacité contractuelle, condition sine qua non pour retrouver la confiance des investisseurs tant étrangers que nationaux. Il s’agit ici d’un ensemble de règles permettant d’instaurer un climat sain, susceptible d’attirer et de stimuler les investissements, qui à leur tour déterminent la croissance. Ces mesures sont maintenant connues sous le vocable de « bonne gouvernance » qui signifie selon la Banque Mondiale “l’usage de l’autorité politique, la pratique du contrôle sur une société et la gestion de ses ressources pour le développement économique et social”. L’État doit aussi s’atteler à faciliter et à contribuer à la mise en place d’un système financier nécessaire à la collecte et à l’affectation de l’épargne à des investissements privés. Le système financier, particulièrement le système bancaire, est très déterminant dans le financement des investissements et des entreprises privées qui sont au centre du processus de production ; par conséquent, ils constituent les moteurs de la croissance. Toutefois, il faut éviter que le système financier ne subisse les pesanteurs de l’État car cela aboutirait à des effets d’éviction sur l’investissement productif. La crise bancaire des années 80 en apporte la meilleure preuve. Enfin, la mondialisation selon Président Henrico CARDOSO impose de meilleures tâches à l’État. Outre les fonctions classiques, il doit accueillir dans un cadre démocratique des dépendances sociales pour plus d’équité. Au demeurant, l’intervention de l’État soulève toujours plusieurs interrogations. L’État devra alors être rénové, maîtriser ses coûts d’intervention et se montrer convaincant par la qualité de ses politiques. Section 2 : L’État dans le développement Selon le professeur J. LAFFONT, un bon État est un Gouvernement bienveillant et informé. Ce Gouvernement se compose alors des hommes politiques qui contrôlent l’appareil d’Etat, utilisent les fonctionnaires des administrations centrales et des collectivités locales, ainsi que les agents des entreprises publiques 285 pour mener à bien leurs politiques. Celles-ci devraient tourner, pour l’essentiel, autour de la mise en oeuvre des moyens pour réaliser les promesses d’amélioration du bien-être faites lors des campagnes électorales. . Quoi qu’il en soit, dans une démocratie, la bienveillance doit être avérée sinon, les hommes politiques risquent de perdre leur emploi. Il faut alors savoir quelles politiques mettre en place pour maximiser le bien-être social compte tenu des moyens disponibles et de la nécessaire préservation des équilibres fondamentaux de l’économie. Les questions sont bien connues en ce qui concerne l’économie : Comment réaliser les arbitrages entre le souhaitable et le possible ? Comment ordonner et planifier les priorités retenues? Comment allouer les ressources entre préférences individuelles et biens collectifs? Comment organiser le processus décisionnel pour arbitrer entre les erreurs du premier type (prendre une mauvaise décision) et les erreurs du second type (rejeter une bonne décision). Paradoxalement, les réformes institutionnelles sont beaucoup plus compliquées à définir et à résoudre que les problèmes économiques. Quel est le modèle institutionnel qui apporte aux populations une autre organisation sociale et un niveau de bien-être supérieur à l’ancien ? L'émergence des marchés libres, en l'absence de toute évolution institutionnelle, n'a pas résolu les problèmes économiques et sociaux auxquels les pays d'Afrique se trouvent confrontés. Paradoxalement, l'approfondissement de la crise économique et sociale ainsi que la mondialisation ont relancé le débat sur le rôle de l'État. En effet, le modèle libéral induit par l'ajustement structurel en Afrique, montre qu’ «Instituer la libre concurrence, la propriété privée et le contrat ne suffit ni pour imposer une modification spontanée des comportements, ni surtout, pour réussir une évolution naturelle vers un régime de croissance stable et de concurrence raisonnablement équitable. La transition n'est donc pas portée par une loi naturelle ou par un attracteur, mais demande au contraire l'intervention d'un agent ou d'un sujet historique, qui est assez aisément identifiable : ce n'est ni un horloger universel ni une force sociale mobilisée mais l'État pour autant que ses institutions soient restées ou redevenues suffisamment fortes ou légitimes». Les Institutions Financières Internationales semblent préconiser désormais un rôle plus accru à l'État, ce qui apparaît clairement dans les recommandations sur la bonne gouvernance. Quelles sont les raisons profondes qui ont motivé ces changements d'orientation et quelles sont les nouvelles fonctions attendues de l'État ? Il semble que les déficiences des marchés ainsi que les nouvelles théories de la croissance endogène ont réintroduit l'État au cœur des mécanismes économiques. I/ Les imperfections du marché et l'affaiblissement du fondamentalisme de marché Sur le plan théorique comme sur le plan empirique, les recherches révèlent de graves défaillances des marchés qui se traduisent selon Lall (1994) dans les faits qu'ils ne donnent pas les signaux corrects dans l'allocation des ressources entre activités simples et complexes et entre l'investissement physique, la technologie achetée et les efforts technologiques internes. Le marché, a priori reconnu efficace, est considéré aujourd'hui comme pouvant se révéler myope laissant apparaître des déficiences trop évidentes. Ces défaillances ont été analysées depuis longtemps PAR N. KALDOR qui soulignait son double échec dans sa fonction allocative et dans sa fonction créative. En effet, soulignait-il, en ce qui concerne la fonction allocative, «premièrement, les prix peuvent donner de mauvais 286 signaux car ils subissent des distorsions de la part de monopoles ou d'autres influences. Ensuite, le travail et d'autres facteurs de production peuvent répondre, de façon inadéquate ou même perverse aux incitations du marché. Enfin, bien que pouvant répondre de manière appropriée aux signaux de prix corrects, les facteurs de production peuvent être immobiles, incapables de se déplacer ou se déplacer trop lentement». Il importe alors, comme l'observe A. TOURRAINE, de cesser de voir dans le triomphe de l'économie de marché le fondement d'un nouveau type de société car "l'économie de marché n'entraîne pas elle-même la formation d'entrepreneurs et d'un large marché national ; de la même manière, politiquement, elle peut se combiner avec un régime autoritaire comme avec une démocratie limitée à des élections formellement pluralistes ou, au contraire, avec une démocratie modifiant en profondeur la répartition des droits, des revenus et du pouvoir". Toutes ces défaillances et imperfections conduisent à des interventions justifiées des pouvoirs publics qui vont devenir des agents capables de transformer à leur avantage les règles du jeu et les conditions de leurs interventions. À cela s'ajoute que les marchés, par essence, ignorent les besoins non solvables et négligent gravement toute vision à long terme. Ensuite des lacunes apparaissent souvent lorsque les conditions de la concurrence sont imparfaites (et donc accompagnées d'une asymétrie d'informations) et génèrent des externalités négatives. Dans le cas de l'Afrique, les dualités structurelles et divers facteurs, obstacles naturels ou sociologiques empêchent la formation et le fonctionnement de marchés libres. Ce sont ces défaillances qui réhabilitent aujourd'hui l'État comme un outil parfaitement indispensable. Toutes ces imperfections soulignées peuvent être groupées en cinq catégories : les imperfections des marchés internationaux en termes d'offre comme de demande qui conduisent les pouvoirs publics à contrôler par divers biais (barrières douanières, normalisation, etc.) la concurrence ; les imperfections des marchés financiers et d'assurances qui empêchent la réalisation de certains projets socialement rentables mais trop risqués ou trop peu rentables pour le secteur privé ; la restructuration industrielle qui fait appel au concept d’ "avantage construit" : l'absence d'une concurrence internationale, suite à l'existence d'oligopoles mondiaux créateurs de rente, amène l'État à subventionner ses entreprises pour les aider à entrer ou à rester dans l'oligopole mondial afin de pouvoir capter pour la collectivité nationale une partie des profits de la rente ; les externalités positives qui contribuent à l'amélioration de la productivité et de la compétitivité de l'entreprise sans que celle-ci ne puisse en supporter les coûts car n'étant pas assurée d'en récupérer la totalité des bénéfices avec le seul jeu du marché, de telles externalités se rencontrent dans l'éducation et la formation, dans la recherche pour le développement, dans la diffusion de l'information et dans la mise en place d'un environnement stable et incitatif ; l'existence de rendements croissants et d'économies d'échelle pouvant conduire à une situation de monopole qui prive l'économie des bienfaits d'une saine croissance. Les théories de la croissance endogène qui s'appuient sur ces externalités ont remis en piste l'intervention de l'État. Les recherches de P. ROMER ont particulièrement exploré les zones où peuvent exister ces externalités : dans le capital privé lui-même, par la technologie et l'information qu'il incorpore, dans le capital public de type infrastructurel qui vient compléter le capital privé, dans la recherche du développement où la production de chaque agent bénéficie de l'ensemble de la connaissance, dans la santé et dans le capital humain (théorie de G. BECKER). La 287 théorie de la croissance endogène réhabilite donc l'intervention publique pour favoriser certaines formes d'accumulation du capital en général, des infrastructures, de la recherche, de la formation. D'autres facteurs motivent encore davantage l'intervention de l'État, particulièrement quand il s'agit des économies en voie de développement. À ce niveau, trois situations supplémentaires peuvent être soulignées où l'État est le seul instrument de régulation : d'abord, la réalisation de la stabilité monétaire dans un cadre macroéconomique et macro-financier assaini ; la lutte contre toute les formes d'exclusion et la production de services sociaux et de biens collectifs que les utilisateurs ne peuvent pas payer, et l'insertion dans le système mondial de très haute compétition. Sur ce dernier point, le Président H. CARDOSO note que «la mondialisation impose de nouvelles tâches à l'État qui, au lieu de s'affaiblir, doit plutôt se renforcer pour être à même de promouvoir le développement. En réalité, le rôle de l'État est bien plus complexe. Outre les fonctions classiques comme la sécurité, la santé et l'éducation, il doit accueillir dans un cadre démocratique, les demandes sociales croissantes pour plus d'équité, plus de justice, pour un environnement sain, pour le respect des droits de l'homme. À une citoyenneté plus exigeante, doit correspondre aussi un raffinement plus grand des actions de l'État. Un État uni et organisé, donc fort, aura de meilleures conditions de faire face aux besoins de la mondialisation». A l'appui de cette idée on avance généralement deux arguments, d'une part, la constitution d'oligopoles mondiaux créateurs de rentes pour ses membres et d'autre part, le nouveau rôle de l'avantage comparatif qui est un élément d'un enjeu plus général : l'avantage compétitif. Les théoriciens de l'avantage construit (BRANDER et SPENCER, 1986) ont montré qu'en l'absence d'une concurrence parfaite sur le marché mondial, avec l'apparition d'oligopoles, l'État est parfaitement fondé "à subventionner ses entreprises pour les aider à entrer (ou à rester) dans l'oligopole mondial afin qu'elles puissent capter à leur profit (et à celui de la collectivité) une partie de la rente prélevée sur les consommateurs étrangers175, c'est-à-dire que, si l'avantage compétitif est construit, l'État sera désormais placé au cœur d'une vaste stratégie de promotion et d'insertion de ses entreprises et autres acteurs économiques dans le système mondialisé. Il lui revient la mission d'aider à la mise en place des conditions d'une compétitivité structurelle permettant, au-delà des prix, de positionner les entreprises nationales sur les marchés porteurs. Le temps de l'État est loin d'être fini. Non seulement le nombre des institutions étatiques augmente passant de 50 en 1945 à 225 en 1996 mais les de ses structures se renforcent. En somme, si les "économies nationales se sont transformées, elles n'ont pas disparu même si leur marge d'autonomie s'est réduite et si leurs instruments d'intervention ne sont plus nécessairement adaptées aux impératifs de la période. L'ensemble de ces raisons explique le retour de l'État comme gestionnaire de l'économie ou créateur de règles. La Banque Mondiale, à travers son approche de la gouvernance, adhère de plus en plus aux théories institutionnelles car elle considère que l'État peut fournir des biens et services qui remplissent des fonctions économiques centrales. De même, la gouvernance désigne les aspects institutionnels et politiques qui permettent à un gouvernement de créer un cadre d'ordre et de stabilité, de formuler et d'exécuter une stratégie. Sous ce rapport, l'État et ses structures organisationnelles, ainsi que les modes de gestion des ressources publiques sont concernés au premier chef. 288 Appliquée à l'ajustement, la bonne gouvernance retrouve toute son importance en sens que dans la nouvelle mouvance, l'efficacité économique et sociale ne peut être atteinte que si on réforme tous les lieux de concentration des pouvoirs : pouvoirs économiques, pouvoirs politiques, pouvoirs judiciaires, etc. Dès lors qu'il est admis une nécessaire redéfinition des rôles et des missions publiques, il faut s'interroger sur l'ampleur des réformes de l'État qu'il importe d'introduire. II/ La réhabilitation et la redéfinition du rôle de l'État «Il est impossible de mener une action durable de modernisation de l'appareil de production, de procéder à de larges réformes sociales, de modifier la culture des entreprises et d'accomplir un véritable effort pour accroître la compétitivité du pays à l'échelle internationale, sans l'aide et le soutien de l'État - mais d'un État complètement rénové» 1°) Les réformes indispensables de l’État Il est connu aujourd'hui que la réforme de l'État ne saurait se limiter au paradigme simple du mieux d'État qui prendrait sa signification dans la déflation des effectifs de la fonction publique, à la privatisation des entreprises publiques déficitaires ou mal gérées. Bien que de telles mesures soient importantes, la réforme devrait aller bien au-delà de ces quelques actions ponctuelles et s'insérer dans une vision globale d'édification d'une organisation sociale de type nouveau. En partant de l'idée que le développement économique requiert plusieurs conditions préalables : l'existence d'un projet national cohérent qui puisse mobiliser les acteurs autour de politiques économiques et financières pertinentes et gérer l'insertion au système mondial en exploitant toutes les opportunités que celui-ci offre en termes de capitaux, de technologie et de marché ; la mise en place d'un système politique décentralisé et la création d'un appareil judiciaire fonctionnel et efficace ; l'existence d'une politique sociale qui garantisse l'égalité des chances, la justice sociale et la solidarité vis-à-vis des plus faibles. L'État s'avère comme un instrument indispensable de mise en cohérence de ces préalables. Cependant, au-delà de cette nécessité bien évidente, des questions se posent et que P. JACQUEMOT énumère comme suit : Quelle est la taille optimale de l’État ? Quelles taches doivent lui être confiées et lesquelles est-il préférable de les laisser au secteur privé ? Doit-il produire lui-même les prestations qu'il fournit ou peut-il en confier la production à des entreprises privées ? Dans quelles conditions faut-il étatiser des entreprises privées ou au contraire privatiser des entreprises publiques ? Faut-il accroître ou réduire la réglementation régissant la plupart des activités privées ? Faut-il vendre les prestations publiques ? Par quels moyens doit-il être mis au service des équilibres macroéconomiques ? Quelles sont les limites de l'endettement public ? 289 À cette série de questions, on peut ajouter celles-ci : s'il faut réformer l'État, pourquoi le faire ? Avec qui ? Pour qui ? Et Comment ? Encore une fois comme le souligne JUDET (1994) la recherche de « l'État minimum » préconisé par la Banque Mondiale est moins à l'ordre du jour que celle de « l'État optimum », allégé sans doute, mais toujours efficace. La crise des économies africaines des années 80 ainsi que les expériences d'ajustement structurel montrent que les stratégies de développement durable et de croissance dépendent à la fois de la transformation des appareils de production par des politiques sectorielles pertinentes et par l'utilisation des acquis de la révolution technologique, de la libéralisation des échanges par des avantages construits à partir des dotations factorielles et du renforcement de la compétitivité, de l'organisation d'une nouvelle approche de la productivité des secteurs public et privé, de la création d'un environnement institutionnel incitatif, de l'élaboration et de la gestion d'une politique sociale. Ces problèmes économiques et sociaux d'une telle ampleur et d'une telle complexité ne peuvent être résolus par la simple émergence des marchés libres. L’État africain doit impérativement s'engager, mais sur de nouvelles bases et après avoir réglé sa double crise financière et fonctionnelle qui l'empêche de disposer de capacités d'analyse et des systèmes d'information permettant l'élaboration de stratégies de modernisation à long terme. En conséquence, l'État devrait se réformer et réadapter ses orientations et structures aux nouveaux processus de développement. Le consensus dégagé par la Banque Mondiale visant à imposer des limites à l'intervention de l'État, à alléger les administrations pléthoriques, à atténuer l'ouverture économique et à accorder une priorité accrue aux ressources humaines est notoirement insuffisant. 2°) L’État «PRO » en Asie exemple désigné par la Banque mondiale La Banque Mondiale offre quelques signes bien évidents de changement de vision allant dans le sens d'une réhabilitation de l'État. Dans son Rapport "The Asian Miracle" (1993), elle montre que le succès des économies asiatiques de haut rendement sont dus avant tout à la fixation correcte des fondamentaux macroéconomiques (épargne et investissements élevés, exportations croissantes, stabilité macroéconomique, régime concurrentiel, fortes dépenses d'éducation) et à une intervention de l'État en harmonie avec le marché (market friendly). Toutefois, il faut aller bien au-delà de ce qu'il est convenu d'appeler le gouvernement du marché par l'État rendu nécessaire pour garantir les conditions de fonctionnement du marché en imposant des normes, des règles. C'est vers un État mobilisateur qu'il faut s'orienter : un État qui soit capable d'assumer des missions de transformation de l'économie, de régulation, de mobilisation des acteurs et de gestion de la cohésion sociale. Ce type d'État devrait réussir l'intégration de la vie politique, de la vie économique et celle des acteurs sociaux. Au regard des expériences asiatiques, cette conception n'est pas loin de celle de l'État « PRO » (promoteur, producteur, prospecteur, programmateur) qui a joué un rôle central dans le développement économique et social. La question fondamentale est alors de savoir quelles sont les réformes à introduire pour opérer une transition d'un État faiblement interventionniste ou en voie de désengagement à un État ayant pour missions essentielles de créer les conditions favorables au développement et à la croissance et qui soit capable de corriger positivement toutes les imperfections des marchés. Dans cette période d'ajustement structurel, ces réformes doivent conduire à doter l'État d'une capacité endogène de 290 formulation et de gestion des politiques macroéconomiques d'une part, et de régulation sociale d'autre part. Toute politique économique dépourvue de contenu social va manquer de légitimité, de durabilité et d'efficacité. Partant de l'expérience de l'Afrique V. K. JAYCOX (1992) note qu'elle n'a pas bénéficié du même traitement que les autres régions. En Afrique, on s'est borné à "gérer la crise" et à quelques exceptions près, les bailleurs de fonds n'ont fait que "répondre à la crise" par des projets d'assistance technique ponctuels et à court terme. Peut-on vraiment se féliciter que l'assistance technique à l'Afrique ait augmenté de 50% depuis le milieu des années 80 et qu'elle atteigne aujourd'hui 4 milliards de dollars par an ? Peut-on accepter la présence de 100.000 conseillers techniques expatriés dans la région, c'est-à-dire plus qu'à l'indépendance" En effet, la capacité d'analyse de la politique économique et la gestion du développement sont les lacunes les plus criantes de l'État. Or, ces capacités sont essentielles au processus d'ajustement. Elles sont au coeur de la dynamique du développement puisqu'elles identifient les changements, les analysent, y réagissent et les gèrent. Dotés de telles capacités, les pays assumeraient mieux leurs politiques de développement et seraient beaucoup plus motivés pour les faire aboutir. À partir de ces missions diverses et des fonctions managériales de l'État, les réformes à entreprendre peuvent se résumer pour l'essentiel à : la mise en place d'un véritable programme de réforme de l'État pour en faire un instrument efficace capable de gérer un système économique performant et un régime démocratique de liberté ; l'instauration d'une administration de développement à même de créer un environnement favorable au développement et à la croissance ; l'élaboration d'une politique sociale suffisamment expressive de l'idée que toute réforme économique et démocratique qui n'induit pas de changement social ne sera pas viable ; en d'autres termes, l'État doit inclure la gestion du social dans sa stratégie de réforme et mettre en place des mécanismes de solidarité ; la décentralisation ou le transfert du pouvoir réel à la base qui permet la mobilisation de cette myriade d'acteurs et d'organisations de la société civile pour un développement participatif. La décentralisation va alors devenir l'école du citoyen réellement actif. IV/ De quelques formes d’État acteur principale de la politique économique. Jadis, l’État avait fortement enflé à la fois au niveau économique (constitution d’un secteur public hypertrophié) et au niveau social (en tentant de protéger tous les citoyens contre tous les dangers). Ce dernier aspect a entraîné une surcharge des finances publiques de manière parfaitement inefficaces : on ponctionne les citoyens par de multiples prélèvements obligatoires sans pouvoir améliorer ni la pauvreté, ni le chômage, ni les infrastructures sociales. Il s’agit de choix national qui a conduit à deux types d’État : l’État justicier et protecteur et l’État partenaire, chaque type idéal pouvant comporter différentes variantes 1°) L’État justicier et protecteur L’interventionnisme social a pour soubassement théorique le réformisme qui a pris aujourd’hui plusieurs significations selon les écoles philosophiques, politiques 291 et religieuses qui l’inspirent. C’est la justice sociale surtout l’équité au niveau de la redistribution des richesses qui est le justificatif qui est le ciment de toutes les Écoles de pensée. La première forme de l’interventionnisme a concerné la protection des travailleurs contre les graves abus de la révolution industrielle du capitalisme naissant en matière de droits des travailleurs, de volume de travail, de niveau de salaire et de la protection du travail. Cette protection passait d’une part par l’élaboration d’un droit du travail protecteur du travailleur et de son outil de travail et d’autre part par le recours à des allocations correctrices de toutes les distorsions qui naissent de l’organisation économique et sociale. Aujourd’hui, une bonne partie des risques sociaux sont couverts par la Sécurité sociale qui partant brasse des Fonds substantiels qui en font un acteur financier de premier ordre dans le système financier international. La seconde forme concerne la fiscalité qui est devenue au fil du temps l’instrument privilégié de l’État : la justice par l’impôt. Il s’agit de réduire les inégalités sociales par une taxation spéciale des grandes fortunes. La socialdémocratie suédoise est basée sur cette philosophie. Il faut écrivait Olaf PALM « un Etat plus doux pour les pauvres et plus exigeant pour les riches ». D’autres États ont élaboré des politiques de redistribution du revenu car selon le mot de Jacques DELORS « Le gâteau social ne sort pas bien découpé du four de la production. Or, mieux découpé plus il sera grand ». La troisième forme est celle de l’État protecteur de l’économie nationale au niveau interne par les nationalisations des secteurs clefs et à même exercé un monopole sur certains d’entre eux comme l’eau, l’électricité et le transport et à l’échelle externe par l’application de politiques protectionnistes vis-à-vis de l’extérieur : protection des industries naissantes et des avantages relatifs. Dans la mondialisation, le protectionnisme est loin d’être éteint, il a changé de forme et se déroule entre les blocs de haute compétition qui configure la mondialisation multipolaire : ALENA, UE, ASEAN, MERCOSSUR. J. M. KEYNES théorise l’interventionnisme de l’État en dégageant une politique économique menée par l’État avec ses deux instruments traditionnels : la monnaie et le budget. L’auteur offre tout à la fois une méthode : la macroanalyse, un but : le plein emploi et un moyen l’investissement à un niveau de vie. L’interventionnisme va alors devenir monétaire et financier et s’exprime par les actions exercées par les organismes publics sur le marché financier ou le crédit à moyen terme. Les émissions d’emprunts publics ou semi publics permettent de mobiliser une bonne partie de l’épargne en vue de financer l’investissement. Progressivement l’Etat a cherché de protéger tout le monde contre tous les risques qui pourtant ne cessent de s’élargir. Ce sera le début de sa dégénérescence : les citoyens de plus en plus nombreux demandent de plus en plus de prestations sociales et veulent payer de moins en moins d’impôts. Ces deux aspirations sont contradictoires. 2°) L’État partenaire : vers un partage de rôle entre l’État et le Privé Cette nouvelle forme d’intervention s’est manifestée d’abord par une volonté « d’économie concertée et « d’économie contractuelle ». La planification française en a été l’occasion. Il s’agit profondément d’une sorte de partage de rôle entre Secteur public et Secteur privé. Keynes dira que « l’État devra faire ce que les entreprises ne peuvent pas faire ». Le secteur public de la recherche-du développement et de la 292 Défense nationale crée des externalités positives. En plus pour rendre les entreprises plus compétitives, l’État favorise les fusions et les concentrations de celles-ci L’interventionnisme va profondément changer de nature et de fonction. L’État n’impose plus mais propose et régule pour le bon fonctionnement de l’économie. Au niveau des structures formelles les choses ne vont pas mieux suite à la crise profonde du système public de sécurité sociale, symbole de «l’État-providence» qui accuse une triple crise d’efficacité (effets pervers de prélèvements excessifs) ; une crise de légitimité avec côté recettes une redistribution à rebours et côté dépenses la solidarité déviée avec des difficultés d’évaluation et une crise d’adaptation. Pris en tenaille entre l’accroissement soutenu des dépenses et le tarissement des sources de financement du fait de l’assainissement économique et financier, le fonctionnement du système de redistribution et de protection sociale est de plus en plus bloqué. Section 3 : La décentralisation ou la connexion avec le local I/ La décentralisation La décentralisation apparaît comme une réponse à la crise de gouvernabilité observée au niveau de l’État central. La décentralisation est en effet considérée comme une des modalités les plus sûres de modernisation des États, et une des voies possibles pour accélérer le développement, notamment en Afrique. La décentralisation correspond à la reconnaissance aux collectivités territoriales locales d'un certain niveau de responsabilité sur la gestion de leurs affaires. Cette responsabilité peut prendre la forme d'un transfert de certaines compétences exercées auparavant par l'État central, ou se traduire par la reconnaissance à la collectivité territoriale d'une compétence générale, à l'exclusion d'un nombre limité de domaines gérés exclusivement par l’État central (affaires étrangères, sécurité publique, gestion macro-économique ...). Cette vision de la décentralisation est en fait avant tout un système de partage de pouvoirs entre l'Etat et ses démembrements. Elle est donc essentiellement reliée à la sphère institutionnelle publique. Mais il existe une autre conception de la décentralisation. Dans la littérature anglo-saxonne, la décentralisation est décrite comme un processus graduel de transfert de pouvoirs aux populations, qui va de la déconcentration à la privatisation, en passant par la délégation et la dévolution des pouvoirs. Vue de cette manière la décentralisation n'est donc plus réservée à la sphère publique, elle concerne de fait tous les acteurs, y compris les organisations et associations de base, les ONG, les intervenants du secteur privé... Dans un cas comme dans l’autre, la décentralisation inscrit le niveau local au cœur de toute stratégie de développement durable. C’est en effet à ce niveau que le développement est expérimenté au quotidien, d’où l’engouement actuel pour les questions de développement économique local. Pratiquement tous les pays de la région ont adopté et mettent en œuvre des politiques de décentralisation par lesquelles les collectivités locales deviennent des acteurs importants du développement. Tous attendent des collectivités locales un second souffle dans la mobilisation des populations pour la bataille du développement, en même temps qu’une meilleure redistribution des fruits de la croissance. C’est la raison pour laquelle la plupart des lois de décentralisation demandent aux collectivités de définir un plan de développement local qui fixe le cadre et la stratégie de l’organisation territoriale du développement local. Le besoin d’une mobilisation politique des acteurs à tous les niveaux autour de la problématique territoriale de la Nation implique un effort important de production 293 d’une information de base localisant les principaux enjeux du développement et les espaces de projets, dans l’objectif d’identifier les collectifs d’acteurs capables de porter les différents projets. Ces espaces-projets sont différents des espaces administratifs et doivent inclure des dimensions supra et intra territoriales. On remet de la sorte les thèmes de l’aménagement du territoire au cœur du débat démocratique. II/ L'aménagement du territoire, un impératif du développement africain Un territoire, au sens économique, est le siège géographique des activités humaines. La population qui occupe cet espace procède spontanément à son organisation, en fonction de données naturelles, culturelles, militaires et économiques. Aujourd'hui, l'état de développement, les progrès technologiques de même que la nécessité de la décentralisation ont rendu nécessaires un aménagement programmé et créatif du territoire, pour au moins trois sortes de raisons: des raisons économiques, des raisons sociales et des raisons politiques. D'abord le modèle d'aménagement obéit à une nécessité économique dans des pays en voie de développement comme les nôtres. Les activités économiques et financières tendent spontanément à la concentration géographique. C'est cela qui explique la bipolarité Dakar – reste du Sénégal. Il en est de même pour les autres capitales. Les producteurs comme les commerçants ont intérêt à se rapprocher de l'espace polarisant. L'industrie appelant l'industrie de même que les services et l'administration, tout finit par se concentrer spontanément dans les grandes villes; ce qui soulève beaucoup de problèmes. Ensuite, le schéma d'aménagement du territoire est une nécessité sociale. En effet, la concentration des activités crée une inégalité géographique devant l'accès à l'emploi. Elle entraîne des migrations qui vident certaines régions et conduisent au surpeuplement d'autres régions. Pour trouver un emploi ou pour en changer, les travailleurs doivent de plus en plus quitter leur lieu de naissance, cela devient une mobilité forcée avec tout ce que cela comporte comme conséquences sociales. Enfin, l'aménagement du territoire procède d'une nécessité politique. Sur ce plan, il faut redéfinir le rôle que l'État doit jouer dans le fonctionnement de l’économie. En effet, l'État moderne est à la fois l'élément stabilisateur, l'instrument de création des externalités positives et le garant de la cohésion sociale et de l'unité nationale. C'est pour ces raisons que l’État doit intervenir dans la localisation des activités en cherchant à les orienter par des incitations et par le financement d'infrastructures de base ou bien en cherchant à les planifier par des moyens « autoritaires » Dans ce cadre, pour éviter les disparités régionales trop fortes et le développement des inégalités, il ne suffit pas de protéger des régions pauvres en leur distribuant par des moyens artificiels des ressources financières ou autres. Il faut plutôt concevoir autrement l'aménagement du territoire pour non seulement changer d'échelle mais également mettre en réseau acteurs et territoire. Une politique de redistribution des revenus en faveur des populations rurales opérée par les autorités ne semble pas indiquée pour une économie aux ressources limitées, du moins elle n’est pas une solution de long terme. Il revient à l’État de définir une stratégie novatrice pour amener les ruraux à participer à la croissance de manière en en recueillir les fruits. J.LAFFONT ne dit-il pas « qu’un bon État est un Gouvernement bienveillant et informé, se composant d’hommes politiques qui contrôlent l’appareil d’État, utilisent les fonctionnaires des 294 administrations centrales et des collectivités locales ainsi que les agents des entreprises publiques pour mener à bien leurs politiques ». Celles-ci devraient tourner, pour l’essentiel autour de la mise en œuvre des moyens pour réaliser les promesses d’amélioration du bien-être faites lors des campagnes électorales. Section 3 : L instauration de la bonne Gouvernance politique, économique et sociale Dans la vision keynésienne, l’État est un agent économique très spécifique, dont l’intervention est légitimée par l’exercice de trois fonctions majeures (selon la typologie de MUSGRAVE) : la production (ou allocation) de biens et services, la redistribution des revenus, la stabilisation ou régulation de l’activité économique. Il doit définir et mettre en œuvre les programmes d’action que sont les politiques publiques indispensables pour assurer les ajustements de structures et les cohérences entre secteurs d’activité. De plus, il doit développer, outre l’infrastructure publique, les règles qui assurent la libre concurrence, la démocratie et une répartition plus égalitaire des actifs dans le secteur privé, témoignant ainsi la confiance reconnue au jeu du marché et à ses fonctions régulatrices. En tant qu’institution, il doit protéger les contrats entre privés et instaurer ainsi une bonne efficacité contractuelle, condition sine qua non pour retrouver la confiance des investisseurs tant étrangers que nationaux. Il établit un ensemble de règles permettant d’instaurer un climat sain, susceptible d’attirer et de stimuler les investissements qui, à leur tour, déterminent la croissance. Ces mesures sont maintenant connues sous le vocable de « bonne gouvernance ». Celle-ci doit particulièrement veiller à légitimer l’action de l’État par une stricte observance des règles d’équité et l’instauration d’institutions judiciaires indépendantes intervenant après échec des médiations préalables et des organes de prévention des conflits. Le volet économique consiste à construire des systèmes, des procédures et des organisations socialement acceptables et capables de réguler dans la transparence et l’équité, la production et la redistribution des richesses économiques, ainsi que les ressources nécessaires au développement de l’ensemble de la société à long terme. Dès lors, la gouvernance économique se décline en quatre grands domaines, reliés entre eux mais distincts dans leurs champs respectifs, leurs méthodes et leurs principes généraux de fonctionnement : Le premier domaine est relatif à la gestion macroéconomique, la bonne gouvernance est souvent mesurée à l’une des simples indicateurs de performance économique, à savoir : la gestion des déficits publics internes et externes, la politique de maîtrise de l’inflation, la politique monétaire et politique de change, les politiques sectorielles incitatives aux activités productives, Le second domaine concerne la création et le développement d’un environnement favorable aux producteurs. Dans ce sens, les aspects les plus couramment évoqués par les opérateurs concernent : le système financier et de crédit, le régime fiscal applicable aux entreprises, la législation du travail, 295 Le troisième domaine intéresse la régulation économique pour laquelle trois éléments semblent devoir être privilégiés pour améliorer la gouvernance économique globale : le système financier, la concurrence, les moyens comptables et d’audit. Le quatrième domaine se rapporte à l’édification et au développement d’une société civile forte, dynamique et capable de demander des comptes aux gouvernements. Elle doit être encouragée par la mise en place d’un cadre institutionnel ouvert sur le pluralisme, la promotion de la dimension genre, l’indépendance de la magistrature et d’autres entités telles que les commissions électorales, les organes chargés des droits de l’homme et les dispositifs anticorruption. Au demeurant, l’intervention de l’État soulève toujours la question de son efficacité ce qui fait penser aux coûts directs de fonctionnement de l’administration, aux coûts imposés au secteur privé, aux distorsions causées dans l’économie. À ce niveau, on peut transposer la formule de la subsidiarité dans la définition des missions de l’État africain : lorsque les ménages et les entreprises ont plus de capacité à exercer une activité, l’État doit s’abstenir d’intervenir. Cette position était déjà défendue par J. M. KEYNES lorsqu’il observait que « l’important pour l’État n’est pas de faire ce que les individus font déjà et de le faire un peu mieux ou un peu moins mal, mais de faire ce que personne d’autre ne fait pour le moment ». À cela, M. Chatelus ajoute que pour être efficace, l’État doit, intégrer les enseignements de la théorie des organisations, les concepts de système et de stratégie. Il lui faut moderniser sa gestion (approche management public), en partant d’une définition claire des objectifs et non des moyens. Cela suppose la réhabilitation des travaux de planification et de prospective. I/ La notion de bonne gouvernance Cela fait une bonne dizaine d’années que le concept de « Bonne gouvernance » a fait irruption dans le domaine du développement. La notion est apparue en 1989, dans une étude de la Banque mondiale. Elle n’a cessé, depuis, d’être évoquée dans les publications des chercheurs, les injonctions des bailleurs de fonds ou les discours des gouvernements. Comment expliquer pareil succès aussi rapide ? Pour qu’un concept soit aussi rapidement popularisé par des milieux aussi divers, il faut qu’il réponde précisément à des préoccupations centrales du système dont il est issu. On serait donc tenté de croire que l’apparition de la gouvernance correspond à un changement de paradigme dans la problématique du développement. Il s’agissait à l’époque, pour les promoteurs des programmes d’ajustement structurel (PAS), de corriger l’approche « économiciste » de ces programmes et de mettre davantage l’accent sur l’importance de leur environnement normatif et institutionnel. Dans les années 90, la dislocation de certains États – tant en Afrique qu’en Europe de l’Est – ainsi que les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des PAS, ont conduit la Banque mondiale è redécouvrir la dimension institutionnelle du marché, déjà très présente chez Adam SMITH On s’est alors enthousiasmé pour les questions touchant au bon fonctionnement des institutions. L’enjeu consistait à trouver les moyens de faire fonctionner efficacement les mécanismes de marché, donc d’éliminer les dernières rigidités qui auraient pu gêner l’ajustement de l’offre et de la demande par les prix. C’est dans un tel contexte, caractérisé par le regain de 296 vigueur de la théorie institutionnelle du marché et la défiance persistante vis-à-vis d’une gestion gouvernementale jugée responsable de la crise, que la Banque mondiale a recouru pour la première fois au concept de bonne gouvernance. Les distorsions qui caractérisent le fonctionnement des marchés ne pouvaient avoir qu’une origine, à savoir : les décisions arbitraires et imprévisibles des États. Responsabilité, transparence, décentralisation et participation, autant de concepts dont l’application n’a concerné qu’un seul acteur : l’État. Le concept a été par la suite affiné par de nombreuses institutions internationales et partenaires au développement (PNUD, Banque Mondiale, OCDE,) comme cela apparaît dans l’encadré qui suit : Encadré 19 : Différentes définitions du concept de gouvernance Agence Canadienne de Développement International (ACDI) : l’ACDI utilise les termes «bon gouvernement» ou «saine gestion des affaires publiques» pour désigner la façon dont un gouvernement gère les ressources sociales et économiques d’un pays. Le bon gouvernement (ou la saine gestion des affaires publiques) désigne un exercice du pouvoir, à divers échelons du gouvernement, qui soit efficace, intègre, équitable, transparent et comptable de l’action menée. Banque Asiatique de Développement : Pour la Banque Asiatique de Développement, la gouvernance se réfère à l’environnement institutionnel dans lequel les citoyens interagissent entre eux et avec les agences gouvernementales. Même si les aspects reliés aux politiques sont importants pour le développement, le concept de bonne gouvernance tel que définie par la Banque aborde essentiellement les ingrédients reliés à une gestion efficace. La Banque perçoit la gouvernance comme un synonyme de gestion du développement efficace. Banque Inter-américaine de Développement : La Banque Inter-américaine de développement est concernée par les aspects économiques de la gouvernance et la capacité de mise en œuvre de l’appareil gouvernemental. Ceci implique la modernisation du gouvernement et le renforcement de la société civile, la transparence, l’équité sociale, la participation et l’égalité des sexes. Banque Mondiale : La Banque Mondiale définit la gouvernance comme la manière dont le pouvoir est exercé dans la gestion des ressources économiques et sociales d’un pays, et dans un but de développement. Cette définition fait ressortir les trois axes de la gouvernance à savoir : la forme du régime politique, la manière dont l’autorité est exercée dans la gestion d’un pays, et la capacité du gouvernement à déterminer et appliquer les politiques. Comité d’aide au développement de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE – CAD). Le CAD utilise une définition de la gouvernance qui rejoint celle de la Banque mondiale, et qui désigne «l’exercice du pouvoir politique, ainsi que d’un contrôle dans le cadre de l’administration des ressources de la société aux fins du développement économique et social». Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD). Pour le PNUD, il faut entendre par gouvernance, l’exercice d’une autorité politique (la formulation de politiques), économique (la prise de décisions à caractère économique) et administrative (la mise en œuvre de politiques) aux fins de gérer les affaires d’un pays. Suivant cette définition, la gouvernance repose sur des mécanismes, des processus et des institutions qui permettent aux citoyens et aux groupes d’exprimer des intérêts de régler des litiges et d’avoir des droits et obligations. Le PNUD a de plus cerné les trois paliers de gouvernance, à savoir l’Etat qui créée un environnement politique et légal propice ; le secteur privé qui crée emplois et revenus, et la société civile qui facilite l’interaction politique et sociale. 297 Il apparaît alors que la gouvernance renvoie pour certains à une amélioration de la gestion du secteur public ; une responsabilité économique ; la prédictibilité et l’autorité de la loi et la transparence dans la gestion des affaires publiques. Pour d’autres, elle signifie «bon gouvernement» caractérisé par les vertus de responsabilité, de légitimité et de compétence (Banque Mondiale, 1989 ; ODA, 1993). Également, la gouvernance rattachée de façon explicite à la démocratie (USAID, 1991). Cependant, une autre tentative visant à synthétiser la définition renvoie à la gouvernance en tant qu’exercice de l’autorité politique, économique et administrative dans la gestion des affaires nationales à tous les niveaux (PNUD, 1997). Appuyée sur trois concepts clefs : la responsabilité, la décentralisation et la transparence, la bonne gouvernance a donc consisté en une sorte de « juridicisation » de l’action publique. Depuis son apparition, la notion de bonne gouvernance est étroitement liée à la recherche de solutions à la crise de l’État avec, cependant, des variantes selon les priorités des organisations intervenant dans l’octroi et la gestion de l’aide internationale. Or, aujourd’hui, deux principales conceptions de l’État émergent : la vision jacobine, inspirée de ROUSSEAU, qui repose sur une conception utopique du pouvoir politique et de la vie démocratique, autrement dit sur un postulat général de bienveillance des hommes politiques et de l’administration. Cette conception est caractérisée par l’absence d’incitations monétaires et de sanction ; la conception inspirée de MONTESQUIEU, qui consacre l’absence de bienveillance des gouvernements et prend compte, à cet effet, de l’influence des groupes d’intérêt. L’organisation de l’État est repensée en termes de contre pouvoirs. La plus ou moins bonne gouvernance étant indéniablement liée à la forme d’organisation de l’État, force est de reconnaître que le modèle jacobin, utile à une certaine époque, est devenu inadapté voire inefficace à cause essentiellement de la complexité de la société et de l’économie. Or, les pays africains semblent prisonniers de la vision jacobine qu’ils ont héritée de colonisation française et qui devient un véritable vecteur de corruption Les institutions internationales sont elles aussi prisonnières de cette vision jacobine. Les politiques d’ajustement dont elles préconisent l’application prônent une réduction des salaires réels – déjà très bas – dans la fonction publique, mettent en place des incitations au départ volontaire des fonctionnaires, incitations dont profitent les employés de l’État les plus dynamiques qui peuvent saisir les opportunités des conditions de travail plus favorables qui leur sont offertes hors de la fonction publique (le secteur privé). La théorie du choix public, outre la nouvelle économie publique dont elle fournit une marque, postule que les décideurs politiques ne sont guidés que par la poursuite de l’intérêt général. En lieu et place de cette vision platonique, la théorie du choix public insiste sur le fait que ces décideurs, comme on le suppose dans la théorie économique standard, se comportent comme «l’homo-économicus» : ils maximisent leur bien-être économique personnel. Sans doute, il serait excessif d’aller jusqu’au bout de la logique de la nouvelle économie politique qui déboucherait sur ce que JAGDISH BHAGWATI 1989 a appelé «le paradoxe du déterminisme » (paradox determinacy). Si les politiciens et les bureaucrates déterminent leurs actions dans le but de maximiser leur bien être personnel, alors l’analyse normative n’a aucune chance d’influencer la politique. Il faut s’interroger sur les conditions préalables à la mise en place des politiques de bonne gouvernance qui sont dans une large mesure liées à l’application des politiques économiques profondes dont l’Afrique a besoin. En effet, le schéma de la bonne gouvernance est appliqué aux pays en développement en général et à 298 l’Afrique en particulier sous l’instigation des partenaires au développement et des institutions internationales. Des efforts louables sont entrepris en Afrique pour mettre en œuvre la bonne gouvernance ; ils sont orientés vers plus de participation, de responsabilité, de décentralisation et de transparence. De nombreux programmes visant à étendre le champ de la responsabilité publique (politique ou administrative) ont été mis en œuvre ces dernières années. Les donateurs ont voulu tout à la fois rapprocher les décisions du lieu de leur mise en œuvre et accroître la soumission au droit des autorités publiques et ce, tant au niveau local que national, à travers la décentralisation et le contrôle de légalité qui l’accompagne, comme par le truchement de mesures tendant à renforcer l’indépendance de la justice. Ils ont cherché à obtenir une plus grande transparence, via l’appui aux médias indépendants, la publication des procédures de passation des marchés publics, ou l’appui à la création de structures d’observation des élections. L’ensemble de ces stratégies a contribué à promouvoir et à renforcer l’État de droit, support essentiel de la bonne gouvernance. II/ Les différents volets de la gouvernance 1°) Le volet institutionnel Il constitue aujourd’hui un enjeu important de la recherche et un volet déterminant de la bonne gouvernance. Comprises comme des ensembles complexes de normes, de règles et de comportements, les institutions sont conçues pour des fins collectives. C’est pourquoi, elles sont souvent assimilées à des organisations c’est-àdire des unités de coordination ayant des frontières identifiables et fonctionnant de façon relativement continue en vue d’atteindre des objectifs partagés par les divers acteurs de la vie économique, politique et sociale. L’État et son administration, les marchés et les ONG sont au cœur même du dispositif institutionnel. Quelles sont leur composition et leurs principales missions, particulièrement dans les réformes économiques et politiques ? Le volet institutionnel comprend les éléments suivants : la création d’une commission électorale indépendante ; l’existence d’un médiateur ; l’auditeur général ; la direction des crimes économiques et de la corruption ; la commission des droits humains ; une autorité indépendante pour les médias ; l’existence d’une société civile active, etc. Cependant, le simple fait de créer ces institutions ne suffit pas. Leur fonctionnement réel est essentiel. La raison en est qu’en dépit de la diversité qui caractérise leurs passés et leurs expériences, les pays africains dans leur ensemble commencent à accepter l’idée qu’il y a urgence à créer et à renforcer un cadre institutionnel pour une bonne gouvernance. Les progrès déjà réalisés sous le multipartisme doivent maintenant être sauvegardés par un tel cadre institutionnel. Au nombre des éléments clés de ce cadre figurent : - un système électoral transparent ; - un pouvoir judiciaire indépendant ; - un organe anti-corruption indépendant ; - une commission indépendante des droits de l’homme ; - des structures d’harmonisation et d’exécution des activités liées aux femmes ; - une société civile forte et active. 2°) Le volet économique, La prise en charge des problèmes de gouvernance économique requiert, de l’État et de tous les acteurs politiques, économiques et sociaux, de la volonté, de 299 l’énergie, du temps et une stabilité institutionnelle minimale. Ces conditions sont nécessaires pour créer progressivement un environnement de gestion économique et sociale cohérente, adapté, diversifié et prévisible. Cela implique le développement rapide de capacités d’élaboration de politiques et de stratégies cohérentes à court, moyen et long termes, combinant l’action de l’État au marché et visant à mobiliser sans conflits sociaux majeurs toutes les ressources internes et externes en vue du développement. Par-delà les carences en tous genres dont souffre structurellement le continent africain, sur lesquelles il n’est pas nécessaire de revenir, l’un des déficits les plus graves réside dans les capacités d’organisation de la société en général et de l’activité économique en particulier. Il appartient aux États, chacun pour ce qui le concerne et en considération de ses conditions spécifiques, d’évoluer, de combler ce déficit et de créer pour ce faire, les conditions internes et externes d’émergence de capacités propres d’ingénieries économique, sociale et institutionnelle à mettre au service des objectifs de l’État, des Entreprises et de la société civile. Cette tâche est certes complexe et de longue haleine, mais elle constitue un objectif incontournable à moyen terme pour introduire et pérenniser les processus de développement de la gouvernance économique. Sur le fond, celle-ci consiste à construire des systèmes, des procédures et des organisations socialement acceptables et capables de régulariser dans la transparence et l’équité, la production et la redistribution des richesses économiques, ainsi que les ressources nécessaires au développement de l’ensemble de la société à long terme. La gouvernance économique peut notamment se décliner autour de quatre grands domaines, reliés entre eux mais distincts dans leurs champs respectifs, leurs méthodes et leurs principes généraux de fonctionnement : La gestion macro-économique. La création et le développement d’un environnement favorable aux producteurs. La régulation économique. L’édification et le développement de la société civile a) La gestion macro-économique Pour l’État, en matière de gestion macro-économique, au moins quatre domaines requièrent une attention particulière pour une bonne gouvernance. Il s’agit respectivement de la gestion des dépenses publiques, de la collecte des ressources publiques notamment les ressources fiscales et assimilées, des régimes de taux de change et des arrangements monétaires. Dans le domaine des dépenses publiques une bonne gouvernance peut s’organiser autour de règles, de dispositions législatives et réglementaires, de mécanismes de contrôle qui puissent assurer : Des processus transparents, démocratiques et largement décentralisés d’expressions des besoins dans les différents secteurs et régions de la société ; Des processus administratifs et politiques d’arbitrages entre les priorités, qui soient clairement affichés et respectés pour leur conférer toute la légitimité souhaitable ; Des processus décisionnels permettant le contrôle de leur effectivité par les différents échelons centraux et décentralisés de l’État, en volumes de dépenses et en destination, en conformité avec les arbitrages arrêtés ; 300 L’équilibre global des dépenses publiques au niveau, si possible, des ressources budgétaires collectées ou sinon, à de faibles niveaux de déficits compatibles avec des objectifs clairement visés de croissance économique ultérieure génératrice de futurs rééquilibrages ; L’équité en faveur des régions et des populations les plus démunies ; L’orientation préférentielle des dépenses publiques vers la création et/ou la consolidation d’externalités profitables aux producteurs et aux entreprises, avec l’appui des représentants de la société civile ; La réduction ou l’élimination des dépenses clairement improductives, et notamment des subventions d’activités notoirement contre-productives et assurées de déficits chroniques ; L’amélioration de la cohésion sociale par la promotion de la solidarité, de la prévention, de la santé, de l’éducation et de la communication ; La rentabilisation et/ou la création d’infrastructures de base et des moyens humains et logistiques nécessaires au développement local ou national ; L’amélioration de la sécurité publique. L’ensemble de ces objectifs appelle la mise en place d’organisations adéquates de concertation politique et sociale, d’autant plus efficaces qu’elles sont ancrées dans des expressions de la légitimité populaire et des règles de droit. Faute de cela, les processus budgétaires et les réalisations peuvent être frappés de contestations et de soupçons d’arbitraire nuisibles à la bonne gouvernance et à l’atteinte des objectifs fixés. Il reste cependant que l’insertion inéluctable des pays africains dans les processus de globalisation économique (et notamment financière) doit inciter à la mise en place de mécanismes et structures assurant, à terme, la libre circulation des capitaux, des garanties suffisantes et attractives pour les investissements directs étrangers, et une autonomie affichée des autorités monétaires, même fondée sur des mécanismes de surveillance en usage à l’échelle internationale. b) La création et le développement d’un environnement favorable aux producteurs La création d’un environnement favorable aux entreprises est un élément essentiel d’une bonne gouvernance économique et, dans ce cadre, les domaines les plus couramment évoqués par les opérateurs sont ceux du système de crédit, du régime fiscal applicable aux entreprises et la législation du Travail. Structure et politique des crédits La plupart des pays africains disposent de systèmes de crédit insuffisamment développés et insuffisamment incitatifs au regard des objectifs traditionnels de mobilisation de l’épargne intérieure, de financement dynamique et adapté de l’investissement et de monétarisation des économies. À ces objectifs s’ajoutent aujourd’hui des exigences de stabilité, de fiabilité, de transparence et d’observation de règles prudentielles généralement admises. Et à l’heure de la globalisation financière, une bonne gouvernance dans ce domaine nécessite d’abord l’existence de cadres juridiques et de normes de gestions bancaires connues des opérateurs économiques, ainsi que de systèmes de supervision bancaire sur les transactions nationales et internationales. Cette instrumentation est nécessaire pour pallier les risques systématiques devenus aujourd’hui plus graves et pour accroître la compétitivité ou l’attractivité des économies africaines. 301 Le régime fiscal L’environnement fiscal de l’entreprise est déterminant pour une bonne gouvernance économique dans les pays en développement en général et l’Afrique en particulier. Cette sensibilité particulière est liée à la faiblesse et l’extrême fragilité des ressources financières des entreprises sur lesquelles des prélèvements inconsidérés agissent négativement. C’est pourquoi l’ensemble des pays africains ont mis en place des dispositifs fiscaux particulièrement incitatifs, exonérant les nouvelles entreprises du paiement de l’impôt sur des périodes plus ou moins longues. Cela constitue déjà un cadre de gouvernance positive, qui doit cependant s’élargir dans des conditions compatibles avec les équilibres budgétaires souhaitables. Une bonne gouvernance dans le domaine du régime fiscal applicable aux producteurs, qu’ils soient personnes physiques ou morales, doit notamment veiller à ce que : - Les dispositions fiscales arrêtées dans un domaine à des fins incitatives ne soient pas annihilées par d’autres dispositions dans des domaines connexes. Une nécessaire cohérence globale dans les objectifs, les moyens et les dispositifs opérationnels de prélèvement doit être constamment recherchée et mise en œuvre. Une attention particulière doit être prêtée à ce titre aux interfaces entre régimes fiscal et régime douanier, notamment pour ce qui concerne les inputs importés ; - Les activités productives effectives bénéficient d’avantages fiscaux significativement plus marqués que les activités purement commerciales et/ou spéculatives ; Une écoute permanente soit accordée aux doléances des organisations et corporations de producteurs, à l’effet d’identifier notamment les effets éventuellement pervers de dispositions fiscales incitatives ; Les marges d’interprétations des services fiscaux soient aussi minces que possible, à l’effet d’éviter des iniquités, des incompréhensions et des arbitraires administratifs toujours préjudiciables au développement des initiatives. À ce titre, une bonne gouvernance doit veiller à organiser des processus d’audits, de contrôle et d’évaluation permanents et professionnels pour corriger les effets pervers des dispositions prises ; La plus grande simplicité possible des textes et de l’architecture des prélèvements fiscaux soit visée. L’adhésion des opérateurs est incompatible avec l’opacité et/ou la trop grande complexité des règles de droit fiscal ; Les voies claires de recours soient juridiquement établies et mises en œuvre selon des conditions de célérité et d’équité devant l’administration, qui puissent conforter l’entrepreneuriat tout en sauvegardant les attributions régaliennes de l’État. En particulier, l’instauration et/ou la dynamisation de tribunaux administratifs ou encore d’organes ouverts de conciliation et de médiation peuvent constituer des axes de travail sur une bonne gouvernance dans le domaine du régime fiscal ; Créer des structures de conseil, d’aide professionnelle et d’expertise fiscale en faveur des opérations économiques dans le domaine fiscal. Ces structures d’appui sont d’autant plus nécessaires que la culture économique moderne est carante dans de nombreux pays africains, et que l’analphabétisme est encore trop répandu ; Vulgariser (par les moyens adéquats à chaque pays et chaque culture) les dispositions essentielles des lois fiscales encadrant les actes d’investissement, de production et de commercialisation. En particulier, il doit être 302 veillé à la contribution des médias lourds à cette vulgarisation, en sus des mobilisations de vulgarisateurs professionnels. La législation du travail Une bonne gouvernance dans le domaine des relations professionnelles doit d’abord veiller à la création et la préservation de l’équilibre des droits entre employeurs et salariés. Cet équilibre est variable selon les conditions historiques et sociales de chaque pays, mais des règles universelles minimales ont été édictées à l’échelle internationale et ratifiées par la plupart des pays africains. Ces règles couvrent des domaines très larges et diversifiés, allant de la reconnaissance des syndicats et du droit de grève à l’instauration de minimum salarial, en passant par les droits à la protection sociale en matière de vieillesse, de maladie et d’accidents du travail. Une bonne gouvernance dans ces différents domaines consiste d’abord en l’organisation de cadres de concertation et de dialogue entre partenaires sociaux, où l’État arbitre en dernier ressort sur la base de règle de droit clairement affichées et d’institution de médiations préalables. La gouvernance économique doit particulièrement veiller à légitimer l’action de l’Etat par une stricte observance des règles d’équité et l’instauration d’institutions judiciaires indépendantes intervenant après l’échec des médiations préalables et des organes de prévention des conflits. La régulation économique Au niveau de la régulation économique, trois domaines semblent devoir être privilégiés pour améliorer la gouvernance économique globale : le système financier, la concurrence et les normes comptables et d’audit. S’agissant du système financier qui a déjà été évoqué partiellement à propos des institutions de crédit, un premier axe de bonne gouvernance consiste à institutionnaliser de façon irréversible l’autonomie des instituts d’émission à l’égard des gouvernements, et affecter à ces instances financières la plénitude des attributions de régulation des contrôles des établissements financiers, de contrôle de la masse monétaire en circulation, de gestion des réserves de change et de fixation des règles prudentielles. Il appartient aux instituts d’émission de veiller, en coordination avec les exécutions, à la stabilité des prix et à la mise en place des dispositifs de régulation et la minimisation des déficits budgétaires. Ces attributions tendent à s’universaliser avec les contraintes de globalisation financière et les exigences légitimes des organisations financières multilatérales. Le captage de ressources longues dans un cadre réglementaire robuste et transparent peut s’effectuer à travers des mesures visant à faire émerger un marché des capitaux telles que la démonopolisation des systèmes de pension et de retraite, la recapitalisation – restructuration des banques de développement de manière à attirer les prises de participation privées et les soustraire à l’ingérence politique, la création de fonds de garanties pour amortir les risques bancaires, la mise en place des stimulations pour le retour des capitaux fugitifs. Normes comptables et audit Le renforcement systématique de la transparence financière et des pratiques comptables des secteurs public et privé est un atout important de gouvernance des pays africains et une condition pour l’instauration de relations saines et rapides avec les institutions financières internationales. 303 Concurrence et compétitivité Il est aujourd’hui universellement admis que l’instauration d’économies de marché saines et dynamiques est indissociable du développement de règles de concurrence loyale entre opérateurs économiques. Ces règles visent, notamment, à rendre transparentes et équitables les conditions d’entrée et de fonctionnement de tous les acteurs dans les marchés nationaux, et à éliminer les obstacles générateurs de rentes indues et d’abus de position dominante. Mais de nombreuses contraintes pèsent sur les économies et sociétés africaines pour l’instauration et la mise en œuvre effective de règles de concurrence économique, aux niveaux interne et externe. Au niveau interne, les économies africaines sont marquées par l’existence de secteurs informels extrêmement importants, la persistance d’activités de subsistance pure, de très faibles niveaux de productivité des facteurs, la prédominance de microentreprises et d’activités modernes naissantes et peu compétitives, une faible monétarisation des échanges et enfin la persistance ou le développement de la corruption. Ses handicaps sont autant de défis pour une bonne gouvernance économique. La gouvernance de la concurrence dans les pays africains nécessite, par conséquent, des efforts considérables d’insertion des économies informelles dans les circuits légaux, l’identification et l’élimination progressive des situation de rentes et de prélèvements indus, le développement de l’information économique et des dispositions particulières permettant d’asseoir l’attractivité des capitaux internationaux tout en préservant, par les voies appropriées, le développement des capitaux locaux de production de biens et de services. Le libre jeu de la concurrence doit donc être analysé au cas par cas et adapté aux objectifs de croissance et de développement. 3°) Le volet social. Ce volet intègre le développement de la santé, de l’éducation et de l’habitat ; en somme trois facteurs constituant les éléments pertinents d’appréciation du développement humain et surtout de la nouvelle dimension de la pauvreté. Tous ces développements ont permis de mesurer toute la complexité de la gouvernance qui devrait permettre de mobiliser toutes les ressources matérielles et humaines de façon efficiente et appropriée afin de libérer toutes les énergies et les forces vives, les compétences, les talents, l’entreprise et l’esprit d’entreprise des populations. Ainsi la bonne gouvernance devient alors l’utilisation efficiente et démocratique de l’État pour la gestion de la société dans ses différents aspects politiques, économiques et sociaux. Quel est l’état de la bonne gouvernance et du développement humain au Sénégal qui vient de connaître une alternance politique remarquable à l’issue d’élections démocratiques? 4°) L’encouragement et le soutien à l’établissement d’une société civile Une société civile forte et active appelle un cadre institutionnel ouvert sur le pluralisme, la promotion de la dimension Genre, l’indépendance du pouvoir judiciaire et d’autres entités telles que les commissions électorales, les organes chargés des Droits de l’Homme et les dispositions anti-corruption. Parmi les indicateurs qui peuvent mesurer la performance de la gestion et de la participation figurent le contenu et l’impact des politiques ainsi que les programmes 304 de valorisation des nationaux. La promotion d’organisations professionnelles et de syndicats est à même de sceller une étroite corrélation entre la croissance économique et la bonne gouvernance qui la sous-tend. Cet enjeu recèle une dimension et un enjeu où l’État lui-même se trouve interpellé dans ses responsabilités historiques. Dans les pays africains, l’État postcolonial est en effet mis au défi de continuer à assurer plus efficacement que par le passé la mission essentielle d’agent de développement et de réaliser cette entreprise en favorisant un rôle croissant du secteur privé comme vecteur de croissance. Cette présentation permet de se prononcer sur l’efficacité des réformes économiques entreprises ainsi que leur impact social. En résumé, on tente de mesurer, à travers ces développements, l’incidence des institutions, surtout publiques, sur le développement. 305 CHAPITRE 14 LIBÉRALISATION DES ECONOMIES AFRICAINES PAR LES PROGRAMMES D’AJUSTEMENT STRUCTUREL La crise des économies africaines dont la manifestation la plus intangible réside dans la montée et la persistance de multiples déséquilibres internes et externes, trouve son origine dans les bouleversements des structures économiques intervenues durant la période coloniale et qui ont imposé partout des modes spécifiques de valorisation conforme à la logique de la division internationale du travail. Cette situation, du fait d’un ensemble d’incertitudes optionnelles, sera entretenue et même amplifiée au lendemain des indépendances en 1960. Ainsi, dans la période 1960/1980, es les économies primaires devenues fortement aléatoires et stagnantes avec une chute de la production, une détérioration en termes réels des prix entraînant un appauvrissement des producteurs. La baisse de la rente agricole qui a résulté de cette situation n’a pas été relayée par de nouveaux secteurs productifs, dynamiques et générateurs de surplus et d’emplois. En dehors du secteur pétrolier, les secteurs miniers n’ont produit qu’une rente épisodique (1973) et les secteurs industriel et tertiaire sont restés encore marginaux. Le secteur industriel n’a pas atteint non plus de grandes performances, ni un dynamisme lui permettant d’aller à la conquête des marchés extérieurs et de contribuer positivement à l’amélioration de la balance commerciale176. Ces différentes évolutions avaient abouti à un ralentissement de la croissance du PIB et une accentuation des déficits chroniques et cumulatifs des Finances Publiques et de la Balance des Paiements. Avec un croît démographique proche de 3 % par an de 1960 à 1980, la croissance du PIB par tête devint négative dans la période de 1970-85. L’excès de demande sur les ressources produites fut accentué par un accroissement continu de la part des dépenses de consommation dans le PIB. La part de l'épargne intérieure dans le PIB est restée partout assez faible. Le déficit du compte courant s’est fortement élevé pendant que celui des finances publiques continue de s’approfondir dans la même période. La perte de compétitivité de l’économie a tendu à faire des capitaux extérieurs une source indispensable de financement des déficits commerciaux. Le service de la dette a pris des proportions considérables alors que la dette extérieure devenait insoutenable. Ce constat laisse apparaître que l’éclatement de la crise économique mondiale des années 70, en déréglant le système économico-financier international, viendra extérioriser toutes les faiblesses structurelles des économies africaines quasi déliquescentes et parfaitement incapables de s’ajuster à la conjoncture. Ainsi, au moment d’aborder le début des années 80, les pays vont connaître une grave et insoutenable crise de paiement. L’ajustement économique et financier devenait presque un impératif indiscutable. C’est dans ce contexte qu’en 1979, les gouvernements démarrent partout des processus ininterrompus d’ajustement devant permettre la stabilisation des déficits par assainissement des structures d’intervention coûteuses et peu productives, et poser les bases d’un développement censé être soutenu à long terme. L’enjeu est décisif et sa contrainte est de minimiser les risques sociaux liés au rétablissement des grands équilibres. Les déséquilibres à caractère macroéconomique ont des causes plurielles et profondes qui, à y regarder de près, se rapportent principalement à l’inefficience des investissements réalisés pour la plupart sur concours extérieurs publics et privés, aux 176 Moustapha KASSÉ : Sénégal de la crise à l’ajustement structurel, Édit. Nouvelles du Sud, Paris 1991 306 distorsions entre structures de production et structures de consommation ainsi qu’aux dérapages de la demande de consommation publique et privée. Des investissements impertinents et non rentables : le temps des éléphants blancs La rationalité économique et financière voudrait que toute décision d’investissement – surtout lorsque celle-ci est fondée sur un emprunt extérieur – soit subordonnée à un nécessaire calcul coûts/avantages. Plus précisément la viabilité – surtout financière – d’un projet implique que le taux de rentabilité de l’investissement dépasse le coût de l’emprunt. Or, dans le cas des pays africains, ce principe de base semble avoir été peu ou très mal appliqué et cela en pleine période de flambée des taux d’intérêt internationaux, de dégradation et d’instabilité chronique de l’environnement extérieur, toutes choses qui rendent aléatoires la rentabilisation des projets économiques internes. La multiplication des chocs exogènes, en renchérissant notamment les coûts internes de production, a contribué à amoindrir, voire annuler la rentabilité des investissements. C’est la période des « éléphants blancs » c’est-dire des investissements massifs sur des projets de rentabilité douteuse. En fait cette baisse de rendement des investissements reste essentiellement due, à partir de 1974, à l’extension du secteur public et à la création d’un vaste secteur parapublic, dont le mode de gestion n’était pas des plus orthodoxes. Ce secteur public et parapublic absorbait annuellement la plupart des crédits bancaires internes et des emprunts extérieurs. En outre, il convient de noter que l’accroissement, dans la production interne, des biens non commercialisables internationalement (comme la construction d’édifices publics sur emprunts extérieurs) a également été déterminant dans la chute de rendement des investissements. En effet, la diminution des produits nationaux échangeables (comme corollaire de ce qui précède) implique une baisse conséquente des recettes d’exportation et donc des difficultés à honorer les échéances du service de la dette, le renouvellement des investissements sur fonds propres et la poursuite de la croissance. Les distorsions entre structures productives et structures de consommation Liée principalement à des contingences historiques, à des traditions productives technologiquement attardées, ainsi qu’à des comportements de consommation largement conditionnés par l’extérieur, la liaison sphère de production/structure de consommation présente partout en Afrique une double distorsion. Celle-ci demeure liée d’une part à la nature des produits et d’autre part au coût de production des biens considérés. C’est ainsi que dans le domaine agricole, la perpétuation après 1960 des agricultures de rente au détriment de l’agriculture vivrière a inexorablement conduit les pays à une crise agro-alimentaire. Cette rupture a engendré une explosion des importations de produits alimentaires. Dans le secteur des activités industrielles, la distorsion s’exprime en termes de coûts pour les produits de l’industrie légère de transformation et en termes de nature du produit pour les biens manufacturés livrés par l’industrie lourde des pays développés. En effet, la politique de promotion d’industries légères substitutives d’importations a généré dans la plupart des cas des coûts de production non compétitifs ; cela a engendré des importations massives de biens manufacturés pourtant localement fabriqués. Par ailleurs, l’inexistence d’industries lourdes 307 intégrées implique la nécessaire importation des biens de consommation de luxe comme les voitures etc. En somme, la distorsion industrielle se traduit d’une part par la production locale de biens manufacturés « légers » difficilement écoulables tant à l’intérieur qu’à l’extérieur parce que non compétitifs, et d’autre part par l’importation massive de biens industriels “lourds” que le tissu industriel national ne produit pas. Cette double distorsion à pour inévitable corollaire l’accentuation du déficit commercial du pays et du solde de la balance des paiements lorsque les mouvements compensatoires de flux de capitaux demeurent insuffisants. L’Expansion non maîtrisée de la demande publique et privée Le déficit en ressources, lorsqu’il y en avait, se maintenait en deçà de 5% du PIB. Toutefois, après l’éclatement de la crise en 1973 et plus particulièrement à partir de 1975, une série de déséquilibres vont s’enclencher, entraînant la rupture brutale de l’équilibre économico-financier. Il s’agit notamment de : l’effondrement brutal de la croissance lié aux fluctuations spectaculaires de la production agricole et au ralentissement survenu dans l’industrie ; “l’envolée” du tertiaire (notamment le gonflement des effectifs de l’administration publique par essence fortement improductive) qui enregistre un taux de croissance plus rapide qu’avant 1975 ; le maintien des niveaux de consommation individuels et l’exploitation de la consommation publique alors même que la production par tête était en très net recul. La conséquence ne se fit pas attendre : l’épargne intérieure devint négative impliquant un recours massif à l’endettement extérieur pour financer les investissements et une part importante des dépenses de consommation publique et privée. Par ailleurs, outre l’augmentation rapide de la masse salariale de la fonction publique, on assiste à une extension des subventions d’exploitation accordées aux entreprises publiques. Ces subventions ont eu pour effet de réduire le coût unitaire réel du produit ou service fourni aux consommateurs privés. C’est dire que l’État, en accroissant son déficit budgétaire sur la base d’emprunts extérieurs, a favorisé l’expansion du secteur public et le maintien du niveau de la demande privée de consommation. En réalité, l’aide et les emprunts extérieurs vont de fait jouer le rôle de fonction d’investissement avec, en conséquence, un impact extrêmement limité faute de pouvoir se greffer sur des projets productifs rentables et capables d’engendrer des effets d’entraînement sur les activités économiques tournées vers le marché intérieur et l’emploi. Cette politique d’emprunt et d’aide ne peut se poursuivre que moyennant des réformes dont le pacquage constitue le Programme d’ajustement structurel. C’est dire alors que la crise de la dette est à l’origine de la vague d’ajustement structurel qui, à partir des années 1980, a submergé dans tous les PSD en général, et à l’Afrique en particulier. Ces Pays en voie de développement (PVD) et les Institutions financières multilatérales (IFM) vont implicitement passer le contrat suivant : maintien des financements et réduction du montant des échéances contre politiques de stabilisation macro-économique (privatisations, dérégulation, réduction des dépenses publiques etc.). 308 L’objectif ultime restait principalement le rétablissement de l’équilibre des comptes extérieurs alors que les objectifs intermédiaires se ramenaient à la réduction du déficit budgétaire et au renforcement de la compétitivité externe du pays. Section 1 : Les fondements théoriques d’ajustement structurel : la recette libérale. des politiques L’intervention des institutions de BRETTON WOODS dans le débat sur le développement va s’accompagner de profondes transformations, tant dans la réflexion que dans la pratique. Une nouvelle ère en matière de développement par le fameux « consensus de Washington » qui est de fait une remise en cause de la théorie du développement et la spécificité des sociétés sous-développées. II constitue en somme une sorte de revanche de la théorie néo- classique qui va étendre le champ d’application de son cadre d’analyse aux sociétés sous- développées. I/ Le référentiel théorique et les recommandations du consensus de Washington : une épure séduisante177. Les programmes d'ajustement s'inspirent de la théorie néo-classique et de la doctrine libérale: théorie quantitative de la monnaie, théorie des parités de pouvoir d'achat et théorie des coûts comparatifs178. 1°) La théorie quantitative de la monnaie Elle est invoquée pour expliquer et justifier que tout processus d'inflation est ruineux et entraîne de multiples distorsions qui auront une incidence négative à la fois sur la balance des paiements et sur l'allocation des ressources pour la croissance. Or, la demande excessive de monnaie est la source principale de l'inflation et des difficultés de paiements. Dès lors, les experts du Fonds s'efforcent d'évaluer un agrégat monétaire déterminant dont le niveau dépend à la fois du volume du crédit intérieur, de la dette extérieure et du déficit budgétaire. Ces trois éléments vont alors constituer des variables macro-économiques sur lesquelles il faut agir pour enrayer ou amoindrir l'inflation. Ainsi la limitation du crédit devra avoir une incidence sur les décisions du secteur privé et public. Elle pourra contraindre le secteur public à réduire de ce fait ses déséquilibres. Quant à la restriction de l'endettement, elle doit se traduire par une compression de crédit et un contrôle de ses effets sur l'accumulation interne car en fait, il faut veiller à ce qu'une dette excessive ne vienne compromettre la réalisation des investissements productifs. Le déficit budgétaire constitue le dernier élément de la demande excessive de monnaie. Ce déséquilibre, pour le Fonds, procède de l'entretien d'une fonction publique pléthorique et surtout, de subventions au secteur public et parapublic. Ces trois variables macro-économiques seront surveillées strictement et maintenues à des niveaux relativement bas pour empêcher une élévation de la masse monétaire qui serait génératrice d'inflation. 177 Confère annexe 1 pour un exposé détaillé du référentiel théorique. Voir également Hakim Ben Hammouda : L’économie politique du post-ajustement, Éditions Karthalla, 1999. 178 Moustapha KASSÉ : L’Afrique endettée, Édit. NEAS-CREA, 1992, chapitre1 de la Partie 2 pp72-73 309 2°) La théorie de la parité des pouvoirs d'achat. Elle montre que l'évolution du change doit refléter le différentiel d'inflation existant entre deux pays. Alors, la PPA permet d’analyser comment le niveau des prix agit sur les taux de change. Elle constitue la référence dans l'élaboration des politiques des taux de change et de l'intérêt. Les taux d'intérêt selon le FMI sont souvent maintenus dans les pays en voie de développement à des niveaux bas. Il en résulte alors une érosion et une mauvaise affectation de l'épargne intérieure. La PPA permet d’expliquer le taux de change de long terme. Il s’agit du taux de change réel qui est défini comme étant le taux auquel on peut échanger un bien ou un panier de biens d’un pays contre le même bien ou le même panier de biens dans un autre pays. Par exemple si 1 kg d’arachides coûte 5 euros en France et 3000 FCFA au Sénégal, alors le taux de change réel doit être égal à 600 FCFA/euros pour que le pouvoir d’achat des monnaies soit la même dans les deux pays. La PPA est utilisée dans l’étude de la surévaluation ou de la sous-évaluation d’une monnaie dans une économie en développement. Dans ce cadre, BALASSA et SAMUELSON ont analysé les mécanismes d’appréciation du taux de change réel dans le cas d’une économie protégée si bien que l’effet BALASSA-SAMUELSON désigne la distorsion dans la PPA due aux différences internationales de productivité relatives entre les secteurs des biens échangeables et des biens non échangeables. Elle montre que l'évolution du change doit refléter le différentiel d'inflation existant entre deux pays. L’inconvénient majeur des taux de PPA est qu’ils sont plus difficiles à mesurer que les taux de marché. Les taux PPA font l’objet d’estimation avec le risque d’incertitude que cela comporte. D’ailleurs la qualité des biens peut changer d’un pays à l’autre. De plus les structures de consommation ne sont pas les mêmes pour tous les pays. Ainsi, il semble difficile de définir un panier de biens standard. 3°) La théorie des coûts comparatifs Elle est évoquée pour justifier la nécessité d'un commerce sans entrave sur la base d'une spécialisation des pays dans les productions où elles ont les meilleures dotations factorielles naturelles, car le commerce extérieur élève la rémunération des facteurs. Il est alors avantageux pour tous les partenaires à l'échange. En conséquence, les pays doivent s’ouvrir aux relations économiques internationales car l'ouverture des frontières confère les mêmes chances de développement aux partenaires. Les techniciens du Fonds évoquent la théorie des coûts comparatifs pour recommander la promotion des échanges internationaux qui sont un moyen pour réaliser le bien-être mondial. C’est sur ce fond doctrinal d'apparence très cohérente, que le FMI élabore une politique générale d'ajustement qui a la prétention d'être valable pour tous les pays confrontés à des déséquilibres macroéconomiques. Le caractère universel de ces solutions procède du fait que pour le FMI, le diagnostic permet d'établir pour tous les pays du Tiers-Monde un mal identique: les difficultés de balance des paiements. Ainsi, les économies sont considérées comme des « boîtes noires » qui réagissent de façon uniforme aux mêmes stimulants : prix, taux d’intérêt, taux de change. À partir de tels diagnostics les PAS doivent permettre de parvenir dans un délai raisonnable à une situation de paiements extérieurs équilibrés. 310 Dés lors, le rétablissement de l’équilibre passe par des modifications structurelles renforçant le rôle du marché dans la régulation de l’économie. Le consensus de Washington va remettre alors en cause toute forme d’interventionnisme étatique et proclamer la suprématie du marché dans l’allocation des ressources. 4°) Les trois approches des Institutions Financières Internationales L’approche monétaire de la balance des paiements Dans cette approche, les déséquilibres de la balance des paiements sont mis en relation avec l’excès de création monétaire : le modèle, au demeurant très simple, permet de calculer le montant de crédit compatible avec un objectif fixé a priori de niveau des réserves extérieures. Il repose sur deux hypothèses : la constance de la demande de monnaie par rapport au revenu et le caractère exogène de l’offre de monnaie résultant d’une décision autonome des autorités monétaires qui fixent le niveau de la composante interne de la base monétaire. Un déséquilibre extérieur ne serait donc que le symptôme d’un mal plus profond, d’origine monétaire. Le rétablissement de l’équilibre de la balance des paiements passe donc, soit par la réduction du crédit intérieur (crédit à l’État et crédit à l’Économie), soit par l’ajustement du taux de change. Dans un premier temps, il sera donc préconisé de réduire le financement monétaire de l’État (ce qui élimine aussi un éventuel effet d’éviction du secteur privé de l’accès aux financements) et, si cela s’avère insuffisant, de réduire aussi le crédit à l’économie. Ce dernier objectif peut s’atteindre de diverses manières, soit par un plafonnement de la progression des crédits, soit par le jeu du taux d’intérêt : le FMI préconise ainsi fréquemment le rétablissement de taux d’intérêt positifs, dans le double but de réduire le crédit et de stimuler l’épargne, supposée sensible au taux d’intérêt. L’approche en termes d’absorption Cette deuxième approche, d’origine keynésienne, correspond à la situation d’une économie en situation de plein-emploi où le déséquilibre résulte d’un excès de revenus distribués. En simplifiant à l’extrême, on peut écrire que le solde de la balance courante (assimilée à la balance des biens et services) est égal à la différence entre le PIB et l’absorption A, définie comme la somme de l’investissement et de la consommation. Soit Y+M = A+X B = X-M = Y-A Avec Y : PIB ; M : importations ; X : exportations et B : solde de la balance des biens et services. La première équation présente le déficit extérieur comme le simple reflet du déséquilibre intérieur, caractérisé par un excès d’absorption par rapport à la production : la fixation d’un niveau trop élevé de consommation privée ou publique ou de l’investissement (du fait, par exemple, de taux d’intérêt réels trop bas) conduira à un niveau de PIB élevé, et donc (en admettant une proportionnalité au moins approximative entre Y et M) à un niveau d’importations trop élevé par rapport aux exportations, considérées comme exogènes et fixes à court terme. Les racines du déséquilibre devront donc être recherchées au niveau de la demande interne «effective», et renvoient à des niveaux de revenu trop élevés (nécessité d’une réduction des salaires réels) ou de l’épargne trop faible (nécessité de relever les taux d’intérêt). 311 Bien que d’origine différente, les deux analyses précédentes se rejoignent pour désigner comme cause principale du déséquilibre externe le financement monétaire du déficit budgétaire. L’approche centrée sur l’offre et les prix relatifs L’approche de l’offre est la référence des programmes de la Banque Mondiale. Elle distingue deux types de biens produits par l’économie considérée : les biens échangeables (bien d’exportation, d’importations et d’import-substitution) et les biens non directement échangeables –ou domestiques-, c’est-à-dire les biens n’entrant pas dans le commerce international : autoconsommation, petite production marchande, logement, certains commerces, … Deux conclusions fondamentales peuvent être tirées de ce modèle simple : 1. Par rapport aux modèles monétaristes, cette approche accorde une très grande importance aux conditions micro-économiques de l’activité et s’intéresse aux mouvements de substitution, tant au niveau de la production que la consommation. 2. Dans cette optique, le non-respect du système des prix intérieurs tel qu’il résulterait des mécanismes de marché est la source des déséquilibres constatés. C’est le système administratif de formation des prix qui, en Afrique, génère les dysfonctionnements dans l’évolution respective des secteurs et entrave la croissance de l’offre sur des bases saines. Trop d’administration des prix et des échanges (subventions, protections aux frontières, contrôle de la commercialisation), instaurée pour protéger les producteurs ou les consommateurs, introduit des biais dans le fonctionnement des marchés, conforte les secteurs protégés dans une structure de coûts non concurrentielle, et enfin entrave l’expansion des secteurs ouverts vers l’extérieur trop mal rémunérés. En vertu de cette approche, la libéralisation des prix et des échanges est donc une condition absolue pour le retour à la croissance équilibrée. II/ Les axes de l'ajustement structurel : les enchaînements de l’épure libérale Les PAS sont formulés en trois étapes par les experts des Institutions Financières Internationales : la première consiste pour les experts à établir un bilan diagnostic de l'économie et à identifier toutes les causes de la montée des déséquilibres ; la deuxième concerne l'élaboration des objectifs économiques et financiers ainsi que la fixation de la durée de réalisation des programmes arrêtés ; la troisième est celle de la formulation des ajustements nécessaires des politiques économiques. Les PAS s'articulent souvent en cinq mesures qui agissent et se renforcent mutuellement pour permettre de restaurer les grands équilibres internes et externes et surtout d'améliorer la solvabilité extérieure de l'État : La première mesure porte sur la croissance économique : le taux doit être le plus élevé possible, elle doit être régulière et harmonieuse. Elle est une fonction du taux d'accumulation du capital donc du volume d'investissement qui lui- même dépend de l'épargne. Il faut réallouer les ressources au profit des projets productifs au détriment des projets sociaux ; La deuxième mesure concerne la monnaie et le crédit : ils doivent être manipulés pour aboutir d'une part au maintien de la demande intérieure à un niveau compatible avec l'équilibre et d'autre part à la réduction des pressions inflationnistes. Cela nécessité alors le contrôle du crédit de la Banque Centrale au Trésor, la réduction 312 du volume du crédit bancaire aux secteurs de l'économie et l'élévation des taux d'intérêt souvent artificiellement maintenus à de bas niveaux ; La troisième mesure est relative aux distorsions des marchés et la vérité des prix. Il faut sur tous les marchés des mécanismes de libre détermination des prix afin qu'ils reflètent les raretés relatives qui s'y expriment ; La quatrième mesure concerne la politique budgétaire qui devrait s'organiser autour d'une régénération des recettes par amélioration de l'administration fiscale, de la réalisation d'économies budgétaires par compression des dépenses et de la masse salariale La cinquième mesure est relative à l'ajustement monétaire et la dévaluation, moyen privilégié, face à la surévaluation des monnaies, pour relancer la croissance par les exportations. Ces cinq volets forment le Programme d’ajustement proposé comme une taille unique aux pays qui recourent aux services du FMI. Mais, à y regarder de prés, ils constituent un ensemble de mesures qui affectent de façon irréversible les orientations et les structures d’un pays. Il s’agit en fait de la mise en place, parfois jusque dans les moindres détails, de politiques économiques d’un modèle de développement qui repose sur l’idéologie et les principes du libéralisme dont le fonctionnement est lié à la division internationale du travail. C’est la référence à cette philosophie économique et à ses présupposés théoriques qui explique la cohérence apparente des PAS. Les causalités privilégiées ont abouti à ces certitudes combinant les enseignements de la théorie quantitative de la monnaie et ceux de la parité du pouvoir d’achat. Elles peuvent être schématisées comme suit 179 : Tableau des enchaînements du référentiel théorique Politiques de crédit laxiste Déficit budgétaire Endettement Création monétaire Hausse des prix Déficit de la balance des paiements et/ou Dévaluation de la monnaie nationale Hausse de la masse salariale Source : Moustapha Kassé : L’Afrique endettée p.77 À partir de cette épure, on saisit mieux les divers enchaînements des réformes préconisées par le FMI pour le rétablissement des grands équilibres180. Moustapha Kassé : L’Afrique endettée Édit. NEAS-CREA p77 Il existe entre les deux institutions une division des tâches et une collaboration fixées par une directive de 1986. Les attributions ne se chevauchent pas : le FMI a pour responsabilité première l’examen de la politique macroéconomique, alors que la Banque mondiale intervient dans le domaine 179 180 313 C’est alors à la Banque mondiale que revient la responsabilité de la création préalable d’un cadre institutionnel incitatif et la réforme de tous les centres de pouvoir pour accompagner la mise en œuvre des politiques sectorielles et de la bonne gouvernance. Cette dernière est considérée comme la capacité institutionnelle de gestion des affaires de l’État fondée sur une logique entrepreneuriale et reposant essentiellement sur des principes de transparence, de participation, de responsabilité, d’équité et de probité. Elle est alors une sorte de catalyseur qui doit réconcilier l’efficacité économique et l’équité, l’État et les citoyens et ériger la démocratie comme noyau dur de la participation des individus à la vie de la cité. Globalement, différentes mesures ont ainsi été décidées, visant à rendre opératoire cette stratégie de conquête des marchés mondiaux : l’élimination des distorsions dans le libre jeu de tous les marchés ; la promotion du secteur privé dans toutes les activités productives ; l’ouverture de l’économie sur le système des relations économiques et financières internationales ; la réduction du rôle de l’État dans les choix de production et d’allocation des ressources ce qui implique la réduction du secteur public, le démantèlement des monopoles publics naturels et la privatisation. On a donc opté en faveur d’un scénario de croissance externe, où l’augmentation du volume des exportations était censée stimuler la demande de travail et de biens d’équipement de la part des entreprises tournées vers le marché mondial. En principe, le processus de déversement industriel aurait dû agir comme courroie de transmission, et diffuser l’impulsion initiale vers l’ensemble de l’économie. Pratiquement, l’ensemble de ce qui caractérisait le “ compromis keynésien ”, processus de négociation politique qui déterminait la gestion de l’économie dans le giron de l’État-Providence, a brutalement été remis en cause comme dans les pays développés, mais dans une plus grande mesure. des réformes structurelles et institutionnelles et dans l’appui aux secteurs privés et publics (voir R.SEROUSSI, Les nouveaux gendarmes du monde, Édit. Dunod, 1994) 314 Section 2 : Synoptique des politiques sectorielles Objectifs généraux Court terme Rétablir les grands équilibres de la balance des paiements et des finances publiques Stabilisation et assainissemen Long terme : efficacité et croissance VOLETS DE POLITIQUE ECONOMIQUE Vérité des prix : aller vers la vérité des prix Politique des prix Fluctuation des prix : permettre une certaine fluctuation des prix Libéralisation de l’économie : vers moins d’Etat Politique institutionnell e Efficience de l’Etat : vers un meilleur Etat Rétablissement des finances publiques : baisse des dépenses Augmentation des recettes Rétablissement finances publiques et balance des paiements Rétablissement de la balance des paiements : Balance commerciale : Diminution des importations Augmentation des exportations Balance des capitaux : Augmentation de l’entrée de capitaux Diminution de la fuite de capitaux I/ Dette et ajustement Trois aspects importants du lien dette et ajustement seront analysés : analyse des facteurs de massification de la dette et qui ont rendu l'ajustement inévitable dans de nombreux pays. L'apparition des crises d'endettement (insolvabilité et non pas illiquidité) va conduire à l'ajustement ; les objectifs des PAS en relation avec l'endettement. Les politiques et programmes d'ajustement abordent le problème des crises d'endettement selon trois (03) axes complémentaires : D’abord la réduction des déséquilibres macro-économiques majeurs Ensuite, la réorientation des structures économiques dans un sens plus favorable à la croissance et aux exportations ; * contrôle de l'évolution de l'encours, de la structure et des conditions; * définition des conditions de rééchelonnements, * les stratégies en matière de dette. L'évolution de la crise de l'endettement depuis 1982 a conduit les acteurs économiques internationaux à adopter différentes stratégies au fur et à mesure qu'évoluaient la crise de la dette et la perception qu'en avaient les principaux acteurs. 315 II/ La politique commerciale Le premier axe de la politique commerciale consiste à faire le bilan des politiques de protection qui ont été menées jusque dans les années 80. Les traits caractéristiques sont de trois (03) ordres : Son niveau est élevé et elle incite à la production d'un bien alors que le pays peut souffrir d'un désavantage absolu pour cette production, La politique commerciale multiplie les exonérations qui finissent par constituer un régime dérogatoire au régime de droit commun, Elle recourt de manière abusive aux restrictions quantitatives destinées à compenser les désavantages relatifs ; Le deuxième axe est relatif aux réformes recommandées pour une libéralisation intégrale du secteur commercial. Ces réformes sont de trois ordres : Réformer tous les dispositifs afin d’avoir un système de protection uniquement tarifaire, La réforme du tarif lui-même, en vue d’une suppression progressive de tous les régimes dérogatoires ainsi que les restrictions quantitatives La réforme de la réglementation du commerce extérieur Ces changements essentiels en faveur de la mise en œuvre d’une libéralisation intégrale appellent des mesures d'accompagnement particulièrement en faveur des acteurs du secteur. C’est tout un dispositif transitoire qui doit se mettre en place pour un apprentissage de la nouvelle réglementation surtout par les entreprises qui bénéficiaient de la protection et qui désormais doivent faire face à la compétition extérieure. Cela soulève de fait deux questions majeures : en combien de temps et comment les faire appliquer ? III/ Les problèmes budgétaires Le budget est, et a toujours été, un souci permanent des pouvoirs publics. À cause de sa complexité, il soulève de nombreux problèmes ainsi bien en pays développés qu’en pays sous développés, même si au niveau de ces derniers les problèmes se posent de façon quelque peu différente suivant les niveaux de développement économique, financier, social, juridique. L’analyse doit être menée avec une extrême prudence et de nombreuses précautions pour au moins une série de trois raisons : la fragilité des concepts utilisés, les ambiguïtés des indicateurs disponibles et les incertitudes propres aux sources d’information, Tout cela confère aux finances publiques africaines une évidente spécificité renforcée par deux éléments additifs d’une part le déficit budgétaire constant ne peut être résorbé que par recours à l’emprunt et /ou réaménagement de la dette ou par financement extérieur (banques et /ou institutions non bancaires) et d’autre part la soutenabilité de ce déficit (solvabilité, inflation) est entachée par des investissements publics très peu productifs, et la mobilisation des ressources, notamment l’épargne en faveur du secteur privé. En analysant les grandes masses budgétaires les recettes comme les dépenses, on s’aperçoit de l’impérative nécessité d’entreprendre des réformes budgétaires. Jugée excessive et nocive, la part des impôts directs doit selon les réformateurs des années 80 baisser. La compensation de l’allègement des impôts directs (sur les revenus) est recherchée à travers l’accroissement de la charge fiscale indirecte. Ainsi avec l’introduction de la TVA, les impôts et taxes de la consommation (impôts directs) ont été alourdis. Une étude réalisée par le FMI portant sur 94 programmes 316 financés par le FMI entre 1980 et 1984 révèle que 79 programmes (soit 84 %) ont comporté des mesures concernant la fiscalité. Parmi celles-ci les plus nombreuses sont de loin celles qui génèrent des recettes supplémentaires de manière rapide et commode tout en contribuant à limiter la consommation privée ce qui concorde parfaitement avec les objectifs immédiats poursuivis alors (contraction de la demande, réduction du déficit budgétaire). C’est le cas des droits et taxes à la consommation qui ont augmenté dans la quasi-totalité des programmes évoqués (77 sur 79). Les taux des taxes spécifiques (tabac, alcool, bière ...), des taxes pétroliers, des taxes générales sur les ventes et des droits de douane à l’importation ont été relevés dans respectivement 61% ,43% ,46% et 51% des programmes comportant des mesures fiscales (26). Encore plus d’autres mesures sans toucher au taux, vont dans le même sens telles celles relatives à l’administration de l’impôt qui ont consacré 52 programmes (soit les deux tiers) et œuvrent à améliorer les conditions de son recouvrement, renforcer les moyens d’identifications et de contrôle des contribuables, rénover des procédures légales de traitement des litiges (27). On constate donc que le levier fiscal a tout de même été actionné de manière appréciable et conséquente dans le cadre de la phase de stabilisation. Il reste que la reforme fiscale a surtout un caractère stratégique. Elle s’inscrit dans la perspective du projet à long terme de restructuration des économies et des finances des PVD. Un modèle de reforme fiscale a été élaboré à cette fin. Ces pays ont été acculés à mettre en œuvre des politiques d’ajustement car confrontés à une crise de leurs finances publiques. Les reformes fiscales recommandées au PVD dans le cadre des programmes d’ajustement structurels ne puisent pas seulement leur inspiration des théories élaborés dans les PD, mais en pratique aussi se déploient selon un modèle conçu par ces derniers puis exportés sans une véritable réflexion préalable quand à sa pertinence dans les pays d’accueil .De prime abord il nous faut citer Alan A. TAIT, ,Directeur adjoint au FMI qui situe parfaitement le problème par cet aveu édifiant : » traditionnellement, fonds a semblé admettre tacitement que tout système d’imposition nationale se développe à partir de taxes commerciales primitives et finit par comporter des impôts sophistiqués sur l’ensemble des revenus . Plus récemment les services du Fonds, reflétant les préoccupations expérimentées en Amérique du Nord et en Europe, ont manifesté d’avantage d’intérêt sur les questions axées sur l’offre. Les résultats de l’évaluation empirique des effets positifs sur l’offre d’une baisse des impôts ont été peu concluants ; le fond a néanmoins conseillé de réduire les taux des personnes physiques, de supprimer les exonérations spéciales et de cesser de recourir au régime fiscal pour atteindre un trop grand nombre d’objectifs ». La reforme fiscale qui leur est proposée, soulève au préalable un problème ardu : comment réduire la pression fiscale sans courir le risque d’aggraver le crédit budgétaire ? Peut être en transférant une partie des charges du contribuable sur l’usager, on espère dans ce cas outre l’extension de la logique du marché, desserrer les contraintes qui pèsent sur l’ajustement des finances publiques, notamment en conciliant entre la rédaction du déficit budgétaire et celle de la pression fiscale. Ceci étant, la sphère de la fiscalité demeure soumise à son tour à des impératifs contradictoires qui n’en rendent la reforme que plus difficile. Comment atteindre les objectifs que sont : le rendement financier, efficacité économique et équité sociale. Que vise toute reforme fiscale ? 317 1°) le Rendement fiscal Elle peut l’illustrer par la courbe de LAFFER :’ l’objectif « de rendement financier peut être atteint en accroissant les recettes fiscales sans alourdir la pression fiscale. L’objectif à cet égard des PAS est de dégager un surplus fiscal permettant de rembourser la dette extérieur principalement publique. Cependant le problème est que force est de constater à quelques exceptions près, la Pression Fiscale a déjà atteint ou dépassée ses limites. De sorte qu’on affirme qu’une nouvelle évaluation des taux peut rapporter un montant inférieur de recettes fiscales, si le niveaux d’imposition et les taux marginaux sont élevés ». C’est dire que la référence de « l’impôt qui tue » est omniprésente. Par ailleurs, on affirme que le coût de l’impôt augmente dans une plus forte proportion que le taux d’imposition débouchant sur le risque de voir l’épargne intérieure diminuer, l’ardeur au travail baisser, la croissance ralentir .... 2°) L’efficacité Aménager les conditions de l’efficacité en choisissant des bases d’imposition qui augmentent parallèlement aux dépenses et non au PIB semble être une bonne stratégie .Les dépenses pouvant augmenter les recettes devraient alors provenir d’un petit nombre d’instruments assis sur une large base « il suffira alors de modifier quelques taux d’imposition pour ramener le total des recherches a&u niveau voulu ». Toujours du point de vue l’efficacité il est préférable de recruter une structure fiscale relativement neutre c'est-à-dire qui procure des recettes nécessaires tout en influençant le moins possible l’affectation des ressources. À cet effet Vito TANZI énonce 5 conditions qui assurent l’efficacité d’un système fiscal. 1ère condition : Présenter un indice de concentration élevé (collecter une grande part des recettes à partir d’un petit nombre d’impôt) ; 2ème condition : Présenter des indices d’érosion faible, de sorte que l’assiette ponctionnée approche le plus possible son niveau potentiel ; 3ème condition : De brefs retards dans le recouvrement de l’impôt ; 4ème condition : Prévoir des pénalités sérieuses pour les fraudeurs ; 5ème condition : Éviter des prélèvements spécifiques. 3°) L’équité Les experts de la BM et du FMI mettent l’accent sur le financement des dépenses distributives car estiment que la justice peut être davantage une question de réduction des différences entre dépenses des ménages, qu’entre des revenus personnels et il précise dans la pratique les impôts ne semblent guère être un moyen de modifier la répartition générale des revenus , leur rôle important du point de vue d’équité et qu’ils fournissent les recettes nécessaires pour payer les dépenses distributives en particulier , en vue d’améliorer les conditions des pauvres. En d’autres termes il revient à la politique d’ajustement structurel de faire évoluer les systèmes fiscaux pour les moderniser les rendre plus simples, plus cohérentes et surtout les permettre de favoriser l’extraversion des économies d’une part et la promotion d’un capital privé d’autre part. Cependant, la réalité est tout autre les ajustements réalisés se sont révélés souvent inadéquats ou inefficaces, et presque toujours régressifs. 318 Mais la reforme réalisée durant les années 80 n’a pas que des défauts, elle est à l’origine de progrès notables dont le plus important est le fait qu’elle ait enfanté de nouveaux outils qui bien que sensiblement amandés, pourraient constituer de bons instruments. En somme tous les États africains avaient une caractéristique commune : des déficits budgétaires qui ont tendance à s’amplifier ce qui précarise totalement les finances publiques. Par ailleurs, les Finances publiques partagent toutes d’une part une grande spécificité des finances publiques avec des recettes budgétaires différentes en Afrique relativement aux autres PVD ? Les dépenses budgétaires également sont spécifiques avec la particularité de la soutenabilité du déficit et les modes particuliers de la réalisation de l’équilibre. L'État est le principal facteur de déséquilibre. Dans les périodes d'instabilité, le comportement de l'État aboutit souvent à une baisse des recettes budgétaires et à une hausse des dépenses ce qui contribue au creusement du fait et le recours à l’endettement extérieur avec par moment des conditions de prêts défavorables. C’est dire que les finances publiques souvent stabilisées mais rarement ajustées: conséquences économiques et sociales ce qui va entrainer deux conséquences: la première se situe au niveau des dépenses courantes qui imposent la réduction de la masse salariale et l’arbitrage sévère des dépenses de matériel et d'entretien ce qui va entraîner la baisse d'efficacité de l'administration et le gâchis de certains investissements, contrôle des dépenses sociales. La seconde conséquence se situe au niveau des investissements qui ont besoin d’une allocation prioritaire. IV/ La politique de change Elle comporte au préalable la restructuration des services publics et des services financiers avec la mise en place de mesures d'assainissement et de diversification des systèmes financiers. La politique de change, instrument de politique économique, comporte deux (02) volets: la définition du régime du taux de change et les réglementations des opérations de change. - Les objectifs de la politique du taux de change : le taux de change d'équilibre à long terme la stabilité du taux de change Les options en matière de régime de change change fixe et change flottant rattachement des monnaies Les choix et leurs conséquences l'intégration économique et la coordination des politiques économiques 319 Schéma : Ajustement structurel du volet de la politique institutionnelle Libéralisation de l’économie Vers le moins d’Etat Efficience de l’Etat Désengagement de l’Etat des secteurs économiques : - Production agricole - Institutions de support - Commercialisation et - transformation agricole Désengagement de l’Etat dans le reste de l’économie : - Infrastructures et biens publics (routes, ports, éducation, santé) ; - Réduction des effectifs de la fonction publique Amélioration du contrôle financier Amélioration du recouvrement des recettes fiscales Vers un «meilleur» Etat Vers le Amélioration de la gestion financière, du personnel, du moins d’Etat matériel et des équipements Vers le moins d’Etat Section 3 : Les coûts sociaux de l’ajustement. En fait, les programmes d’ajustement structurel, partout où ils sont appliqués, et quel que soit le résultat a induit des conséquences négatives sur les dépenses sociales. Aussi bien en matière de revenus, d’emploi, de logement, de santé et d’éducation, les coûts unitaires ont été fortement augmentés. Selon les analystes du développement, les pays en développement qui ont le mieux réussi à réduire la pauvreté, notamment les pays de l’Asie, ont dû engager très tôt leur transition démographique mais surtout sont parvenus à fournir des services essentiels de santé et d’éducation à la majorité de la population aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural et ont lourdement investi dans les services sociaux. Or, dans les années 80, les politiques de stabilisation appliquées en Afrique se sont avérées très coûteuses du point de vue social et elles se sont conjuguées aux facteurs d'environnement défavorables pour réduire la qualité de vie des populations des PSD. La pauvreté est devenue la réalité dominante du monde contemporain. Toujours présentes dans l'histoire économique et sociale du monde, les inégalités entre le Nord et le Sud, entre les pays, les villes et les campagnes, entre les individus ont pris des dimensions extrêmement graves. Une question qui vient immédiatement à l'esprit quand on parle de pauvreté est celle de savoir comment identifier les pauvres. Pour répondre à cette interrogation, différentes études sur la pauvreté ont été proposées et elles permettent de répondre à cette question et à certaines autres comme: Qui sont les pauvres ? 320 - Combien y a t-il de pauvres et quelle proportion représentent-ils dans la population ? Quel est leur degré de pauvreté ? Où vivent-ils ? Quels groupes socio-économiques sont les plus pauvres ? Quels groupes sont exposés à la pauvreté ? La pauvreté augmente-t-elle ou diminue- t-elle dans le temps ? Répondre à la première question à savoir qui sont les pauvres, revient généralement à déterminer le seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté peut être déterminé à partir des revenus ou de dépenses de consommation alimentaire ou totale. La première méthode consiste à classer les ménages par fractile de revenu (quintile, décile, ...) et à déterminer pour chaque fractile le niveau de revenu en deçà duquel le ménage ou l'individu est considéré comme pauvre, c'est-à-dire incapable d'assurer le minimum vital. La deuxième méthode basée sur les dépenses de consommation consiste à déterminer le niveau de dépenses minimum qui permet à l'individu d'assurer le minimum vital, c'est-à-dire les 2.400 calories par équivalent adulte. Il est important de souligner que chaque méthode de détermination du seuil de pauvreté comporte des avantages et des limites. La méthode de détermination du seuil de pauvreté basée sur les revenus n'est pas adaptée aux pays africains. D'abord, les pays africains ont une importante population agricole. Les revenus des ruraux sont fortement dépendants des aléas climatiques et des cours du marché international. L'autoconsommation est un élément important qui contribue à la survie des populations, notamment à travers les systèmes de solidarité familiale, de culture vivrière d'autosubsistance, etc. Le niveau du revenu monétaire n'est pas suffisamment accoutumé pour savoir si un ménage est dans une situation de pauvreté ou non. La détermination du seuil de pauvreté à partir des dépenses de consommation des ménages présente l'avantage de refléter mieux le niveau de vie des populations. Cette méthode permet d'évaluer les dépenses effectives des ménages qu'il s'agisse de dépenses alimentaires ou non alimentaires, quelque soit la source de financement de ces dépenses. Il ne faudrait pas perdre de vue que même les indicateurs calculés à partir de la consommation sont des mesures moyennes qui portent généralement sur des données annuelles. Ainsi, n'appréhendent-ils pas le caractère saisonnier de la pauvreté ? Certains ont été donc amenés à distinguer entre la pauvreté chronique et la pauvreté transitoire. La première renvoie au caractère structurel de la pauvreté alors que la seconde en saisit le caractère saisonnier. Le phénomène de la disette, bien connu dans les pays du Sahel, relève de la pauvreté transitoire. Les sources de données utilisées dans ce genre d'exercice sont les enquêtes budget-consommation qui commencent à être disponibles dans beaucoup de pays en développement. Ces enquêtes ont l'avantage de fournir beaucoup d'informations sur les dépenses et revenus des ménages, l'accès aux infrastructures de base (santé, éducation) indicateurs sont utilisés. Mais ils ne présentent pas tous la même robustesse. Mais on a pendant longtemps pensé qu'une forte croissance économique était suffisante pour l'éliminer. L'après deuxième guerre mondiale a montré la coexistence de la montée des inégalités, de la pauvreté et de l'augmentation continue du produit par tête. Le regain d'intérêt de la littérature économique pour la problématique de la pauvreté est un reflet de la préoccupation grandissante des opinions publiques, nationales et internationales, à l'égard de la montée de ce phénomène. 321 Section 4 : Limites des politiques d'ajustement et l’amorce du post-ajustement L’ajustement structurel a généralement été assez bien admis puisque tous les États africains se sont dotés de PAS largement inspirés des thèses néo-libérales en vogue dans les années 80. Ces PAS, aux résultats très médiocres, ont fait l’objet de critiques sévères concernant leur mise en œuvre concrète : réformes imposées de l’extérieur sans mobilisation des acteurs et des ressources internes, prescriptions standards ignorant l’histoire et les réalités socio-économiques locales, ignorance ou impasse complète des structures institutionnelles. Indispensables à la mise en œuvre des PAS. Mais au-delà de ces critiques empiriques, émerge dans les années 90, une remise en cause plus fondamentale du néo-libéralisme monétariste et de l’ensemble de l’analyse néo-classique. Les critiques formulées peuvent être présentées sous les 04 axes qui suivent : 1°) L’aggravation de la pauvreté et l’absence d’un modèle de répartition des revenus La mise en œuvre des politiques d’ajustement structurel a conduit les Institutions Financières Internationales à oublier la lutte contre la pauvreté qui constituait pourtant l’objectif essentiel revendiqué dans les années 1970. En pratique, ces politiques, du fait de leur priorité macro-économique, n’ont comporté aucun filet de sécurité, aucune mesure spécifique de correction, visant à endiguer l’aggravation de la pauvreté et la dégradation des conditions de vie des couches les plus démunies, directement et fortement touchées par les économies budgétaires (voir A.H. SARRIS). Le constat de la montée de la pauvreté, comme constaté au chapitre précédent, débouche sur une question théorique nouvelle : l’objet de l’économie peut-il se résumer à la recherche de l’efficience maximale dans l’allocation des facteurs de production par le marché, indépendamment de toute préoccupation quant à la répartition des richesses ainsi créées ? Ce postulat ne sous-entend-il pas que la distribution sociale s’opère selon des critères socio-politiques, exogène donc à la rationalité économique ? Ne faut-il pas partir du postulat opposé et considérer au contraire que la répartition des richesses est un facteur économique endogène déterminant, qui contribue à définir l’efficience des facteurs de production ? Comment ignorer, par exemple, que l’accès à l’éducation ou à la santé, largement façonné par les politiques de répartition, modèle de manière fondamentale la productivité du travail et des ressources humaines ? Comment ignorer également l’impact qu’à la répartition des richesses sur l’orientation sectorielle des investissements et de la production, du fait de la diversité des comportements d’épargne et consommation des différentes couches sociales ? Ces questions font apparaître que le paradigme sur lequel se sont fondées les politiques d’ajustement ignore des pans essentiels du champ de l’analyse économique. 2°) Le marché possède un pouvoir d’incitation limité La foi exclusive dans les vertus du marché a souvent conduit à surestimer les capacités de réponse des agents économiques, et notamment des agriculteurs, aux incitations par les prix. Force est de constater que, dans bien des cas, l’offre agricole n’augmente pas toujours de manière aussi importante ou aussi rapide que prévu. Non parce que les agriculteurs seraient insensibles aux prix mais parce que l’incitation par 322 les prix, si elle est une condition nécessaire, n’est pas toujours une condition suffisante au développement de la production. Interviennent d’abord les comportements antirisque de producteurs, avant tout soucieux de se protéger contre l’instabilité des prix inhérente aux marchés des produits agricoles (voir notamment les travaux de BOUSSARD). Interviennent aussi les contraintes structurelles extérieurs au marché final (accès aux intrants, à la technologie, au financement surtout) qui limitent la capacité d’augmentation de la production de chaque agriculteur. Le coût du crédit, et surtout la couverture du risque (garantie exigée par les organismes prêteurs), sont ici des freins puissants à l’accumulation des moyens de production par les producteurs les plus démunis, les moins à même précisément de fournir les garanties de crédit exigées. Peut-on espérer que le seul jeu du marché du crédit, qui tend à renchérir le coût des prêts lorsque les risques augmentent, puisse répondre à ce besoin essentiel de couverture du risque des producteurs les moins nantis (souvent la grande masse de la paysannerie) en dehors de toute institution publique ou coopérative d’assurance et de péréquation des risques ? 3°) L’impératif de la mondialisation : discours libéral et pratiques protectionnistes L’ouverture à la concurrence internationale par la réduction des taxes à l’exportation et des subventions à l’importation constitue un levier essentiel des politiques d’ajustement structurel. En effet, la recherche de l’efficience maximum dans la valorisation des facteurs dont chaque pays est doté suppose une spécialisation internationale dans les productions pour lesquelles le pays est comparativement le mieux placé. Cette doctrine, théorisée par Ricardo, il y a plus d’un siècle, est essentiellement statique. Elle suppose une immobilité internationale complète du capital et du travail et une rémunération homogène des facteurs dans les différents pays échangeurs (qui est loin d’être réalisées aujourd’hui). Elle implique encore une réciprocité complète et une symétrie parfaite dans la manière de traiter les échanges internationaux dans les différents pays partenaires. Or, en matière d’échanges agricoles en tout cas, les pays développés, conduits par les États-Unis et l’Union européenne, continuent de protéger activement leurs marchés. De ce point de vue, le nouvel accord de l’OMC, bien qu’induisant les changements importants dans la distribution des soutiens agricoles, ne modifie pas de manière déterminante l’avantage considérable que confère aux agriculteurs des pays industriels le maintien d’importants transferts publics à leur profit (voir K. ANDERSON). Comment dans ces conditions, avec une productivité du travail initiale bien inférieure, les pays soumis à l’ajustement structurel peuvent-il espérer être compétitifs sinon par une sous-rémunération accrue de leur main- d’oeuvre, qui ne pourra que renforcer la paupérisation et la crise d’accumulation dans leur agriculture et, au plan macro-économique, la récession par la demande que la pression sur le revenu agricole induit ? Cette libéralisation inégale, par delà la question de morale politique qu’elle pose, soulève des questions de théorie économique. À partir du moment où les marchés ne sont plus des marchés de libre concurrence mais des marchés oligopolistiques, la théorie ricardienne perd sa validité. Comme le montrent certaines théories économiques modernes (voir notamment la théorie du protectionnisme stratégique développée par P. KRUGMAN), dans ce cas l’optimisation de l’emploi des facteurs de production passe par une certaine dose de protectionnisme ou, en tout cas, par une intervention active des pouvoirs publics et économiques pour créer les structures favorables à l’avantage concurrentiel (voir les travaux de PORTER). Ces quelques 323 considérations appellent, par-delà le doute sur le bien-fondé d’une ouverture systématique sur les marchés internationaux, à revoir le lien indissoluble qu’établissent les politiques d’ajustement structurel entre le rétablissement des équilibres macroéconomiques internes et l’ouverture externe. Cet aggiornamento théorique ne ferait d’ailleurs que retrouver la pratique : de l’aveu même des bailleurs de fonds internationaux, la libéralisation se réduit le plus souvent à une réduction des protections à un niveau «raisonnable». 4°) L’économie politique oubliée La plupart des experts et des chercheurs reconnaissent aujourd’hui que l’économisme étroit des analyses, justifiant les politiques d’ajustement structurel, bute sur une réalité économique, sociale et politique beaucoup plus complexe que ne le laissent entrevoir les schémas mécanistes de l’ajustement macro-économique. Conçu au départ pour favoriser les couches sociales productives les plus nombreuses, à commencer par la paysannerie, l’ajustement structurel se heurte à des rapports sociaux bien vivaces. Dans bien des cas, les couches sociales dominantes, bien représentées dans l’appareil d’État, détournent les mesures d’ajustement susceptibles de les pénaliser et reportent sur les couches les moins organisées et souvent les plus démunies (dont la paysannerie), le poids de la contrainte d’ajustement. De ce fait, l’analyse économique ne peut continuer à ignorer l’économie politique (voir J. BEGHIN et M. FAFCHAMPS). Dès lors, on peut manquer de noter le contraste entre l’ambition des ajustements économiques proposés et la modestie, voire l’inexistence, des recommandations concernant les ajustements politiques nécessaires. Peut-on alors concevoir une libéralisation économique sans une libéralisation politique parallèle, qui rende aux citoyens, aux collectivités territoriales et aux groupes socio-professionnels la capacité de s’organiser librement pour avancer dans la construction d’une économie de marché régulée de manière socialement plus équitable et politiquement plus conforme au schéma pluraliste ? Certes, la dimension politique, pour essentielle qu’elle soit, échappe au domaine d’intervention des organismes financiers internationaux. Ce sont ces critiques qui ont poussé à la recherche de nouvelles voies alternatives à la politique d’ajustement structurel ; ce que BEN HAMMOUDA appelle le post-ajustement dont il faut analyser les quelques idées fondatrices. 324 325 Les difficultés actuelles de la plupart des pays africains dont les manifestations les plus tangibles résident dans les déséquilibres économiques et financiers chroniques et l’accentuation des déficits vivriers, trouvent leur origine lointaine dans les structures héritées de la colonisation que les politiques et stratégies de développement post indépendance n’ont pu modifier profondément. Parmi les nombreuses caractéristiques économiques échues de la colonisation qui ont induit des conséquences économiques et sociales trois, au moins, méritent d’être soulignées : D’abord le système d’accumulation productive fondé sur la rente agricole et minière continue d’entraîner des distorsions structurelles très prononcées qui se manifestent dans l’accentuation de la spécialisation en faveur des activités exportatrices (d’origine agricole et minière) et le fonctionnement d’un modèle industrialisation en faveur de branches et techniques légères peu compétitive et souvent destinée principalement au marché local; Ensuite la formation d’un déficit alimentaire aggravé par une démographie galopante et une urbanisation accélérée ; ce déficit est la conséquence de la quasi faillite des politiques agricoles qui ont favorisé les cultures de rente au détriment des cultures vivrières181 et produit un exode rural massif constituant la gangrène urbaine ; L’accentuation des défaillances de caractère macroéconomique (double déficit de la balance des paiements et des finances publiques) et macro financiers (inflation, endettement interne et externe) suite aux faibles performances des systèmes productifs et à la précarité des bases de l’accumulation productive (déficit d’épargne). Ces déficits se résolvent par recours à l’endettement et aux capitaux extérieurs, deux phénomènes qui font de l’économie mondiale une réalité ultime. Les solutions, sous plusieurs angles, passent par la formulation et la mise en œuvre de politiques économiques d’accroissement de l’offre de production permettant la création d’un flux abondant de richesses en vue de la réalisation du bien-être des populations. Faut-il le rappeler, la politique économique est précisément l’ensemble des actions délibérées de l’État qui visent à réaliser un certain nombre d’objectifs économiques et sociaux parmi lesquels figurent pour les PSD, la croissance du PIB et du niveau de vie, l’utilisation optimale des ressources naturelles et de la main d’œuvre, l’équilibre des échanges et des paiements extérieurs, la stabilité des prix. Dans cette optique, la politique est dite sectorielle ou encore structurelle lorsqu’elle porte sur des secteurs d’activités comme l’agriculture, l’industrie, les services, le commerce avec pour objectifs de rendre durablement plus efficient l’appareil productif sur une période longue. qui peuvent modifier à moyen et long terme le fonctionnement de l’économie. Les théories et les analyses, prenant appui sur l’exemple des pays développés, où l’accumulation et la mobilisation du capital physique sont apparues comme les facteurs décisifs du développement agricole et industriel, proposent des stratégies et politiques économiques que doivent suivre les États pour élever le niveau de leurs forces productives matérielles et humaines à partir d’investissements massifs dans les secteurs d’activité porteurs de croissance comme les infrastructures de base, l’agriculture, l’industrie, le tertiaire, la technologie etc. Parmi les éléments caractéristiques de ces stratégies et politiques de développement se détachent sans aucun doute, les politiques agricoles, industrielles Le phénomène est bien connu : les pays produisent essentiellement ce qu’ils ne consomment pas et consomment conséquemment ce qu’ils ne produisent pas. 181 326 et technologiques, la politique commerciale ainsi que la contribution de l’État à la création d’un ensemble d’externalités positives sans lesquelles ces diverses politiques seront difficiles et beaucoup trop onéreuses pour les diverses entreprises privées et publiques. Au demeurant, toutes ces politiques auxquelles s’ajoutent le maintien d’une économie monétaire, bancaire et fiscale qui stimule le développement et élève substantiellement les taux d’épargne et d’investissement, la diversification de la production et les incitations pour l’affluence des IDE, devraient permettre d’asseoir les bases d’une économie moderne et d’augmenter les surplus mobilisables pour le financement des investissements productifs. Au seuil du 21ème siècle, la production moyenne africaine était inférieure à ce qu’elle était 30 années auparavant. Selon la Banque mondiale, dans certains pays, elle avait même chuté de plus de 50%. Dans de nombre d’entre eux, les ressources financières en chiffres absolus par habitant étaient plus faibles qu’à la fin des années 60. La part africaine au commerce mondial a reculé et compte pour moins de 2%. « De plus l’Afrique est restée à la marge de l’expansion industrielle et elle risque de rater la Révolution informatique mondiale avec le creusement du fossé numérique. Contrairement à d’autres pays qui ont opté pour la diversification, la plupart des pays africains demeurent en bonne partie des exportateurs de produits primaires. Ces pays dépendent aussi de l’aide et sont extrêmement endettés »182. La quasi-totalité des pays africains, techniciens comme les décideurs politiques adhèrent aux orientations et options faisant de l’agriculture le secteur prioritaire avec trois objectifs majeurs: La formation de surplus pour alimenter le fonds d’accumulation et contribuer au financement des importations de biens d’équipement et de consommation intermédiaire ; La couverture des besoins vivriers et autres biens destinés à d’autres secteurs; L’élargissement du marché national par les revenus distribués aux producteurs directs ; La libération d’une partie de la main d’œuvre pour d’autres activités suite à un accroissement de la productivité du travail par actif rural et par surface cultivé. L’ampleur actuelle du retard des PSD est liée dans une très grande mesure à des facteurs démographiques qui compliquent considérablement les problèmes avec un doublement de la population tous les 20 ans. La population augmente et demeure principalement rurale, l’intensification de l’agriculture est extrêmement lente dans la plupart des PSD. Le retard de l’agriculture entraîne à son tour une pénurie aiguée de produits alimentaires que les pays doivent importer en quantités croissantes. Cette aggravation du problème alimentaire a aussi une incidence négative sur l’industrialisation car premièrement, une part toujours plus importante des recettes en devises est employée à l’achat de produits alimentaires à l’extérieur et, deuxièmement, la nécessité d’accroître la production agricole nationale restreint les investissements dans l’industrie Selon les prévisions démographiques, la croissance de population. Le problème alimentaire concerne avant tout le monde sousdéveloppé où des millions de personnes souffrent de la sous-alimentation et de la disette. Certains États disposent de richissimes ressources minérales et énergétiques et possèdent en même temps une base extrêmement restreinte de croissance économique avec un niveau scientifique et technique extrêmement bas. Malgré leurs immenses richesses les populations les États ne profitent pas des acquis de la Révolution Scientifique et Technique. La dynamique de la productivité du travail 182 Banque mondiale : L’Afrique peut-elle revendiquer sa place dans le 21ème siècle p.11 327 n’est pas non plus à l’avantage des PSD. La part de ces pays dans les dépenses de recherche développement n’est qu’un peu plus de 4%. L’agriculture se voit impartir des fonctions socio économique exorbitantes et pour les réaliser des réformes profondes du secteur s’avèrent indispensables. Il y a un peu plus d’une quarantaine d’années, la situation alimentaire était catastrophique en Asie suite à une gestion désastreuse du secteur agricole et largement excédentaire en Afrique. Aujourd’hui, elle s’est totalement inversée avec « des greniers pleins en Asie et vides en Afrique. Cette nouvelle donne a une triple signification : elle est un cri d’alarme, une mise en garde et un massage d’espoir. En une quarantaine d’années, l’Asie a entrepris d’immenses réformes agraires et mis en culture 70 millions d’hectares, exactement l’équivalent des terres cultivées en Afrique. Cette production céréalière a augmenté de 175% dans la période alors que celle de l’Afrique s’est accrue de seulement 17%. Toutefois, les performances asiatiques apportent la preuve que l’Afrique qui a plus de dotations factorielles peut s’en sortir à condition de mettre en œuvre des stratégies vigoureuses de développement agricole183. Cela suppose entre autres mesures : moderniser les méthodes culturales, implanter un régime de prix incitatifs, conserver dans les zones rurales une offre illimitée de main d’œuvre qui doit contribuer à maintenir les salaires à un niveau très bas, créer un module de développement et une forme de distribution qui permette de transférer une partie des surplus vers les villes et enfin accélérer la formation et l’expansion du marché intérieur, à travers une offre croissante de multiples produits commerciaux. Qu’en est-il de l’industrialisation que la théorie économique désigne comme la voie royale de création de capacités productives ? Les théories économiques tentent d’établir que l’industrialisation doit être un objectif majeur car elle autorise : la valorisation des matières premières locales, et partant, l’accroissement de la valeur ajoutée pour la quasi-totalité des agents économiques, la résorption du sous emploi, et une augmentation du savoir faire, du savoir quoi faire des acteurs. Toutefois, compte tenu du stock limité des capitaux physiques et humains, de la diversification des tissus industriels et des nouvelles spécialisations, des formes multiples de délocalisation, la question se pose de savoir quel modèle d’industrialisation adopter ?184 La question est d’autant plus importante que le modèle d’import substitution a produit de médiocres résultats avec de faibles liaisons avec les autres secteurs notamment l’agriculture. La réponse asiatique a été la réalisation d’une transition de l’Industrialisation de substitution aux importations à l’industrialisation par promotion des exportations. Comment réaliser les principales articulations : Agriculture/industrie, Industries légères/industries lourdes, Techniques fortes consommatrices de main d’œuvre /techniques à forts coefficients capitalistiques ? Un volet important du développement concerne la politique technologique qui est une question transversale. En fait les innovations technologiques de plus en plus nombreuses et rapprochées bouleversent complètement les systèmes productifs et modifient profondément les conditions de la compétitivité. Cela fait dire à KONDRATIEF et J. SCHUMPETER que ces révolutions techniques qui apparaissaient une ou deux fois par siècle engendraient les grands cycles de la vie économique. Dans cette période de mutations technologiques accélérées avec une diffusion verticale rapide de la recherche vers l’application et une diffusion Moustapha KASSÉ : L’État, le technicien et le banquier face aux défis du monde rural, Éditions NEA Dakar, 1994 184 En voie d’édition : Moustapha KASSÉ : l’industrialisation est-elle encore possible ? Editeur : Presses Universitaires du Sénégal 183 328 horizontale également rapide d’un secteur à l’autre, la question se pose pour les PSD de savoir comment gérer cette nouvelle variable qui peut hâter le développement ou alors les larguer complètement dans la compétition mondiale. Cette Partie étudie aussi d’autres politiques qui soutiennent les politiques sectorielles à proprement parler comme la politique monétaire, la politique commerciale et la politique de recours à l’endettement Extérieur, aux Investissements Directs Étrangers et à l’Aide Publique au Développement pour combler le déficit de financement interne dû à la faiblesse de l’épargne domestique. 329 CHAPITRE 15 L’AGRICULTURE PEUT-ELLE ETRE LE MOTEUR DE LA CROISSANCE ET DU DÉVELOPPEMENT ? Dans les premières étapes de l’industrialisation, particulièrement en Europe au siècle, l’agriculture a été le facteur primordial du développement économique et social. Dans la plupart des pays, plus de la moitié de la population vivait directement de l’agriculture qui fournissait la partie essentielle de la production. Il est donc évident que le développement global suppose et débute souvent avec le développement de l’agriculture. La génération d’un surplus agricole (au-delà de ce qui est nécessaire pour nourrir les travailleurs du secteur) a permis de financer l’industrialisation en lui fournissant les gains de devises. L’expérience historique montre d’ailleurs que toutes les révolutions industrielles en Europe comme en Asie ont été précédées par d’importantes révolutions agraires. Plus près de nous, en Asie, l’agriculture se trouve à l’origine de l’industrialisation. Après avoir réalisé sa réforme agraire, le Japon a transformé toutes ses colonies d’Asie en colonies agricoles productives et prioritairement en greniers à riz. L’agriculture conditionnait les investissements dans le secteur industriel naissant et bénéficiait d’importantes infrastructures de base : énergie hydro-électrique, infrastructures de transport et de communication, infrastructures portuaires. Tout cela avait été précédé par une confiscation des terres des hobereaux locaux par l’administration coloniale. Après leur libération, ces pays ont continué de faire de l’agriculture la clef de leur stratégie de développement. En définitive, les rendements agricoles ont souvent été supérieurs au croît démographique, ce qui n’est pas le cas en Afrique. Globalement dans les PSD, l’agriculture occupe une place centrale et exerce des fonctions importantes. Elle est souvent la principale source d’activités économiques et sociales et la plus grande pourvoyeuse d’emplois grâce à une maind’œuvre abondante et peu formée. Également, elle est la première source de revenus dans les zones rurales où vivent encore actuellement la majorité des pauvres. En effet, malgré cette importance capitale et ses multiples incidences sur le PIB, l’emploi, et la balance commerciale, les statistiques établissent d’une part, que le niveau de vie de la paysannerie reste encore très faible et qu’il ne cesse de se détériorer et d’autre part, que les niveaux de productivité et le degré d’utilisation des facteurs modernes de production reste assez modeste. En poussant un peu plus le constat, on s’aperçoit que l’agriculture africaine est dans une situation encore plus grave : une crise larvée aussi bien au niveau du secteur vivrier qu’à celui des cultures de rente : baisse de la production alimentaire par tête d’habitant, diminution des exportations de produits de rente en volume et en valeur, détérioration du niveau de vie des populations rurales complètement gagnées par la pauvreté. L’Afrique a remplacé l’Asie et l’Amérique Latine dans le recours à l’aide alimentaire. Un Rapport prospectif de la Banque mondiale (1990-2020) est encore beaucoup plus pessimiste, puisqu’il prévoit dans l’intervalle le doublement des importations alimentaires. Ce tableau des indicateurs comparés des agricultures d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine montre le retard de l’Afrique par rapport aux deux autres continents et il révèle surtout le manque de compétitivité de ce secteur dont dépendent plus de 70% de sa population. La Banque mondiale résume la situation comme suit : En Afrique, moins de 7 pour cent de la surface cultivée sont irrigués. L’achat d’intrants y est limité de même que la mécanisation, les rendements de céréales (reflet de la productivité des terres consacrées à la production céréalière 19ème 330 sont inférieur à la moitié de ceux qui sont observés dans d’autres régions en développement. Même dans le cas des tubercules et de la banane plantain qui trouvent de bonnes conditions agro écologiques en Afrique, les rendements sont inférieurs à ceux obtenus en Asie et en Amérique latine la productivité du travail n’est pas très forte en agriculture ; dans le passé, le produit marginal du travail a été à peu prés le même que le produit moyen, tandis qu’en Asie et en Amérique Latine, le produit moyen du travail est nettement supérieur au produit. Encadre : Situation comparative de l’agriculture dans les 3 Continents En Afrique, moins de 7 pour cent de la surface cultivée est irriguée, l’achat d’intrants y est limité de même que la mécanisation, les rendements de céréales (reflet de la productivité des terres consacrées à la production céréalière sont inférieur à la moitié de ceux qui sont observés dans d’autres régions en développement. Même dans le cas des tubercules et de la banane plantain qui trouvent de bonnes conditions agro écologiques en Afrique, les rendements sont inférieurs à ceux obtenus en Asie et en Amérique latine la productivité du travail n’est pas très forte en agriculture ; dans le passé, le produit marginal du travail a été à peu prés le même que le produit moyen, tandis qu’en Asie et en Amérique latine, le produit moyen du travail est nettement supérieur au produit marginal (DELGADO ET RANADE 1987). En 1988 – 92 le stock de capital agricole par hectare de terre agricole en Afrique représentait environ le sixième de celui d’Asie et moins du quart de celui d’Amérique latine (CNUCED 1998).La sous capitalisation est liée au manque de compétitivité des produits africains sur les marchés mondiaux. D’autres facteurs viennent encore aggraver cette situation ; coût élevé des transactions (AHMED ET RUSTAGI 1987 ; JAFFEE et MORTON 1995), faiblesse des institutions et des services de soutien (EICHER 1999) manque de diversification et d’intégration verticale (Delgado 1998b) en conséquence, l’agriculture africaine s’est trouvée constamment marginalisée dans le commerce mondial (NG ET YEATS 1996) Histoire et politiques. L’agriculture africaine est marquée par des siècles de mauvaises politiques et d’échecs sur le plan institutionnel, et elle porte un lourd passé d’extraction des ressources et d’imposition fiscale dans les zones rurales. Les améliorations apportées aux politiques entre le milieu des années 1950 et la fin des années 1960 n’ont pas eu d’effets durables. Les distorsions ultérieures de ces politiques – sous la forme d’une évaluation des taux. Source : Banque mondiale L’expérience montre que les agricultures des PSD n’ont pas rempli les rôles historiques qu’elles ont tenus ailleurs en Europe, en Asie et même dans certains pays d’Amérique Latine. En résumé ce rôle se présente sous les fonctions suivantes : la couverture des besoins vivriers d’une population en augmentation rapide (parfois à un taux supérieur à 2,5%) ; la formation de surplus substantiels pour l’élargissement de ses bases sociales et matérielles, et le financement d’autres secteurs comme l’industrie ; la libération d’une partie de la main-d’œuvre pour d’autres secteurs par suite d’une augmentation de la productivité du travail agricole ; la formation d’une demande de biens industriels et de services. 331 La première fonction est la plus importante et elle consiste à répondre à la demande de produits vivriers d’une population croissante et fortement urbanisée et disposant d’un niveau de revenu par tête qui augmente. Dans ce cadre, une production agricole stagnante entraînerait une hausse des prix alimentaires et pour le secteur industriel une hausse des salaires, ce qui réduirait d’autant plus le potentiel d’épargne et d’investissement et accroîtrait les importations alimentaires Dans pareille situation, les moyens en devises disponibles pour l’achat par exemple de biens d’équipement industriel nécessaire à la poursuite de l’industrialisation vont diminuer. Cette situation se présente lorsque les conditions d’existence et de travail des paysans sont précaires, du fait de l’archaïsme des méthodes et moyens de travail, du faible niveau de mécanisation et d’irrigation, du bas niveau d’utilisation des facteurs modernes de production agricole, de la faible diversification et prédominance de la monoproduction de rente , de la faiblesse des marchés urbains et de la faible consommation finale et intermédiaire de produits manufacturiers et de l’absence de liens avec l’industrie. Dans le cadre des PSD, le secteur vivrier est loin de répondre aux besoins en biens alimentaires d’une population en expansion rapide et d’une urbanisation accélérée. Ce déséquilibre en Afrique est à la base d’une crise alimentaire aggravée par des facteurs liés aux instabilités de la nature (les sécheresses, les inondations, le péril acridien, et d’autres calamités) et ceux découlant de la détérioration des espaces politiques avec les guerres civiles et les divers conflits qui affectent principalement les populations rurales (déportés et déplacés). À cela viendra s’ajouter le modèle de consommation des villes qui porte principalement sur des biens importés et non produits par les systèmes agraires locaux (riz, blé et autres céréales). Quant à la deuxième fonction, elle est relative aux surplus provenant des agricultures. Ils sont déprimés d’abord par le niveau peu rémunérateur des prix agricoles souvent fixés par les administrations publiques. Les paysans sont purement et simplement spoliés par les diverses officines de commercialisation privées ou publiques. La différence entre le prix d’achat aux paysans et le prix de commercialisation extérieure est souvent importante. Elle se répartit entre les coûts d’usinage et de transport, les marges de commercialisation et autres prélèvements des intermédiaires. Les producteurs directs finissent par ne percevoir qu’environ les 2/5 du prix d’achat. La troisième fonction concerne la libération de l’excédent de main-d’œuvre qui relève d’une logique toute spécifique car elle n’est pas commandée par une élévation de la productivité du travail agricole. En effet dans le cas des pays développés, l’agriculture familiale a été modernisée à un moment où l'industrie et l'économie urbaine étaient en pleine expansion et pouvaient absorber sans difficulté les surplus de main d'œuvre d’origine rurale. Également à cette période, il était possible de protéger le marché national et de subventionner l’agriculture. Aujourd’hui, du fait des accords internationaux signés avec les Institutions Financières Internationales, les États ne peuvent plus utiliser certains instruments de politique économique, ni continuer à soutenir et orienter de façon efficace l'agriculture et le monde rural. Conformément à leurs engagements internationaux, les États suppriment les subventions sur les intrants, les mécanismes de péréquation et de garantie des prix agricoles, éliminent les barrières non tarifaires à l'importation et baissent ou suppriment les droits perçus à l'importation de certains produits. En toute conséquence, la détérioration des conditions du travail agricole entraîne une demande de plus en plus forte d'activités et d'emplois non agricoles en milieu rural pour une population qui continue de croître. Cela crée le chômage endémique qui 332 pousse à un exode rural massif vers les centres urbains, la pauvreté urbaine étant plus attrayante que la pauvreté rurale.185. Enfin la quatrième fonction a trait à l’élargissement du marché intérieur par les achats provenant de la population rurale. Seulement, la campagne africaine est aujourd’hui, le siège de la pauvreté absolue qui fait que la demande rurale de biens de consommation, au regard de la faiblesse des revenus, est extrêmement étroite. De plus, on observe dans le monde rural africain un changement des habitudes de consommation en faveur des biens importés.186 Comme cela a été souvent répété (peut-être de manière simpliste), le riz et le blé sont en train de chasser, jusque dans les campagnes, les céréales et tubercules cultivés localement.187 À ce constat, diverses explications ont été proposées comme les faibles cours mondiaux, l’insuffisance des productions céréalières locales, les effets pervers de l’assistance alimentaire Toutes ces restrictions observées sont souvent la preuve de l’échec des politiques agricoles et ce, malgré de nombreuses réformes structurelles et divers aménagements entrepris par les États africains : politique d’ajustement du secteur agricole, socialisation et collectivisation des campagnes ; peu importe : les résultats dans les deux cas sont simplement décevants. En effet, ces politiques n’ont pas réussi à réduire la pauvreté de masse, le chômage et les inégalités. Il est vrai que des réformes, si volontaristes et si pertinentes qu’elles soient, ne sauraient remplacer une politique agraire assise sur des options claires appuyées par des institutions pertinentes de mise en œuvre. Quelles sont ces réformes entreprises et quelles sont leurs limites effectives ? Section 1 : Les médiocres résultats des réformes du secteur agricole. Dans les PSD, la terre représente la principale source de richesse et la source du pouvoir économique, politique et social. Dans ces conditions, le système de tenure tend à refléter les rapports de production et les structures de classe. Dès lors, sa restructuration, sa répartition par des règles et procédures vont impliquer des changements dans la position économique, politique et sociale des individus ou de certains des groupes dominants au sein de la société. Dans cette optique, l’un des premiers éléments de toute réforme agraire sera d’apporter des modifications significatives et substantielles dans le système de tenure, le régime de propriété et de contrôle des terres ainsi que des ressources en eau. Ces modifications sont posées comme préalables à la création d’emploi et à la redistribution du revenu qui sont devenues des nécessités urgentes. En effet, deux mesures sont souvent considérées comme les préalables à toute réforme agraire : d’une part l’expropriation des grandes propriétés et la redistribution des terres aux cultivateurs individuels et d’autre part la collectivisation des terres issues de l’expropriation. Dans le premier cas la réforme est d’obédience libérale et se Le cas du Sénégal, assez symptomatique, est analysé dans mon ouvrage : L’État, le Banquier et le Technicien face au monde rural sénégalais » (Édit.NEA, 1992). Dans le cas qui nous intéresse, l’application des Programmes d’ajustement Agricole (PASA) a produit deux résultats intangibles et paradoxaux : un recul net des deux principales cultures d'exportation (l’arachide et le coton) et une progression rapide des importations de produits alimentaires pour combler le creusement du déficit vivrier. 186 En Afrique de l’Ouest par exemple, la consommation de riz est en train de se généraliser au point de remplacer les céréales et les féculents locaux. 187 Cette opinion doit être nuancée car ces deux biens alimentaires sont introduits différemment du point de vue quantitatif selon les pays et les régions. 185 333 propose d’exploiter toutes les potentialités du capitalisme agraire ; dans l’autre cas la réforme est d’inspiration socialiste et s’appuie sur la collectivisation et la socialisation de l’agriculture avec une forte intervention de l’État. Il importe alors d’analyser ces deux modes d’organisation du monde rural et d’évaluer leurs performances et surtout leurs capacités à transformer économiquement et socialement le monde rural africain. I/ Les modes d’organisation et de transformation inspirés de principes du libéralisme donnent encore de médiocres résultats. La vision libérale a pour objectifs majeurs la mise en place d’une organisation qui permette l’établissement dans les campagnes de rapports de production et de travail capitalistes ainsi que l’organisation de marchés libres. Ces orientations devraient se traduire par : la généralisation de la forme privative d’appropriation des terres orientée vers la recherche de la rentabilité de l’exploitation agricole que celle-ci soit de petite ou de grande taille ; l’introduction de combinaisons de facteurs de production tournées vers l’efficacité et le profit : investissements en capital, en technologie et en travail qualifié ; la formation d’un salariat agricole. Si de telles conditions étaient réunies, le capitalisme s’instaurerait pour impulser dans les campagnes son dynamisme propre et son mode de reproduction. Pour les libéraux, cette forme de développement agricole est mieux à même d’exploiter toutes les opportunités et de valoriser les capacités humaines pour rendre possible la réduction de la pauvreté de masse, du chômage et des inégalités particulièrement entre villes et campagnes. Si bien que toute réforme dans le secteur agricole soulève les questions comme : qu’est-il advenu de la pauvreté, du chômage et des inégalités ? Le comportement de ces indicateurs (réduction de la pauvreté, du sous-emploi, et accroissement des revenus), permet de juger positivement ou non les performances du développement agricole. Ainsi, si un ou deux de ces indicateurs arrive à s’aggraver, et tout particulièrement s’il en est ainsi des trois, alors il paraîtra hasardeux de qualifier le résultat de positif, même lorsque la croissance économique du pays (ou son revenu per capita) est appréciable. Les Réformes libérales introduites dans les campagnes ont presque toutes comme objectifs principaux l’amélioration de ces indicateurs de performance. Il est bien évident que le développement global suppose et doit souvent débuter avec celui de l’agriculture qui constitue l’activité majeure de la plus grande partie de la population (entre 40 et 70%). Sans la production d’un surplus agricole (au-delà de ce qui est nécessaire pour nourrir les travailleurs de l’agriculture), l’industrialisation ne peut continuer en l’absence de sources alternatives de gains de devises. Il est donc attendu de l’agriculture qu’elle remplisse les fonctions motrices dans le développement économique et social en répondant, entre autres, aux besoins vivriers d’une population en expansion rapide et d’une urbanisation accélérée. Les régimes de propriété de la terre et les réformes de ces derniers constituent un volet important de toute réforme agraire. Alors les systèmes de tenure comprennent tous les arrangements légaux ou contractuels par lesquels la population des campagnes a accès aux opportunités de productivité de la terre. Il reflète les règles et procédures qui gouvernent les droits, devoirs, libertés et positions des individus et des groupes dans l’usage et le contrôle des ressources de base de la terre 334 et de l’eau. En fait, ils commandent aussi bien l’utilisation des facteurs de production (capital, travail et technologie), l’emploi, que la distribution des revenus dans le secteur agricole. Ils influencent le processus de formation des prix sur les marchés agricoles et le recours au crédit (sûreté). Les formes privatives introduites par les changements significatifs et substantiels dans les systèmes de tenure devraient se traduire en fait, par l’amélioration des perspectives d’augmentation de la production et de la productivité et pour autant que soient créées les conditions permettant l’augmentation des investissements et du travail à travers une distribution plus équitable. Par ailleurs, cette libéralisation doit être facilitée par les services de support à l’agriculture : crédit agricole, commercialisation, recherche, offre d’inputs, transformation et stockage. Ainsi, pour réussir, la réforme doit être complétée par la mise en œuvre d’une infrastructure importante dans les domaines de l’énergie hydro-électrique, des transports, des communications, et des infrastructures routières et portuaires. Cependant, l’analyse de la quasi-totalité des agricultures africaines montre un mauvais comportement des indicateurs de performance, ce qui dénote les insuccès des réformes introduites : perpétuation du dualisme avec la coexistence d’un soussecteur dit moderne où évoluent les rapports capitalistes de production et un soussecteur traditionnel archaïque. Les bases du premier sont extrêmement réduites et ne manifestent aucune tendance à l’exclusivité, même s’il arrive parfois que des propriétaires fonciers se transmutent en capitalistes agraires et utilisent des salariés agricoles, alors que le second sous-secteur est régénérateur de formes précapitalistes avec des méthodes et techniques de production peu productives. II/ Les formes de collectivisation de l’agriculture ne font guère mieux : inefficacité de l’intervention massive de l’État et du Mouvement coopératif. Les pays qui ont appliqué ces réformes avaient pour base doctrinale que l’édification d’une société moderne devait s’appuyer sur le développement prioritaire de l’agriculture qui est le premier foyer de l’accumulation productive. Pour l’État, il s’agissait d’extorquer la rente d’origine agricole et minière par des mécanismes divers (fiscalité, termes de l’échange interne, manipulation monétaire et fixation des prix agricoles). 1°) intervention massive des États par le biais d’un secteur public rural devant permettre un contrôle total sur la production et la commercialisation. Les réformes inspirées des principes des divers socialismes sont largement minoritaires en Afrique. Progressivement, et à juste titre, les États s’installent au cœur du système rural en mettant en place un vaste réseau de sociétés d’intervention pour réaliser les axes de la politique agraire. On va alors assister, partout en Afrique, à la prolifération des sociétés publiques dans les domaines des services de support à l’agriculture : crédit agricole, commercialisation, recherche, offre d’inputs (engrais, produits phytosanitaires, semences, recherche et vulgarisation), transformation et stockage, gestion de l’aide alimentaire. Elles sont chargées de promouvoir le développement rural, d’encadrer les paysans et de diffuser les technologies susceptibles d’améliorer la productivité du travail et les rendements. Toutefois, au fil des années, elles vont connaître des problèmes à la fois financiers, techniques et 335 sociaux suite parfois à des gestions bureaucratiques inefficientes. Elles deviendront des gouffres financiers qui grèveront lourdement les finances publiques. Elles seront les premières victimes de l’ajustement structurel. Dans les pays où elles ont été mises en fonctionnement, la Banque mondiale et le FMI ont exigé systématiquement leur démantèlement. Cette option d’une gestion socialiste de l’agriculture a toujours été accompagnée par l’impulsion d’un Mouvement Coopératif dont il faut analyser les grandes lignes, bien qu’il n’existe pas en Afrique un modèle unique. 2°) Le mouvement coopératif Dans la plupart des réformes d’inspiration socialiste les paysans sont regroupés dans des coopératives de production ou de commercialisation. La société coopérative est un moyen par lequel les faibles producteurs cherchent à se défendre en se groupant. Aussi l’adhésion à la coopérative doit être libre et la gestion de l’organisme démocratique ; il doit y avoir une répartition équitable des fruits mais aussi des risques de l’entreprise. L’édification d’un système coopératif autonome n’a pas été à l’origine un mouvement spontané des paysans. Le mouvement a été souvent organisé, structuré et surtout contrôlé par les États dans le but de se substituer aux anciennes compagnies coloniales qui avaient le monopole de la distribution, de l’approvisionnement et de la commercialisation des produits agricoles. Dans beaucoup de pays, la structure coopérative, dans sa conception comme dans sa structuration et son fonctionnement s’apparentait plus à un rouage de l’administration publique qu’à une organisation de solidarité et de responsabilisation de producteurs librement associés. Le mouvement s’est largement étendu à beaucoup de pays quelle que soient leurs options idéologiques. Cela procède d’une volonté d’exercer un contrôle intégral sur toute la production et la commercialisation des produits agricoles. Cette intervention massive de l’État a conduit à l’affaiblissement du mouvement coopératif en Afrique. Toutefois, un exemple intéressant de regroupements collectifs dans l’agriculture a été celui établi en Tanzanie dans les années 60. La politique de base est « la villagisation » ou UJAMAA qui a trait au concept traditionnel de coopération communale et de partage. L’Ujamaa constitue autant une unité économique qu’un mode de vie, ou une entité politique. Les principaux aspects des orientations sont les suivantes : La technologie moderne, le renforcement de la production, l’augmentation des revenus, rendue possible par les nouvelles techniques sont désirables mais un système d’organisation s’impose si l’on veut éviter l’aggravation des inégalités qu’engendre le processus de modernisation quand il est abandonné aux seules forces du marché. La population doit être distribuée dans l’espace de façon à assurer les services et les qualifications nécessaires à une agriculture moderne : éducation, santé, assistance technique, commercialisation et crédit. Une telle distribution favoriserait l’établissement de petites industries dans les zones rurales La « villagisation » avec la réduction des inégalités qu’elle entraîne, réduit les migrations rurales-urbaines. Cette politique devrait introduire deux changements fondamentaux dans le système traditionnel : les mouvements physiques de population et le fonctionnement communal d’entreprises. Pour réussir, la coopération doit reposer sur un des principes clairement définis qui doivent assurer : 336 une gestion démocratique des unités coopératives qui se manifesterait dans l’élection des organes dirigeants, le contrôle du fonctionnement et des finances, une liberté totale et absolue d’adhésion ou non à la coopérative sans aucune espèce d’obligation ou de contrainte ; cela permet l’instauration d’une compétition stimulante entre les coopératives et d’autres formes d’exploitation ; la coopération est condamnée à faire preuve de sa supériorité d’organisation et d’efficience ou disparaître dans le cas contraire. un bénéfice mutuel qui permet de régler les intérêts de la coopérative en tant que personne morale et ceux de ses membres ; il est donc question des conditions de formation et de répartition du fonds d’accumulation, mais aussi de la rémunération de la force du travail. Dans ce domaine aussi, la coopération doit faire la preuve qu’elle offre, à court ou moyen terme, des ressources financières ou matérielles plus importantes. La coopérative est souhaitée car on estime qu’elle est une forme d’organisation plus efficiente permettant une meilleure valorisation de la production et du travail agricoles. Les interventions publiques d’encouragement et d’assistance au mouvement coopératif procèdent de la conviction qu’au plan socioéconomique l’exploitation coopérative est supérieure à la petite exploitation individuelle et par ailleurs, qu’elle peut rendre ces avantages accessibles à la grande majorité des paysans. Par sa dimension et la libération du producteur, l’exploitation coopérative permet la réalisation plus efficiente des facteurs modernes de production et une division sociale du travail favorable à une élévation de la productivité. Ce cadre structurel réalise les meilleures conditions de génération d’un surplus beaucoup plus important pouvant être utilisé pour des réinvestissements internes pour améliorer les instruments de production ou améliorer le niveau de vie des coopérateurs. En somme, une coopération menée avec clairvoyance et lucidité à partir d’objectifs matériels, clairs, accessibles et acceptés par les paysans, constitue le meilleur moyen, la voie la plus simple pour lever les obstacles et les contraintes relatives à l’instauration d’une agriculture moderne et efficace capable de répondre à la demande croissante en produits vivriers et en matières premières pour les agroindustries. Cependant, dans la quasi-totalité des pays sous-développés, les politiques agraires devront opérer des réorientations de la production agricole dans une double direction d’un abandon progressif des monocultures de rente destinées à l’exportation et d’un développement de nouvelles productions permettant de satisfaire les besoins internes. III/ Les résultats des réformes Beaucoup d’études relatives aux agricultures africaines sous le régime de la réforme depuis un quart de siècle établissent un bilan assez mitigé. Relativement aux fonctions attendues de l’agriculture qui occupe en Afrique entre 40 et 70% de la population et fournit parfois jusqu’à 90% du PIB. C’est aussi le secteur qui offre le plus d’emplois. Des réformes agraires, un ensemble d’effets sont attendus. D’abord elles doivent rendre le secteur capable de couvrir les besoins vivriers en augmentation rapide, d’augmenter l’emploi, d’influer positivement sur les investissements et la productivité et d’accroître les revenus des producteurs ruraux. Malgré les nombreuses réformes adoptées et appliquées dans la plupart des pays, les résultats 337 globaux dans le domaine de l’alimentation et de l’emploi ont été décevants. Beaucoup d’indicateurs évoqués se sont détériorés de manière notable. Au niveau de l’alimentation par exemple, des études récentes montrent que la production alimentaire par habitant a augmenté au taux négatif de 0,52% par an entre 1981 et 1989. Pour l’ensemble du continent la perte totale de céréales par rapport à la production a augmenté légèrement, passant de 13,5% en 1983 à 13,8% en 1989 pour atteindre 14% en 2000188. En fait, l’accroissement démographique s’est combiné à la stagnation de la production alimentaire et agricole ; il en est résulté une augmentation de la facture d’importations céréalières faisant reculer l’horizon de l’autosuffisance alimentaire. Entre 1981 et 1989, les importations alimentaires africaines ont été en moyenne de 11,8 milliards de dollars et si les tendances actuelles se poursuivent, elles atteindraient 21 milliards de dollars en 2010 (en prix constants). Dans la même période les recettes d’exportations de produits agricoles seraient au mieux de 12 milliards de dollars. Le moins que l’on puisse dire est que la production vivrière s’accroît moins vite que la population dont la demande alimentaire se diversifie en faveur des biens alimentaires importés et de l’aide alimentaire. En 2002, 2003 et 2004, l’agriculture africaine a enregistré quelques embellies avec des taux de croissance respectifs de 2,7%, 3,8% et 5% supérieurs à ceux de la population. Toutefois, il semble que l’amélioration des cours mondiaux des produits agricoles soit l’une des raisons principales. Sinon, la production a été stagnante avec des déclins dans certaines régions : Afrique Australe, Centrale et de l’Ouest suite à la mauvaise qualité des politiques agraires, aux fléaux naturels (sécheresse, invasion de criquets) et politiques (afflux de réfugiés et de déportés). En prenant l’emploi, l’exode rural est la meilleure preuve d’une double dégradation des revenus et de l’emploi. La tendance à abandonner les campagnes est un phénomène cumulatif. Dans la plupart des pays, le système productif est rudimentaire et repose sur de petites exploitations familiales et paysannes qui demandent peu de main d’œuvre pour accomplir les principales tâches de production. Il va s’en suivre une réduction de la force de travail des familles paysannes non compensées par une amélioration et une modernisation des moyens de production et d’accroissement de la productivité. C’est le processus infernal d’exode rural aggravé par l’explosion démographique caractéristique des PSD. À cela viendra s’ajouter comme fait aggravant la détérioration des revenus des paysans ce qu’exprime de manière significative Louis SANMARCO « Pendant qu’Abidjan se transformait à vue d’œil triomphante dans ses gratte-ciels et ses nombreux embouteillages tentaculaires dans ses bidonvilles, les villageois dans l’ensemble ne changeaient guère, habitant les mêmes paillotes, vivant des mêmes menus, dans les mêmes habits. À peine paraissaient-ils dans l’ensemble plus vieux»189. La situation est la même pour toutes les capitales africaines ? IV/ les raisons des contre performances des réformes dans l’agriculture À l’évidence, les réformes entreprises, quel que soit leur soubassement doctrinal, ont produit de médiocres performances globales. L’organisation libérale de l’économie rurale basée sur la petite exploitation familiale et la propriété privée de la En prenant l’Afrique de l’Ouest, la production par tête était dans les années de 20 à 25% inférieure à celle des années 60. Seulement 1% de la production mondiale de céréales est récoltée en Afrique de l’Ouest et% pour l’ensemble du continent. 189 L.SANMARCO : Le monde rural sacrifié : De l’injustice au risque écologique Afrique Contemporaine n°164 nov-déc. 1992 188 338 terre n’a permis ni la diversification et l’accroissement de la production, ni l’augmentation des investissements, ni la réduction substantielle des grandes inégalités existantes dans la plupart des PSD. Le système collectif, bien que fournissant une garantie plus grande contre la réapparition des inégalités susceptibles d’émerger dans un système où prédominent la propriété privée et les fermes familiales, présente à son tour certaines difficultés : le processus décisionnel y est plus complexe et rend difficile la formation de capacités d’entreprise potentielles et la libération des initiatives individuelles. Ces résultats s’expliquent par plusieurs séries de raison que l’on peut regrouper en deux: celles qui sont internes à l’agriculture et les secondes qui sont externes. 1°) Les raisons internes Elles se définissent comme un ensemble de facteurs internes à l’agriculture qui bloquent l’instauration et le développement de rapports de production capitalistes efficients à savoir : L’abondance de la terre et les formes traditionnelles de son appropriation sociale. C’est un trait important qui explique que le paysan peut échapper à toute forme de domination et d’exploitation qui s’établirait à partir du contrôle sur le moyen de production que constitue la terre. Cette perspective d’autonomie du paysan individuel se renforce par le fait qu’il a toujours la possibilité de développer des cultures destinées à sa consommation personnelle. Dans des économies non intégralement monétarisées, la culture de rente est un «complément de revenu». L’Exploitation n’est donc pas une fatalité.190 L’exploitation familiale dans des formes traditionnelles de production se fait aux moindres coûts pour le marché mondial. Ce facteur établit que la production agricole se déroule dans des conditions sociales spécifiques d’une reproduction traditionnelle de la force de travail. Une main d’œuvre nourrie au mil, maïs et manioc coûte certainement moins chère que celle nourrie au beefsteak. En conséquence, faisant jouer exclusivement la logique du profit, les consommateurs externes gagnent au maintien des exploitations familiales archaïques dans lesquelles la reproduction de la force du travail s’effectue aux moindres coûts. L’instabilité des écosystèmes et les contraintes naturelles accroissent les risques pour l’investissement privé. Les investissements ont besoin de conditions de valorisation marquées du sceau de la stabilité et du moindre risque ce qui raccourcissent d’autant les délais de récupération des capitaux engagés et garantissent la rentabilité. Cette logique détermine, de façon générale, le choix des branches d’intervention. Or, à y réfléchir de près, on s’aperçoit que les contraintes naturelles ne permettent pas la réalisation de cette logique. Les instabilités liées aux phénomènes naturels récurrents et incontrôlables accroissent les risques des investissements dans le secteur agricole. C’est dire que l’ampleur des risques ne milite pas en faveur d’une implantation du capitalisme dans un milieu naturel caractérisé par son extrême fragilité et son instabilité. Même au cas où le capitaliste voudrait contourner ces difficultés, il se trouverait dans l’obligation d’engager de lourdes charges d’infrastructures qui augmenteraient ses coûts de production et partant amoindriraient le niveau global de ses profits sous contrainte d’un marché extérieur favorable. Cette phrase est prêtée à CHE GUEVARA par Amath DANSOKHO lors d’une rencontre à Alger avec des Révolutionnaires africains après sa fameuse tournée clandestine en Afrique (1965). 190 339 Incontestablement, ces trois séries de raison expliquent, certainement en partie, les restrictions et le blocage de l’expansion des rapports de production capitaliste dans les campagnes. Il s’y ajoute d’autres raisons de nature externe au secteur agricole. 2°) Les raisons externes On peut repérer un certain nombre d’obstacles externes qui s’opposent à l’extension des bases mêmes du capitalisme dans les campagnes : Les diverses formes d’extorsion, de mobilisation et d’utilisation improductive des surplus issus de la rente agricole ne permettent pas la formation d’une base autonome d’accumulation pour l’investissement et l’élévation de la productivité sectorielle. Tout un arsenal de mesur