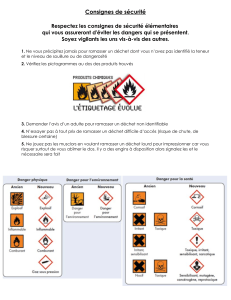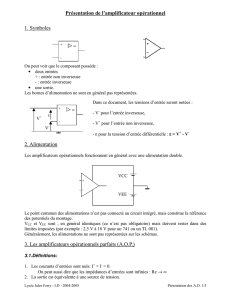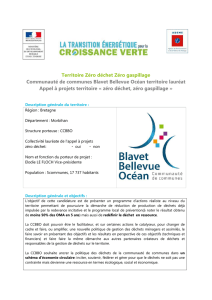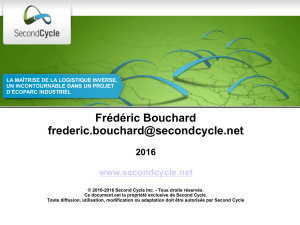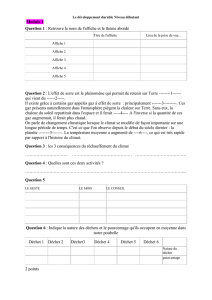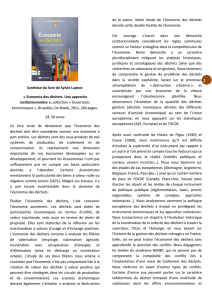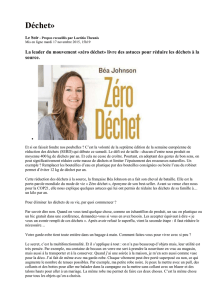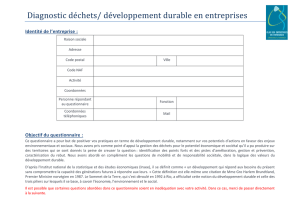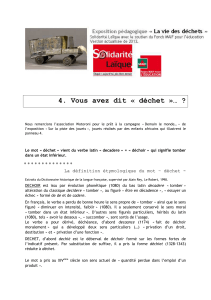RECHERCHE SUR LES DECHETS EN ECONOMIE ET EN SOCIOLOGIE PARTIE

·
PARTIE 1 RECHERCHE EN ÉCONOMIE
INTRODUCTION
(SHS)
SHS
1

��:

l

•

5) ;
 6
6
 7
7
1
/
7
100%