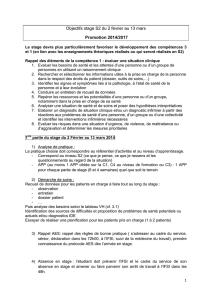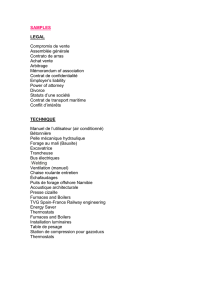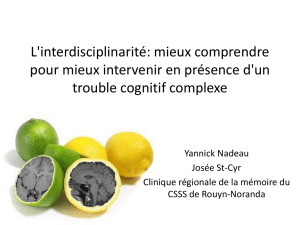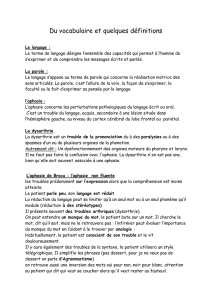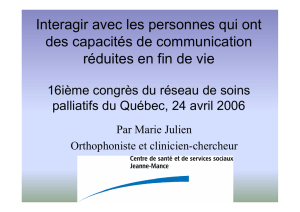Les aphasies progressives primaires : aspects cliniques Primary

Synthèse
Les aphasies progressives primaires :
aspects cliniques
Primary progressive aphasia: clinical aspects
DANIELLE DAVID
1
OLIVIER MOREAUD
1,2
ANNIK CHARNALLET
1,2
1
Unité de neuropsychologie,
Département de neurologie &
CMRR, CHU Grenoble
2
Laboratoire de psychologie
et neurocognition, LPNC
CNRS UMR 5105,
Grenoble
Tirésàpart:
O. Moreaud
Résumé. L’aphasie progressive primaire (APP) ou syndrome de Mesulam est caractérisée
par la survenue insidieuse et l’aggravation progressive sur plusieurs années de troubles du
langage de nature aphasique chez des patients âgés de 45 à 70 ans. La classification la plus
pertinente distingue une forme non fluente (anomie avec réduction du langage, sans
troubles de compréhension) et une forme fluente (anomie avec discours fluide et troubles
de la compréhension des mots isolés), souvent assimilée à la démence sémantique bien
que certains cas peuvent en être distingués. L’évolution se fait vers un mutisme et un
tableau démentiel le plus souvent de type frontal. L’APP est sous-tendue par des lésions
neurodégénératives siégeant principalement dans les régions périsylviennes gauches.
Dans deux tiers des cas, des lésions différentes de celles de la maladie d’Alzheimer sont
observées (inclusions tau positives dans l’APP non fluente, inclusions de type maladie du
motoneurone dans les APP fluentes). Dans le tiers restant les lésions sont de type Alzhei-
mer.
Mots clés :
aphasie progressive, démence sémantique, Alzheimer, démence frontotemporale
Abstract. Primary progressive aphasia (PPA), initially described by Mesulam, is a syndrome
of progressive deterioration of language, occurring in the presenium. Several classifica-
tions have been proposed, but the most useful one distinguishes non fluent and fluent
forms of PPA. Both begin by anomia. In non fluent PPA, there is a progressive reduction of
language, sometimes with aggramatism and articulatory impairment, but without impair-
ment of comprehension. Fluent PPA is characterized by preserved fluency with severe
impairment of single word comprehension. It is frequently confounded with semantic
dementia (SD), but some observations can be differentiated from SD. After several years, all
patients become mute, and most of them develop dementia, usually of frontal lobe type.
The syndrome of PPA is due to neurodegenerative brain pathology affecting mostly the
perisylvian regions of the left hemisphere. In most cases, no Alzheimer type pathology was
found in the brain, but tauopathy (mainly in non fluent PPA) or motor neuron disease type
pathology - tau negative ubiquitin inclusions (mainly in fluent PPA). However, Alzheimer
type pathology was found in a substantial number of cases.
Key words:progressive aphasia, semantic dementia, Alzheimer, frontotemporal dementia
En 1982, Mesulam [1] a individualisé, au sein des
affections neurodégénératives, une entité spé-
cifique, l’aphasie progressive, à partir de six
observations
1
. Cette nouvelle entité est devenue
l’aphasie progressive primaire (APP) [2], connue aussi
sous le nom de syndrome de Mesulam. L’APP réalise
une détérioration isolée et progressive du langage,
d’installation insidieuse, évoluant sur plusieurs années
et pouvant s’associer en fin d’évolution à une altération
intellectuelle globale [3]. Elle est habituellement la
conséquence d’une atrophie focale progressive des
régions périsylviennes de l’hémisphère gauche.
En 2001, Mesulam a proposé sept critères nécessai-
res pour poser le diagnostic d’APP [4] :
1) apparition insidieuse d’une détérioration isolée et
progressive du langage, caractérisée par un manque
du mot et/ou un trouble de la compréhension des mots
qui se manifestent dans le discours spontané et lors de
l’évaluation formelle du langage ;
2) absence de limitation des activités de la vie quoti-
dienne autre que celle générée par les troubles du
langage, pendant au moins deux ans après le début
des troubles ;
1
5 cas d’aphasie anomique et un cas de surdité verbale chez une jeune
fille de 17 ans (cas 4). Cette observation pourrait être séparée des
autres étant donné le jeune âge de la patiente et la non évolutivité des
troubles à 10 ans du début.
Psychol NeuroPsychiatr Vieil 2006;4(3):189-200
Psychol NeuroPsychiatr Vieil, vol. 4, n° 3, septembre 2006 189
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 05/06/2017.

3) normalité des fonctions langagières pré-morbides
(un antécédent de dyslexie développementale est
néanmoins accepté) ;
4) absence, au cours des deux premières années de la
maladie, d’apathie, de désinhibition, d’oubli des événe-
ments récents, de troubles visuo-spatiaux, de déficit de
reconnaissance visuelle et de troubles sensori-
moteurs, comme en témoignent l’anamnèse, l’évalua-
tion des activités quotidiennes et le bilan neuropsycho-
logique ;
5) présence éventuelle d’une acalculie et d’une apraxie
idéomotrice durant ces deux premières années. De
même, une discrète apraxie constructive et des persé-
vérations sont acceptées dans la mesure où elles ne
perturbent pas les activités de la vie quotidienne ;
6) d’autres fonctions cognitives peuvent être altérées
après les deux premières années, mais les troubles du
langage restent au premier plan tout au long de l’évo-
lution et s’aggravent plus rapidement que les autres ;
7) exclusion par l’imagerie cérébrale de causes spécifi-
ques, comme par exemple un accident vasculaire ou
une tumeur.
L’APP débute dans le présenium, entre 45 et 70 ans
[4, 5]. La durée de la maladie est variable, de4à14ans,
en moyenne 8 ans. L’évolution se fait habituellement
vers une perte d’autonomie et le développement d’une
démence, le plus souvent de type frontal en6à7ans
[6]. La prévalence du sexe est très variable suivant les
études [4, 5, 7, 8]. L’imagerie morphologique et fonc-
tionnelle met en évidence une atrophie et une hypoac-
tivité des régions corticales périsylviennes, gauches
dans environ deux tiers des cas, bilatérales pour le tiers
restant [7].
Le syndrome est sous-tendu par des affections neu-
rodégénératives dans la majorité des cas, même si
quelques cas de maladie de Creutzfeldt-Jakob ont pu
être décrits [9]. Les lésions sont plus marquées dans les
régions frontales et périsylviennes gauches que dans
l’hippocampe et le cortex entorhinal (qui sont les
régions les plus touchées dans la maladie d’Alzhei-
mer). Environ 60 % des patients ont des altérations
focales non spécifiques (perte neuronale, gliose, spon-
giose des couches corticales superficielles). Des inclu-
sions tau et ubiquitine positives peuvent être présen-
tes, mais la présence de corps de Pick ne concerne que
20 % des patients avec APP. Enfin, pour les 20 % res-
tants, des lésions de maladie d’Alzheimer sont présen-
tes, souvent avec une distribution et une topographie
atypiques [10, 11]. Dans une série post mortem pros-
pective de 22 patients, Kertesz et al. [12] ont mis en
évidence dans un nombre élevé de cas, des lésions de
type Alzheimer (9 patients), associées ou non à une
pathologie gliale ; les auteurs précisaient toutefois que
ces patients étaient plus âgés et présentaient des trou-
bles de la mémoire associés. Ils proposaient pour ces
cas l’appellation d’aphasie progressive « possible ».
Chez les autres patients, la pathologie était distribuée
comme suit : maladie de Pick (3 patients), dégénéres-
cence cortico-basale (5 patients), inclusions de type
maladie du motoneurone (tau et synucléine négatives,
ubiquitine positives) (4 patients), corps de Lewy (1
patient). Ces résultats montrent l’hétérogénéité neuro-
pathologique qui sous-tend le syndrome. Les patholo-
gies non Alzheimer étant néanmoins les plus fréquen-
tes, la classification de Lund et Manchester inclut les
APP au sein des atrophies lobaires frontotemporales
[13].
L’aphasie progressive peut être familiale. Le tableau
clinique est alors rarement pur, d’autres troubles cogni-
tifs et comportementaux sont associés, au moins chez
certains membres de la famille. Une famille a été
décrite dans laquelle tous les membres affectés souf-
fraient d’APP ; chez un sujet, l’autopsie a révélé des
lésions ubiquitine positives [14]. Récemment, dans une
famille d’APP évoluant vers une DFT, l’autopsie de
deux frères a montré la présence conjointe de corps de
Lewy et d’inclusions tau positives dans le noyau basal
de Meynert [15].
Classification clinique
Dans les années qui ont suivi la publication prin-
ceps de Mesulam [1], de nombreuses études de cas et
de groupes ont été publiées. Une majorité de ces étu-
des s’est intéressée au statut nosologique de l’aphasie
progressive par rapport aux maladies d’Alzheimer et
de Pick. L’étude détaillée des troubles du langage
n’était pas toujours au premier plan mais l’analyse de
ces travaux met en évidence l’existence d’une grande
hétérogénéité sémiologique. On ne retrouve pas un
syndrome clinique unitaire et des tableaux cliniques
différents sont regroupés sous le même terme d’apha-
sie progressive.
Au cours des années 1990-2000, des tentatives de
classification ont été proposées à partir d’études longi-
tudinales de groupes de patients. Certains auteurs ont
tenté de classer les cas d’APP suivant le critère d’apha-
sie fluente/non fluente ; d’autres se sont attachés à
décrire des tableaux cliniques plus précis, proches de
la sémiologie rencontrée dans les aphasies vasculaires.
Kertesz et al. [8] ont décrit, à partir de l’étude longi-
tudinale de 38 patients, des tableaux aphasiques pré-
cis : 17 patients avaient une anomie pure ; 7 patients
D. David, et al.
Psychol NeuroPsychiatr Vieil, vol. 4, n° 3, septembre 2006190
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 05/06/2017.

étaient qualifiés de logopéniques, ce terme décrivant
un discours plutôt non fluent, ralenti, avec un manque
du mot au premier plan, des phrases courtes n’excé-
dant pas quatre mots, une syntaxe préservée mais sim-
plifiée, sans trouble de la phonologie, de l’articulation
et de la compréhension [1, 3, 16] ; 4 patients avaient
une aphasie non fluente qui évoquait un tableau
d’aphasie de Broca, caractérisée par une anomie, des
erreurs articulatoires et phonologiques et un agramma-
tisme ; 2 patients avaient « une aphasie sémantique ou
démence sémantique » avec, au premier plan, un trou-
ble de la compréhension des mots sans trouble de la
syntaxe ni de la phonologie dans le contexte d’un dis-
cours fluent ; 2 patients étaient mutiques alors que leur
compréhension était relativement épargnée ; 6 patients
présentaient une aphémie ou apraxie verbale avec des
« erreurs articulatoires et phonologiques » (probables
troubles arthriques), un débit de parole ralenti, parfois
une tendance au bégaiement et un trouble de la proso-
die. Ces derniers patients sont à rapprocher d’autres
cas publiés sous le nom de « perte progressive du
langage et apraxie bucco-faciale associées à un hypo-
métabolisme frontal » [17], de « perte progressive du
langage avec dysfonctionnement prémoteur » [18],
d’« anarthrie progressive » [19] ou d’« aphémie pro-
gressive pure » [20]. Par ailleurs, des études de cas
isolés ont décrit des tableaux de surdité verbale pure
avec un trouble isolé de la compréhension du langage
oral, en l’absence de trouble de l’expression et de la
compréhension du langage écrit, qui présentaient, à
l’imagerie, une atrophie et un hypométabolisme tem-
poral supérieur gauche : cas 4 de Mesulam [1], cas 2 de
Croisile et al. [21], cas d’Otsuki et al. [22]. Ces tableaux
d’anarthrie et de surdité verbale progressives repré-
sentent des tableaux frontières et se détachent du
cadre strict des APP.
Une autre approche a tenté une classification des
APP selon l’axe de la fluence. Snowden et al. [23] ont
décrit trois sous-types d’APP à partir de l’étude longitu-
dinale de 16 patients :
1) le profil A, « anomie/non fluent » (5 patients) était
caractérisé par un manque du mot, un style télégraphi-
que, une répétition altérée, des troubles de la lecture et
de l’écriture, une compréhension relativement bien
préservée et évoluait vers le mutisme. L’imagerie mon-
trait une atrophie asymétrique plus prononcée à gau-
che et un hypométabolisme hémisphérique gauche ;
2) le profil B, « anomie + trouble de la compré-
hension/fluent » (6 patients), était caractérisé par un
manque du mot, de nombreuses paraphasies sémanti-
ques, un trouble de la compréhension des mots, des
régularisations en écriture, dans le contexte d’un dis-
cours fluent avec une articulation, une syntaxe et une
prosodie préservées. L’évolution se faisait vers une
réduction du langage, avec une écholalie, des persévé-
rations et des troubles sévères de la compréhension,
et, pour quatre de ces patients, une agnosie associative
et des troubles du comportement faisant évoquer un
tableau de démence sémantique. Chez trois patients,
l’imagerie montrait une atrophie et un hypométabo-
lisme antérieurs bilatéraux (symétriques ou prédomi-
nant à gauche) ;
3) le profil C (5 patients), regroupait des formes inter-
médiaires, difficiles à classer. Quatre patients présen-
taient un tableau mixte, le profil A accompagné d’un
déficit marqué de la compréhension, une évolution
vers un mutisme, mais gardant parfois la capacité à
s’exprimer par écrit (par des mots isolés). Chez ces
patients, l’atrophie cérébrale était globale, symétrique
ou plus marquée à gauche et un hypométabolisme
frontal gauche était observé. Le dernier patient présen-
tait un discours fluent voire logorrhéique, de type apha-
sie de Wernicke, avec une certaine préservation de la
compréhension des mots concrets. L’atrophie frontale
était bilatérale, mais l’hypométabolisme était plus mar-
qué à droite.
Dans la même optique, Mesulam [4] a décrit deux
grands tableaux d’APP en séparant clairement les for-
mes non fluentes et fluentes et en prenant en compte
l’évolution. Il a décrit ainsi une première phase, le stade
anomique, commun à toutes les APP, caractérisée par :
– un discours fluent malgré la recherche de mots, la
présence de pauses, l’utilisation de mots neutres et la
production de paraphasies sémantiques ;
– un manque du mot lors d’épreuves de dénomination,
sans trouble de la compréhension de ces mêmes mots
(désignation correcte).
À ce stade, la grammaire, la syntaxe et la lecture
sont préservées et la compréhension est parfaite ; on
peut observer des paraphasies phonémiques et des
troubles de l’écriture.
Ce stade anomique peut évoluer en deux tableaux
aphasiques différents :
1) l’APP non fluente, se différenciant en deux sous
types :
–une forme anomique pure dans laquelle le manque
du mot reste isolé, s’aggrave progressivement et évo-
lue vers un mutisme ;
–une forme avec agrammatisme, proche de l’apha-
sie de Broca et caractérisée par un débit de parole
ralenti, une perte de la prosodie, un manque du mot,
Les aphasies progressives primaires
Psychol NeuroPsychiatr Vieil, vol. 4, n° 3, septembre 2006 191
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 05/06/2017.

une articulation laborieuse et une très bonne compré-
hension ;
2) l’APP fluente, caractérisée par un débit de parole et
une articulation normaux, un manque du mot, un trou-
ble de la compréhension du mot isolé, en l’absence de
déficit majeur de l’identification visuelle des objets et
des visages. Les patients accèdent, ici, aux connaissan-
ces sémantiques à partir d’une entrée visuelle (objets,
visages) et non à partir des mots, qu’ils soient entendus
ou lus. Mesulam pose ici le problème de la définition
AB
Figure 1. A : IRM encéphalique (TI coronal) d’un homme de 59 ans présentant une APP non fluente évoluant depuis 2 ans : atrophie
frontale inférieure, insulaire et probablement temporale externe supérieure gauche. B: IRM du même patient, 6 ans plus tard (Flair
coronal) : atrophie hémisphérique gauche beaucoup plus diffuse, atteignant notamment la partie antérieure du lobe temporal dans ses
parties interne et externe, et la tête du noyau caudé ; à droite, le lobe frontal inférieur, la partie supérieure et antérieure du lobe temporal,
et l’insula antérieure sont discrètement atrophiques.
Figure 1. A: cranial MRI (coronal T1): left inferior frontal, anterior insular, and lateral anterior and superior temporal atrophy in a 59 year old
man with non fluent primary progressive aphasia. B: MRI in the same patient, 6 years later (coronal FLAIR): progression of the atrophy in
the left hemisphere, now affecting the mesial and lateral anterior temporal lobe, and the head of the caudate nucleus; the anterior part of
the right frontal lobe, the anterior and superior temporal lobe, and the right anterior insula are also slightly atrophic.
AB
Figure 2. A : IRM encéphalique (Flair coronal) d’un homme de 67 ans avec APP fluente (patient AL) : atrophie temporale antérieure
gauche, interne et externe, hypersignaux de la substance blanche. B:Spect du même patient : hypoperfusion temporale antérieure et
externe gauche.
Figure 2. A: Cranial MRI (coronal FLAIR): left mesial and lateral anterior temporal atrophy, with bilateral white matter hyperintensities, in a
67 year old man with fluent progressive aphasia (patient AL, see text). B: SPECT in the same patient: lateral anterior temporal
hypoperfusion.
D. David, et al.
Psychol NeuroPsychiatr Vieil, vol. 4, n° 3, septembre 2006192
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 05/06/2017.

de la démence sémantique, généralement assimilée à
l’APP fluente. Pour lui, la démence sémantique sort du
cadre des APP et doit être considérée comme un « syn-
drome APP - plus », c’est-à-dire une aphasie fluente
plus un déficit de la reconnaissance visuelle. Nous
reviendrons plus loin sur cette question.
Quelle que soit la forme initiale (fluente ou non),
l’évolution se fait vers une aphasie globale avec un
quasi-mutisme et des troubles sévères de la compré-
hension. À ce stade, il n’est plus possible d’évaluer les
patients et des troubles cognitifs plus globaux et du
comportement peuvent apparaître.
Les données neuroanatomiques sont corrélées aux
tableaux cliniques : Mesulam a observé un hypométa-
bolisme et une atrophie dans les régions périsylvien-
nes gauches (incluant le cortex frontal inférieur) chez
les patients non fluents dont la compréhension du lan-
gage était préservée, alors que chez les patients qui
présentaient une aphasie fluente, un hypométabolisme
et une atrophie touchant les régions moyenne,
inférieure et polaire du lobe temporal gauche étaient
mis en évidence. C’est aussi ce que nous observons
chez nos patients, au moins en début d’évolution
(figures 1 et 2).Ces données sont confortées par l’étude
de Gorno-Tempini et al. [16], qui portait sur 31 patients
soumis à une évaluation cognitive détaillée et à une
mesure de l’atrophie en IRM. Onze patients présentant
une aphasie progressive non fluente et produisant des
erreurs syntaxiques et morphologiques, présentaient
une atrophie significative de l’aire de Broca (aires 44,
45), du gyrus frontal inférieur gauche (aire 47), de
l’insula gauche, du putamen gauche et des noyaux
caudés ; 10 patients atteints d’APP fluentes et de
démence sémantique avaient une atrophie bilatérale
temporale antérieure (mésiale et latérale) ; enfin, chez
10 patients atteints d’aphasie logopénique, une atro-
phie du gyrus angulaire gauche, du tiers postérieur du
gyrus temporal moyen et du sulcus supérieur temporal
gauche était observée.
Une étude clinicopathologique récente [24] conforte
l’intérêt de la distinction fluente/non fluente, en mon-
trant que la majorité des APP non fluentes appartien-
nent au cadre des tauopathies, alors que les lésions
observées dans les APP fluentes (démences sémanti-
ques incluses) sont identiques à celles observées dans
les maladies du motoneurone (présence d’inclusions
ubiquitine positives et tau négatives). On peut aussi
noter qu’un tiers des cas dans chaque sous-groupe
avaient des lésions de type Alzheimer.
En résumé, même si les résultats de certaines étu-
des sont parfois divergents, les tableaux décrits et les
tentatives de classification peu homogènes, la classifi-
cation en fonction de la fluence du discours semble
bien correspondre à une réalité clinique et anatomique.
En effet, même si ce terme de fluence n’est jamais
défini de façon spécifique, on peut déjà, au stade ano-
mique commun aux deux profils d’APP (dans lesquels
les productions en termes de longueur de phrases et de
nombre de mots sont souvent équivalentes), classer le
discours des patients en non fluent et fluent. Le débit
des patients non fluents est ralenti, haché, la prosodie
est parfois altérée, parler paraît demander un effort,
même si, à ce stade, il n’existe pas de trouble articula-
toire. Leur comportement vis-à-vis de la communica-
tion est aussi caractéristique : leur appétence au lan-
gage est moindre, ils redoutent les situations de
communication. Ils ont une très bonne conscience de
leurs difficultés, en sont très affectés, et ont une nette
tendance à se replier sur eux-mêmes. À l’opposé, les
patients fluents ont un discours fluide, un débit de
parole normal, même si on note des pauses à la recher-
che des mots. Leur appétence au langage et la prosodie
du discours sont préservées ; la communication et
l’élocution sont aisées. Ils ont également une bonne
conscience de leurs troubles, qu’ils décrivent en géné-
ral très bien. Ils sont cependant beaucoup moins affec-
tés et tristes que les patients non fluents et restent très
à l’aise dans la communication même lorsque leurs
troubles s’aggravent.
Nous allons maintenant détailler ces profils d’APP.
L’aphasie progressive primaire
non fluente
Ce tableau d’APP est le plus majoritairement décrit
et le plus documenté dans la littérature. Il a été rap-
porté par de nombreux auteurs [1, 4, 5, 8, 10, 11, 24-26].
L’exposé qui va suivre est une synthèse de ces différen-
tes études et de notre propre expérience du syndrome.
Nous décrirons essentiellement les premières années
d’évolution, avant que s’installe un tableau démentiel
(très habituellement de type frontal) avec troubles du
comportement.
A - Sur le plan du comportement et de la person-
nalité, les patients atteints d’APP non fluente ont une
excellente conscience de leurs troubles qui s’accompa-
gne souvent d’un état anxieux voire dépressif, et d’une
nette tendance au repli sur soi. Lors des évaluations, ils
coopèrent parfaitement. Ils sont indépendants et auto-
nomes dans les actes de la vie quotidienne. Ils restent
actifs, voyagent, bricolent, jardinent, font du sport, cer-
tains même continuent à travailler.
Les aphasies progressives primaires
Psychol NeuroPsychiatr Vieil, vol. 4, n° 3, septembre 2006 193
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 05/06/2017.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%