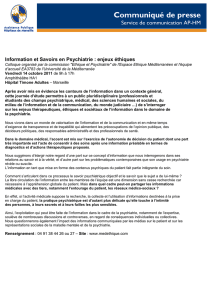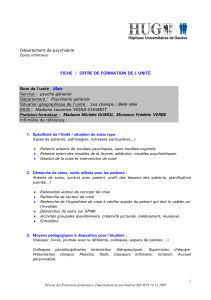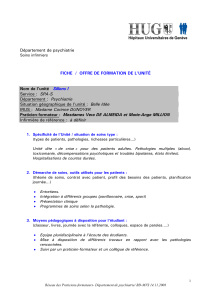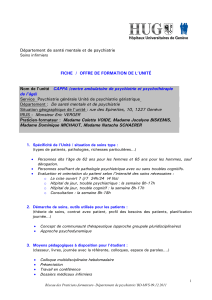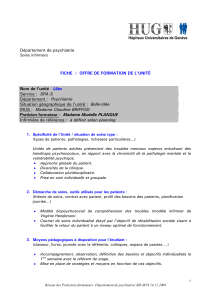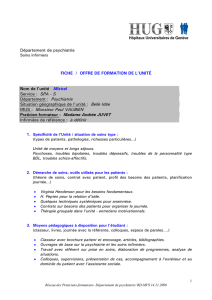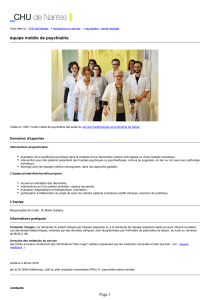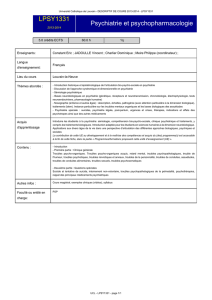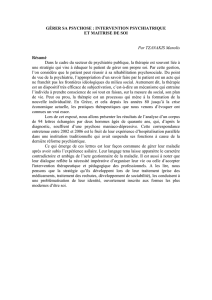Lire l`article complet

167
Act. Méd. Int. - Psychiatrie (21), n° 7, septembre 2004
É d i t o r i a l
Principe de précaution en psychiatrie
J.M. Havet*
a notion de risque semble être
devenue impensable et insup-
portable pour nos concitoyens.
L’existence doit pouvoir se dérouler
de façon totalement prévisibl e,
linéaire, sans qu’aucun événement
inattendu ne vienne la perturber.
Seuls sont admis et envisagés l’ac-
c roissement du bien-être et les
événements dits – après coup –
“heureux”, qui, même s’ils nous
surprennent de par leur caractère a
priori i m p ro b a bl e , seront acceptés en
ra i s o n des effets positifs qu’ils
induisent.
Mais, qu’un problème surgisse et
la recherche du responsable s’ensuit
sans tarder. Tout a-t-il été bien fait
pour éviter que cette catastrophe,
cette difficulté, cette complication
ne survienne ?
Ce phénomène s’est généralisé sur
le plan social : le principe de pré-
caution est universellement admis
(au moins pour les habitants des
pays riches et industrialisés), et les
gouvernements se voient régulière-
ment reprocher de ne pas avoir pris
à temps les mesures qui s’impo-
saient en fonction de circonstances
qui, à l’évidence, auraient justifié
d’y avoir recours. Il est vrai que
gouverner, c’est prévoir, mais l’évi-
dence en question ne découle bien
souvent que de l’analyse rétrospec-
tive des conséquences que l’on a pu
observer. Remonter aux sources, au
feu à partir de la fumée, est souvent
plus aisé que d’anticiper les événe-
ments avec assurance et certitude.
Rien d’étonnant, dans ce contexte, à
ce que la médecine se voie soumise
aux mêmes impératifs sécuritaires.
Il est v rai que l’un des principes
go u v e r n a n t sa pratique est “p r i m u m
non nocere”, (“p r e m i è rement, ne pas
nuire”), que l’objectif du médecin
est de donner à ses patients le maxi-
mum de chances d’évoluer favora-
blement et qu’il lui faut pour cela
leur assurer des soins conscien-
cieux, dévoués et fondés sur les
données acquises de la science.
Selon toute apparence, cela va de
soi. Mais, en l’occurre n c e ,de quoi
s’agit-il dans le cadre de la p ra t i q u e
p s y c hiatrique quotidienne ?
On nous demande souvent, de façon
paradoxale, d’être attentifs à empê-
cher les patients de commettre l’ir-
réparable tout en garantissant leur
liberté de mouvement et de circ u l a t i o n .
Les soignants se verront reprocher
un défaut de surveillance en cas de
f u g u e , de suicide ou d’ag re s s i o n .
*
Service de psychiatrie d’adultes,
CHU Robert-Debré, Reims.
L

168
É d i t o r i a l
D’autre part, on n’hésitera pas à
faire valoir auprès d’eux le droit
des patients à disposer d’eux-mêmes
et à leur reprocher des pratiques
jugées coercitives. De quelque côté
qu’il se tourne, le soignant joue per-
dant et se voit acculé à une prudence
e x t r ê m e ,à mesurer ses propos et
à surveiller ses écrits. Seul le res-
pect inconditionnel d’un protocole
consensuel assurera sa sauvegarde,
au prix de la mort de sa créativité.
Même si, entre 1980 et 2001, le
nombre annuel de journées de trai-
tement par antidépresseur a été
multiplié par 6,2 sans réduction
parallèle du nombre de décès par
s u i c i d e , on n’hésitera pas à condam-
n e r le médecin qui, devant l’expres-
sion d’une tristesse (qualifiée a
posteriori de dépression si la situa-
tion se détériore), n’aura pas mis
en œuvre cette prescription. À la
moindre menace suicidaire, il reste
alors à déclencher sans hésiter une
hospitalisation sur demande d’un
tiers, sans tenir compte de la dyna-
mique relationnelle et affective dans
laquelle elle s’inscrit. Le sujet est
malade : il faut le soigner, qu’il soit
d’accord ou non, puisque son entou-
rage l’exige et que cela est son droit.
Une interprétation extensive de la
loi du 27 juin 1990 l’autorise, et le
principe de précaution l’obl i g e. Cela,
même si les auteurs du DSM IV tien-
nent à préciser qu’“aucune d é f i n i t i o n
ne spécifie de façon adéquate les limites
précises du concept de tro u b le mental”.
Les comportements humains n’étant
– fort heureusement – ni soumis à
un déterminisme sans faille, ni pré-
visibles avec certitude, mais simple-
ment parfois envisageables selon un
certain degré de probabilité, leur
maîtrise par les actions d’autrui
reste relative, voire aléatoire. Bien
plus, n’arrive-t-il pas que l’on pro-
voque par nos actes le contraire de
ce que l’on voulait obtenir ? Les
chemins de l’enfer sont pavés de
bonnes intentions, se plaît à nous
rappeler la sagesse populaire.
Pas plus que le juge remettant en
liberté un délinquant qu’il pense en
bonne voie de réinsertion, le psy-
ch i a t re ne peut être certain des effe t s
de ses interventions. Il lui faudra
pourtant, en cas de pro bl è m e , être en
mesure de les justifier… tandis que,
si tout se passe bien, personne ne
v i e n d ra l’en féliciter, puisqu’il n’aura
fait que ce que l’on attendait de lui.
Il nous faut faire entendre qu’une
p ratique psychiatrique sans risque
ne saurait exister. Ce risque doit
ê t re, certes, mesuré, calculé et pris
dans l’intérêt même du patient,
mais il ne peut être totalement
écarté. Faute de quoi, on tendra à
évoluer de plus en plus vers une
p ratique aseptisée, frileuse, qui
ga ra n t i r a la tranquillité du pra t i-
cien, à qui rien ne pourra être
re p ro ché , mais qui, loin de servir
les patients et leur entourage, aura
toutes les chances de leur être pré-
j u d i c i abl e.
Une théorie du risque en psy-
chiatrie re s t e à élab o re r. Vo i l à
qui pourrait être l’occasion d’un
p ro chain colloque.
1
/
2
100%