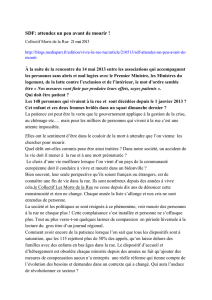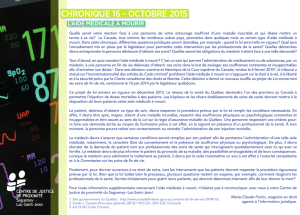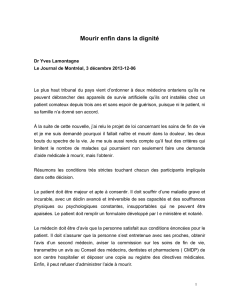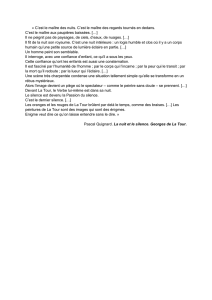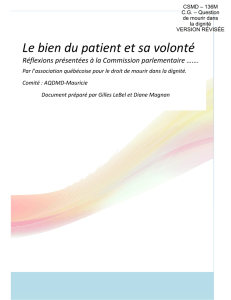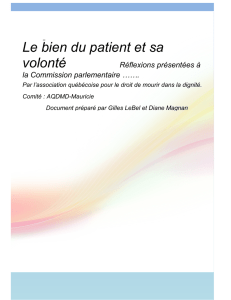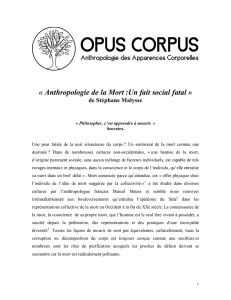Discours de réception à l`Académie des lettres du Québec, présenté

!
"!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
#$%&'()%!*+!),&+-.$'/!0!123&4*,5$+!*+%!1+..)+%!*(!6(,7+&8!
-),%+/.,!1+!9!'&.'7)+!:;"<!0!12=*$>$&+!?4%.'/@A$)'/B!
!
!
C4)'1+!D),&E+..+!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
:!
!
!
F!G+!524--+11+!A4)$+8!
H+!I4$%!5'()$)!*+I4/.!I'(%B!
G+!I'(%!+/!-)$+8!
)+J4)*+K@5'$B!
L+J4)*+K!5+%!54$/%8!5'/!I+/.)+8!5'/!&'(8!!
5'/!*'%8!-+/*4/.!M(+!H+!/+!I'(%!I'$%!-4%B!
L+J4)*+K!5+%!,-4(1+%!M($!.)+571+/.!M(4/*!H+!/2N!&)'$%!-1(%8!
54!-'$.)$/+!M($!%+!%'(1OI+!M(4/*!H+!52+5-').+B!!
L+J4)*+K!1+%!-1$%!*+!54!-+4(8!
+/!*+%%'(%!*+!54!-+4(8!5+%!'%8!
12$/&1$/4$%'/!*+!54!.P.+8!
1+%!5'(I+5+/.%!*+!54!7'(&E+8!! !
5+%!-+.$.%!J+%.+%!%+&)+.%8!!
1+!714/&!*+!5+%!N+(QB!
G+!I'(%!+/!-)$+8!!
)+J4)*+K@5'$8!!
+/I+1'--+K@5'$8!!
%'(>>1+K!%()!5'$B!!
G+!I4$%!5'()$)!*+I4/.!I'(%B!
G+!524--+11+!A4)$+B!
6(4.)+!>'$%B!R!!
!
!
C2,.4$.!1+!-)'1'J(+!*+!54!-$O&+!Les$quatre$morts$de$Marie8!,&)$.+!+/.)+!"STT!+.!"SS;B!
U')%M(+!H+!&E+)&E4$%!(/+!45')&+!-'()!&+!*$%&'()%8!&+%!5'.%!*+!A4)$+!5+!)+I+/4$+/.!
%4/%!&+%%+B!G+!1+%!4$!*247')*!)+-'(%%,%8!&4)!$1!/+!5+!%+5714$.!-4%!4--)'-)$,!
*2+5-)(/.+)!14!I'$Q!*2(/!-+)%'//4J+!*4/%!(/+!.+11+!&$)&'/%.4/&+B!A4$%!$1%!
$/%$%.4$+/.B!31')%8!H+!1+%!4$!14$%%,%!%+!-'%+)!%()!14!-4J+B!V.!-($%!H24$!&'5-)$%!M(+!&+!
-+.$.!5'/'1'J(+!/24!-4%!,5+)J,!-4)!E4%4)*!*+%!)+-1$%!*+!5'/!&+)I+4(B!V/!I,)$.,8!$1!
&'/.$+/.8!+/!%'/!&W()8!12+%%+/.$+1!*+!&+!M(+!H+!I+(Q!I'(%!*$)+!&+!%'$)8!0!I'(%!.'(%8!
&E+)%!5+57)+%!*+!123&4*,5$+8!&E+)%!&'11OJ(+%8!&E+)%!45$%B!
!
G+!5+!%'(I$+/%!*(!H'()!'X!&+!-)'1'J(+!4!-)$%!>')5+B!G2,.4$%!*4/%!5'/!4(.'8!+/!)'(.+!
-'()!411+)!&E+)&E+)!54!>$11+B!U2$*,+!52,.4$.!I+/(+8!M(+1M(+!.+5-%!4(-4)4I4/.8!*2(/+!
-$O&+!M($!5+..)4$.!+/!%&O/+!M(4.)+!5'5+/.%!*4/%!14!I$+!*2(/+!>+55+B!G24I4$%!-4%%,!14!
54.$/,+!0!N!.)4I4$11+)B!G2+/!,.4$%!4(Q!-)+5$+)%!7417(.$+5+/.%B!G+!)'(14$%8!*'/&8!+/&')+!
E47$.,+!-4)!5+%!+Q-1')4.$'/%!*(!54.$/8!+.8!.'(.!0!&'(-8!H24$!),&$.,!0!I'$Q!E4(.+8!.'(.+!
%+(1+!*4/%!5'/!4(.'!Y!F!G+!524--+11+!A4)$+8!H+!I4$%!5'()$)!*+I4/.!I'(%B!G+!I'(%!+/!
-)$+8!)+J4)*+K@5'$B!R!G+!5+!%'(I$+/%!*(!.)+571+5+/.!%'(%!54!-+4(!+.!*(!74..+5+/.!
*+!5'/!&W()B!C+!/2,.4$.!-4%!54!-)+5$O)+!+Q-,)$+/&+!*2,&)$.()+8!54$%!&2+%.!&+.!4-)O%@
5$*$@108!*4/%!14!&$)&(14.$'/!*+!A'/.),418!M(+!H24$!+(!1+!%+/.$5+/.!*24I'$)!.)'(I,!54!
>),M(+/&+8!5'/!%'(>>1+8!54!I'$QB!!
!

!
Z!
G+!I$+/%!*(!.E,[.)+B!C2+%.!%4/%!*'(.+!&+14!M(+!H+!I'(14$%!*247')*!4>>$)5+)!+/!'(I)4/.!
&+!*$%&'()%!-4)!124*)+%%+!*+!A4)$+!4(!-(71$&B!3*'1+%&+/.+8!H+!/+!)PI4$%!-4%!*+!
&'(&E+)!*+%!5'.%!%()!*(!-4-$+)8!54$%!*+!5+!.+/$)!*+7'(.!%()!(/+!%&O/+B!A+%!
-)+5$O)+%!J)4/*+%!,5'.$'/%!1$..,)4$)+%8!H+!1+%!4$!I,&(+%!4I+&!\&E+]E'I8!V()$-$*+8!
^E4]+%-+4)+8!-($%!#(7,8!U')4/J+)_!U+()%!5'.%8!H+!1+%!4$!+/.+/*(%!I$7)+)!*4/%!(/+!
%411+!7$+/!4I4/.!*+!1+%!1$)+B!G24$!&'55+/&,!0!>),M(+/.+)!1+%!.E,[.)+%!0!M(4.')K+!4/%B!G+!
M($..4$%!54!74/1$+(+8!-)+/4$%!1+!.)4$/8!5+!)+/*4$%!4(!&+/.)+@I$11+!-'()!411+)!0!14!
C'5,*$+@C4/4*$+//+8!0!12`)-E+(58!4(!L$*+4(!a+).8!4(!6(4.2^'(%B!G+!I'N4$%!.'(.B!V.!
H24$54$%!.'(.!b!C2,.4$.!12,-'M(+!7,/$+!*+!12$//'&+/&+!+.!*+!14!*,&'(I+).+b!3(@*+10!*+%!
7+4(.,%!*+%!.+Q.+%8!*+!14!-+)>')54/&+!*+%!$/.+)-)O.+%8!&2+%.!1+!J+%.+!.E,[.)41!1($@
5P5+!M($!5+!.)4/%-').4$.!Y!H'(+)8!$5$.+)!1+!),+18!&),+)!*(!>4(Q!-'()!>4$)+!%()J$)!(/+!
,5'.$'/!I)4$+B!G+!/24I4$%!-1(%!M(2(/!*,%$)!Y!*+I+/$)!0!5'/!.'()!c$/48!d-E$J,/$+8!
`-E,1$+8!5+!.+/$)!.)+5714/.+!%()!(/!-14.+4(!+.!*$)+!Y!F!G+!%($%!(/+!5'(+..+8!/'/!&+!
/2+%.!-4%!e4B!R!#$)+!Y!F!G24$!),>1,&E$8!54!5O)+8!+.!H+!*'$%!4&&+-.+)!*+!5'()$)8!54$%!
H2+/.+/*%!5+!*'//+)!(/+!5').!J1')$+(%+B!R!#$)+!Y!F!a'$10!*(!)'54)$/8!&2+%.!-'()!1+!
%'(I+/$)B!G+!I'(%!+/!-)$+8!45'()8!%'(I+/+K@I'(%B!R!!
!
f!I$/J.@+.@(/!4/%8!H24$!,.,!4*5$%+!+/!$/.+)-),.4.$'/!0!12=&'1+!c4.$'/41+!*+!\E,[.)+B!U+!
)PI+!*+!54!H+(/+!I$+b!A4$%!&()$+(%+5+/.8!&+..+!-,)$'*+!*+!>')54.$'/!/+!524!-4%!
4--').,!12+Q.4%+!4..+/*(+B!G24I4$%!14!*'(1'()+(%+!$5-)+%%$'/!*+!/+!-4%!I)4$5+/.!
F!4--4).+/$)!R!g!0!&+..+!>45$11+8!0!&+!5,.$+)!g8!*+!/+!-4%!&'))+%-'/*)+!0!14!>$J()+!
&'/%4&),+!*+!124&.)$&+8!-4%!4%%+K!$/%.$/&.$I+!+.!+Q.)4I+).$+8!.)'-!%4J+!+.!),>1,&E$+B!G+!
/+!%4I4$%!-4%8!41')%8!M(+!H+!/2,.4$%!-4%!.'(.!0!>4$.!4(!7'/!+/*)'$.8!M(+!54!-14&+!/2,.4$.!
-4%!%()!(/!-14.+4(!0!&E+)&E+)!*+I4/.!(/!5+..+()!+/!%&O/+!&'55+/.!*+I+/$)!c$/48!
d-E$J,/$+8!`-E,1$+8!D1+()+..+!'(!C4)5+/!M($!&E4/.+!%()!14!A4$/h!54!I)4$+!-14&+!,.4$.!
4(!.'(.!*,7(.!*+!14!&E4i/+!.E,[.)41+8!M(4/*!$1!/2N!4!-4%!+/&')+!*+!5+..+()!+/!%&O/+8!
-4%!*24&.+()%8!-4%!*+!*,&')%8!-4%!*+!1(5$O)+8!5P5+!-4%!*+!%411+!'X!%+!),(/$)8!M(4/*!
$1!/2N!4!-4%!12'57)+!*2(/+!c$/48!*2(/+!d-E$J,/$+8!*2(/+!`-E,1$+8!*2(/+!D1+()+..+8!*2(/+!
C4)5+/!M($!&E4/.+!%()!14!A4$/B!6(4/*!$1!/2N!4!)$+/8!+/!>4$.B!L$+/!M(2(/+!.P.+8!(/!&W()!
+.!*(!%$1+/&+B!!
!
G24$!5$%!*(!.+5-%!0!&'5-)+/*)+!M(+!&2+%.!0!&+!%$1+/&+!M(+!H24--4).+/4$%B!f!54!%').$+!
*+!12=&'1+!c4.$'/41+8!4(!*,7(.!*+%!4//,+%!%'$Q4/.+@*$Q8!H24$!-1(.j.!)+H'$/.!14!J)4/*+!
&145+()!*+!14!&'/.+%.4.$'/!+.!*+!14!&),4.$'/!&'11+&.$I+B!G2,.4$%!J41I4/$%,+!-4)!14!
)+5$%+!+/!M(+%.$'/!*+!.'(%!1+%!-'(I'$)%!+.!%().'(.!-4)!14!I'1'/.,!*+!)+*'//+)!0!
124&.+()!14!-1+$/+!)+%-'/%47$1$.,!*+!%4!-4)'1+B!3(!\E,[.)+!*+%!C($%$/+%8!'X!H24$!>4$.!
4I+&!-4%%$'/!(/!.E,[.)+!+/J4J,!*4/%!14!1(..+!>,5$/$%.+8!/'(%!-)4.$M($'/%!14!
*,5'&)4.$+!+Q.)P5+B!\'(.+%!1+%!*,&$%$'/%8!*+!.'(%!')*)+%8!*+I4$+/.!P.)+!-)$%+%!
+/%+571+B!U+%!%+(1%!5'5+/.%!*+!-4(%+!*4/%!/'%!-+)-,.(+1%!*,74.%!,.4$+/.!&+(Q!'X!
/'(%!/'(%!)+.$)$'/%8!&E4&(/+!*+!%'/!&j.,8!-'()!,147')+)!1+%!%&O/+%!*+!14!-$O&+!+/!
&E4/.$+)B!C2,.4$.!(/!.)4I4$1!)$J'()+(%+5+/.!&4*),!-4)!1+!&4/+I4%!M(+!/'(%!4I$'/%!
&'/e(!+/%+571+8!4-)O%!*+%!E+()+%!*+!*$%&(%%$'/%!+/>1455,+%8!54$%!&2,.4$.!.'(.!*+!
5P5+!*+!12,&)$.()+B!G+!5+!%($%!5$%+!0!&E,)$)!&+%!5'5+/.%!7,/$%!'X!H+!5+!)+.)'(I4$%!
%+(1+!*+I4/.!54!>+($11+B!C'5-.+!.+/(!*+!54!/4.()+!-+(!-').,+!0!14!&'/>)'/.4.$'/8!$1!
-+(.!%+571+)!,.'//4/.!M(+!H+!5+!%'$%!14/&,+!*2+571,+!*4/%!&+..+!4I+/.()+!5$1$.4/.+!
+.!&'11+&.$I+B!C2,.4$.!-4)!&'/I$&.$'/8!7$+/!%k)8!54$%!4I+&!1+!)+&(18!H+!&)'$%!M(+!&2,.4$.!

!
l!
4(%%$!(/+!>4e'/!*+!5+!)4--)'&E+)!*(!*,7(.!*+!14!&E4i/+B!#(!1$+(!'X!-)+/*!>')5+!14!
-4)'1+B!U+!1$+(!*(!.+Q.+B!U+!1$+(!*(!%+/%B!!
!
U+!5'(I+5+/.!*+!)+5$%+!+/!M(+%.$'/!4!>$/$!-4)!%2+%%'(>>1+)8!+.!5'$!4(%%$B!3-)O%!
.'(.+%!&+%!4//,+%!0!5+!>'/*)+!*4/%!1+!J)4/*!F!/'(%!R8!H24$!%+/.$!1+!7+%'$/8!&'55+!.4/.!
*24(.)+%8!*+!)+I+/$)!4(!-+.$.!F!H+!RB!G+8!&'5,*$+//+!*$-1j5,+!4N4/.!.'()/,!1+!*'%!0!14!
&4))$O)+!-'()!-').+)!(/!5+%%4J+!%'&$41!4(Q!-'-(14.$'/%!&'(-,+%!*(!.E,[.)+h!H+8!
.)+/.+/4$)+!*,%+5-4),+8!&E+)&E4/.!0!)+/'(+)!4I+&!%+%!')$J$/+%8!4I+&!%4!/4.()+!
-)'>'/*+8!+.!4I+&!124).!M(2+11+!4I4$.!.4/.!4$5,B!C+14!4!*'//,!Baby$BluesB!m/+!-$O&+@
-4%%4J+!+/.)+!14!5$1$.4/.+!M(+!H2,.4$%!+.!124(.+()+!M(+!H+!&'55+/e4$%!0!*+I+/$)B!
n)+5$+)!.+Q.+!,&)$.!+/!%'1'8!-+/*4/.!1+%!-14J+%!*+!%$1+/&+!*$%-'/$71+%!*4/%!1+!
7)'(E4E4!*+!54!54$%'/!*+!H+(/+!5454/B!n)+5$+)!.+Q.+!-)'*($.!%()!%&O/+B!n)+5$+)%!
)4I$%%+5+/.%B!n)+5$O)+%!*,&+-.$'/%B!n)+5$+)!&E'&!*+!I'$)!+Q-'%,%!+/!-1+$/+!1(5$O)+!
1+%!%+&)+.%!*+!5'/![5+B!C+!/2,.4$.!-4%!12+Q.4%+!4..+/*(+B!!
!
o+()+(%+5+/.8!(/+!4(.)+!-$O&+8!+/.)+@.+5-%8!4I4$.!,5+)J,B!G+!*$%!F!,5+)J,!R8!&4)!
&2+%.!7$+/!4$/%$!M(+!&+14!%+!-4%%+8!/'/!p!`/!54)&E+!%()!(/+!-14J+!.'(.+!1$%%+B!V.!I'$10!
M(+!12W$1!+%.!4..$),!-4)!(/+!4%-,)$.,!M($!7)$11+!4(!1'$/B!`/!+%.!$/.)$J(,B!6(2+%.@&+!M(+!
&2+%.!p!`/!%24--)'&E+8!'/!%+!-+/&E+8!'/!&'55+/&+!0!.$)+)B!U+!-1(%!%'(I+/.8!&+!/2+%.!
M(2(/!7'(.!*+!7'$%B!n+.$.+!$*,+!%4/%!)4&$/+8!%4/%!-)'>'/*+()B!`/!124))4&E+!+.!'/!1+!
14/&+!*4/%!14!5+)B!A4$%!*24(.)+%!>'$%8!14!&E'%+!),%$%.+8!7$+/!-14/.,+!*4/%!1+!%'1B!31')%8!
'/!%+!5+.!0!&)+(%+)B!V.!&2+%.!1+!-1(%!7+4(!5'5+/.B!C+1($!*+!.'(%!1+%!-'%%$71+%B!F!d1!N!4!
.4/.!*+!7+4(.,!*4/%!.'(.!&+!M($!&'55+/&+!R8!*$.!L$1]+B!C+14!+%.!I)4$!-'()!1+%!H'()%8!1+%!
%4$%'/%8!1+%!45'()%8!14!I$+8!+.!.+11+5+/.!I)4$!-'()!14!&),4.$'/B!3(!*,7(.!'/!-+(.!.'(.!
$54J$/+)8!(/!/4I$)+!%'5-.(+(Q!+/%+I+1$!%'(%!1+!%471+8!(/+!&$.,!+/.$O)+!'X!%24J$.+!+.!
+Q-1'%+!.'(.!&+!M($!/'(%!.'()5+/.+B!`/!&)+(%+!0!124I+(J1+8!'/!-41-+8!'/!.[.+8!'/!%+/.!
(/+!>')5+8!-+(.@P.)+!1+!&'/.'()!*2(/!-+)%'//4J+8!'/!&'/.$/(+8!'/!*,&'(I)+!*24(.)+%!
&')-%8!+.!-($%!%+!*+%%$/+!(/+!%.)(&.()+B!`/!*$)4$.!M(4.)+!5')&+4(QB!n+(.@P.)+!M(4.)+!
.+5-%B!V.!M('$!+/&')+!p!`/!*$)4$.!(/+!5').B!c'/8!M(4.)+!5').%B!`/!&'/.$/(+8!'/!
&'/.$/(+8!+.!-($%!(/!4-)O%@5$*$8!.'(.+!%+(1+!*4/%!%'/!4(.'8!'/!*$.!.'(.!E4(.!Y!F!G+!
524--+11+!A4)$+8!H+!I4$%!5'()$)!*+I4/.!I'(%B!G+!I'(%!+/!-)$+8!)+J4)*+K@5'$B!R!!
!
c'(%!N!)+I'$10B!!
!
C+!-)'1'J(+!+%.!4(%%$!I$I4/.!+/!5'$!M(2+/!&+!H'()!*+!"STT8!/'/!%+(1+5+/.!-4)&+!M(2$1!
-').+!1+!%'(I+/$)!*2(/!5'5+/.!*,.+)5$/4/.8!54$%!-4)&+!M(2$1!/'55+!+/!&$/M!-+.$.%!
5'.%!&+!M($!&'/%.$.(+!-'()!5'$!1+!&W()!*+!12,&)$.()+!.E,[.)41+B!!
!
A'()$)B!#+I4/.B!a'(%B!L+J4)*+KB!A'$B!!
!
A'()$)8!*247')*B!n'()!M(+!I$I+!(/!-+)%'//4J+8!-'()!M(2$1!-($%%+!I$7)+)!*+!.'(.+!%'/!
[5+!%()!(/+!%&O/+8!M(+1M(+!&E'%+!+/!5'$!*'$.!5'()$)B!m/!5414$%+8!(/+!*'(1+()8!(/!
%+&)+.8!(/!)+J)+.8!(/+!71+%%()+8!(/+!&'1O)+!+/>'($+8!(/+!&E'%+!M($!J)'/*+!+.!-41-$.+B!
G+!14!-'%+!&'55+!(/+!'>>)4/*+!%()!54!.471+!*+!.)4I4$18!H+!&)4M(+!(/+!411(5+..+!+.!H+!
5+.%!1+!>+(B!V.!&2+%.!&+!&),-$.+5+/.8!&+..+!&E41+()!+/J+/*),+!-4)!&+!M($!>1457+!+/!
5'$8!&2+%.!&+14!M($!&),+!14!I$+B!=&)$)+!(/!-+)%'//4J+!*+!.E,[.)+8!&2+%.!$/%&)$)+!&+!

!
9!
&),-$.+5+/.!%()!14!>+($11+!-'()!M(2$1!-($%%+!+/>1455+)!1+!&')-%!*+!124&.+()8!124/$5+)8!
*+I+/$)!%4!)+%-$)4.$'/B!V.!%$!14!.)4/%5$%%$'/!+%.!),(%%$+8!.'(.+!14!%411+!+%.!%4$%$+!0!%'/!
.'()!-4)!&+..+!I$7)4.$'/B!31')%!%24))P.+/.!1+%!.'(%%'.+5+/.%!+.!1+%!&)4M(+5+/.%!*+%!
%$OJ+%8!1+!%$1+/&+!*+I$+/.!-1(%!-)'>'/*8!-41-471+B!C'55+!%$!1+%!%-+&.4.+()%!
74%&(14$+/.!.'(%!+/%+571+!*4/%!1+!%$1+/&+!-)+5$+)8!&+1($!M($!),J/4$.!1')%M(+!124(.+()!
4!-'%,!%'/!'>>)4/*+!%()!%4!.471+!+.!&)4M(,!%'/!411(5+..+B!!
!
V/%($.+8!F!*+I4/.!RB!n),-'%$.$'/!74/41+!+.!-'().4/.!%$!$5-').4/.+8!-4)&+!M(2+11+!
*$%.$/J(+!12,&)$.()+!*)454.$M(+!*+%!4(.)+%!>')5+%!1$..,)4$)+%B!m/!)'54/8!-4)!
+Q+5-1+8!%+!-4%%+!*4/%!1+%!54$%'/%8!*4/%!1+%!)(+%8!*4/%!14!>')P.8!*4/%!14!I$+h!(/+!
-$O&+!*+!.E,[.)+!%+!-4%%+!%()!(/!-14.+4(8!M($!>4$.!%+5714/.!*2P.)+!(/+!54$%'/8!(/+!
>')P.8!(/+!)(+8!+.!1+!.'(.!%+!*,)'(1+!devant!(/!J)'(-+!*+!-+)%'//+%!),(/$+%8!M($!
)+e'$I+/.!+/!5P5+!.+5-%!1+%!),-1$M(+%8!1+%!J+%.+%8!14!1(5$O)+8!1+%!&'(1+()%8!1+%!%'/%8!
14!5(%$M(+B!=&)$)+!-'()!1+!.E,[.)+!%+!>4$.!*4/%!14!&'/%&$+/&+!&'/%.4/.+!*+!&+..+!
*'(71+!-),%+/&+!+.!*(!&4)4&.O)+!,-E,5O)+!*+!&+..+!)+/&'/.)+B!U+%!5'.%!/+!%+)'/.!
+/.+/*(%!M(2(/+!%+(1+!>'$%8!1+%!$54J+%!M(2$1%!&E4))$+/.!*+I)'/.!%2$5-)$5+)!.'(.!*+!
%($.+B!#2'X!12$5-').4/&+!*+!14!&14).,B!C4)!1+!.+5-%!+%.!&'5-.,8!+.!1+!>$1!%+!*,)'(1+!+/!
&'/.$/(B!d1!/2N!4!-4%!14!-'%%$7$1$.,!*+!)+&(1+)8!)+I'$)!(/!-4%%4J+8!),+/.+/*)+!(/+!
-E)4%+B!U+!&E'&!*'$.!4I'$)!1$+(!$&$!+.!54$/.+/4/.B!
!
V.!-($%8!F!)+J4)*+K@5'$!RB!C+.!4--+1!*(!)+J4)*!/24--4).$+/.!-4%!%+(1+5+/.!4(!
.E,[.)+B!=&)$)+8!-(71$+)8!&2+%.!.'(H'()%!$/I$.+)!1+!)+J4)*!*+!124(.)+8!54$%!-'()!124(.+()!
*)454.$M(+8!&+.!4--+1!+%.!-1(%!-)+%%4/.8!+.!-1(%!-,)$11+(Q!+/&')+8!&4)!12+Q-'%$.$'/!+%.!
.'.41+B!U+%!,5'.$'/%8!1+%!$*,+%!%+!)+.)'(I+/.!54J/$>$,%8!*,&(-1,%!-4)!1+%!+>>+.%!*+!
1(5$O)+8!1+%!5(%$M(+%!-'$J/4/.+%8!1+!H+(!>+)I+/.!*+%!4&.+()%B!3%%$%!*4/%!14!%411+8!
124(.+()!)+%%+/.!-EN%$M(+5+/.!1+!-'$*%!*+!.'(%!&+%!)+J4)*%!7)4M(,%!%()!%'/!5'/*+!
$/.,)$+()h!(/+!+Q-,)$+/&+!J)$%4/.+8!54$%!4(%%$!47%'1(5+/.!.+))$>$4/.+B!!
!
G+!I4$%!5'()$)!*+I4/.!I'(%8!)+J4)*+K@5'$B!!
!
^4/%!.)'-!52+/!)+/*)+!&'5-.+8!+/!&+!H'()!*+!"STT8!.'(.+!%+(1+!*4/%!5'/!4(.'8!H24$!
.'(&E,!4(!-4)4*'Q+!*+!&+!M($!4114$.!*+I+/$)!5'/!5,.$+)8!M($!+%.!14!>'$%!J,/,)'%$.,!+.!
I4/$.,8!%4&)$>$&+!+.!J+%.+!/4)&$%%$M(+B!!
!
V/>$/8!&+!-)'1'J(+!52+%.!I+/(!%-'/.4/,5+/.!0!&4(%+!*+!A4)$+B!!
!
3I4/.!+11+8!$1!N!4I4$.!+(!31$&+8!12E,)'q/+!*+!Baby$Blues8!4-)O%!$1!N!4!+(!=1$%48!r,4.)$&+8!
a$'1+..+8!o,1O/+8!?)[&+8!A4*+1+$/+8!G(%.$/+B!V.!54$/.+/4/.8!%()!12,&)4/!+.!*4/%!5+%!
&4)/+.%8!$1!N!4!A4)$+@`*$1+!+.!d%5O/+B!\'(%!5+%!-)'.4J'/$%.+%8!0!12+Q&+-.$'/!*+!5'/!
&E+)!^$5'/!U47)'%%+8!%'/.!*+%!>+55+%B!V11+%!%'/.!1+%!4%.)+%!4(.'()!*+%M(+1%!
.'()/+/.!1+%!&'/%.+114.$'/%!M(+!H+!&),+B!G+!/+!1+%!$/I+%.$%!*24(&(/+!5$%%$'/!
*,/'/&$4.)$&+B!G+!5+!&'/.+/.+!*+!1+%!>4$)+!+Q$%.+)B!U+()!%+/.$5+/.!*2P.)+!(/!-+(!+/!
54)J+8!F!0!&j.,!R8!1+()!$5-)+%%$'/!*+!/+!-4%!%4I'$)8!*+!/+!-4%!F!4--4).+/$)!R8!1+()!
*,%$)!*+!.)'(I+)!1+()!-14&+!*4/%!14!%'&$,.,8!*4/%!1+!5'/*+8!1+()!*,%4))'$8!1+()!
.)$%.+%%+8!1+()!I4/$.,8!1+()!4))'J4/&+!M(+1M(+>'$%8!1+()!)+&E+)&E+!5414*)'$.+!*+!
1245'()8!1+()!7+%'$/!*2P.)+!I(+%8!1+()!I'1'/.,!*2+Q$%.+)8!1+()!$/&'55+/%()471+!
 6
6
 7
7
1
/
7
100%